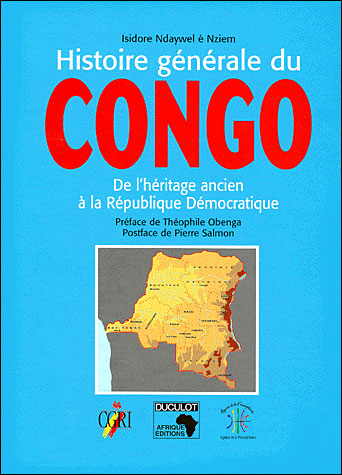
Introduction : L'écriture de l'histoire du Congo
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Introduction
L’écriture
de l’histoire du Congo
L’écriture de toute histoire procède avant tout d’une intention. Celle-ci transparaît dans des options et des choix préalables. Mais avant cela, l’entreprise suppose l’existence de matériaux disponibles, indispensables à cette élaboration. Et, une fois le travail réalisé, celui-ci prend nécessairement place au sein d’un environnement bibliographique donné qu’il sera censé contester ou enrichir d’une façon ou d’une autre. Voilà autant d’étapes dans le processus d’écriture de l’histoire du Congo qui retiendront notre attention ici, avant même que soit entamée la lecture de l’évolution de ce peuple.
La problématique inhérente à l’écriture de l’histoire du Congo vaut en fait pour l’ensemble de l’Afrique. La plupart des difficultés d’ordre théorique s’y retrouvent, à commencer par la définition même du type d’histoire qu’on entend faire prévaloir, jusqu’à la question insidieuse de la terminologie soulevée par le problème de la langue qu’est le français choisi comme véhicule des réalités aussi « lointaines » culturellement que celles de l’Afrique.
En fait, de quelle histoire faut-il rendre compte en Afrique et au Congo, et pour qui ? L’historiographie africaine a bien raison de dénoncer le statut ambigu des « études africaines » et partant de l’histoire africaine qui s’y rattache [1]. En effet, bien qu’elle s’en défende, l’histoire africaine, pour l’essentiel, reste encore de nos jours le fait de non-Africains, européens ou américains, à quelques nuances près.
Hier, ils étaient seuls à en rendre compte sur le plan scientifique. Même si de nos jours on ne peut négliger la part de production africaine, c’est la part non africaine qui l’emporte – parce que plus aisément diffusée, y compris en Afrique – et ce, même auprès de l’élite politique africaine. Du reste, la production africaine n’est pas forcément originale et détachée de tout, perméable qu’elle est aux courants scientifiques influents originaires d’outre-mer qui font alors la loi, décrétant que telle vision, telle source ou tel thème était pertinent et que tel autre était sans intérêt. Même les écrits locaux ne sont donc jugés valables que dans la mesure où ils se situent dans le prolongement de ces visions, qu’ils assument et défendent de préférence.
Ainsi, on considérait hier le document écrit comme la seule source valable, pour conférer à un souvenir donné le statut de « document historique ». Cette restriction prévalut jusqu’aux années 60, quand la science africaniste outre-mer réalisa que le « texte oral », la documentation la plus abondante en histoire africaine, constituait une autre source valable à l’instar du « texte écrit » et qu’il pouvait se prêter, moyennant quelques précautions, à une exploitation scientifique. Il était enfin permis de faire référence à la « tradition orale ». Malgré les réserves émises par certains, qui considèrent que ce genre de document mène à une «anthropologie à l’imparfait », dans une permanente insécurité chronologique, on peut estimer que la bataille de la tradition orale a été gagnée et définitivement gagnée [2].
Reste à l’exploiter. Jusqu’ici, l’unique oralité qui est prise en compte est celle du passé, laquelle fonctionne dans le quotidien comme un témoignage auriculaire. L’oralité au présent – la rumeur, le témoignage oculaire, le récit – n’a pas encore sa place dans l’histoire africaine. Les théories « d’histoire orale », qui gagnent en crédit ailleurs, n’ont toujours pas fait de percée significative dans l’univers africaniste [3].
En effet, « l’histoire populaire » demeure marginale car on reste attaché à « l’histoire officielle », celle des grands hommes et des grands événements. Minimisant l’histoire du peuple, « l’histoire sans histoire », celle de « la pluie et du beau temps » et celle de « l’homme de la rue », on ne pense pas à prendre en compte les sources qu’elle sécrète, le quotidien oral, les inscriptions sur les murs, la chanson, etc. Tout un chemin reste encore à parcourir pour compléter la nomenclature des sources d’histoire africaine.
Toutefois, il y a lieu de se réjouir, au vu des progrès réalisés : en effet, il y a quelques décennies encore, on déniait à l’Afrique le fait même d’appartenir à l’histoire. Il n’y avait alors « d’histoire africaine » que celle de « l’Europe en Afrique ». Aussi, dans le cas du Congo, l’histoire commençait-elle avec Diogo Câo puis avec Livingstone et Stanley, pour continuer avec Léopold II et la colonisation belge. Fort heureusement, l’histoire scientifique est venue modifier depuis les années 60 cette vision des choses.
Pourtant quelques lacunes demeurent particulièrement dans l’étude des périodes anciennes. Dans sa trop grande assurance d’avoir restitué les sociétés africaines à la lecture du temps, l’histoire africaine n’a pas été suffisamment consciente de sa cécité. Jusqu’ici, elle n’a été capable de décrypter le code secret du passé que lorsqu’elle était en présence des structures qui lui rappelaient celles d’Europe. En dehors de celles-ci, elle était déroutée et dissimulait à peine son incompétence. C’est ainsi qu’une distinction fut établie entre les « société étatiques », admises alors à l’histoire, et les « sociétés non étatiques », qui en demeuraient exclues parce que « segmentaires » et « anarchiques » [4]. Un éminent scientifique français (Pierre Alexandre) a pu même écrire, à propos de ce terrain déroutant où l’on ne trouve ni royaume ni chefferie : «… c’est la partie de l’Afrique la plus ingrate et la plus décevante pour l’historien… » (Deschamps, H., 1971 : 353). Belle excuse pour notre ignorance et pour l’impuissance de notre outil méthodologique. On comprend alors qu’à l’époque, – et on n’est pas bien loin de cette tradition – l’histoire du Congo et de l’Afrique Centrale ne pouvait que se limiter à un inventaire des empires (Luba et Lunda) et des royaumes (Kongo, Tyo, Kuba, Borna. Zandé). Même quand on s’aventurait à rendre compte de l’évolution d’une vaste région regroupant des populations diverses dans la savane du Sud, on prenait soin de les qualifier de « royaumes de la savane », (Kingdoms of the savanna) sous peine de voir l’opinion scientifique évacuer de l’étude son caractère historique pour la laisser à l’anthropologie, science généreuse qui. sur le terrain africaniste, a toujours eu la vocation de servir de fourre-tout (Vansina. J.. 1966).
Il a fallu attendre les conceptions historiographiques nouvelles – celles de la nouvelle histoire – déterminées à faire de « l’histoire totale », pour connaître une avancée hardie dans la conquête des faits d’histoire africaine (Le Goff. J.. 1978 : 210-241 et Obenga, T., 1980). Et pourtant, la réalité, sur le terrain, n’a jamais changé de nature. Elle n’a été que de l’histoire, même si on a mis du temps à s’en apercevoir et à façonner des instruments capables de la domestiquer.
L’histoire africaine enseignée au lycée, et diffusée auprès du lettré africain non spécialiste de la question, demeure tributaire de cette vision qui appartient pourtant au passé, ce qui justifie, on va le dire plus loin, le caractère discriminatoire de nos connaissances des populations du Congo. C’est dire combien l’entreprise demeure périlleuse de vouloir rendre compte, avec prétention à l’exhaustivité, de l’histoire de tout un peuple, tel celui du Congo. Pourtant, il était nécessaire de s’y lancer puisqu’il existe, de toute évidence, une histoire « africaine » de l’Afrique et en l’occurrence une histoire « congolaise » du Congo qui entend être une lecture du « dedans », rigoureuse mais édifiante, des faits et des événements dont cet espace a été le théâtre.
Donc, en fonction des choix contemporains, l’on se propose de rendre compte surtout des éléments convergents de cette évolution, soubassement certain de la nation congolaise d’aujourd’hui. C’est ainsi que l’on a opté d’emblée pour la notion de « peuple congolais », notion qui n’entend retenir des « populations congolaises » que leur aspect des « fondements » de cette réalité contemporaine qu’est le Congo et qui constitue notre vraie préoccupation. Comme on le sait, l’élaboration de l’histoire « nationale », quand bien même elle serait « nationaliste », ne s’oppose pas à la prise en compte des « histoires locales ». Bien au contraire, c’est à partir des « histoires particulières » (histoires des différentes régions et des différentes époques) suffisamment élaborées que doit se construire une synthèse dynamique, digne d’être qualifiée d’histoire de la communauté.
Mais un tel processus, dans le cas qui nous occupe, ne prétend pas être à même de prendre en compte les multiples particularités de toutes les populations qui se réclament du Congo. L’entreprise aurait été pratiquement impossible. Du reste, à l’heure où cette étude intervient, nos connaissances sur les populations du Congo, bien que fort avancées, demeurent parcellaires parce qu’encore réparties de manière inégale tant sur le plan spatial que sur le plan temporel. Les investigations des chercheurs se sont portées davantage vers les populations de la savane, surtout de la savane du Sud, que sur celles des zones forestières qui constituent pourtant une partie suffisamment importante de l’espace national [5]. De même, l’histoire de la colonisation et de la décolonisation qui couvre le dernier siècle correspond à un foisonnement de documents qui contraste avec le vide documentaire des nombreux siècles qui précèdent et qui ont été témoins d’un important itinéraire historique pourtant digne d’intérêt. On s’efforcera de suppléer à cette lacune à l’aide de nombreuses monographies inédites, thèses de doctorat et mémoires de licence, documents de valeur scientifique inégale sans doute mais qui ont l’heureux avantage d’être produits, dans leur grande majorité, par des Congolais eux-mêmes, à partir des données issues tout droit du terrain.
Dans cette optique, l’ouvrage aurait sans doute gagné à être une oeuvre collective où des spécialistes des différentes histoires locales auraient pu apporter des exposés solides et suffisamment élaborés. Si cette option n’a pas été retenue, c’est pour mettre Vaccent sur l’aspect unitaire de ce cheminement apparemment différent et même divergent. L’histoire nationale doit, selon nous, se raconter d’un seul tenant, des origines à nos jours, au travers de ses particularités régionales. Plus qu’un assemblage d’histoires régionales et ethniques difficiles à organiser dans une seule vision d’ensemble, l’histoire consciente d’une nation est avant tout, comme on l’a déjà dit, synthèse des faits, saisie cohérente d’un cheminement parce que destinée à devenir une projection conséquente et assumée vers l’avenir. C’est à ce prix que la démarche envisagée peut être vraiment rentable pour les contemporains, dans leur préoccupation d’élaboration d’un devenir en fonction des besoins et des potentialités qui sont les leurs.
Mais dans le cas présent, on doit élucider la question de base, celle que pose l’emploi successif des mots « Congo », « Zaïre » et « Congo ». Serait-il correct de qualifier de « zaïrois » l’ensemble du patrimoine historique qui préexiste au concept même du Zaïre ? Faut-il estimer que « l’histoire du Congo » ne concerne que les périodes où ce terme était d’usage et qu’elle évacue les années où le pays était le « Zaïre » ?
On sait que l’existence juridique de l’État ne date pas d’avant 1885, son indépendance intervient en 1960 et son véritable envol se situe à partir de sa Deuxième République. Jusqu’en 1971, le pays était qualifié de Congo (République Démocratique du Congo, République du Congo, Congo Belge, État Indépendant du Congo) du nom de l’ancien royaume qui a fleuri sur sa côte atlantique vers le XVe siècle, royaume qui s’est étendu au nord de l’Angola et dans les deux républiques congolaises comme on le verra plus loin. Déjà pendant la période coloniale, on connaissait l’existence de deux Congo qui se distinguaient par la différence d’identité de leur colonisateur. On parlait du « Congo Belge » qui se démarquait du « Congo-Français », le Moyen-Congo, sous-ensemble de l’AEF (Afrique Equatoriale Française). A l’heure des indépendances, pour éviter la confusion entre les deux Républiques, on fit alors référence aux capitales. Le Congo-Léo (poldville) n’était pas à confondre avec le Congo-Brazza (ville). Quand l’ancien Congo Belge est devenu, en octobre 1971, le Zaïre, cette décision unilatérale du maréchal Mobutu permit au moins une distinction heureuse entre Congo et Zaïre. Le terme « Zaïre » relève d’une mauvaise audition du mot « nzadi » désignant un fleuve quelconque. La déformation est ancienne puisqu’elle date du XVe siècle et prit un sens particulier pour qualifier « le fleuve Zaïre » [6]. Le terme est également porteur d’exotisme du fait de la déformation d’un mot du terroir. Tout en étant d’origine locale, il n’est revendiqué par aucun patrimoine ethnique précis. Il aurait donc pu symboliser bien l’État-nation, réalité nouvelle qui se veut en dehors de l’espace de l’ethnicité. Toutefois, pour marquer la volonté de rupture avec l’ère du mobutisme avec son cortège de « mal zaïrois », il a paru utile de renouer avec l’ancienne appellation de « Congo » et récupérer par là, dans la conscience collective, une antériorité qui semblait avoir été évacuée [7].
L’histoire ne s’élabore qu’à partir d’un certain présent qui en détermine l’optique dans laquelle la lecture de l’évolution est faite. Dans ce sens, la qualification du présent est celle-là même qui affecte la temporalité passée et future. C’est ainsi que l’on s’exprime pour désigner les peuples et les nations ; c’est de cette même façon que s’opère la distribution de l’histoire humaine dans son ensemble, dans le domaine spatial et temporel.
L’organisation prestigieuse des Aztèques et des Incas, qui est évidemment antérieure au concept d’Amérique, fait partie intégrante de l’histoire de l’Amérique. De même, on parlerait des Mexicains et Brésiliens de l’an 5000, alors que rien n’affirme qu’en l’an 5000, ces deux pays porteront encore les noms de Mexique et Brésil. Il en est de même du concept de République Démocratique du Congo. Il couvre toute l’évolution précédente : les histoires particulières des populations qui le constituent, les royaumes et les empires de cette région du continent, l’étape de l’État Indépendant du Congo et du Congo Belge ainsi que toute l’aventure postcoloniale dans ses multiples révisions terminologiques (République du Congo- Léo, République du Zaïre).
L’histoire du Congo étant reconnue à présent dans sa spécificité, demandons-nous maintenant comment dater ses origines. Toute société est sensible à l’histoire de ses commencements. Comme c’est à partir d’elle que s’élaborent les fondements du présent, on comprend la tendance populaire qui consiste à s’assurer du confort d’origines glorieuses en s’attribuant des ancêtres héroïques même imaginaires, pour édifier les générations montantes et leur inculquer le sentiment de fierté du groupe.
En fait, la quête des origines est tributaire de la conception même que l’on se fait de l’histoire d’un peuple. Quand on parle de l’histoire du Congo, insiste-t-on davantage sur l’histoire de l’espace du Congo, des différentes aventures dont il a été le théâtre ou plutôt sur l’histoire de cet amas de populations qui se qualifient aujourd’hui de congolaises ? S’il fallait s’en tenir à la première perception, on devrait remonter le cours du temps jusqu’à l’émergence du continent africain, dont l’espace considéré ne constitue qu’une portion, pour noter ou plus précisément pour tenter de noter les différents faits d’évolution des Congolais depuis l’apparition de l’espèce humaine. L’entreprise paraît utopique dans l’état actuel des connaissances.
L’histoire du Congo, la plus réaliste parce que saisissable et à même d’être utilisée sur le plan social, est celle qui s’est façonnée avec ceux qui habitent cet espace et qui s’identifient et se définissent par rapport à celui-ci. C’est donc davantage « l’histoire des congolais », la « mémoire des peuples du Congo » qui doit être saisie pour être offerte comme matériau d’élaboration du futur de ces mêmes peuples.
Cette clarification permet de percevoir un autre voile, qui mérite tout autant d’être dissipé. L’histoire du Congo peut-elle avoir démarré en dehors des limites de l’espace du Congo ? On dit des Bantu, la grande majorité de ces populations congolaises, qu’ils proviennent des régions lointaines situées aux abords du lac Tchad. L’histoire du Congo commencerait-elle de la sorte aux confins du Cameroun et du Nigeria Occidental ? Le phénomène inverse a également été noté : certaines aventures humaines commencées ici se seraient prolongées en dehors de cet espace. L’essaimage des frères de Lueji a étiré considérablement l’histoire Lunda jusqu’en Angola et en Zambie. Une certaine histoire du Congo aurait débordé sur ces deux pays ou, suivant un autre point de vue, une certaine histoire de l’Angola et de la Zambie aurait sa source au Congo. Finalement, où et quand commencerait l’histoire du Congo et où s’achèverait-elle ?
Notre point de vue est que la seule référence aux populations s’avère un critère partiel. Il apparaît nécessaire de revenir sur la dimension spatiale pour délimiter le champ de l’histoire du Congo. Celle-ci est assurément constituée des multiples aventures des populations congolaises, à la condition que celles-ci se soient déroulées sur cet espace reconnu comme étant le Congo. Hors de ce cadre, on est en présence des éléments dont l’importance permet une meilleure intelligibilité de la portion de l’évolution considérée, sans pour autant se confondre avec elle. Donc si l’histoire des Bantu commence au bord du lac Tchad, l’histoire congolaise des Bantu ne démarre qu’avec leur arrivée dans des savanes et des forêts du Congo. Inversement, l’ensemble du patrimoine historique Lunda ne pourrait être mis en valeur dans le seul cadre de l’histoire du Congo puisqu’il déborde largement de ses frontières. Il faudrait se situer dans le cadre d’un exposé sur l’histoire de l’Afrique pour pouvoir en rendre compte, de manière plus complète, en incluant également les composantes angolaises et zambiennes de ce patrimoine. Dans le contexte restreint du Congo, cette partie de l’histoire de l’empire ne devrait intervenir que de manière subsidiaire, afin de ne pas sacrifier la bonne compréhension du phénomène Lunda dans son ensemble comme faisant partie intégrante de l’histoire du Congo.
Reste à faire un dernier discernement au niveau des termes à utiliser pour désigner les faits. D’abord, les diverses modalités de régionalisation de l’histoire au cours des différentes époques passées correspondent à tout un éventail de concepts. Certains ont été attribués par le scientifique lui-même : clan, tribu, chefferie, royaume, empire. D’autres ont été consacrés par l’administration et ce à partir du XIX’ siècle : secteur, collectivité, commune, zone, territoire, district, sous-région, province, région. Il serait utile de préciser le sens exact de chacun des termes, pour éviter tout risque d’ambiguïté. Plus délicat est le problème posé par l’usage des ethnonymes dans la langue de l’écriture de cette histoire. Dans les langues locales, ces désignations sont en principe affectées des préfixes grammaticaux : Mumbala (singulier), Bambala (pluriel). La pratique admise dans le langage scientifique est de laisser tomber la particule du nombre, remplacée par l’usage de l’article (Le Mbala. Les Mbala) pour éviter une répétition inutile (le Mumbala, les Bambala). Mais ces termes ébréchés (Mbala au lieu de Mumbala) constituent un nouveau lexique ethnique, inexistant sur le terrain, parfaitement inconnu et déroutant pour les populations concernées mais imposé par la science africaniste. Est-il permis de faire violence à la réalité, au nom d’une prétendue rationalité ? Le jeune étudiant qui connaît dans la pratique ces différentes populations doit mémoriser leurs désignations « scientifiques » afin de tenir un langage intelligible aux africanistes et du même coup inintelligible pour le lecteur africain moyen.
Que faire à présent ? Peut-on marcher à contre-courant ? Cet usage a en tout cas créé de nouvelles confusions qui n’existaient pas dans la réalité. D’abord cet emploi n’a pas affecté tous les ethnonymes. Si l’on parle de « Luba » et de « Kongo » eç supprimant les préfixes, on parle également des Mangbetu et des Wagenia. au lieu de Ngbetu et Genia qui seraient les formes conformes à cette logique. Cette coexistence est peut-être malheureuse mais elle est à présent plus ou moins consacrée. En effet, décapitez ces dernières désignations de leurs préfixes, elles deviennent franchement méconnaissables pour la grande majorité des africanistes et des Congolais : Ngbetu (au lieu des Mangbetu), Genia (au lieu de Wagenia), Binza (au lieu de Mabinza), Konda (au lieu de Ekonda), etc. Pourtant on n’éprouve pas le même dépaysement lorsqu’on parle de Pende, Yaka, Kongo, Lega, etc. Pour compliquer le problème, il faut signaler que certains ethnonymes, différents sur le terrain deviennent similaires lorsqu’ils sont décapités de leurs préfixes. Tel est le cas de la confusion apparue entre les Bembe (Besi bembe du Bas-Congo) et les Bembe (Babembe du Maniema).
Comment souscrire à un minimum de cohérence de l’ensemble de l’œuvre sans trop heurter les habitudes des uns et des autres ? On sera obligé ici de se plier à la loi du genre, tout en déplorant le poids d’un tel héritage. Le contester aurait apporté un surcroît de travail du reste délicat car les préfixes à restituer sont variables d’une région à l’autre : A-ngwi, Wa-nande et Ba-nianga désignent toutes le grand nombre mais différemment. D’ailleurs, les contradictions du langage courant qui ont été notées et qui conservent aux uns des préfixes qu’ils enlèvent aux autres, sont dues en réalité à la différence de maîtrise de terrain. Lorsqu’une région a été jadis suffisamment sillonnée par les anthropologues, la terminologie locale, stylisée par le langage scientifique, a eu le temps d’être diffusée du contexte purement livresque à la pratique et à l’usage courant. C’est ainsi que certains termes ne posent pas de problèmes. Si la terminologie stylisée de certaines populations a encore une allure quelque peu ésotérique, c’est qu’elle n’a pas encore eu le temps de se transmettre correctement de l’homme de la science à l’homme de la rue. Donc, à vouloir sauvegarder la cohérence des nombreux signifiants d’origine ethnique, on ne pourrait pas éviter, ici et là, le malaise causé par la forme éludée des termes. Il va falloir compter avec cet état de choses et conserver les contradictions dénoncées.
Au-delà de la question du préfixe, on doit savoir également que la saisie du radical – élément essentiel de la désignation ethnique – est également déroutante bien souvent. Les lettrés coloniaux, à la suite de leurs enquêtes de terrain, avaient établi une première nomenclature de noms des ethnies, qui existaient réellement ou qu’ils ont inventés de toutes pièces. Ces ethnonymes ont été consignés scrupuleusement par Olga Boone (1961, 1973). Mais déjà à ce niveau, on note de graves lacunes. A propos de chaque groupe, l’auteur, après avoir cité une série d’appellations souvent similaires qui s’y rapportent, indique finalement, on se demande au nom de quel principe et suivant quel critère, la désignation à utiliser, celle dont l’administration coloniale avait assuré la diffusion, même auprès des autochtones. Ceux-ci 1 ont adoptée et les ethnographes de première heure en ont fait usage.
Si les choses en étaient restées là, on aurait sans doute simplifié le problème. Mais le courant scientiste qui caractérise la linguistique africaine contemporaine a contesté ce premier registre de noms. En procédant de manière systématique à la description des parlers locaux, le linguiste prend soin de demander aux autochtones comment ils se désignent et comment ils sont qualifiés par les voisins. Ce sont ces termes qu ils consignent fidèlement. D’où l’origine d’un second registre d’appellations ethniques parallèles, actuellement en circulation dans le langage africaniste. L’écart entre le premier terme recueilli par le colon et l’actuel revendiqué par la linguistique est parfois important, comme on peut en juger : Lunda et Ruund, Rega et Lega, Lori et Lujel, Banda et Mbuan, Ngoli et Ngwii, etc. Sur quelle terminologie tabler désormais ? La seconde série a évidemment l’avantage d’être correcte, bien que son utilisation demeure limitée et se trouve même ignorée des lettrés non linguistes. On sera obligé ici pour des raisons pédagogiques, de privilégier ces termes d’origine locale.
Il reste à poser un dernier problème du genre. Les périodes et les zones acculturées de l’histoire du Congo ont produit une catégorie particulière d’anthroponymes vis-à- vis desquels il faut à tout prix se définir. Les fonctionnaires coloniaux n’étaient pour ainsi dire pas connus sous leurs noms d’origine. Durant toute leur carrière, ils étaient connus par des pseudonymes, des surnoms, et pour tout dire, des noms africains qui, pour les autochtones, constituaient leur seule et unique identité. C’est donc a posteriori, et à partir de la littérature écrite dont le contenu est véhiculé auprès des masses par les lettrés autochtones, que se sont diffusés des noms tels que « Livingstone », « Stanley », « Chaltin » au lieu de Bula-MatadL Bwana-Muzuri, Nkashama. etc. Sur quels anthroponymes construire l’exposé historique qui entend rendre compte du point de vue des locaux, surtout quand on sait que pour les personnages non européens, l’histoire coloniale a jugé utile de retenir davantage les pseudonymes, plutôt que leur nom d’origine. Par exemple, le grand trafiquant afro-arabe de l’Est du Congo est appelé dans les écrits Tippo-Tip, ce qui est un surnom, au lieu de Ahmed bin Muhammad El-Murjebi son vrai nom. La pratique a cautionné sans le savoir une véritable discrimination. Une fois de plus, pour ne pas dérouter le lecteur, contentons-nous ici de signaler le problème. Mais idéalement, la lecture africaine de l’histoire aurait dû se construire à partir des noms africains de ces personnages, si les masses africaines avaient continué à garder davantage en mémoire ces noms-là au lieu de ceux d’origine. Donc, plutôt que de parler de Dhanis, « baron » dans la hiérarchie de son pays, il aurait fallu parler de Fimbo (fouet), son nom africain.
C’est pour lutter contre cette discrimination que, dans le cas des rois du Kongo, on n’a pas jugé bon de retenir les noms d’origine, à l’instar des fonctionnaires de l’E.I.C. ou de la colonisation. De manière « classique », ces rois autochtones sont cités suivant des normes occidentales : Antonio IV. Diogo I. Garcia IH. Pourtant, tous portaient des noms locaux par lesquels ils étaient désignés par la grande majorité de leurs sujets : Muzinga wa Nkuwu, Mubemba a Muzinga. etc. Baptisés, ils ont eu certes des prénoms chrétiens, mais comment les citer : en français, la langue qui prévaut aujourd’hui au Congo ? en portugais, langue dans laquelle s’est effectuée cette christianisation ? ou encore dans l’adaptation kongolaise de ces prénoms portugais ? Le premier roi du Kongo est-il Jean I, Dom Joâo I ou Ndo Nzau ? Alfonse Ier, Afonso ou encore Ndo Funsu Funsu ? De toute évidence il faut d’emblée écarter la version française qui ne prévaut certainement pas sur le terrain. Entre la version portugaise et kongolaise. il faut choisir celle qui est proche de la réalité du terrain. Les Portugais et quelques lettrés devraient être à peu près les seuls à prononcer correctement ces prénoms dans la langue d’outre-mer que fut le portugais. La plupart s’en tenaient à leur propre compréhension de ces noms : Ndo Nzau au lieu de Dom Joâo. Il faut, malgré la difficulté de l’entreprise, faire justice ici à la version africaine de l’histoire, au langage congolais de l’histoire, au risque d’escamoter ou de mutiler l’histoire elle-même.
2 LA PÉRIODISATION DE L’HISTOIRE DU CONGO
Le champ historique qui s’offre à notre analyse mérite aussi d’être saisi au travers des subdivisions internes qui ont caractérisé son cheminement dans le temps.
Les origines de l’histoire qui nous préoccupe ici ont été identifiées à la phase de la première occupation de l’espace par les ancêtres des habitants actuels (fin du premier millénaire). A partir de là, on doit admettre que l’évolution a vécu différentes périodes, finalement difficiles à ramener à un seul et même schéma, à cause des différences qui apparaissent aussitôt que l’on examine quelque peu en profondeur les divers aspects de ce cheminement. Voilà pourquoi, en fait de périodisation, on aurait pu s’en tenir au découpage fort général et quelque peu simpliste qui décèle dans toute histoire africaine, trois phases : l’âge précolonial, l’âge colonial et l’âge postcolonial. Mais dans le cas du Congo, cette tripartition est vraiment inadaptée. Quand s’arrêterait cette période « précoloniale » : en 1908 avec le début de la colonisation ou en 1885 avec la création de l’État Indépendant du Congo ou même en 1483 au moment où les premiers secrets du fleuve se laissent dévoiler pour la première fois à un Européen ? De même, on peut se demander comment séparer la phase de l’État Indépendant du Congo (1885-1908) de l’âge proprement colonial (1908-1960) qui en constitue le prolongement logique. Il y a même lieu d’aller plus loin. Cette période de l’amorce d’une modernité d’origine externe (1800-1960) n’est-elle pas à rapprocher de cette autre période de la prise en charge par les autochtones de cette même modernité (de 1960 à nos jours) ? Entre les deux, il y a bien sûr une césure importante, celle des indépendances. Mais la perception de la césure doit-elle mettre en veilleuse l’unité de l’alexandrin ? Ceci fait penser à l’illusion d’optique qui veut que, à regarder les arbres de trop près, on en arrive à oublier qu’ils forment tous ensemble une forêt.
Il faut donc renoncer définitivement à une lecture tripartite de l’histoire africaine car elle est franchement trompeuse. Tout au plus, on peut s’en tenir à une bipartition, fort générale sans doute, mais qui a l’avantage d’être correcte et qui peut servir de référence, en attendant qu’on lui trouve des subdivisions internes suffisamment pertinentes. Reste à résoudre le problème de la terminologie. Comment en effet qualifier ces deux âges : des origines à 1800, puis de 1800 à nos jours ? Le champ d’inspiration ne pourrait être les termes de précolonial – colonial – postcolonial. Cette terminologie est vicieuse. Elle a toujours fait dire aux historiens plus qu’ils ne voulaient dire réellement. L’emploi de ces mots insinuait en effet que la période la plus importante de l’histoire africaine était l’âge « colonial », les deux autres périodes ne trouvant leur signification profonde que par rapport à elle ; voilà pourquoi elles étaient qualifiées de « pré » et de « post » coloniales. Est-il nécessaire d’ajouter que le non-dit de cette terminologie est pédagogiquement et idéologiquement peu intéressant, dans la mesure où il continuait à refuser aux Africains le droit à la créativité historique ? Ils ne devaient leur naissance, tout comme leur continuité dans l’histoire, qu’à la colonisation. On n’a aucun intérêt à perpétuer cette négation qui risque d’atrophier pour de bon la prise de conscience de l’Africain de sa responsabilité historique.
Mais alors, quel terme utiliser ? Les historiens de « l’école de Lubumbashi » ont opté pour les termes de période « ancienne » et « moderne » pour qualifier cette bipartition. Le concept de « période ancienne », qui chez les anglophones, évoque surtout la préhistoire, a l’avantage ici d’éviter toute confusion avec l’âge précolonial qui, lui, s’achevait littéralement à l’aube de la colonisation. L’âge « ancien » de l’histoire africaine s’arrête plutôt en 1800 et désigne les « antiquités » négro-africaines, période au cours de laquelle les autochtones, détenant encore en principe un maximum d’initiatives sur leur espace, ont pu élaborer les grands « classiques » de leur culture. Cette position minimise de la sorte l’aventure portugaise sur la côte atlantique, dont l’impact n’a pas affecté de manière suffisamment significative l’ensemble du pays.
La « période moderne » est plus vulnérable du point de vue de son expression. D’abord, elle est déroutante parce qu’elle évoque l’histoire moderne européenne déjà estompée alors que celle d’Afrique serait encore au présent. De plus, elle peut insinuer, à tort, qu’il n’y a de modernité africaine que celle d’origine européenne. Y-a-t-il moyen de remédier à ce risque de déficience autrement qu’en le dénonçant ? L’on y a pensé à Lubumbashi en explicitant davantage cette désignation par l’appellation de « période moderne et indépendante ». Mais l’initiative est à peine plus heureuse ; le concept d’indépendance est trop conjoncturel, trop ponctuel pour désigner une période, laquelle dépasse en principe le simple aspect événementiel. Il va donc falloir se contenter, nous semble-t-il, de la qualification de « moderne ». mais en la sauvegardant de la connotation d’extraversion à laquelle elle pourrait être mêlée et en la complétant avec le concept de « contemporain » à la place de celui de « l’indépendance ». La période « moderne et contemporaine », c’est donc ce second âge de l’histoire caractérisé par la modernité, inauguré avec les grands voyages du XIXe siècle et qui a introduit une nouvelle organisation de l’espace sous forme d’émergence d’États « modernes » différents, quant à la nature de leurs frontières et quant à leur contenu politique, des États qui existaient jusque-là.
Entre la période « ancienne » et la période » moderne et contemporaine », on devrait reconnaître l’existence d’une transition, d’un tournant, moment au cours duquel les structures anciennes ont été en pleine décomposition sous les assauts de l’ordre nouveau. C’est le temps de la protomodernité, les années de « réajustement » pour reprendre le terme de Joseph Ki-Zerbo (1972). Cette époque qui marque le tournant s’étale du XVIIc-XVIIIe siècle – même pour la région côtière – jusqu’à la première moitié du XIXe siècle.
Avec ces précisions, une lecture historique, périodisée, peut être tentée, en s’appuyant essentiellement sur des éléments internes. L’âge ancien de l’histoire, couvrant la période précédant l’époque de la confiscation de l’initiative sur cet espace, a connu lui aussi ses temps forts et ses centres d’innovation. On peut y relever trois grands moments.
D’abord le temps des commencements qui est celui du peuplement du pays entraînant une répartition de l’espace. Cette préoccupation, comme le confessent les traditions historiques, aura été présente jusqu’au XIXe siècle ; elle aura connu son temps fort avec l’essaimage des Bantu sur cette partie centrale du pays, malgré le fait que la répartition interne ne fut jamais donnée une fois pour toutes et qu’elle ait été constamment revue suivant les exigences du mode d’approvisionnement.
L’occupation de l’espace une fois réalisée, on assista alors à l’émergence des systèmes politiques et culturels, fruits des multiples symbioses entre la dynamique des peuples, les exigences de l’environnement et la configuration des populations préexistantes. C’est en réalité le point culminant de l’histoire locale et qui affecte tous les domaines : politique, culturel, technologique.
Avec les premières greffes culturelles pratiquées « du dehors » sur les structures internes et surtout avec le fonctionnement des hommes valides acheminés vers les côtes, des stratégies nouvelles virent le jour. Les bouleversements introduits entraînèrent des réajustements de jour en jour plus importants. On est au seuil du second âge de l’histoire.
L’âge moderne et contemporain prend la relève lorsque les impératifs du dehors commandent une nouvelle répartition de l’espace, sous l’angle commercial d’abord (XVIIIe-XIXe siècle), sous l’angle politique ensuite (XIXe– début XXe siècle). Après s’être retrouvées regroupées en zones commerciales, les populations congolaises découvrirent l’existence d’une superstructure qui les coiffait et dont la consistance ne fit que croître : « Etat Indépendant du Congo », « Congo Belge ». Elles s’employèrent à sortir de là : c’est l’aventure de la décolonisation.
Il faut à présent apprivoiser cette superstructure, l’arracher à l’extraversion qui l’a sécrétée, lui donner un contour qui corresponde aux données réelles du terrain, en faire un instrument de promotion non plus de ceux qui l’ont introduite mais de ceux qui la subissaient. C’est la problématique du moment, la longue marche pour accéder, après la décolonisation, à l’âge proprement contemporain.
3 SYNTHÈSE D’HISTOIRE DU CONGO
Il va de soi que notre entreprise s’inscrit dans la foulée de bien d’autres qui ont choisi de présenter une synthèse de l’histoire du Congo. Cette préoccupation a été plus impressionnante que cela n’apparaît à première vue [8]. Le premier texte le plus significatif du genre est incontestablement celui de E. Mendiaux, Histoire du Congo, des origines à Stanley, Bruxelles, 1961. Cet ouvrage accorde une certaine place à l’histoire ancienne du Congo, encore qu’il n’ait traité cette partie qu’en guise d’introduction à l’histoire « belge du Congo », le but poursuivi ayant été de faire comprendre aux Belges et aux Congolais de l’époque « l’importance de l’œuvre accomplie en commun durant quatre-vingts ans » (p. 5). En dépit d’une vision passablement dépendante de l’européocentrisme, cet ouvrage constitue, jusqu’à preuve du contraire, la contribution belge la plus importante en matière de synthèse d’histoire du Congo. Elle précède ainsi de 15 ans la première initiative issue de la plume d’un Congolais : L’histoire du Zaïre de Tshimanga wa Tshibangu (Bukavu, Ceruki. 1976). Ce second travail, malgré ses limites [9](9), constitue une première référence écrite de l’histoire nationale, préfacée du reste par le Commissaire d’État à l’Education nationale et donnant une idée suffisamment précise de l’évolution du pays, surtout dans sa phase coloniale et postcoloniale (pp. 63-172). Si l’ouvrage présente quelques faiblesses, c’est essentiellement dans l’exposé concernant la partie ancienne.
Avant et après Tshimanga, on ne pourrait minimiser la quote-part décisive de R. Cornevin et de Th. Obenga. L’histoire du Congo de Cornevin a paru, en première édition, en 1963. Largement diffusé à l’époque à Kinshasa. cet ouvrage était le premier document impeccable dans sa présentation, qui proposait la synthèse la plus complète de l’histoire du pays, de la préhistoire aux actualités récentes de la décolonisation. Mais une seconde édition fut nécessaire afin de corriger de nombreuses erreurs. C’est ce qui fut fait avec la parution de L’histoire du Congo- Léopoldville – Kinshasa (Paris, Berger-Levrault. 1966). Cette édition fait date. C’est certainement la première étude consistante qui ait pu paraître dans une collection aussi sérieuse que celle des « Mondes d’Outre-Mer » dirigée par H. Deschamps. La parution d’un autre texte de l’auteur (le Zaïre. P.U.F.. 1972, « Que sais-je » n° 1489) a définitivement permis à l’histoire du Congo d’être connue. Mais ici aussi. le texte n’est pas forcément à l’abri de la critique. Quand l’auteur parle, par exemple, de la création du M.V.R. (Mouvement des Volontaires de la République) qui constituera la base du M.N.R. (Mouvement National de la Révolution) (p. 102), on comprend qu’il est question du C.V.R. (Corps des Volontaires de la République) et du M.P.R. (Mouvement Populaire de la Révolution). Il faut toutefois saluer et louer sa dernière parution, à titre posthume, qui a tenté de compenser quelques-unes des lacunes dénoncées ici (Cornevin R., 1989).
On sait que l’œuvre de Cornevin fait souvent l’objet de critiques sévères [10] Mais on doit également lui faire justice et reconnaître le service immense que ce haut fonctionnaire français a rendu à l’histoire de l’Afrique et en particulier à l’histoire Congo, en attendant l’éclosion décisive d’une histoire africaine et congolaise. L’écart existant entre « l’histoire du Congo » et « l’histoire congolaise » situe justement le champ difficilement accessible à R. Cornevin, en dépit des efforts louables qu’il a consentis dans ce domaine.
Théophile Obenga (1977) a eu également l’idée de faire un livre sur le Congo/ Kinshasa, à la fois pour valoriser les travaux de ses étudiants à Lubumbashi et apporter une contribution sympathique à la connaissance de ce pays voisin [11]. C’est ce qui fut fait. Présence africaine en assura la publication. On sait que Fr. Bontinck (1977), à sa parution, en fit une analyse fouillée tout en déplorant son caractère sommaire [12]. En réalité, l’ambition de Th. Obenga consistait à compléter la présentation des populations d’Afrique Centrale par celle des populations « zaïroises ». Celles du Congo/Brazzaville avaient déjà fait l’objet d’un premier exposé, dans l’Introduction à la connaissance du peuple de la République Populaire du Congo (Brazzaville, Librairie Populaire, 1973) où chaque population était identifiée dans son système de parenté, son organisation sociale, politique et économique. Animé de la même préoccupation, l’auteur s’est consacré par la suite à une étude plus approfondie des populations de la cuvette (La cuvette congolaise, les hommes et le structures, Paris, P.A., 1976), avant de poursuivre ses investigations sur le champ congolais. L’ouvrage sur le Congo constitue donc l’élément de tout un ensemble assorti des explications sur l’organisation moderne du pays, spécialement dans le domaine de la culture, de l’enseignement et de la recherche, initiative heureuse qui apporte en plus à l’ouvrage les qualités d’un guide indispensable pour pénétrer les réalités du pays.
Le présent ouvrage se propose de tirer largement profit de ces réalisations. A défaut d’être un manuel, il entend être un ouvrage de connaissance générale sur l’histoire du peuple du Congo dont l’abord aisé pour le spécialiste n’exclura nullement, espérons-le, la curiosité du lettré de tout bord intéressé par l’itinéraire historique des peuples de cette région d’Afrique.
Le chercheur prendra connaissance de ce texte en manière d’introduction, conscient qu’il y a toujours place pour une connaissance plus approfondie. C’est dans cette intention qu’une bibliographie substantielle clôture ce texte.
CORRESPONDANCE DES NOMS ET DES TERMES
|
Noms coloniaux |
Nom de l’ère de Mobutu |
Noms actuels |
|
Adminsitrateur de terril. |
Commissaire de zone |
Administrateur de ter |
|
Albert (commune) |
Kamalondo (Zone) |
Kamalondo (com.) |
|
Albert (lac) |
Mobutu (lac) |
Albert (lac) |
|
Alberta |
Ebonda |
Ebonda |
|
Albertville |
Kalemie |
Kalemie |
|
Bakwanga |
Mbuji-Mayi |
Mbuji-Mayi |
|
Banningville |
Bandundu |
Bandundu |
|
Banzyville |
Mobaye |
Mobaye |
|
Bas-Congo |
(Kongo Central) Bas-Zaïre |
Bas-Congo |
|
Baudouinville |
Moba |
Moba |
|
Bourgmestre |
Commissaire de zone |
Bourgmestre |
|
Brabanta |
Mapangu |
Mapangu |
|
Camp Cito (Cité) |
Quart. Kauka |
Quart. Kauka |
|
Centre extra-coutumier |
Cité |
Cité |
|
Charlesville |
Djokopunda |
Djokopunda |
|
Commune |
Zone |
Commune |
|
Congo belge |
Congo/Zaïre |
Congo |
|
Coquilhatville |
Mbandaka |
Mbandaka |
|
Costermansville |
Bukavu |
Bukavu |
|
Cristal (Mts) |
Mayumbe (Mts) |
Mayumbe (Mts) |
|
Dendale (Commune) |
Kasa-Vubu (Zone) |
Kasa-Vubu (Com.) |
|
Député |
Commissaire du Peuple |
Député |
|
District |
Sous-région |
District |
|
Edouard (lac) |
ldi Amin (lac) |
Edouard (lac) |
|
Elisabetha |
Lukutu |
Lukutu |
|
Elisabethville |
Lubumbashi |
Lubumbashi |
|
État indépendant du Congo Congo/Zaïre |
R.D. Congo |
|
|
Flandria |
Boteka |
Boteka |
|
Gouvernement |
Conseil Exécutif |
Gouvernement |
|
Gouverneur de Province |
Commissaire de Région |
Gouverneur de Prov. |
|
Haut-Congo (District) |
Haut-Zaïre (Sous-rég.) |
Haut-Congo (Dist.) |
|
Jadotville |
Likasi |
Likasi |
|
Kalina (Commune) |
Gombe (Zone) |
Gombe (Commune) |
|
Katanga |
Shaba |
Katanga |
|
Léopold II (lac) |
Maindombe (lac) |
Maindombe (lac) |
|
Léopoldville |
Kinshasa |
Kinshasa |
|
Leverville |
Lusanga |
Lusanga |
|
Luluabourg |
Kananga |
Kananga |
|
Mérode |
Tshilundu |
Tshilundu |
|
Ministre |
Commissaire d’Etat |
Ministre |
|
Mont Stanley |
Mont Ngaliema |
Mont Ngaliema |
|
Nouvelle-Anvers |
Mankanza |
Mankanza |
|
Paulis |
Isiro |
Isiro |
|
Parlement |
Conseil Législatif |
Parlement |
|
Ponthierville |
Ubundu |
Ubundu |
|
Port-Francqui |
Ilebo |
Ilebo |
|
Province |
Région |
Province |
|
Province orientale |
Région du Haut-Zaïre |
Province orientale |
|
Renkin (Quartier) |
Matonge |
Matonge |
|
Rhodésie du nord |
Zambie |
Zambie |
|
Rhodésie du sud |
Zimbabwe |
Zimbabwe |
|
Saint-Jean (Commune) |
Lingwala |
Lingwala |
|
Secteur |
Collectivité |
Secteur |
|
Stanley (Commune) |
Makiso (Zone) |
Makiso (Com.) |
|
Stanley Pool |
Pool Malebo |
Pool Malebo |
|
Stanleyville |
Kisangani |
Kisangani |
|
Tanganyka (pays) |
Tanzanie |
Tanzanie |
|
Territoire |
Zone |
Territoire |
|
Thysville |
Mbanza-Ngungu |
Mbanza-Ngungu |
SIGLES ET ABRÉVIATIONS COURANTS
|
ABA |
Académie des Beaux-Arts |
|
ABAKO |
Alliance des Bakongo |
|
ACCT |
Agence de Coopération Culturelle et Technique |
|
ADAPES |
Association des anciens élèves des Pères de Scheut |
|
AFAC |
Association des Fonctionnaires et Agents de la Colonie |
|
AFDL |
Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo |
|
AGEL |
Association Générale des Etudiants Congolais |
|
AIA |
Association Internationale Africaine |
|
AICA |
Association Internationale de Critique d’Art |
|
AIMO |
Affaires Indigènes et Main-d’Oeuvre |
|
AMC |
Annales du Musée du Congo |
|
AMRCB |
Annales du Musée Royal du Congo Belge |
|
ANC |
Armée nationale congolaise |
|
AND |
Agence nationale de Documentation |
|
ANEZA |
Association nationale des Entreprises du Zaïre |
|
APIC |
Association du Personnel Indigène de la Colonie |
|
APL |
Armée Populaire de Libération |
|
ARSC |
Académie Royale des Sciences Coloniales |
|
ARSOM |
Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer (succède à ARSC) |
|
ASSANEF |
Association des anciens élèves des Frères (des écoles chrétiennes) |
|
ASSORECO |
Association des Ressortissants du Haut-Congo |
|
ACTAR |
Association des Tchokwe du Congo, de l’Angola et de Rhodésie |
|
BACB |
Bulletin Agricole du Congo Belge |
|
BCR |
Compagnie de Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga |
|
BCZC |
Bulletin du Cercle Zoologique Congolais |
|
BJIDCC |
Bulletin des Juridictions Indigènes et du Droit Coutumier congolais (Elisabethville) |
|
BMRHNB |
Bulletin du Musée Royal d’Histoire Nationale de Belgique |
|
BMS |
Baptist Missionary Society |
|
BNZ |
Bibliothèque Nationale du Zaire |
|
BO |
Bulletin Officiel |
|
BSBEC |
Bulletin de la Société Belge d’Etudes Coloniales |
|
BSBG |
Bulletin de la Société Belge de Géographie |
|
BSBGH |
Bulletin de la Société Belge de Géologie et d’Hydrologie |
|
BSGA |
Bulletin de la Société de Géographie d’Anvers |
|
BSRBAP |
Bulletin de la Société Royale Belge d’Anthropologie et Préhistoire |
|
CADULAC |
Centre Agronomique de l’Université de Louvain en Afriqqe Centrale |
|
CDD |
Commissaire de district |
|
CEA |
Cahiers d’Etudes Africaines |
|
CEB |
Communauté ecclésiale de base |
|
CEDAF |
Centre d’Etudes et de Documentation Africaines |
|
CELTA |
Centre de Linguistique Théorique et Appliquée |
|
CEMUBAC |
Centre d’Etudes Médicales de l’Université Libre de Bruxelles en Afrique Centrale |
|
CEPSE |
Voir CEPSI |
|
CEPS1 |
Centre d’Etudes des Problèmes Sociaux Indigènes devenu CEPSE (Centre d’Etudes des Problèmes Sociaux et Economiques) |
|
CERDAC |
Centre d’Etudes et de Recherches Documentaires sur l’Afrique Centrale, Lubumbashi (Faculté des Lettres) |
|
CEREA |
Centre de Regroupement Africain |
|
CES |
Cahiers économiques et sociaux |
|
CERUKI |
Centre de Recherches Universitaires sur le Kivu |
|
CFL |
Chemins de fer Africains du Congo supérieur aux Grands Lacs |
|
CHANIC |
Chantier Naval et Industriel du Congo |
|
CK |
Compagnie du Kasai |
|
CND |
Centre National de Documentation |
|
CNKI |
Comité National du Kivu |
|
CNL |
Conseil National de Libération |
|
CNS |
(la) Conférence nationale souveraine |
|
CNS |
(le) Conseil national de Sécurité |
|
CONACO |
Convention Nationale Congolaise |
|
CONAKAT |
Confédération des associations tribales au Katanga |
|
CONDIFA |
Condition féminine |
|
CRISP |
Centre de Recherches et d’Informations socio-politiques |
|
CRP |
Centre de Recherche Pédagogique (Kinshasa) |
|
CSK |
Comité Spécial du Katanga |
|
CVR |
Corps des Volontaires de la République |
|
Ed. |
Edition |
|
EGI |
Etablissements Généraux des Imprimeries |
|
EHA |
Etudes d’Histoire Africaine – Lubumbashi – Département d’Histoire (Faculté des Lettres) |
|
EHESS |
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) |
|
EIC |
Etat Indépendant du Congo |
|
ENDA |
Ecole Nationale de Droit et d’Administration |
|
EZ |
Etudes Zaïroises |
|
FAR |
Forces Armées Rwandaises |
|
FAZ |
Forces Armées zaïroises |
|
FAZA |
Forces aériennes zaïroises |
|
Fasc. |
Fascicule |
|
FBI |
Fonds du Bien-Etre Indigène |
|
FGTK |
Fédération Générale des Travailleurs Kongolais |
|
FIKIN |
Foire Internationale de Kinshasa |
|
FLNC |
Front de Libération Nationale du Congo |
|
FNLA |
Front National de Libération de l’Angola |
|
FOMULAC |
Fondation Médicale de l’Université de Louvain en Afrique Centrale |
|
FORCAD |
Secrétariat général à la Formation des cadres |
|
FOREAMI |
Fondation Reine Elisabeth au Congo pour l’Assistance Médicale aux Indigènes |
|
FORMINIERE |
(Société Internationale) Forestière et Minière |
|
FPR |
Front Patriotique Rwandais |
|
GECAMINES |
Générale des Carrières et de Mines |
|
HCB |
Huileries du Congo Belge |
|
HCR |
Haut Conseil de la République |
|
HCR-PT |
Haut Conseil de la République – Parlement de Transition |
|
HIA |
History in Africa |
|
IBTP |
Institut des Bâtiments et Travaux publics |
|
UAL |
International Journal of American Linguistic |
|
IMNZ |
Institut des Musées Nationaux du Zaïre |
|
INA |
Institut National des Arts |
|
INEAC |
Institut National d’Etudes Agronomiques au Congo |
|
INERA |
Institut National des Recherches Agronomiques |
|
IPN |
Institut Pédagogique National – Kinshasa |
|
IPNCB |
Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge |
|
IPNCRB |
Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi |
|
IRCB |
Institut Royal Colonial Belge (précède ARSC) |
|
IRES |
Institut de Recherche et d’Etudes Scientifiques |
|
ISC |
Institut Supérieur du Commerce |
|
ISP |
Institut Supérieur Pédagogique |
|
IST |
Institut Supérieur Technique |
|
ISTA |
Institut Supérieur des Techniques Appliquées |
|
ISTI |
Institut Supérieur des Techniques de l’Information |
|
JAH |
Journal of African History-Londres. depuis 1960 |
|
JMPR |
Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révolution |
|
KUL : |
Katholieke Universiteit te Leuven |
|
MIBA : |
Minière de Bakwanga |
|
MNC |
Mouvement national Congolais |
|
MOPAP |
Mobilisation, Propagande et Animation Politique (Secrétariat Général) |
|
MPLA |
Mouvement Populaire de Libération de l’Angola |
|
MPR |
Mouvement Populaire de la Révolution |
|
MRAC |
Musée Royal de l’Afrique Centrale |
|
MRCB |
Musée Royal du Congo Belge |
|
NEA |
Nouvelle Edition Africaine |
|
OCA |
Office des Cités Africaines |
|
ONATRA |
Office National de Transport |
|
ONRD |
Office National de Recherche et de Développement |
|
OTRACO |
Office de Transport Congolais |
|
OUA |
Organisation de l’Unité Africaine |
|
PA |
Présence Africaine |
|
PNP |
Parti National du Progrès |
|
PSA |
Parti Solidaire Africain |
|
PRP |
Parti de la Révolution Populaire |
|
PU |
Présence Universitaire |
|
PUF |
Presses Universitaires de France |
|
PUNA |
Parti de l’Unité Nationale |
|
PUZ |
Presses Universitaires du Zaïre |
|
RADECO |
Rassemblement des Démocrates Congolais |
|
RCA |
République Centrafricaine |
|
RCB |
Revue Coloniale Belge |
|
RJC |
Revue Juridique du Congo |
|
RVA |
Régie des Voies Aériennes |
|
SONAS |
Société nationale d’assurancces |
|
SONECA |
Société nationale des Editeurs, Compositeurs et Auteurs |
|
SNCZ |
Société nationale de chemins de fer du Zaïre |
|
SUEE |
Société nationale d’électricité |
|
SRBAP |
Société Royale Belge d’Anthropologie et Préhistoire |
|
SRBG |
Société Royale Belge de Géographie |
|
T. |
Tome |
|
UCL |
Université Catholique de Louvain-La-Neuve |
|
UDEAC |
Union Douanière d’Afrique Centrale |
|
UDPS |
Union pour la Démocratie et le Progrès social |
|
UEAC |
Union des Etats d’Afrique Centrale |
|
UGEC |
Union Générale des Etudiants Congolais |
|
ULB |
Université Libre de Bruxelles |
|
UMHK |
Union minière du Haut-Katanga |
|
UNAZA |
Université Nationale du Zaïre |
|
Unikin |
Université de Kinshasa |
|
Unikis |
Université de Kisangani |
|
Uni lu |
Université de Lubumbashi |
|
UNTZA |
Union nationale des Travailleurs zaïrois |
|
UOC |
Université Officielle du Congo (et du Rwanda-Urundi) |
|
Vol. |
Volume |
[1] Voir à ce sujet entre autres les travaux de G. Leclerc (1972). J. Copans (1974. 1990). A. Schwarz (1980), B. Jewsiewicki et D. Newbury (1985). V..Y. Mudimbe (1982. 1988).
[2] Les travaux de Vansina, J. l’ont suffisamment démontré (1961, 1991).
Voir aussi une synthèse de l’auteur sur la question : 1980 : 167-190 ; 1982 : 3-13.
[3] Il existe une littérature imposante sur la question axée surtout sur l’étude du passé-présent ; Henige, D., 1983 ; Rosaldo, R, 1980 ; 89-99 ; Bernardi, B. et Al. 1978 : 35-58 ; Thompson, P., 1981. Dans is onograp ie zaïroise, 1 oralité la plus exploitée est «le récit de vie» (Jewsiewicki B., Mbokolo E., Ndaywel e Nziem, Sabakinu K., 1990, 1993).
[4] Le « grand classique » fut le texte de Fortes, M. et Pritchard, E., 1961.
[5] L’étude de Jan Vansina, sur les peuplades de la forêt (1991) tente enfin de combler ce vide.
[6] La première mention écrite du mot Zaïre date de 1529. Dans une lettre de D. Joao III. roi du Portugal, adressée au roi du Kongo, le fleuve est appelé « Rio Zayre » (Brasio. A., 1952-1954 : 521-539 ; Jadin, L. et Dicorato, M„ 1974 : 171-182). Dans la suite, sur une carte de Antonio Sanches (1941), on constate que le fleuve se divise à l’embouchure en deux branches appelées « Zaïre » et « Congo » (Maréchal, P., 1973 : 35-36).
[7] L’appellation de « République Démocratique du Congo » était déjà inscrite dans la Constitution de Luluabourg ; elle avait été d’usage pendantsept ans (1964-1971), avant que le pays ne devienne le « Zaïre ».
[8] La synthèse la plus ancienne semble être celle d’Albert Michiels : Notre colonie-géographie et notice historique, Bruxelles, 1910 ; ce texte a servi de manuel pendant des années et a connu plusieurs éditions. Il y a eu ensuite deux petits textes non négligeables des années 20 : Pergameni C., Afrique Centrale et le Congo-Zaïre. Bruxelles, 1924 et Le Jeune L., Chronologie de l’histoire du Congo-Belge, Anvers, 1926. Mais la grande production dans ce domaine se situe plutôt vers les années 30 : Grégoire H.. Histoire du Congo pour la jeunesse. Bruxelles. 1930 ; Kermans H. et Monhein C., La conquête d’un empire – Histoire du Congo Belge. Bruxelles. 1921 et surtout Bollati Ambrogio, Il Congo Belga, Milano, Institute per gli studi di politica internazionale, 1939. Dans les années qui suivent jusqu’à l’aube de la colonisation, on note bien d’autres initiatives non moins intéressantes tendant à faire connaître l’histoire des « Belges au Congo » : Hànel K. Der Belgishe Kongo » Weltgeschehen », Leipzig, 1944 ; Wauters A., The Belgian Congo, reserver of the allies, London, 1942 ; Gérard J., Esquisse d’histoire congolaise, Anvers, 1944 ; Perier G.D., Le Congo des Belges, Bruxelles, 1948. 40 p. ; Van Werveke H.. Geschiedenis van België en van Belgish Congo, Gent. 1951, 163 p. ; Gelder V., Coup d’œil sur le Congo après un quart de siècle, 1RCB ; 1952, 12 p. ; Leveque R., Le Congo-Belge – Son histoire. Bruxelles. 1960.101 p
[9] Cf. compte-rendu de Tshund’Olela et Yogolelo. T.. 1977
[10] Même dans les pages de Likundoli, une polémique du genre s’est engagée entre cet auteur et L. Greindl (Cornevin, R., 1974 ; Greindl, L., 1974 b).
[11] Voir à ce propos Obenga, T., 1977.
[12] Voir Bontinck, F., 1977 : 315-316,



