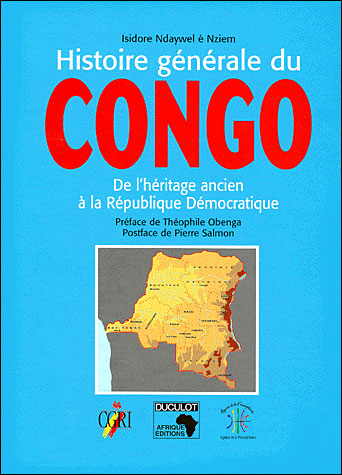
Partie 2 - Chapitre 1 : Les aventures de la côte
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 1
Les aventures de la côte
Dès le début du second millénaire, la région de la côte atlantique comptait un certain nombre de petits royaumes indépendants les uns des autres, bien que tous liés à une même culture. Parmi eux, le Kongo [1] allait se révéler comme l’un des plus prestigieux de la région. Son histoire particulière est du reste révélatrice des problèmes et des tendances qui s’étaient esquissés à cette époque. Ce seul aspect justifie déjà l’intérêt qu’on peut lui accorder. Mais la raison essentielle qui fait du Kongo l’une des pages particulièrement fascinantes de l’histoire de l’Afrique Centrale est certainement ailleurs. C’est, de tous les royaumes de cette partie de l’Afrique, celui sur lequel l’historien est le mieux renseigné. Sur ce point, l’historiographie est en effet particulièrement éloquente et fournit un éventail de documents : récits et témoignages de voyageurs dont les plus importants ont été édités, documents d’archives accessibles dans les meilleurs dépôts du monde, plusieurs études publiées, etc. [2].
Il faut noter que la tradition orale n’a pas été pour autant négligée. Bien au contraire, elle a connu deux états de collecte. Le premier s’est réalisé aux XVIe et XVIIe siècles ; son résultat intervient quelque peu dans certaines compilations (Dapper, O.) et surtout dans des « relations » de voyage (Pigafetta, Jean-François de Rome, Cavazzi, etc.)[3]. Ces auteurs déclarent explicitement tenir d’autres personnes un certain nombre de faits qu’ils rapportent, surtout ceux qui concernent l’origine du royaume. Une seconde collecte de tradition orale est celle qui s’est réalisée au début de ce siècle et qui est à la base de certaines synthèses fameuses sur la culture Kongo (Cuvelier, J. et surtout Van Wing, J.).
C’est un hasard heureux qu’un statut historiographique aussi privilégié en Afrique soit revenu à un royaume qui avait eu le temps de développer ses institutions bien avant de subir les assauts de l’acculturation. En fait ce foisonnement de documents est censé assurer une diffusion importante à cette réalité politique et culturelle que fut le Kongo. Ils nous permettent de comprendre, par généralisation, comment on vivait à l’époque dans le Congo ancien car la région côtière, loin d’être isolée, était en contact avec une grande partie du pays. D’ailleurs, les innovations d’origine externe qui le secouèrent à ce moment avaient fini par influencer de proche en proche l’ensemble du pays. Il faut dire que l’expérience d’acculturation que le Kongo a connue compte pour beaucoup dans la compréhension de son devenir. Il s’agit d’abord d’un contact qui, dans ses aspects officiels, a duré des siècles, ce qui confère à cette expérience avec le Portugal une importance plus grande que celle de nos relations avec la Belgique [4].
Incontestablement, cette première expérience demeure riche d’enseignements. D’abord parce que certaines réalités sociales contemporaines procèdent, par leur origine profonde, de cette période : christianisation, traite des esclaves, etc. Ensuite, dans la mesure où certains problèmes de coopération actuels s’étaient déjà posés à ce moment, ils peuvent aujourd’hui être abordés en connaissance de cause. Une maîtrise suffisante des données de l’histoire du Kongo pourrait donc permettre une lecture plus judicieuse des questions contemporaines des deux Congo, de l’Angola, et en généralisant, de toute l’Afrique Centrale. On évoquera d’abord les questions des fondements de cette organisation politique, avant de donner une idée de l’évolution qu’elle a connue et des institutions qu’elle a développées (Hilton, A., 1985)
L’histoire du peuplement de la région suggère que les ancêtres du Kongo seraient venus du nord avant d’essaimer dans la zone de l’embouchure du fleuve Congo. Ce nouvel habitat n’était pas inoccupé : les Pygmées (Mbaka), encore présents, partageaient ce territoire avec une première vague de Bantu qui étaient arrivés plus tôt que les Kongo. Les Mbundu faisaient partie de ce groupe.
Les nouveaux venus n’eurent guère d’autre possibilité que de se mêler aux populations déjà installées. C’est de cet amalgame de populations qu’allaient naître les différents groupes qui plus tard seront appelés Kongo. L’on pourrait s’interroger sur l’origine de ce choix ethnonymique. Il n’est pas facile de déterminer la signification et l’origine d’une dénomination ethnique. Elle peut avoir été au point de départ un sobriquet forgé par les voisins avant d’être adopté par la société concernée, laquelle forge a posteriori une signification, glorieuse de préférence, pour se mettre en valeur. Pour le cas du Kongo, il serait difficile d’avancer une quelconque hypothèse, dans un sens comme dans un autre.
Et pourtant, certaines tentatives d’explication paraissent plausibles. Aux dires de F. Ngoma, « Kongo » proviendrait vraisemblablement de Nkongo qui signifie « chasse ». A ce propos une légende raconte que l’emplacement du village d’origine aurait été découvert par un chasseur qui, fasciné par la beauté du site, décida d’en faire un village. Par métonymie, ce lieu fut appelé Kongo. Mais une autre explication rapproche plutôt ce terme d’un mot similaire, Nkongo, qui veut dire « couteau de jet » ou « lance » (Ngoma, F., 1962, 16-17). On suppose aussi que Kongo pourrait être le nom de la personne qui aurait mis au point cette technique, à moins que cela soit tout simplement le nom de cette arme qui deviendra plus tard une monnaie et même un insigne de dignité.
Quoi qu’il en soit, les deux explications se rejoignent quelque peu dans la mesure où elles tournent autour du même phénomène de chasse ou d’activité guerrière. On constate dans les explications glanées dans la tradition orale que le terme affecte tantôt l’arme tantôt la personne qui l’utilise, tantôt encore les deux phénomènes à la fois. Cette interprétation devient plus claire encore lorsqu’on associe le chasseur, le conquérant, avec deux autres assertions suggérées par G. Balandier. Kongo serait aussi un ancien synonyme du mot « Mfumu », chef ou homme libre par opposition à esclave. Et si l’on procédait à la décomposition du mot Kongo, cela aboutirait à désigner la peau du léopard. Chasseur-fondateur de village, lance, peau de léopard, chef, tout cela renvoie au même contexte, celui de l’aristocratie et de la politique. Visiblement, c’est à une telle interprétation que nous invite ce terme.
Avant l’avènement du royaume, il faut croire que les différents groupes étaient indépendants les uns des autres et aucun d’entre eux d’ailleurs ne se réclamait d’être Kongo. Seule la relation clanique assurait une certaine liaison entre tous. Mais, parmi tous, un clan passait pour être noble : c’est le clan Nsaku considéré comme propriétaire terrien, et qui recevait le tribut de tous les autres groupes. Ceci impliquait, sur le plan politique, l’existence d’une structuration par chefferies dont les plus importantes étaient : Nyanga occupée par les populations de souche Mbundu et Teke ; Mpangu fondée par les Kyowa. une branche des Nsaku : Nsundi qui est l’unification de plusieurs petites entités réalisées par les Mpanzu ; Mpemba qui comprenait les petites seigneuries de Kasi, Ndamba et Wandu : Mbata qui regroupait les Zombo, les Nzolo, les Nsongo, les Mulaza et des populations méridionales de la région : Musulu, Nzeto, Mbwela, etc. et, enfin, Sopo qui regroupait les populations côtières (Tshungu, B.Z., 1979 : 59-98). Suivant les estimations de T. Obenga ces chefferies étaient déjà en place aux IIIe et IVe siècles (Obenga, T., 1976 : 5).
L’apparition du royaume serait liée à l’avènement d’un ancêtre-fondateur, du moins d’après la tradition. Nimi Lukeni [5] serait parti de la chefferie de Bungu, sur la rive droite du fleuve qu’il aurait traversé pour s’installer sur les terres méridionales [6]. Les raisons de ce déplacement ne sont pas évidentes. Une lecture attentive de ce passage de la tradition orale permet tout juste de conclure qu’il y eut scission au sein de l’aristocratie régnante de Bungu. Une partie de celle-ci émigra. Avec ses compagnons (Besi Kongo), Lukeni se mêla aux autochtones. Son avènement aura consisté à unifier les chefferies déjà existantes en s’imposant à toutes les aristocraties locales.
Il est plus vraisemblable de croire, à l’encontre de la tradition orale, que le royaume s’est élaboré progressivement tant du point de vue de l’espace que de celui de la centralisation, sans que cela ne procède véritablement d’une initiative consciente.
C’est sans doute dans ce sens qu’il faut comprendre l’existence des foyers dynamiques relevés par Batsikama. L’avènement de chacun d’eux aurait entraîné l’intégration d’une région particulière : Kongo-dya-Mpangala aurait apporté l’unification de Mbamba et une partie de Nsundi, Kongo-dga-Mulaza aurait assuré l’intégration des régions occidentales situées entre l’Inkisi et le Kwango (Mpangu, Mbata) ; Kongo- dya-Mpanzu, celle des terres du nord-est (Loango, Ngoyo et une partie de Nsundi). La dernière phase dynastique, Kongo-dina-nza, correspondrait à la prise de position de la partie centrale du pays (Mpemba), assurant de la sorte l’unification des grandes régions déjà conquises (Batsikama, M., 1979 : 180-228). Kongo-dya- Mpangala, Kongo-dya-Mulaza et Kongo-dya-Mpanzu devinrent alors dépendants de Mbanza Kongo ; de ce fait le royaume fut définitivement constitué (carte 5).
Quand situer la constitution de ce royaume ? En matière de datation, on n’est guère à l’aise. Non seulement les matériaux sûrs font défaut, mais l’entreprise elle- même paraît laborieuse dans la mesure où l’on se rallierait à l’hypothèse d’une élaboration progressive du royaume. De toute façon, le néolithique au Bas-Congo a été identifié au Ier siècle de notre ère, ce qui marque déjà la limite extrême de la fondation de ce royaume (De Maret, P., 1978 : 69-73). Les traditions recueillies au XVIIe siècle et qui ont été consignées dans les « relations » de l’époque, suggèrent une certaine datation. L’auteur anonyme de l’historia do reino do Congo qui écrit vers 1624, dit que l’avènement de Lukeni eut lieu environ 350 ans auparavant (Bontinck, P., 1972 : 84-85). C’est-à-dire, vers 1274. Toujours selon cet auteur, à partir de cette date jusqu’en 1504, soit en l’espace de 230 ans, huit règnes se seraient écoulés (celui de Lukeni, de six inconnus [7], puis celui de Muzinga a Nkuwu (Bontinck, F., 1972 : 88). Et pourtant, traditionnellement, on situe la fondation de ce royaume au XIVe siècle (Van Wing, J., 1921 : 80-81). Les auteurs les plus sérieux n’hésitent pas confirmer cette chronologie (Balandier, G., 1965 : 22 ; Randles, W., 1969 : 18).
Que retenir en définitive ? Quelle est la datation la plus vraisemblable ? Il faut estimer que, pour avoir été si bien constitué au XVe siècle à l’arrivée des Portugais, le royaume a dû certainement avoir eu le temps de se développer, de perfectionner ses institutions et de parfaire son organisation. Ce n’était donc pas un jeune royaume que Diogo Câo découvrit en 1483, mais plutôt un vieux royaume pétri d’une longue expérience. Dans ce cas, ce ne seraient pas quelques règnes qui auraient séparé l’époque de Muzinga Nkuwu de la fondation du royaume, mais des dynasties entières représentées par la succession au pouvoir de plusieurs clans royaux.
La fondation du Kongo en tant que royaume date certainement d’avant le XIVe siècle. En attendant que soient exhumés des matériaux plus précis permettant de faire avancer le débat, il paraît raisonnable de s’en tenir aux estimations de l’auteur anonyme de « l’Historia do reino do Congo ». On peut donc considérer que les chefferies royales du genre de Bungu, Mpangu, Soyo, existaient dans la région dès la fin du premier millénaire. Elles n’ont donné lieu à un regroupement géré politiquement que vers le XIIIe siècle (avènement de Lukeni). Une telle expérience a eu le temps de s’affirmer, de se consolider et même de commencer à décliner en deux siècles. C’est à ce stade de son évolution que le royaume sera visité par les sujets de Sa Majesté le roi du Portugal.
Il convient à présent de préciser l’étendue qu’a connue ce royaume. Entreprise complexe puisque celle-ci a varié d’une époque à l’autre. Il faut croire, avec Balandier, que le Kongo n’a jamais été aussi vaste qu’au temps de son histoire obscure, celle qui précède la période d’acculturation (Balandier, G., 1965 : 15). Depuis le contact avec l’Europe et le développement de la traite des esclaves, il ne fera que perdre l’une après l’autre les seigneuries qui étaient sous sa dépendance : Angola. Matamba, Loango, Kakongo, Ngoyo, etc. Mais faut-il croire qu’il y eut vraiment une époque où toute cette région côtière était sous la dépendance du pouvoir de Mbanza Kongo ? Les titres portés par le Mani Kongo l’affirment. Mais il y a lieu de s’en méfier quelque peu. Le roi du Kongo pouvait très bien chercher à additionner ses titres de prestige en énumérant la « nationalité » de tous ses sujets, même si cela ne correspondait pas rigoureusement à la réalité. Et quand bien même tous les peuples cités lui auraient été soumis, ils ne devaient pas nécessairement faire partie du territoire du Kongo.
Il faut lever une équivoque, lorsque le contemporain que nous sommes considère les faits anciens de l’Afrique. Actuellement, la notion de frontière obéit à des critères précis. Elle requiert forcément la précision cartographique. Il faut se rappeler que pour le monarque ancien, cette précision était inexistante ; comme on l’a expliqué plus haut, celle-ci ne semblait même pas nécessaire. Il suffisait que les aristocraties locales reconnaissent son pouvoir en apportant régulièrement le tribut pour que le roi estime qu’il régnait sur elles, même s’il n’avait pas une idée précise de l’étendue du territoire ainsi constitué. En réalité, cela n’avait guère d’importance car on régnait sur des hommes et non sur un territoire donné. La frontière était essentiellement un principe de distinction de peuples et subsidiairement seulement, une modalité de découpage de l’espace, cette dernière acception étant d’ailleurs la conséquence de la première.
Pour le cas Kongo, on a raison d’établir une distinction entre un noyau central étroitement administré par le pouvoir de Mbanza Kongo et une zone périphérique sur laquelle le pouvoir royal agissait avec beaucoup moins d’efficacité. Le noyau central était constitué des six provinces du royaume : Mbamba. Soyo, Mpangu, Mbata, Nsundi et Mpemba. Quant à l’environnement politique du royaume, il était composé des seigneuries proches qui finiront toutes par se soustraire à sa dépendance : Loango, Kakongo et Ngoyo étaient des territoires dépendants. La tradition populaire illustre cette vassalité en estimant qu’ils se trouvent être une création du Kongo. Trois neveux de Mani Kongo seraient partis les créer (Batsikama, M., 1971 : 135). Dans la réalité des faits, une hiérarchie interne différenciait les trois entités : tout en dépendant du Kongo, Loango faisait également sentir sa domination sur les deux autres royaumes. On comprend qu’il ait été le premier à donner le ton pour se soustraire à la tutelle du Kongo. L’indépendance fut revendiquée et acquise à la faveur du développement de la traite qui était réellement florissante à partir du port de Loango. On constate qu’en 1539, Loango n’est pas repris dans les titres du roi du Kongo. En tout cas, au début du XVIIe siècle, son autonomie peut être considérée comme étant définitivement acquise. A cette époque, Kakongo et Ngoyo étaient également autonomes sans qu’il ne soit possible de déterminer depuis quand cette autonomie était acquise (Randles, W., 1969 : 21 ; Batsikama M., 1971 : 121-144). Quant au royaume Mbundu d’Angola, il n’était au point de départ qu’une simple excroissance du Kongo. C est avec l’avènement de Ngola Inene qu’il acquit une vigueur particulière. Alors il cessa d’être « Ndongo », de son nom archaïque, pour être appelé, du nom de son créateur, « A-Ngola » (Sujets de Ngola). Vers 1530, le royaume passait déjà pour être autonome, mais cela n’empêchait pas le Mani Kongo de s appeler toujours « seigneur des Ambundu ». Vers la fin du XVIe siècle, l’autonomie était certainement acquise de manière définitive en dépit de la préséance que le Ngola reconnaissait toujours au Mani Kongo. Ce ne sont plus des tributs qu’il lui faisait parvenir mais plutôt des cadeaux (Randles, W., 1969 : 24). Les autres petites entités connurent 1 une après l’autre un cheminement similaire à l’égard du pouvoir de Mani Kongo, ce qui indique le sens dans lequel allait évoluer la région, surtout à partir du XVIIe siècle avec le développement de la traite des esclaves (carte 5).
Trois périodes importantes marquent l’évolution politique de ce royaume, du moins si l’on excepte la partie obscure de cette évolution qui concerne les origines lointaines.
La première période qui va de 1483 à 1540 est caractérisée par une réorganisation et une adaptation du royaume aux sollicitations nouvelles : christianisme, commerce côtier, etc. La deuxième période, c’est l’apogée de l’acculturation ; elle va de la fin du règne de Ndo Funsu (1543) à la bataille d’Ambuila (1665). A l’issue de cette bataille, le royaume sera divisé. Certaines initiatives seront prises pour refaire l’unité, mais celle-ci s’avérera compromise à jamais. Commencera alors la troisième période qui débute en 1665 et dont le terme peut être fixé au XIXe siècle. Présentons brièvement la succession des faits au cours de ces différentes périodes.
De 1483 à 1543
Muzinga a Nkuwu siégeait sur le trône de Mbanza Kongo, lorsque les caravelles de Diogo Câo, sujet de sa Majesté le roi du Portugal, sillonnèrent les eaux de l’embouchure du fleuve Congo. L’occasion fut ainsi accordée au sujet du Mani Kongo de découvrir l’homme blanc. Cela se passait dans les tout premiers jours du mois d’août 1483 (Bontinck, F., 1973 : 3-31). Ce fut la date de la découverte officielle garantie par l’installation d’un padrâo, monument de pierre qui sanctionnait toute « découverte » géographique des Portugais depuis que Henri le Navigateur avait lancé ce peuple dans la voie des expéditions maritimes. Il n’est pas impossible que le contact officiel ait été précédé de quelques autres contacts qui furent gardés secrets tant que le padraô n’était pas planté (Bontinck, F., 1976 : 347-365).
En tout cas, l’événement faisait date car, grâce à cette rencontre, le Kongo et partant, toute l’Afrique Centrale, ne pouvait plus être ignoré. C’est à un destin nouveau qu’il était désormais appelé. L’illustre explorateur baptisa le fleuve dont il venait d’atteindre l’embouchure du nom de « Rio de Padrâo ». Mais ce fleuve qu’on qualifia également par la suite de « Rio Poderoso » (fleuve puissant) était tout simplement appelé « Nzadi » par les gens du pays. On usait également du terme de « Mwanza », vocable qui semble être le nom spécifique du fleuve.
Il aurait été utile de recueillir les réactions des autochtones suite à ce premier contact. Mais une telle démarche n’aurait pu aboutir qu’à une vision partielle des choses, étant donné qu’on ne peut disposer pour ce faire des documents d’origine locale. Quoi qu’il en soit, il paraît évident que la vue de l’homme blanc, bien que ce fût une première fois, ne provoqua pas de choc véritable. Au contraire, le premier contact fut plutôt serein. On supposait volontiers avoir affaire à des « mindele » c’est-à-dire des « revenants ». Il n’était certes pas courant d’en rencontrer mais si cela se produisait un jour, pensait-on, ils devaient nécessairement se présenter sous cet aspect car l’ancêtre, suivant la cosmogonie des peuples de la côte, habitait au fond de l’océan et s’il lui arrivait de prendre la forme d’un revenant, il devait nécessairement être blanc. Curieusement, Diogo Câo et ses hommes correspondaient à cette vision des choses. C’est cette méprise étrange qui justifie l’accueil extrêmement serein qui leur fut réservé. La vue des bateaux (les pirogues des ancêtres) impressionnait en même temps qu’elle confirmait le statut extrahumain des nouveaux venus. C’est cette atmosphère d’euphorie, de curiosité et en même temps d’assurance qui amenait certains à monter à bord pour visiter les bateaux, C’est ainsi que pour ramener quelques otages de l’actuel Benguela à Lisbonne afin d’illustrer sa découverte, l’explorateur n’eut qu’à lever l’ancre. Les populations d’Afrique Centrale, composées de quelques nobles de Soyo, se retrouvèrent de la sorte au Portugal en cette fin du XVe siècle. A leur retour au Kongo, en 1485, au cours d’une nouvelle expédition de Diogo Câo, ils ne purent s’empêcher de décrire les « merveilles » qu’ils avaient vues en Europe. Le roi, ému, souhaita voir ces mêmes merveilles se réaliser dans son royaume. Il réclama menuisiers et maçons pour construire des bâtisses aussi impressionnantes que les châteaux de la Renaissance qui lui avaient été décrits. Il demanda également de communier à ce rituel qui donnait une telle puissance au Blanc. C’est ainsi qu’il dut comprendre le sens profond du baptême. Conformément à ses souhaits, une grande expédition civilisatrice composée d’ouvriers et de missionnaires franciscains aboutit le 29 mars 1491 à Mpinda, principal port du royaume. Mais le Mani Soyo qui les reçut exigea d’abord que le baptême lui soit conféré. Il fut baptisé avant le Mani Kongo, le 3 avril, jour de Pâques ; il prit alors le prénom de Manuel qui était celui de Don Manuel, cousin de Joâo II et son successeur ! Le roi lui-même ne le fut que le 3 mai. Il se prénomma Ndo Nzao (Dom Joâo) comme son homologue portugais dont il estimait être le frère. De la même façon, pour des besoins d’homonymie, sa femme Muzinga a Nlenza, baptisée le 5 juin, devint Ndona Leonor, à l’instar de la reine portugaise ; le fils aîné Mubemba a Muzinga devint Ndo Funsu, prénom de l’héritier de la couronne portugaise, déjà décédé à cette date-là sans qu’on l’ait su au Kongo.
Par ailleurs quelques enfants de la famille royale et de la noblesse furent envoyés pour des raisons d’études au Portugal. Ce fut là la première expérience d’envoi d’étudiants « boursiers » en Europe. Mais dans la suite, Muzinga a Nkuwu dut se rendre à l’évidence. Tout cela avait été trop vite. Une bonne part de la noblesse n’était pas enthousiaste pour ce qui passait pour être des excentricités du roi. Lui- même avait de la peine à soutenir le statut monogamique qu’on lui imposait ; la polygynie, proscrite par le catholicisme, était pourtant un symbole de prestige et une nécessité économique dont il ne pouvait se passer. C’est ainsi qu’il finit par renoncer au baptême pour retourner au paganisme. Il fut suivi dans ce mouvement par son second fils Mpanzu. Mais la reine et le premier fils préférèrent demeurer fidèles au christianisme. Cette divergence était vraisemblablement le reflet d’une division plus fondamentale qui rongeait la famille royale. C’est que le roi et sa femme avaient des vues complètement divergentes en matière de succession : le roi avait une préférence pour Mpanzu tandis que la reine soutenait volontiers celle de Ndo Funsu, lequel en tant que Mani Nsundi était le successeur présomptif. L’incident éclata à la mort de Muzinga a Nkuwu en 1504. L’interrègne s’annonçait très chaotique ; afin d’anéantir une fois pour toutes les prétentions au pouvoir de Mpanzu a Muzinga, le frère aîné, Mubemba a Muzinga se présenta aux portes de la capitale avec une armée de partisans. Il eut tôt fait de détrôner son frère devenu successeur de fait et s’empara du pouvoir. Dans le récit qu’il fit lui-même de cette bataille, Ndo Funsu attribua volontiers la victoire de son camp à une intervention de saint Jacques escorté d’une troupe d’anges (Jadin, L. et Dicorato, M., 1974 : 59). Il faut supposer qu’il s’agissait tout simplement d’une intervention portugaise discrète dans la bataille.
Ndo Funsu vint donc au pouvoir. Dès son avènement, la première action menée fut de briser les résistances intérieures contre la nouvelle politique (Cuvelier, J., 1946 : 120). Les grands dignitaires furent invités à se dépouiller de leurs fétiches et amulettes. Ces objets, une fois accumulés, furent brûlés ainsi que les cases à fétiches. C’était la première fois, en Afrique Centrale, qu’on assistait à une destruction en bonne et due forme de pièces de sculpture au nom de la christianisation et de la civilisation. Il est évident que l’objectif visé était bien plus la modernisation du royaume, de ses institutions et du mode de vie de ses habitants que le désir effréné et gratuit de les placer sous la protection du christianisme et de la culture occidentale. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le souci de Ndo Funsu d’ouvrir largement les frontières de son royaume à l’influence du dehors. Il réclama des prêtres, des instituteurs, des maçons, des charpentiers, etc. Un plus grand nombre d’enfants furent envoyés au Portugal pour y étudier, en même temps qu’on procédait à l’ouverture d’écoles sur place. Lui-même montra l’exemple en s’imposant un programme d’instruction. Dans un premier temps, cette politique eut du succès. La cour de Lisbonne envoya volontiers missionnaires et techniciens.
Mais ce beau programme d’acculturation portait en lui les germes de sa propre destruction. Il ne pouvait que s’enliser dans toutes sortes de difficultés, ce beau projet de coopération qu’on croyait définitivement instauré entre Ndo Funsu et son homologue portugais, le roi Don Manuel, homme intelligent et avisé qui venait de succéder à Joâo II, celui-là même qui avait amorcé des contacts avec Muzinga a Nkuwu. En réalité, la couronne portugaise était prisonnière de son propre jeu. Depuis le premier voyage de Diogo Câo, beaucoup de choses avaient changé et l’on ne pouvait plus se permettre de mener une simple politique de charme avec le Kongo. Il y avait entre autres le fait de la découverte du continent d’Amérique.
En effet, une dizaine d’années après que Diogo Câo eut atteint les rivages du fleuve Congo, plus précisément en 1492, le Nouveau Monde apparut aux yeux du Blanc comme étant plus intéressant que l’Afrique. L’on y faisait des plantations de canne à sucre et l’on y extrayait de l’or : tous ces travaux entrepris allaient exiger la présence d’une main-d’œuvre robuste qui ne pouvait être recrutée qu’en Afrique. D. Manuel du Portugal, préoccupé désormais par l’exploitation du Brésil, ne pouvait accorder au Kongo qu’une attention de moins en moins soutenue, sauf en matière de traite d’esclaves, celle-ci conditionnant l’exploitation systématique de l’Amérique. Le Mani Kongo était loin d’imaginer qu on le leurrait.
Pourtant ce revirement de la situation se traduisait, sur le terrain, par certaines attitudes suffisamment révélatrices de la part des coopérants. Nombre d’entre eux, laïcs comme missionnaires, estimaient ne pas avoir d’instructions à recevoir de ce nègre de roi. On n’hésitait donc pas à se passer de ses instructions et même à le tromper pour le rendre ridicule. D’aucuns venaient chez lui et prétendaient être parents du roi du Portugal afin de recevoir des faveurs et des présents. Parmi ceux- ci, il y avait même des aventuriers et des marchands d’esclaves (Cuvelier J., 1946 : 126-127). Une conduite si peu courtoise humiliait le roi et le discréditait auprès de son peuple. Mais il y avait plus grave encore que cette simple question du respect de la personnalité royale et de son autorité. C’est que la présence des coopérants ne se traduisait pas par une rentabilité quelconque ou plus exactement la rentabilité significative à leurs yeux s’avérait totalement différente de ce qui avait été escompté.
Les techniciens qui n’étaient rien d’autre que des ouvriers, refusaient de travailler aux côtés des Noirs, à leurs yeux des inférieurs, qui se prétendaient nobles. Aussi estimaient-ils qu’ils étaient, au moins d’une classe correspondante à celle des nobles locaux et, par conséquent, ils refusaient de transporter des planches, soulever des briques et placer des tuiles. Ils préféraient consacrer leur temps à une autre activité, les négociations en vue de l’achat et de la vente des esclaves. Cet autre travail était à leurs yeux plus intéressant à tous points de vue.
Tout cela était loin d’arranger Ndo Funsu. N’ayant aucune autorité sur ces étrangers, il finit par faire entendre ses plaintes à la cour portugaise. Il demanda l’envoi d’un ambassadeur qui devait demeurer sur place pour discipliner ses compatriotes au nom de son roi. Simâo da Silua fut chargé de cette mission. Il s’embarqua pour le Kongo avec, dans ses bagages, un recueil d’instructions connu sous le terme de Regimento. Ce texte a pu être conservé et nous est parvenu. En le parcourant, on saisit d’emblée que les instructions émanant de la couronne portugaise débordaient très largement les problèmes qui lui avaient été soumis par Ndo Funsu. On prenait cette demande d’ambassadeur comme prétexte pour mettre à exécution un plan d’acculturation du royaume et de prospection systématique de son territoire.
Mais cette mission était vouée à l’échec, comme le note J. Vansina, à cause de 1 inapplicabilité de ce genre de plan conçu en dehors des réalités concrètes du royaume (Vansina, J., 1965 : 40). Elle échoua effectivement avant même d’avoir commencé, à cause de 1 intervention des Portugais de S. Tome : ces dissidents, chassés de la métropole et regroupés sur cette île pour s’adonner à la traite négrière, n’avaient aucun compte à rendre au Portugal (Randles, W., 1969 : 130-131). S. da Silva trouva la mort avant même d’arriver à Mbanza Kongo. Entre-temps, les exactions et les excès dénoncés par Ndo Funsu ne faisaient que se poursuivre de plus belle. Dans une lettre à son « frère » du Portugal, il ne put s’empêcher de le regretter en des termes fort émouvants : « Il y a de nombreux trafiquants dans tous les coins du pays. Ils y apportent la ruine. Il ne se passe pas de jour que des gens ne soient enlevés pour être mis en esclavage ; ni les nobles ni les membres de la famille royale ne sont épargnés » [8]. Le phénomène était devenu réellement inquiétant. La chasse à l’homme était en quelque sorte décrétée. Mais pour résoudre le problème, le Portugal opta pour une fuite en avant. Plutôt que de réduire l’activité négrière, on choisit de déstabiliser Ndo Funsu, trop idéaliste pour entrer finalement dans le jeu. Le négrier et les pombeiros se mirent à traiter davantage avec les chefs locaux plutôt qu’avec le roi. On attenta même à sa personne, en pleine église, au cours d’une messe de Pâques [9]. Ce roi, qui avait suscité lors de sa prise de pouvoir un vent d’enthousiasme parmi les Blancs, s’éteignit un jour dans l’ombre, en 1543 selon toute vraisemblance (Randles, W., 1969 : 104). Le rêve d’une collaboration sur un pied d’égalité avait échoué. Le projet de société que Ndo Funsu avait tenté de défendre ne se réaliserait jamais. Pourtant son action eut un impact extraordinaire qui se ressentira au sein du royaume pendant un siècle au moins. L’influence de son règne est attestée par une tradition suivant laquelle ne pouvait prétendre au trône que celui qui pouvait être descendant de Ndo Funsu.
On devra faire justice à ce roi. Les historiens modernes ont eu tendance à le présenter tantôt comme un apôtre inconditionnel du christianisme, tantôt comme un naïf à la solde des Portugais. La réalité est que ce « nationaliste », qui aura cherché de bonne foi à moderniser son royaume, aura en définitive hâté sa ruine en ouvrant largement ses portes à l’influence étrangère.
De 1543 à 1665
L’après Ndo Funsu est une période bien laborieuse, caractérisée par une longue crise qui s’est étalée sur plus d’un siècle. En effet, de la mort de Ndo Funsu (1543) jusqu’à la bataille d’Ambuila (1665), des problèmes inextricables sont apparus. L’anarchie et les tensions internes aboutissaient bien souvent à des interventions plus ou moins marquées des étrangers dans la gestion du royaume, ce qui provoqua des changements politiques fréquents. Il faut savoir en effet qu’on dénombre pas moins de dix-sept règnes dont l’histoire est, à peu de choses près, une succession ininterrompue de situations anarchiques. En voici quelques éléments, choisis parmi les plus saillants.
Rappelons d’abord que la mort de Ndo Funsu fut suivie d’une période sombre due au vide causé par la perte d’un si grand roi et à la situation anarchique qui caractérise toute succession. On finit par connaître une relative stabilité avec le règne de Ndo Dioko (Diogo 1er) Muzinga a Mpanzu en 1544. Ce règne connut l’arrivée des Jésuites au sein du royaume ; ces missionnaires jugèrent bon de discipliner le christianisme du Kongo, qui était alors fort ambigu. Le roi lui-même n’était pas épargné par leurs reproches à cause de sa vie licencieuse. Aussi décida-t-il de les expulser car il préférait s’entendre avec le clergé régulier, plus accommodant à l’égard des mœurs du pays. Mais il ne tarda pas à mourir, en 1561. Il fut remplacé par une série de rois qui finirent tous assassinés. Le dernier de la série, Ndo Ndiki (Henrique) Mpanzu a Muzinga mourut dans la guerre entre les Jaga en 1568 sans laisser d’héritier. C’est alors que le pouvoir passa entre les mains du fils d’une de ses femmes : Ndo Luvualu (Alvaro 1er) Mpanzu a Muzinga. Comme son prédécesseur, il passe pour être un roi tristement célèbre. Son règne aura été marqué par lépisode le plus sanglant de toute l’histoire du royaume. Celui-ci allait du coup susciter l’ingérence militaire portugaise la plus spectaculaire. De quoi s’agit-il ? Depuis 1561. le Kongo subissait une série d’attaques de la part de ses adversaires locaux particulièrement les Jaga en 1568. De la Province de Mbata où ils firent irruption, ceux-ci se dirigèrent vers la capitale, saccageant tout sur leur passage. Ils eurent tôt fait de mettre en déroute les armées royales ; lors de la prise de la capitale, le roi s’enfuit et se réfugia sur une île sur le fleuve.
Tableau 1 — Souverains du Kongo (jusqu’à la fin du XVIIe siècle)
|
D’APRÈS W. RANDLES (1968) |
D’APRÈS BATSIKAMA (1971) |
|||
|
01. |
D. Joâo I. Nzinga a Nkuwu |
(+ 1506) |
Muzinga a Nkuwu Ndo Nzao |
(+ 1506) |
|
02. |
D. Afonso I. |
(1506-43) |
Mpanzu a Muzinga |
(1506-1507) |
|
03. |
D. Pedro I. |
(1543-44) |
Mubemba a Muzinga Ndo Funsu |
(1507-1542) |
|
04. |
D. Francisco I. |
(1544) |
Muzinga a Mubemba Ndo Petelo |
(1542-43) |
|
05. |
D. Diogo l“ |
(1545-61) |
Mpanzu a Muzinga Ndo Fula |
(1543-44) |
|
06. |
D Bemardo I. |
(1561-67) |
Muzinga a Mpanzu Ndo Dyoko |
(1544-61) |
|
07. |
D. Henrique |
(1567-68) |
Muzinga a Mpanzu Ndo Funsu |
(1561) |
|
08. |
D. Alvaro I. |
(1568-87) |
Muzinga a Mpanzu Ndo Mbeledanu |
(1561-67) |
|
09. |
D. ALvaro II |
(1587-1614) |
Mpanzu a Muzinga Ndo Diki |
(1567-68) |
|
10. |
D. Bemardo II |
(1614-15) |
Mpanzu a Muzinga Ndo Luvwalu |
(1568-78) |
|
11. |
D. Alvaro III |
(1615-22) |
Muzinga a Mpanzu Ndo Luvwalu |
(1578-1614) |
|
12. |
D. Pedro II |
(1622-24) |
Muzinga a Mpanzu Ndo Mbele |
(1614-15) |
|
13. |
D. Garcia I |
(1624-26) |
Muzinga a Mpanzu Ndo Luvwalu |
(1615-22) |
|
14. |
D.Ambrosio I. |
(1626-31) |
Mubemba a Muzinga Ndo Petelo |
(1622-24) |
|
15. |
D. Alvaro IV. |
(1632-36) |
Mubemba a Muzinga Ndo Ngalasia |
(1624-26) |
|
16. |
D. Alvaro V. |
(1636) |
Mubemba a Muzinga Ndo Bolozi |
(1626-31) |
|
17, |
D. Alvaro VI. |
(1636-41) |
Mubemba a Muzinga Ndo Luvwalu |
(1631-36) |
|
18. |
D. Garcia II. |
(1641-61) |
Mubemba a Muzinga Ndo Luvwalu |
(1636-38) |
|
19. |
D. Antonio I. |
(1661-65) |
Mpanzu a Muzinga Ndo Luvwalu |
(1641-63) |
|
20. |
D. Alvaro VII. |
(1665-66) |
Muzinga a Muzinga Ndo Ngalasia |
(1641-63) |
|
21. |
D. Alvaro VIII. |
(1666-69) |
Mubemba a Muzinga Ndo Ntoni |
(1663-65) |
|
22. |
D. Raphaël I. |
(1669) |
Mpanzu a Muzinga Ndo Luvwalu |
(1666-69) |
|
23. |
D. Alvaro IX. |
(1669-72) |
Mpanzu a Muzinga Ndo Luvwalu |
(1669) |
|
24. |
D. Raphaël I. (Revenu) |
(1678-74) |
Mpanzu a Mubemba Ndo Lufwayi |
(1669-78) |
|
25. |
D. Daniel I. |
(1674-78) |
Mpanzu a Mubemba Ndo Nanyele |
(1678-1680) |
N.B. : Randles a établi sa liste sur base de la documentation écrite existante, tandis que Batsikama fait intervenir également les éléments de la tradition orale en même temps qu’il a transcrit les prénoms des rois en langue Kongo. Quant aux noms, ils ont été transformés suivant les indications tirées des travaux de F. Bontinck.
Le royaume fut anéanti et la misère s’installa dans tous les coins du pays. Même le roi et sa cour ne purent y échapper car la famine s’abattit sur l’île, suivie de la peste et de toutes sortes de maladies. Le roi lui-même fut atteint. C’est alors qu’il pensa se tourner vers le Portugal, d’ailleurs sur conseils de ses techniciens européens. Le roi Sébastien accepta de dépêcher sur les lieux un corps expéditionnaire de 600 hommes avec mission de délivrer le Kongo de ses assaillants. Arrivée au Kongo en mars 1571, cette mission, dirigée par F. Gouvea, réussit à repousser les envahisseurs. Après avoir délivré le royaume, F. Gouvea rétablit le roi sur son trône.
Quelle est au juste l’identité de ces Jaga qui firent trembler tout un peuple et parvinrent à démonter le royaume le plus évolué de l’époque ? Question importante et délicate sur laquelle les opinions demeurent divergentes. Mais de plus en plus on s’accorde à dire que c’était un groupe d’origine ethnique diversifiée, comportant en tout cas des Kongo, des Lunda-Cokwe et des Yaka [10]. Sans doute ce dernier groupe était-il dominant, ce qui justifie le vocable « jaga » qui n’est certainement pas étranger à celui de « yaka » (Miller, J.C., 1973 : 121-149).
Immédiatement après sa délivrance, Ndo Luvwalu 1er offrit au Portugal, en guise de reconnaissance, la souveraineté sur une partie de son royaume. Mais le Portugal déclina cette offre heureusement pour lui car quelque temps après Ndo Luvwalu changea d’avis. La présence massive des Portugais au sein du royaume commençait à lui inspirer de la crainte. C’est entre autres pour cette raison qu’il décida d’envoyer son ami, Duarte Lopez, à Rome. Il avait pour mission, en plus de la demande coutumière de personnel religieux, de solliciter une protection spéciale du Souverain Pontife. La mission échoua. Le seul résultat positif fut la rencontre de Duarte Lopez avec l’humaniste italien Filipo Pigafetta. Le récit du premier inspira la composition d’un livre qui est de la plume du second (Pigafetta. F., 1591).
Ndo Luvwalu 1er meurt en 1578 ; son successeur, Ndo Luvwalu II Muzinga a Mpanzu eut également à faire face aux ambitions expansionnistes des Portugais d’Angola. Comme son prédécesseur, il pensa se tourner vers le Vatican, implorant sa protection. Mais les Portugais réagirent en s’opposant à l’envoi de missionnaires non portugais au Kongo. Cette réaction peut s’expliquer par le fait qu’à l’époque, le Portugal réalisait qu’il commençait déjà à perdre du terrain face à la concurrence d’autres nations, notamment la Hollande. Plus que jamais, il était sensible aux infiltrations étrangères. Quant à Ndo Luvwalu II, il essaya de rester indifférent aux pressions portugaises qui lui demandaient, entre autres choses, de chasser du royaume les Hollandais considérés comme hérétiques, parce que non-catholiques.
Bien que courageux, Ndo Luvwalu, en mourant en 1614, n’aura finalement pas réussi à renforcer l’autonomie du royaume. Il n’en fut pas autrement après lui, d’autant que surgirent de nouvelles luttes pour la succession. Avec l’avènement de Ndo Mpetelo Mubemba a Muzinga en 1622, il y eut un nouvel incident spectaculaire avec les Portugais. Le gouverneur de l’Angola attaqua un chef Kongo sous prétexte qu’il donnait asile aux fugitifs de l’Angola. Le Mani Mbamba intervint, la bataille fut rude. Elle tourna au désavantage du responsable militaire du Kongo, le Mani Mbamba. Cet incident ne resta pas sans conséquences. Les Kongolais se vengèrent sur les Portugais installés dans le royaume. La réaction de la métropole fut heureusement modérée. Elle se contenta de s’en prendre au gouverneur de l’Angola considéré comme le principal instigateur de l’incident. Entre-temps les rênes du Kongo continuèrent à passer dans les mains de plusieurs obscurs successeurs. En 1631, on assista à un changement de dynastie avec l’arrivée au pouvoir de Ndo Luvwalu IV Mubemba Muzinga du clan Kimulaza. Pour légaliser ce pouvoir quelque peu usurpé, il demanda au pape de lui envoyer une couronne qui désormais deviendrait l’emblème du pouvoir au Kongo comme dans les autres nations chrétiennes. Mais il mourut sans avoir eu le temps d’obtenir satisfaction. Ses successeurs immédiats. Ndo Luvwalu V et Ndo Luvwalu VI, ne connurent pas de règnes plus longs.
Il faudra attendre Ndo Ngalasia II Mubemba a Muzinga pour connaître à nouveau, à partir de 1641, un règne qui s’affirme nettement. Ce personnage est en effet considéré comme le plus grand roi du Kongo, après Ndo Funsu. De plus, il a laissé de lui l’image d’un homme astucieux. Au beau milieu de la crise, il parvint à se maintenir au pouvoir pendant une vingtaine d’années. Il est vrai que l’essentiel de sa politique, de laquelle il tirera un maximum de profit, consistera à opposer les Européens entre eux, les Hollandais et les Portugais, les Capucins et les autres congrégations religieuses. Mais ce règne connut une sérieuse opposition de la part de la province de Soyo. La guerre éclata même entre le Mani Kongo et le Mani Soyo, guerre qui se termina à l’avantage de ce dernier. C’est alors que les Capucins s’employèrent à réconcilier ces deux aristocraties, ce qui leur valut d’être appréciés par le roi. Deux d’entre eux, notamment Jean-François de Rome, furent envoyés à Rome pour que le pape rende la monarchie au Kongo héréditaire et envisage l’excommunication de ceux qui ne se soumettraient pas à ce principe. Le pape se déroba à cette demande mais se contenta d’envoyer la couronne tant convoitée par les rois précédents.
D’abord proche des Hollandais installés à Luanda, Ndo Ngalasia II devint à partir de 1649 l’ami des Portugais. Mais cette amitié s’estompa lorsqu’un nouveau conflit éclata à propos de l’emplacement des mines [11]. Le roi fut contraint soit de révéler l’emplacement des mines soit de céder les terres situées vers le sud du royaume. Comme il n’avait pas de mines dont l’emplacement pouvait être révélé, il perdit des terres au sud, notamment l’île de Loanda d’où provenait la monnaie du royaume.
A sa mort en 1661, Ndo Ngalasia II fut remplacé par son fils Ndo Ntoni Ier (Antonio Ier) Mvita Nkanga (Tsimba, M., 1979 : 312-313), dénommé également Mubemba a Muzinga (Batsikama, M., 1971 : 237). Comme son prédécesseur, il se montra hostile aux étrangers. Il refusa lui aussi au gouverneur de l’Angola le droit de prospecter les terres du royaume pour y chercher des mines. Mais cela allait lui coûter cher. Suite à ce refus, le gouverneur encouragea le Mani Wandu, chef d’une bourgade du Sud, à se rebeller contre le pouvoir central. Sans trop réfléchir, Ntoni Ier’ organisa une expédition punitive contre le chef rebelle ignorant que celui-ci pouvait bénéficier du secours de Luanda. C’est ce qui arriva. L’affrontement eut lieu près d’Ambuila, le 29 octobre 1665. Les troupes de Mani Mbamba furent décimées. Le roi lui-même fut tué ; de même qu’une grande partie de la noblesse. Cette bataille marquait vraiment la fin d’une époque. Les derniers règnes s’étaient distingués par une hostilité marquée à l’égard des Portugais et par un effort d’instaurer une royauté héréditaire. En vain.
De 1665 à 1800
Après Ambuila, plusieurs clans candidats à la royauté s’affrontèrent. Le compromis n’était plus possible. C’était la troisième période de l’évolution du royaume, caractérisée par la division et des tentatives d’unification.
La balkanisation du royaume fut dès lors consacrée. Devant T impossibilité d’aboutir à un consensus général, il y aurait désormais trois rois rivaux régnant en même temps à Bula, au Mont Kimbangu et à Sâo Salvador, tandis que Soyo s’estimait toujours indépendant. Cette coexistence de plusieurs pouvoirs engendra un état de guerre permanent qui affaiblissait fortement le principe même de la royauté. Certains prétendants se faisaient proclamer roi sans les cérémonies et les insignes caractéristiques. La crise était à son comble. Il fallait faire quelque chose. L’appel à une certaine restauration du royaume était indispensable. On assista précisément à deux tentatives de restauration de l’unité perdue, l’une d’ordre politique et l’autre d’ordre messianique.
Evoquons d’abord les essais d’unification opérés dans le domaine strictement politique. Après une série d’affrontements, il y eut par exemple le règne de Ndo Mpetelo III. (Don Pedro) Nsimba du clan Kimbangu qui, proclamé roi, fut tué par le Mani Soyo. Il fut remplacé par son frère Ndo Nzao II (Joâo) Nzuzi. Ce dernier tenta, durant son règne, de reconstruire l’unité du royaume (1683-1717). D s’attaqua d’abord à l’autonomie de Soyo et parvint même à lui arracher une partie de son territoire. Par la suite, un missionnaire capucin (G. Merolla da Sorrento) engagea des pourparlers avec les chefs locaux pour qu’ils reconnaissent Ndo Nzao II Nzuzi comme seul et unique roi. Cette tentative échoua parce qu’elle coïncida avec le départ précipité du capucin. Après celui-ci, Luca da Caltanisetta tenta de reprendre les négociations, à pure perte.
A la même époque, une autre tentative de refaire l’unité du royaume s’organisa autour d’un autre candidat, Ndo Mpetelo IV. Il avait l’avantage d’appartenir à deux clans royaux : Kimpanzu et Kimulaza. Désireux de se faire connaître comme seul roi légitime, il devança Ndo Nzao II Nzuzi à Sâo Salvador où il fut consacré roi par le Mani Vunda. Il bénéficia également de l’appui d’autres missionnaires, notamment de Francisco da Pavia. Ce dernier alla même jusqu’à solliciter l’intervention du pape en essayant de le convaincre de la nécessité de rétablir la stabilité politique du royaume. Le pape préféra ne pas intervenir.
Une fois de plus, la réunification du royaume par des moyens politiques était compromise.
Quant aux tentatives d’ordre messianique, elles consistaient à faire appel à des recettes d’ordre religieux pour résoudre le problème politique donné. Cette méthode mettait en lumière la soif du peuple Kongo de retrouver la paix loin du contexte d’affrontement et de guerre civile. Le recours à la religion était aussi significatif de l’impuissance de la politique face au problème posé.
Bernardo da Gallo nous rapporte les signes de « déviations religieuses » significatifs au niveau politique. Chaque fois, rapporte-t-il, après les exercices de piété, le peuple prenait l’habitude de réciter trois Ave Maria. Cette pratique, disait-on. avait été ordonnée par la Sainte Vierge Marie au cours d’une apparition quelle avait faite à une femme afin que l’unité du royaume soit restaurée.
En 1704, la prophétie d’une vieille femme Appolonia Mafuta annonça que la Sainte Vierge lui était apparue et lui avait fait part de l’indignation de son fils contre ce peuple qui refusait de se mettre en marche vers Sâo Salvador. Destruction et incendie étaient des châtiments annoncés si le peuple n’acceptait pas de s’exécuter. Mafuta exhibait, en guise de la révélation, une pierre représentant la tête du Christ déformée par la méchanceté des hommes et par les coups de houes des femmes qui se permettaient d’aller aux champs le dimanche. Ces prédictions eurent un certain succès car Mafuta fit des adeptes. Elle brûlait des fétiches et opérait des miracles.
Le cas le plus important fut celui de Ndona Béatrice Kimpa Vita Nsimba. Elle avait 20 ans quand elle commença son action. Dans son jeune âge, il semble qu’elle ait eu le pouvoir de guérir. En 1704, elle fut à l’agonie. Selon ses propres dires, elle mourut et ressuscita. C’est au cours de cette agonie qu’elle aurait été inspirée par saint Antoine de Padoue. Il lui confia pour mission d’amener le peuple Kongo à retrouver l’unité.
Ndona Béatrice alla d’abord chez Ndo Mpetelo IV qui lui offrit l’hospitalité. Mais le nombre de ses adeptes allait croissant au point que les Portugais et les missionnaires demandèrent à Ndo Mpetelo IV l’élimination de la prophétesse. Le roi hésita, ce qui donna à Ndona Béatrice le temps de fuir. Elle se rendit alors à Bula, l’autre capitale.
Mais pendant tout ce temps, l’action de la prophétesse acquit des bases solides. Ses émissaires sillonnaient l’ensemble du royaume et son succès était réel dans toutes les régions. Certains de ses adeptes racontèrent qu’ils avaient rencontré quelques saintes, telles : Anne, Lucie, Isabelle…
Mais l’action de Ndona Béatrice s’accompagnait d’une légère contradiction. Pendant qu’elle prêchait en tant que prophétesse, elle était accompagnée d’un Portugais, surnommé « saint Jean », qui était en quelque sorte son mari. D’après les témoignages de l’époque, il semble que, faute de parvenir à avorter après une conception, elle se réfugia dans les bois en disant à ses adeptes qu’elle allait prier pour défendre leur cause auprès de Dieu. Dans les bois, elle mit au monde un fils et fut surprise par les Portugais pendant qu’elle allaitait l’enfant. Elle reconnut qu’il lui appartenait tandis que son amant en niait la paternité. C’est ainsi qu’ils furent tous deux arrêtés et menés à Ndo Mpetelo IV.
Une fois de plus le roi se montra hésitant. Ce fut peut-être dans l’espoir de voir les adeptes de la prophétesse la libérer au cours du voyage à Loanda que le roi décida son transfert dans cette ville où elle devait finalement être jugée. La sentence de mort fut prononcée et la prophétesse ainsi que son mari furent brûlés le 2 juillet 1706.
L’enseignement religieux de Béatrice ne disparut pas pour autant. Elle laissa de nombreux adeptes. Certains d’entre eux affirmèrent l’avoir revue plusieurs fois. On peut toutefois estimer que ce projet de restauration politique par des tentatives d’ordre messianique échoua également. Le phénomène d’émiettement politique semblait donc irréversible ; l’unité qui avait été consacrée par l’action politique de Lukeni touchait à sa fin.
3 LES INSTITUTIONS SOCIO-POLITIQUES
La population du royaume Kongo semble avoir connu une organisation matrilinéaire classique. Mais les chroniqueurs et les témoins anciens en font très peu de cas : le phénomène semble les avoir quelque peu décontenancés. Ils ne se sentaient réellement intéressés que par le système politique puisqu’ils ne pouvaient agir que par le truchement du chef. Les quelques éléments fournis par ces chroniqueurs sur la vie sociale permettent de se rendre compte qu’il s’agissait de l’organisation matrilinéaire courante. On retrouve la structure par clan, la pratique de la polygynie, l’existence du mariage préférentiel, la succession d’oncle à neveu, etc.
L’élément social le plus explicite en raison de sa connotation politique serait la stratification sociale. Il existait, indépendamment des Portugais, un clivage social entre le roi, les nobles, les hommes libres et éventuellement les esclaves. Rien ne prouve de façon explicite l’existence de l’esclavage dans le royaume. Mais on suppose que le phénomène existait parce qu’il est attesté dans des régions voisines. Quant aux hommes libres, ils représentaient le plus grand groupe et étaient d’origine Mbundu, sinon d’origine pygmoïde. Ils constituaient également la population des provinces et subissaient l’autorité des conquérants.
La noblesse était constituée de deux catégories de personnes : ceux qui tiraient leur noblesse de l’histoire même du royaume et ceux qui étaient anoblis contre payement ou autres prestations. Au-dessus de tous, il y avait le roi, démarqué de la noblesse par la fonction qu’il exerçait et par les privilèges qui étaient attachés à sa fonction. Mais ce clivage n’était pas toujours très marqué et s’estompera peu à peu. La qualité supranaturelle associée au roi sera progressivement démystifiée à cause des querelles de succession et des interventions maladroites des Portugais dans ce domaine.
La gestion du royaume revenait au roi et aux nobles. Le roi était en principe le maître incontesté du royaume ; il représentait la force et la vitalité. De ce fait, il rendait la justice en dernière instance, nommait et destituait les fonctionnaires. Un code reprenant une série de principes de gestion du royaume existait, pour aider le roi dans sa tâche.
– La caste dirigeante regroupait toute la noblesse exerçant certaines fonctions particulières au sein du royaume ; il s’agissait d’un regroupement et non d’une assemblée opérationnelle.
– Le conseil d’Etat était une assemblée plus constitutionnelle que représentative. Il était composé de 10 à 12 membres et avait de l’influence, tant lors de l’élection d’un roi que sur les décisions politiques que celui-ci pouvait prendre.
– Le corps administratif était le corps des fonctionnaires qui comprenait trois catégories :
1° Les gouverneurs de provinces et chefs de villages ;
2° Les fonctionnaires de la cour et
3° Les prêtres chargés du culte.
– La garde royale était l’instance chargée de l’exécution des décisions royales.
Elle était composée de serviteurs du roi, souvent d’origine esclave.
Dans la gestion quotidienne, la contestation était inévitable entre les différentes instances, particulièrement entre le roi et la caste dirigeante ou le Conseil d’Etat, ou encore entre la caste dirigeante et le peuple. Quand le roi en place n’avait pas d’envergure, il était bien souvent l’objet de manipulations des conseils. Si, par contre, le roi était fort, l’inverse se produisait. Il arrivait toutefois que le roi se passât de conseils et dans ce cas, il trouvait appui auprès du peuple.
En 1632, période où l’autorité royale fut marquée, le roi Ndo Luvwalu IV créa un entourage composé d’esclaves. Mais à la fin du XVIIIe siècle, à l’époque où la grandeur du roi n’était plus qu’un souvenir, la situation se renversa. C’est dans ce rapport dialectique entre le roi et le conseil que se réalisait la gestion politique du royaume.
Trois fonctions particulières marquaient la classe des nobles, à savoir l’élection du roi, la gestion des provinces et l’exercice de la justice.
3.1 L’élection
Il faut d’abord se rappeler que la monarchie au Kongo était élective. Ce principe visait à dégager du groupe des candidats éventuels une personnalité susceptible d’exercer le pouvoir de manière effective.
On distinguait trois principaux électeurs : le Mani Soyo, le Mani Mbata, le Mani Vunda.
Les deux premiers combinaient leur fonction d’électeur avec celle de la gestion des provinces. Il s’agissait également des rares régions sur lesquelles n’intervenaient pratiquement pas de nominations royales. Le Mani Soyo était considéré comme faisant partie du clan royal. Il était l’oncle du roi. Mais cette parenté était sans doute « arrangée », histoire de justifier l’existence d’une situation politique assez particulière. Plus tard, Soyo devint indépendante à cause de son statut commercial privilégié et à la suite d’une série de guerres menées contre la capitale.
Mbata, la province la plus orientale, présentait également une situation assez particulière. En effet, l’aristocratie politique en place était d’origine autochtone (le clan Nsaku). De ce fait, le pouvoir de Mani Mbata était teinté d’une connotation religieuse. Mbata demeura longtemps autonome. Même après sa conquête, il garda toujours son statut privilégié. Il ne devint réellement province qu’au XVIe siècle, c’est-à-dire sous le règne de Ndo Funsu. L’aristocratie locale était donc liée au roi par une relation de type matrimonial.
Le Mani Vunda n’était pas un gouverneur mais un dignitaire représentant un pouvoir particulier, supérieur d’une certaine manière au pouvoir royal lui-même ; il s’agissait d’un pouvoir héréditaire. Le Mani Vunda était en effet recruté dans le clan Nsaku, clan reconnu dans toute la région comme détenant le pouvoir terrien. Suivant les traditions d’origine, les représentants du clan Nsaku avaient exercé naguère un pouvoir politique. Vaincus, ils avaient été intégrés au nouveau système politique avec charge d’introniser le roi. Il était donc indispensable que le maître de la cérémonie religieuse accepte le candidat qui devait être intronisé.
L’OUEST DE L’AFRIQUE CENTRALE VERS 1850 – Carte 5

3.1 La gestion des provinces
La gestion des provinces revenait à six dignitaires dont le statut variait selon la province dont ils avaient la gestion. Il faut d’abord tenir compte du fait que certains dignitaires étaient nommés par le roi et d’autres non. Ensuite, la direction de certaines provinces était associée à d’autres charges au sein du royaume. A titre d’exemple, rappelons que le fait d’être Mani Nsundi s’accompagnait d’un certain avantage en ce sens que le présumé était héritier présomptif. D’autre part, lorsqu’on était Mani Mbamba, on était nécessairement chef d’armée ; le Mani Mpangu était chargé de l’information.
Il existait une terminologie propre à la noblesse du royaume, mais celle-ci n’était pas toujours claire étant donné les efforts d’acculturation opérés dans ce domaine. A l’échelon inférieur, nous trouvons le terme Kitomi réservé vraisemblablement aux chefs de terre. On retrouve également le terme Mfumu. Selon Laman. ce titre se référait à des critères de richesse et n’était jamais employé pour désigner le roi. H y a ensuite le terme Mani, qui désignait la noblesse sans distinction hiérarchique particulière. Il désigne aussi bien le roi, le gouverneur que le chef de village ou le chef de terre. Il est également affecté de plusieurs variantes : Mani. Mwene. Mwe, Ne. etc. Un seul terme est réservé exclusivement au roi et n’affecte pas les échelons inférieurs, c’est le terme Ntinu.
3.2 La justice et la législation
Le pouvoir législatif revenait conjointement au roi et aux conseils. Les lois étaient proclamées dans des marchés et les dignitaires qui exerçaient les fonctions administratives se chargeaient de les faire respecter. L’exercice de la justice revenait au chef de village ou au gouverneur de province suivant le cas. Mais personne ne pouvait directement en appeler au roi. Même à la capitale, les juges étaient distincts. L’intervention royale en matière judiciaire se faisait donc en dernier appel.
Dans la capitale, lorsqu’on introduisait une affaire importante, le roi prenait part à la séance mais restait silencieux. Il pouvait se réserver le droit d’examiner une affaire avec les juges avant ou après l’instruction. Il va de soi que les juges rendaient justice en essayant de se conformer aux opinions royales.
Il existait aussi une certaine tendance au despotisme en matière judiciaire. On infligeait aux coupables les peines qu’on estimait méritées. Le recours aux ordalies était également pratiqué et resta en honneur même après la christianisation.
Le cas du Kongo pose plus d’un problème. Voilà une création politique authentiquement africaine qui a été aux prises avec les influences d’origine européenne et cela à l’époque même où émerge le phénomène de l’impérialisme. En effet, c’est à la suite des grandes découvertes maritimes du XVe siècle, mobilisant les potentialités d’Afrique noire et d’Amérique au seul profit de l’Europe, que certains peuples allaient se développer au détriment d’autres, contraints par le fait même à se sous- développer. Le conflit du Kongo avec le Portugal se situe précisément dans ce contexte de l’impérialisme naissant et mériterait une étude approfondie. Bornons-nous ici à présenter une évaluation sommaire de cette action dont certains pensent qu’elle échoua [12], alors que d’autres pensent que la tournure tragique qu’ont prise les événements est précisément la preuve que l’acculturation n’a que trop bien réussi au Kongo puisqu’elle a entraîné la destruction totale du royaume [13].
Signalons d’abord, avec l’arrivée des Portugais, l’apparition sur le paysage kongolais d’un certain nombre de réalités maté telles qui n’ont certainement pas manqué d’influer sur la société. La demande plusieurs fois réitérée de maçons, menuisiers et tuiliers avait pour objet de calquer l’architecture du Kongo sur le modèle portugais, pour ériger églises et cathédrales. Dans l’ensemble, l’entreprise n’a pas porté ses fruits. Le terrain offre actuellement très peu de spectacle de ruines. Les techniciens, au lieu de s’en tenir au secteur immobilier, préféraient se convertir sur place en marchands d’esclaves.
L’apport le plus spectaculaire dans ce domaine, bien qu’il soit inattendu, se situe au niveau de l’agriculture avec l’introduction des plantes dites d’origine américaine. Certes, avant l’arrivée du Blanc, les champs kongolais n’étaient pas vides. On y cultivait l’igname, certaines céréales tels le sorgho, le millet à chandelle et très vraisemblablement la banane dans ses deux variétés. C’est dans ce contexte nouveau que le kongolais allait faire la connaissance d’une céréale nouvelle, le maïs, utilisé d’abord pour le bétail mais qui finira par supplanter le sorgho et le millet (de Rome, J.F., 1648 : 89-90). Il faut signaler aussi l’introduction de certaines variétés de manioc, tubercule qui s’imposa rapidement, reléguant l’igname au rang des nourritures subsidiaires. Il y eut aussi le tabac, le café, la vigne, etc. Dans le domaine des animaux domestiques, il faut noter que vache, mouton, chèvre, et canard acquirent définitivement droit de cité auprès des habitants du Kongo. D’autres espèces, tels le cheval, l’oie, ne purent s’adapter réellement au climat. Toutes ces nouveautés furent introduites aux XVIe et XVIIesiècles (de Rome J.F., 1648 : 98-99 ; Bontinck F., 1972 : 69-78).
Mais tous ces biens passaient quelque peu inaperçus à l’époque. L’élément dont l’introduction passait pour être de loin la plus révolutionnaire était incontestablement le christianisme. Introduit comme on le sait à partir du XVe siècle, il s’est imposé en deux phases successives, correspondant du reste à deux tendances quelque peu divergentes.
La première phase de christianisation (XVe-XVIe siècle) fut quelque peu agressive. Elle était le fait de missionnaires portugais qui situaient leur action dans le cadre de la lutte contre l’Islam. Il s’agissait finalement d’une christianisation exigeante qui ne tolérait aucune adaptation ou conciliation avec les éléments culturels locaux. Cette action fut amorcée de manière concrète en 1491. Les travaux de la construction de la première église débutèrent le 6 mai de cette même année. Dans la suite, une série d’églises furent érigées dans la capitale tant et si bien qu’on la surnomma Kongo dia Ngunga – (capitale des cloches). Cette première christianisation fut effectuée au nom de saint Jacques. C’est du reste grâce à l’intervention de ce saint, dit-on, que Don Funsu l’emporta sur son frère en 1506. Ce règne fut propice au développement de cette première christianisation. Plusieurs ordres religieux furent installés dans le royaume. Mais le train de vie excentrique des ecclésiastiques tout comme celui de la plupart des Portugais obligea le roi portugais à dépêcher un ambassadeur sur les lieux.
Vers la fin du règne de Ndo Funsu, le progrès de la christianisation était manifeste. En 1514, le Kongo fut rattaché à l’évêché de Madère. En 1534. il fut rattaché à l’évêché de Sâo Tomé.
Les successeurs immédiats de Ndo Funsu n’eurent guère le temps de se préoccuper autant de questions religieuses. Mais en 1548, les Jésuites arrivèrent au Kongo pour fonder une école à San Salvador.
Après le règne de Ndo Luvwalu 1er et à la suite de la publication du livre de Pigafetta, un évêché fut créé au Kongo ; l’église de la capitale fut élevée au rang de cathédrale. C’est alors que Mbanza-Kongo prit officiellement le nom de Sâo Salvador (Saint-Sauveur) (1596). La juridiction de cet évêché s’étendait jusqu’en Angola. Sa création marquait un point dans la lutte des rois du Kongo contre la tutelle portugaise.
Le début du XVIIe siècle fut marqué par un événement religieux important : l’arrivée du protestantisme suite à la présence des Hollandais sur la côte. Cette autre christianisation eut un impact moins important, d’abord parce que le séjour des Hollandais fut limité dans le temps et dans l’espace, ensuite parce que ceux-ci s’intéressaient davantage au commerce qu’à d’autres activités.
En 1619, les Jésuites revinrent au Kongo pour reprendre le projet de la fondation d’un collège. Ce collège fut actif de 1624 à 1669. C’est de cette époque que date la publication du catéchisme kikongo du Père Mattheus Cardoso [14].
La seconde phase de christianisation démarra sous le règne de Ndo Ngalasia II, celui-là même qui accueillit en 1648 les Capucins italiens et espagnols envoyés par Rome. Cette arrivée revêtait une double signification : elle enlevait à la christianisation du royaume son caractère strictement portugais ; de plus elle venait réactiver la vision missionnaire qui s’était déjà diffusée. En outre, elle constituait un renfort parce que les missions n’avaient pas assez de prêtres. C’est cette nouvelle vague missionnaire qui s’intéressa davantage à la vie du pays et aux moeurs de la population. Avec elle, on vit apparaître une série d’écrits sur la vie du royaume [15].
Mais l’apostolat de ces Capucins commença plutôt mal : en effet, un Capucin flamand, Adrien Willems, en religion Georges de Geel, fut assassiné en 1652 dans la province de Mbata pour avoir essayé de mettre fin à une cérémonie fétichiste. Ndo Ngalasia II voulut mettre à mort tous les habitants du village où s’était produit l’incident, mais les missionnaires le lui déconseillèrent (Hildebrand, P., 1940).
Cette christianisation rénovée se réclamait de saint Antoine de Padoue. En effet, saint Antoine avait séjourné en Afrique du Nord, au Maroc, vers les années 1220, et à cause de son activité missionnaire, son culte fut introduit par les Capucins. Rien que la vie de ce saint constituait un facteur important d’unité entre les Capucins œuvrant au Kongo ; par les circonstances de sa vie, ce saint suggérait qu’une harmonie était possible entre Italiens, Espagnols et même Portugais. En effet, né à Lisbonne en 1195, Antoine mourut à Padoue en Italie en 1231. Son culte était donc très populaire tant au Portugal qu’en Espagne, on l’invoquait pour n’importe quel malheur. Son culte se répandit au Kongo et connut un grand retentissement car il était en quelque sorte proche du « fétichisme ».
A partir du XVIIIe siècle, ce culte conduisit même à l’apparition d’une secte particulière qu’on appela « la Secte des Antoniens ». C’était une religiosité qui avait la réputation d’être une expression plus adaptée et plus populaire du christianisme. Dans cette secte, on invoquait aussi bien les saints que les ancêtres. On n’hésitait pas à procéder à une transposition géographique de toutes les données de la Révélation afin de la rendre plus explicite et plus actualisée. Le mouvement avait aussi une ambition politique évidente. Il s’agissait de restaurer l’unité du royaume, démarche qui exigeait le départ, ou tout au moins le désengagement des Portugais. Ce mouvement qui eut des précurseurs (Mafuta) se réalisa véritablement avec Ndona Béatrice.
Cette christianisation rénovée mit en évidence, de manière plus explicite qu’auparavant, le problème de l’éducation et de la formation des autochtones, bien que cette tendance connût des limites. Une certaine réticence se manifestera dans la formation du clergé autochtone ; seuls les enfants des nobles pouvaient accéder au système scolaire.
Mais le second élan de christianisation ne se fit pas sans mal ; les difficultés rencontrées étaient liées à la situation et au statut même des missionnaires dans le royaume. D’abord, ils étaient trop peu nombreux et cet état de choses s’expliquait par un certain nombre de facteurs, notamment la mortalité et les restrictions d’ordre politique. L’autre obstacle, aussi important que le premier, réside dans le manque d’enthousiasme des autorités ecclésiastiques à l’idée de créer un clergé autochtone. Il y eut bien sûr des jeunes gens qui furent envoyés en Europe pour y faire des études religieuses. Mais cela n’apporta pas de résultats réellement probants. Le collège fondé par des Jésuites à la capitale ne formait que du personnel auxiliaire (catéchistes, sacristains…). La pénurie de personnel religieux s’expliquait aussi par des raisons financières. Au temps de Ndo Funsu, le roi payait lui-même les missionnaires. Au début du XVIIe siècle, cette situation changea ; il fut question que le royaume soit pris en charge par les rois d’Espagne et du Portugal. Mais à la suite de l’intervention hollandaise, les deux couronnes (Espagne-Portugal) cessèrent de subventionner le clergé du pays. A partir de cette époque, les évêques de Sâo Salvador ne résidèrent plus au lieu de leur siège épiscopal. Ils préféraient rester à Loanda et se rallier à Sâo Salvador épisodiquement.
Une dernière difficulté était liée à la langue. Les missionnaires utilisaient les services d’interprètes parce qu’ils ne connaissaient pas assez les langues locales. Sermons et séances de confession s’effectuaient de cette manière. L’interprétation pouvait être erronée de même que les missionnaires pouvaient mal comprendre un problème qui leur était présenté. La question linguistique se situait dans un contexte plus vaste, celui d’une incompréhension culturelle entre missionnaires et autochtones. Mais sur le plan strictement linguistique, soulignons les efforts qui furent réalisés surtout à partir du XVIe siècle. En 1624, Cardoso publia son catéchisme en kikongo déjà cité ; en 1652, Georges de Geel publia également un dictionnaire trilingue (kikongo-latin-espagnol).
Reconnaissons ici que si cette christianisation, sur le plan doctrinal, fut quelque peu vouée à l’échec, elle aura du moins contribué à diffuser pour la première fois les données de la Révélation en Afrique Centrale.
Mais son plus grand mérite se situe au niveau extrareligieux notamment en matière d’éducation et d’instruction (Rabczuk, W., 1974 : 25-44). La première initiative du genre date de l’époque du premier roi chrétien. En 1487, un certain nombre de jeunes kongolais furent envoyés au Portugal pour y apprendre à devenir de bons chrétiens, à lire et à écrire. Ce contingent fut confié au couvent Saint-Eloi des Chanoines de Saint-Jean l’Evangéliste.
A partir de 1492, ce couvent recevait régulièrement des jeunes Kongolais. C’est dans ce couvent qu’avaient étudié les deux fils du roi Ndo Funsu 1er, Ndo Diki et Ndo Funsu (fils). Ce dernier, après ses études, s’installa définitivement à Lisbonne où il dirigea une école publique tout en bénéficiant d un traitement alloué par le roi. Il semble qu’il ait eu beaucoup de bons disciples (Cuvelier J., 1946 : 162). Mais plus encore que Ndo Funsu, c’est Ndo Diki qui allait faire honneur à son père car il allait devenir évêque, le premier de l’Afrique Centrale (Bontinck, 1979a : 149-169). Que sait-on de sa vie ? Peu de chose, en définitive. Ndo Diki (Henrique) Kinu a Mubemba (Jadin, L, 1961 : 472) naquit vers 1495 à Mbanza Nsundi, à l’époque où son père était encore Mani Nsundi et où la première mission évangélisatrice venait de fouler le sol du royaume à la demande du roi Muzinga a Nkuwu. Baptisé sous le prénom d’Henrique, il se rendit au Portugal pour y étudier vers 1509, accompagné d’un de ses cousins. A l’époque, il n’avait qu’une quinzaine d’années. C’est alors qu’il entreprit sa formation religieuse. Qu’il ait été un brillant étudiant qui soit parvenu à assimiler le latin parfaitement ne fait pas l’ombre d’un doute. Ce qui est moins sûr, c’est qu’il se soit rendu à Rome afin d’y présenter au Pape Léon X l’obédience du roi son père (Cuvelier, J. 1946 : 472). Malgré les nuances généralement apportées à la question, suggérant que quelques Kongolais s’étaient joints à la grandiose ambassade portugaise de 1514 (Bontinck, F., 1970 : 37-33), il semble qu’il faille définitivement conclure qu’une telle expédition n’a jamais eu lieu (Bontinck, F., 1970 :159). Léon X n’a jamais vu le fils du roi du Kongo ; cependant, il a dû consentir à lui accorder la dispense d’âge qui lui permit d’accéder à l’épiscopat avant 30 ans. Cela se passa en 1518. Ndo Diki fut alors promu évêque titulaire d’Utique. On s’empressa d’abord de lui conférer l’ordination sacerdotale en 1520, probablement le 25 novembre avant le sacre épiscopal au cours des premiers mois de 1521. La même année il retourna au Kongo où, du reste, son père réclamait sa présence. Mais l’évêque, de santé plutôt fragile, ne connaîtra qu’une dizaine d’années d’apostolat, avant de s’éteindre, vraisemblablement en 1531.
Cet évêque, qui n’aura connu finalement qu’une existence éphémère, demeure un symbole au regard de l’histoire. Ce fut le premier intellectuel de la région, produit d’une modernité d’origine externe qui ne pourra plus jamais être rayée de la vie de ce royaume et de sa périphérie [16].
Mais tous les jeunes Kongolais qui se sont rendus à Lisbonne n’ont pas été aussi brillants que le fils du roi Ndo Funsu. Tous n’avaient pas autant d’aptitudes. Les neveux du roi par exemple revinrent après deux ans, ayant à peine appris à lire et à écrire. Pire encore, la correspondance de Ndo Fonsu traduit quelquefois sa déception et son amertume face aux résultats médiocres des élèves envoyés à Lisbonne. Dans une de ses lettres au roi, il écrit : « Punissez-les sévèrement, séparez-les les uns des autres en les répartissant dans différents établissements de façon qu’ils ne puissent ni se voir ni se parler » (Brasio, A., 1952 : 406-407). Il faut également noter qu’il y avait un taux de mortalité assez élevé parmi les jeunes envoyés à Lisbonne. Des dix élèves envoyés en 1516, un seul survécut.
Sur place au Kongo, il existait également un réseau d’écoles. Le premier établissement du genre fut construit en 1509 sur ordre du roi. L’instruction des élèves fut alors confiée aux chanoines de Saint-Eloi. Il y avait également des écoles de provinces dirigées par des autochtones pour enseigner la Sainte Foi. Une série d’écoles pour filles fut également créée par la sœur du roi (Rabczuk, W., 1974 : 30-33).
Mais ces efforts louables n’ont pu aboutir à des résultats concluants. On n’assistera pas au Kongo, comme à Tombouctou, à une véritable percée des lettrés autochtones. La correspondance de Ndo Funsu mise à part, nous ne disposons pas de textes de l’époque qui soient de la plume des autochtones.
Il faut savoir que ces projets ont tourné court. Les enseignants, comme on l’a déjà vu, se convertissaient en marchands d’esclaves plutôt que de continuer à alphabétiser les jeunes nègres. De plus, le climat politique, de jour en jour plus malsain, ne facilitait pas les choses, le phénomène d’enseignement étant directement dépendant du religieux et du politique. Il suffira que la couronne portugaise se détourne quelque peu de Sâo Salvador au profit de Loanda pour que cette disposition soit suivie par l’Eglise, provoquant inéluctablement la destruction progressive du réseau scolaire en place.
Les aventures de la côte kongolaise avaient en quelque sorte accéléré le cours de l’histoire de l’ensemble du pays. Les conséquences de ce contact avec l’extérieur allaient se répandre de proche en proche jusqu’à atteindre les peuples les plus éloignés.
L’expérience laborieuse de collaboration avec une nation européenne – le Portugal – s’avérait un prélude à des expériences similaires que la société congolaise tout entière était vouée à connaître à l’avenir. Entre-temps, les données culturelles spécifiques du Kongo étaient modifiées par l’influence lusitanienne.
Texte : Par quoi on remplace le pain et le vin
La Relatione de Jean-François de Rome (1648) apporte les informations les plus détaillées sur la « vie quotidienne » au royaume du Kongo et partant, à l’ouest du Congo ancien. C’est en témoin oculaire qu’il fournit tant de détails sur la flore, la faune, la gastronomie et la physionomie des individus. La lecture permet de se rendre compte qu’à trois siècles d’intervalle, le changement a été finalement fort minime.
« Vers la fin de l’hiver, c’est-à-dire à la fin de septembre, on commence habituellement à cultiver la terre, car c’est alors que débutent les pluies ; la récolte se fait au mois de décembre. On sème de nouveau au début de janvier, pour obtenir une autre récolte à la fin de l’été, c’est-à-dire vers la fin d’avril. Ainsi chaque récolte se fait dans la saison d’été, en hiver on ne sème ni récolte. Leur façon de cultiver la terre demande peu de travail à cause de la grande fertilité du sol : ils ne labourent ni ne bêchent mais avec un hoyau ils grattent un peu la terre, assez pour recouvrir la semence. Moyennant cette légère fatigue, ils font des récoltes abondantes, à condition que les pluies ne fassent pas défaut. Si le temps reste au sec, tout se dessèche et les gens sont réduits à une grande pénurie de vivres, car ils n’amassent pas de réserves pour l’avenir et ne sèment que le nécessaire.
Le grain qu’ils sèment n’est pas le nôtre dont nous faisons le pain, mais c’est le grain que nous appelons « grain turc » et qui en leur langue s’appelle Masa ma Mputu (graminée importée Zea mays), c’est-à-dire grain du Portugal, puisque ce furent les Portugais qui l’importèrent. De ce grain, ils possèdent toujours une grande quantité. Ils sèment encore certaines autres espèces de millet, semblables au sarrasin ; certaines espèces ont l’enveloppe blanche, d’autres l’enveloppe rouge ; une certaine espèce est si petite qu’elle ressemble au grain de sénevé, mais elle est appréciée au-dessus de toute autre, à cause de son meilleur goût. On l’appelle luku (eleusine corocana) et elle se multiplie outre mesure. Pour faire de la farine de ces millets et grains, ils ne se sentent pas de meules de moulin mais de grands mortiers en bois. Ils y versent le grain quelque peu mouillé, et avec des pilons également de bois, ils le broient ; puis à l’aide de tamis de paille très fins, ils séparent la farine du son.
Ils ne fabriquent pas du pain comme on le fait en Europe, puisqu’ils ne se servent pas de fours ; lorsqu’ils veulent manger, ils mettent une marmite d’eau sur le feu, et tandis que l’eau bout, ils y versent de la farine qu’ils retournent continuellement avec un bâtonnet ; ils en mettent jusqu’à ce que l’eau soit absorbée ; il en résulte une sorte de masse pâteuse ou disons une sorte de polenta (spécialité italienne, bouillie de farine ou de maïs). On l’extrait de la marmite et on la laisse quelque temps couverte d’étoffes pour qu’elle se durcisse un peu. Elle leur sert de pain et ne nuit en rien à la santé. Elle ne se conserve pas plus de trois jours ; par après elle se corrompt, devient aigre et n’est plus bonne à être mangée. Cette sorte de pain, ils l’appellent dans leur langue : Mfundi.
Les Portugais leur ont appris à faire du pain, d’une autre façon encore et ce pain est bien meilleur. Voici comment ils procèdent. Ayant obtenu la polenta, ils en font des gâteaux, grands de deux doigts, qu’ils mettent au feu, sur un treillis de fil de fer ; grillés de la sorte, ces gâteaux sont très bons. Ils appellent cette espèce de pain : Mbolo (terme d’origine portugaise).
Leur tient encore lieu de pain une racine appelée Madioka, laquelle est comme un gros panais. Quand on déterre cette racine, elle est vénéneuse ; pour enlever le poison on la fend au milieu et on la met dans l’eau où on la laisse rouir durant deux ou trois jours, puis on la retire de l’eau et on la met sécher au soleil. Si quelque animal vient boire de cette eau, il meurt sur-le-champ. Quand, par après, ils veulent manger de cette racine, ils la mettent quelque temps sur des braises ; elle leur sert de pain mais elle est fort insipide. Ils ont aussi l’habitude de faire de la farine de cette racine. Ils s’y prennent ainsi : extraite de l’eau et séchée quelque peu, ils la grattent avec un certain instrument à eux, qui ressemble à une râpe ; puis la farine est mise au soleil ; à première vue elle ressemble à du fromage râpé. On la conserve dans des sacs et sans y mettre du levain ni en faire du pain, on la mange ainsi avec des cuillères. Cette farine est bonne à préparer en potage, car en la mettant dans le bouillon, elle se dilate beaucoup, ressemblant à un pain râpé. La plante qui produit cette racine est un arbuste court, aux branches éparses et presque sans tronc. Cet arbuste ne produit pas de semence. On coupe les branches en plusieurs morceaux d’une longueur d’un palme et demi et on les enfonce dans un petit tertre, l’extrémité sortant de la terre. Ces tiges produisent sans tarder, non pas une, mais plusieurs racines. Celles- ci, comme la farine qu’on en extrait, se conservent longtemps.
Le vin qu’on boit en ces régions n’est pas du vin de raisin mais une certaine liqueur blanche comme le petit lait et qui est produit par une espèce de palmier qui pousse dans ce royaume. Cette liqueur est piquante et douce et très bonne, mais elle ne se conserve que peu de temps, puisque après trois jours elle se convertit en vinaigre. Au moment où on l’extrait du palmier, elle bout comme du moût ; comme les gens n’ont pas la tête très forte, ils s’enivrent facilement de ce vin. Voici pourquoi il n’y a pas de vin de raisin : c’est au moyen du vin européen que les Portugais ont commencé à faire le commerce des esclaves destinés aux Indes Occidentales ; s’ils avaient permis la culture de vignes dans ces régions, le vin d’Europe aurait perdu toute sa valeur commerciale, d’autant plus que les ceps y donnent des raisins deux fois par an ; les Portugais arrachèrent les vignes qu’ils avaient d’abord plantées, en vue d’acheter ces esclaves au moyen de vin. Il n’est resté que peu de vignes, dans certains endroits, et les raisins ne servent qu’à être mangés. Le tronc du palmier duquel on extrait le vin n’est pas très gros mais très haut : il y en a qui ont la hauteur d’une pique et demie. Cette liqueur s’extrait à la cime ; pour la tirer, ils font des entailles près des branches et ils y attachent des calebasses dans lesquelles le vin dégoutte. Lorsqu’ils estiment que les calebasses sont déjà remplies, ils montent sur le palmier et les détachent ; ceci se fait habituellement le matin de bonne heure et le soir. Ils extraient le vin, toute l’année, sans autre travail que de tailler de temps à autre quelques branches. La grande facilité d’obtenir cette espèce de vin explique pourquoi ils n’ont jamais planté des vignes, qui demandent beaucoup de culture et de soins. Leur façon de grimper sur ces palmiers est vraiment merveilleuse et je crois que très peu de gens de chez nous se risqueraient à monter ainsi. Ils ne se servent ni d’échelle ni de corde mais d’un cerceau très résistant, de forme ovale et qui s’ouvre et se ferme. Ils s’entourent le corps et le palmier de ce cerceau, en se tenant à quelque distance du palmier, de sorte que commodément ils puissent y mettre le pied en appuyant les reins contre le cerceau ; ceci fait, des deux mains ils soulèvent le cerceau de deux palmes, en plaçant au même moment les pieds en haut. Comme le tronc du palmier est rugueux tant le cerceau que les pieds s’y accrochent facilement. Ainsi soulevant successivement le cerceau et déplaçant les pieds vers le haut, ils arrivent facilement à la cime du palmier. Comme ils sont très habiles et agiles, iis montent et descendent avec une telle rapidité, qu’à les voir on est saisi de crainte. Il arrive souvent qu’un tireur tombe en bas, non pas parce que la façon de monter inventée d’eux ne soit pas sûre mais parce que, parvenus en haut et voyant les calebasses pleines de vin fumant, ils se sentent pris d’une telle envie de boire ce vin dont ils sont si friands qu’ils en dégustent une bonne quantité. Ayant l’esprit troublé, ils ne retrouvent plus les mouvements synchronisés de la descente et ainsi facilement ils tombent en bas. Beaucoup sont morts sur-le-champ ; les autres sont guéris de cette façon extraordinaire : on les étend par terre et on les flagelle très fortement, particulièrement la partie du corps qui a percuté le sol. Traités de cette manière, ils se rétablissent. On les flagelle avec des branches d’un arbre qui produit un fruit duquel on extrait de l’huile semblable à celle de l’Europe ; pourtant on ne la consomme pas, on la brûle seulement.
Il y a encore une autre sorte de vin, produit par une autre espèce de palmier, et qui en leur langue se nomme matumbe (raphia vinifera) ; ce vin a la même couleur que l’autre mais il n’est pas aussi bon. Le tronc de ce palmier est assez bas mais ses branches ont la longueur d’une pique et sont plus ou moins semblables à celles du palmier ordinaire. Des côtés de ces branches, ils fabriquent les torts des maisons et ces solives sont étonnamment fortes et légères.
Dans certaines régions on trouve ces deux sortes de vin en grande quantité, comme dans la province de Nsundi, de Soyo et dans les îles du fleuve Zaïre. Dans d’autres régions on n’en trouve aucune sorte : en effet, lorsque, nous rendant en Angola, nous passâmes par le duché de Mbamba, dans la plus grande partie de ce duché nous ne buvions jamais du vin mais de l’eau.
Les peuplades qui n’ont pas de vin, se fabriquent une boisson avec de la farine cuite dans l’eau. Cette boisson est comme une espèce de bière et quoiqu’elle soit d’une moindre saveur, les gens s’en enivrent aussi. Afin de pouvoir célébrer la sainte Messe, il est nécessaire d’amener de nos régions tant le vin que la farine pour les hosties : ceci ne va pas sans beaucoup de peine. Avec la faveur divine, nous espérons pouvoir nous procurer de la farine sur place. D’après ce qu’on dit, notre blé, attiré puissamment par le soleil, ne parvient pas à pousser de racines profondes et ne produit que de l’herbe abondante ; pourtant nous croyons que si on le semait sur certaines collines assez hautes et fraîches, il donnerait des épis et avec une certaine abondance.
Quant aux fruits, il y en a quelques-uns de nos régions, mais non pas dans chaque province ; ainsi les Portugais y ont importé des citrons, limons et oranges ; quelques particuliers cultivent aussi des raisins dans leur jardin.
Parmi les autres fruits que nous y avons goûtés, il y en a quelques-uns entièrement différents des nôtres, mais ces fruits ne s’y trouvent pas en grande quantité. Il y a trois sortes de fruits qui sont vraiment bons ; dans la langue du pays ils se nomment, l’un niceffo, l’autre ananassa, le troisième cocco.
Le niceffo (sorte de banane ?) est comme un concombre de grandeur moyenne ; à l’intérieur il ne contient pas de noyau et il se pèle avec la même facilité qu’une figue ; lorsqu’il est bien mûr tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, il a la couleur de beurre et la chair est très tendre et a un goût si savoureux qu’on ne peut se rassasier d’en manger ; il ne nuit pas à la santé et il y en a toute l’année. Pourtant ce fruit ne se trouve pas partout dans le royaume. La plante qui produit ce niceffo est comme un palmier haut d’environ deux cannes (environ 5 m), elle a des feuilles très grandes mais pourtant tendres ; le tronc n’est pas de bois mais formé de ces feuilles superposées ; à la cime celles-ci s’épandent et forment une belle chevelure. La plante contient tant de suc que, quand on coupe le tronc, il en sort une quantité si abondante qu’il semble se changer en une source. Cette plante ou disons cet arbre produit une grande grappe, pleine de ces niceffo, parfois la grappe en porte deux cents. En un an il ne produit qu’une seule grappe ; quand le fruit a été cueilli, la plante pourrit au pied et tombe par terre, mais de sa racine naissent d’autres plantes, de sorte qu’elle se propage abondamment ; n’importe quelle petite partie de cette racine, si on la met en terre, produit bientôt une nouvelle plante. A l’intérieur de ce fruit on voit une chose curieuse : lorsqu’on le coupe de travers on y remarque, quoique peu distinctement, comme l’image d’une croix, formée de certaines nervures tendres parcourant l’intérieur du fruit et tirant quelque peu au noir. Cela s’observe sur toute la longueur du fruit, lorsqu’on le coupe tranche par tranche.
L’autre fruit, appelé ananassa (ananas) est comme une grande pomme de pin pointée, de diverses couleurs ; l’écorce est tendre comme celle d’un melon, la chair ressemble à celle d’un cognassier très mûr et aussi son goût y ressemble beaucoup, mais il est meilleur. Au sommet du fruit il y a quatre ou cinq petites feuilles ; si on coupe cette partie et qu’on la jette par terre, il en naît rapidement une autre plante. Elle a la propriété suivante : si on y enfonce un couteau et qu’on l’y laisse toute la nuit, le lendemain matin on trouvera le fruit presque tout consumé. Ce fruit est produit par une plante qui est comme un grand cardon ; il est très bon pour ceux qui souffrent de la pierre et de la gravelle.
Le cocco (noix de coco) a la grandeur d’un melon moyen, sa forme se rapproche de l’ovale ; l’écorce épaisse de deux doigts environ, est très dure ; si on veut manger ce fruit, on doit l’ouvrir avec une hachette ou un instrument semblable. Quand on a enlevé l’écorce, on trouve une noix grande comme un œuf d’autruche, de la couleur d’une châtaigne, et très dure. A l’intérieur de cette noix il y a une chair épaisse d’un doigt, partout attachée à la paroi extérieure ; cette chair est blanche comme le lait mais quelque peu dure ; elle contient, dans son circuit, une eau si précieuse et délicieuse que vraiment elle peut s’appeler un nectar ; sa quantité remplira environ un verre. L’arbre qui produit ce fruit ne diffère nullement des palmiers qui donnent le vin. Il y a d’autres fruits du pays mais ils ne sont pas très savoureux.
Des plantes potagères, comme les choux, la laitue, le persil, la chicorée, la menthe, les radis et d’autres, se rencontrent dans certaines contrées, mais pas dans d’autres. Des courges se trouvent en bonne quantité et elles sont très grandes. Comme les autres légumes, les courges ont été importées par les Portugais. Lorsque dans nos régions, on apporte de la semence de radis aussi gros que le bras d’un homme, la semence produite par ce radis, ne contient plus tant de vigueur ; aussi la deuxième année elle produit des radis plus petits, la troisième année ils sont encore moindres, de sorte que la quatrième année ils sont comme un radis ordinaire, de l’espèce qu’on mange.
L’ail et les oignons sont très rares, il faut beaucoup de soins pour les maintenir en vie, et ils restent toujours petits. Les choux et les laitues poussent très bien : les petits pois et les pois chiches et les autres légumes d’Europe ne donnent pas de fruits considérables.
Les légumes du Congo sont de trois espèces. L’une est appelée dans leur langue guando (wandu) et sa forme ressemble à celle des petits pois, mais elle n’a pas un aussi bon goût. L’autre s’appelle incassa (nkasa) : ce sont de petits haricots rouges, très bons. Il y a grande abondance de ces deux espèces de légumes. La troisième est constituée de grandes fèves, blanches et rouges, en partie différentes des nôtres. Elles sont très bonnes. Les Portugais les importèrent du Brésil, c’est pourquoi dans la langue du pays elles se nomment lucanza lua Brasil, c’est-à-dire fève du Brésil. La racine, appelée patate (patate douce), qui se trouve aussi en Espagne, particulièrement à Malaga, se cultive au Congo en très grande quantité ; elle est très bonne, on la mange cuite dans l’eau ou sur les braises. Elle a un goût qui ressemble assez bien à celui de la châtaigne et beaucoup la mangent au lieu de pain (…).
Si ces gens aiment ce qui est doux, ils aiment également ce qui est amer, aussi mangent-ils avec beaucoup de délectation un fruit qu’ils appellent cola. Celui-ci est un peu dur et très amer ; il facilite le bon fonctionnement de l’estomac. C’est pourquoi ils ont l’habitude de le prendre à jeun ; ils le mangent aussi après le repas pour faciliter la digestion de la nourriture. Au cours de la journée, voulant boire de l’eau, ils prennent d’abord de ce cola, lequel leur rend l’eau très savoureuse. L’arbre qui le produit est très haut, son fruit est comme une petite pomme de pin, à l’intérieur il contient quatre ou cinq pulpes, séparées à la façon des châtaignes, et de couleur rouge et incarnat (…).
Quant aux bêtes, il y a au Congo beaucoup d’animaux domestiques qu’on trouve en Europe, comme les boeufs, vaches, chèvres, moutons, poules, pigeons et autres semblables. Ces animaux y vivent en bon nombre. Les boeufs et les vaches sont comme ceux de nos contrées ; les gens ordinaires n’en possèdent pas mais uniquement les notables comme les rois, ducs, comtes. Ils ne savent pas traire les vaches et les brebis ni faire du fromage et autres laitages, comme on le fait en Europe, soit parce que ces animaux donnent peu de lait, soit parce que les habitants n’apprécient pas ces délicatesses. La dernière raison est la plus probable ; en tout cas, il n’y a ni fromage ni beurre ni aucune autre sorte de laitage. Les moutons de ces contrées ne donnent pas de laine ; ils ont le poil court comme celui d’un cheval. Les porcs sont comme les nôtres mais excessivement gros et gras, à l’exception de ceux de Soyo lesquels ont peu de lard. Les poules ne sont pas très grandes mais de taille médiocre et pour le reste semblables aux nôtres, elles pondent beaucoup mais leurs œufs sont petits. Il y a aussi des chiens et des chats importés par les Portugais. Les chiens ne servent à rien puisqu’ils n’aboient pas étant comme muets. Il n’y a ni chevaux, ni mulets ni ânes et par conséquent ni chars, ni carrosses. Les hommes eux-mêmes font le travail des chevaux, puisqu’ils portent des charges de grands poids, autant que pourrait porter un âne et cela sur une distance de quinze et dix- huit milles. Les hommes servent aussi de chevaux aux nobles qui veulent voyager. Ils les portent dans un hamac, grand et long, dont les extrémités sont attachées à une perche qu’on met sur les épaules d’un homme qui marche par devant et d’un autre qui marche par derrière, le hamac étant entre eux deux. Ces porteurs courent avec une telle rapidité comme s’ils étaient des chevaux et on les appelle de ce nom. La personne qui voyage dans le hamac peut s’étendre ou s’asseoir à sa guise et en chaque position elle voyage très confortablement, car elle ne ressent aucune secousse. Quand ils doivent faire un long voyage, les porteurs du hamac sont relayés de temps à autre par d’autres porteurs frais ; c’est pourquoi le seigneur doit se faire accompagner de huit ou dix « chevaux ».
Tous ceux qui ont des esclaves voyagent de cette manière, même le roi. Les nobles et les riches possèdent des hamacs très beaux, faits de Kapok, avec des dentelles et des ouvrages très curieux ; le roi a un hamac très beau, orné de bouffettes et de dentelles d’or ; la perche aussi est entourée de velours fixé par des clous dorés ; ainsi orné, le hamac a belle apparence.
Outre les animaux domestiques, il y en a d’autres, sauvages, parmi lesquels de nombreux éléphants. On lès capture habituellement de la façon suivante : lorsqu’on connaît le sentier où l’éléphant a l’habitude de passer, on y creuse un profond fossé, qu’on couvre de branches. Si l’éléphant tombe dans ce puits, il n’en peut plus sortir. Les chasseurs aux aguets lui tombent immédiatement dessus et le tuent. Ils en vendent la chair, qui est très bonne, surtout la trompe. S’ils veulent domestiquer l’éléphant pour le vendre vivant, ils employent le stratagème suivant. D’après ce que j’ai lu dans les livres, un homme se montre très dur à l’égard de l’éléphant, lui donnant de nombreuses bastonnades ; alors un autre homme prend sa défense, se tournant contre celui qui le frappe. Ils jouent ce jeu durant quelques jours ; ainsi l’éléphant se prend à l’égard de son défenseur d’une si grande amitié qu’il se laisse entièrement dominer par lui, se soumettant en tout et partout à ses ordres.
Il y a également de nombreux lions et léopards et encore d’autres animaux, comme les buffles qu’ils nomment mpakasa. Ceux-ci sont très féroces et tuent souvent les voyageurs, non pas de leurs cornes mais de leurs pattes, comme font les buffles de nos contrées.
Il y a beaucoup de cerfs, d’antilopes et « vaches sauvages », de couleur rousse mais petites ; nombreux sont aussi les loups et les renards.
Au comté de Soyo, particulièrement dans les îles du fleuve Zaïre, les singes et magots, petits et grands, abondent. Voyant passer les gens, ils sautent dans les arbres, semblant leur jouer une farce.
Dans la province de Mpemba, il y a des chats muscats ; ils sont grands et malins ; c’est pourquoi on a l’habitude de les garder dans des cages de bois bien solides. Bien qu’ils soient sauvages, ils se familiarisent vite avec leur maître. Dans cette même province, il y a un animal qu’on appelle zèbre. Sa stature ressemble à celle d’un mulet, mais son poil est totalement différent. De la ligne de l’épine dorsale vers le ventre, il est garni de bandes de trois couleurs : noir, blanc et tanné ; le cou, la tête et les pattes sont striés de la même façon ; les bandes sont larges de trois doigts et disposées dans l’ordre suivant : à la couleur blanche succède le noir, au noir le fauve et ainsi de suite, toujours dans le même ordre. Sa course est très rapide ; si on le domestiquait il pourrait très bien servir de cheval, car il n’est pas fort sauvage. Pourtant les naturels du pays préfèrent faire eux-mêmes fonction de cheval, plutôt que de se mettre en tête de le domestiquer.
Il y a une espèce de serpent si grand et démesuré qu’il avale un cerf entier. Il ne manque pas de personnes qui l’ont vu dans ces contrées. Durant mon séjour au Congo, un Portugais me raconta qu’en traversant un bois avec des compagnons, ils trouvèrent un de ces serpents étendu à travers le chemin. Il avait le ventre gonflé et semblait dormir. En effet, après avoir mangé beaucoup, cet anima! a ceci de caractéristique qu’il reste assoupi et comme mort. Voyant le serpent, tous furent grandement effrayés et montèrent dans les arbres. De là ils lui tirèrent de nombreux coups de mousquet. L’ayant tué ainsi, ils l’ouvrirent et dedans ils trouvèrent un cerf avalé peu auparavant. La chair de ce serpent est bonne à manger, car il n’est nullement venimeux.
Il ne manque pas de faisans, de starines grises, de perdrix,mais ils ne sont pas aussi bons qu’en Europe, car leur chair tire au noir et est assez coriace.
Les oiseaux de ce pays sont ordinairement revêtus de plumes de très belles couleurs, comme le vert, le rouge, le jaune, le bleu et couleurs similaires, mais peu ont le chant suave. Il y a une grande quantité de tourterelles ; surtout le matin et le soir, elles joignent leur morne chant à celui des autres oiseaux et elles font une musique ennuyeuse et très affligeante. Les perroquets sont très nombreux surtout dans les îles du fleuve Zaïre. Ils sont de couleur grise, avec quelques plumes rouges dans les ailes.
On mange rarement du poisson, non pas parce qu’il n’y a pas de fleuve – il y en a beaucoup et ils contiennent une grande quantité de poissons – mais parce que les habitants s’appliquent peu à la pêche. Les poissons de ces fleuves diffèrent des nôtres d’Europe, pourtant ils sont très bons ; une espèce en particulier a une chair si blanche et si savoureuse qu’elle ressemble à la poitrine d’un chapon. Ce poisson est grand de deux palmes et demi.
Ceux qui habitent près de la mer consomment des poissons en plus grande quantité que ceux qui habitent à l’intérieur de la terre, car la mer qui baigne ce pays, est très poissonneuse. Ils salent les poissons et les vendent ensuite aux marchés ; leur se! est comme celui qui se vend à Rome avant qu’il soit purifié et rendu blanc. Le roi seul est propriétaire des salines. Si le roi veut punir un de ses sujets, duc, comte ou marquis, il défend de lui vendre du sel, à lui et à son peuple.
Voilà ce qui a trait aux caractéristiques du royaume et aux fruits, aux animaux etc. J’en viens maintenant à traiter des habitants du royaume et de leur façon de se vêtir.
Les naturels du Congo sont tous de couleur noire, mais l’un est plus foncé que l’autre ; on en voit beaucoup de couleur de châtaigne et d’autres qui tirent plus sur l’olivâtre. Entre eux, ils regardent le plus noir comme le plus beau. A leur naissance, ils ne sont pas noirs mais blancs et puis peu à peu ils deviennent noirs. Leurs mères, ne pouvant attendre que leur enfant prenne de soi-même leur noirceur, l’enduisent d’un certain onguent, et ainsi oint, elles l’exposent toute la journée aux rayons du soleil. Je ne comprends pas comment l’enfant n’en meurt pas. Elles l’exposent ainsi plusieurs fois, de sorte que l’enfant, en peu de temps, devient noir comme du charbon. Alors le père et la mère sont tout contents, voyant leur enfant devenu semblable à eux-mêmes.
La noirceur de cette nation ne procède pas de la chaleur excessive du soleil, comme certains le pensent. En effet, comme je l’ai dit plus haut, les chaleurs dans ces contrées sont très modérées ; en plus les Européens y restent blancs comme dans leurs propres patries, et les enfants qui leur naissent sont et restent blancs. La noirceur des habitants provient du fait de leur nature et qualité intrinsèque. En effet, nous constatons aussi que les enfants nés de noirs en Espagne ont la même noirceur que leurs parents. Il y a certains enfants de père et de mère noirs qui naissent blancs et quels que soient les moyens qu’ils emploient, jamais ils ne peuvent leur donner leur propre noirceur ; aussi sont-ils tenus pour des monstres (albinos). Ils ont les mêmes traits que les noirs ; leurs cheveux sont crépus mais blancs ; ils ont la vue courte mais quant aux autres caractéristiques du corps, ils sont bien faits comme les autres. Pourtant ils sont très rares. Les noirs du Congo ne sont pas aussi difformes que ceux de la Nubie ; ils ont bien les lèvres un peu épaisses et le nez un peu aplati, mais dans une mesure telle que cela ne les rend nullement difformes ; quant à la stature, ils sont plutôt grands que petits ; tant les hommes que les femmes sont de taille vraiment harmonieuse ; ils sont agiles à la course et doués d’une grande force ; ils ne se laissent pas pousser les cheveux mais ils les coupent, les femmes aussi bien que les hommes, et les esclaves font de même. Les hommes portent une petite barbe mais lorsqu’ils approchent de la trentaine, ils la coupent, gardant seulement des moustaches comme en Europe. Lorsqu’ils vieillissent, leurs cheveux blanchissent comme chez nous ; ordinairement ils vivent longtemps ; ainsi j’ai vu parmi eux des vieillards de 108 et 110 ans. Après s’être rasés, tant les hommes que les femmes s’enduisent la figure et la tête d’une sorte de craie de couleur jaunâtre ; alors ils sont d’un aspect terrifiant. Après deux ou trois jours, ils se lavent soigneusement la figure et la tête et la peau se découvre lisse comme une pierre noire, ce qu’ils apprécient beaucoup ».
(Jean-François DE ROME, traduit par F. Bontinck, 1964 : 88-104).
[1] Kongo (avec K) se réfère au royaume du Kongo. il se distingue de ce fait du Congo (avec C) qui sera utilisé plus tard pour qualifier les réalités contemporaines (Congo-Kinshasa : Congo-Brazzaville ; République Démocratique du Congo ; République du Congo).
[2] Cf. bibliographie.
[3] Pour une présentation critique de certains d’entre eux (J.F. de Rome, Cavazzi ; J. da Sorrento : L. da Caltanissetta), cf. Mudimbe-Boyi M. (1977 : 45-60).
[4] Rien qu’en s’en tenant à la partie la plus officielle de l’histoire des relations du Kongo avec le Portugal (1482-1665), on peut constater qu’elle est plus étendue que l’expérience récente du contact de colonisation et de décolonisation.
[5] L’ancêtre-fondateur portait deux noms associés à son origine familiale. Nimi serait lié à son clan paternel tandis que Lukeni proviendrait du clan maternel.
[6] Plusieurs versions de tradition orale sont consacrées à cet événement, voir Randles, W., 1968 : 17- 18.
[7] La tradition orale n’est pas si muette quant à l’identité des successeurs. On croit savoir que l’ancêtre-fondateur eut pour successeurs immédiats deux de ses frères ou cousins parallèles qui devinrent ainsi le deuxième et le troisième rois. Le quatrième roi fut le propre fils de Lukeni, Nkuwu a Ntinu. On dit que c’est à partir de cet avènement que fut instauré le système d’élection. Ceci correspond sans doute à un changement dynastique puisque Nkuwu a Ntinu n’avait pas les mêmes références claniques que ses prédécesseurs. Muzinga a Nkuwu qui régnera plus tard sera l’un de ses descendants.
[8] Lettre du 6 juillet 1526 (Jadin, L. et Dicorato, M„ 1974 : 156) reproduite dans cet ouvrage aux pp. 253-4.
[9] Lettre du 17 décembre 1540 (Jadin, L. et Dicorato, M., 1974 : 218).
[10] Cf. chapitre 1 de la quatrième partie.
[11] Le Portugal a cru pendant longtemps que le Kongo regorgeait de mines d’or, d’argent et de cuivre. Il a cru trouver confirmation de cette idée dans le fait que les rois du Kongo, depuis Afonso, refusaient que l’on procède à une prospection systématique de leurs terres. Cette méprise sera entre autres à la base de la destruction du royaume.
[12] Cf. Balandier, G., » Le royaume Congo et l’acculturation ratée », Actes du XIIe Congrès International des Sciences Historiques, Vienne, 1965
[13] C’est entre autres le point de vue soutenu par Randles, W. (1968 : 129-148 ; 183-196).
[14] Ce catéchisme a été édité. Cf. Bontinck, F. et Ndembe, N.. 1978.
[15] Pour avoir une idée à peu près complète des écrits des missionnaires Capucins sur le Kongo, cf. Filesi, T. (1968b : 207-236).
[16] Il est regrettable qu’on n’ait encore trouvé aucun écrit de ce personnage.



