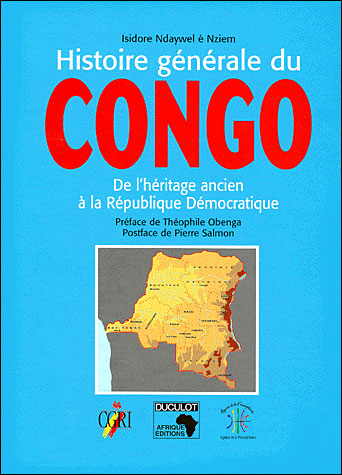
Partie 6 - Chapitre 2 : La mutation
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 2
La mutation
Le fruit du changement était mûr, il fallait le cueillir. La revendication congolaise n’avait que trop duré, face à une colonisation qui faisait la sourde oreille. Certes, depuis la fin de la guerre, certaines réponses avaient été apportées aux demandes autochtones, en particulier celles des évolués. Mais ces solutions ne suffirent pas à calmer la population : elles étaient trop tardives. La Belgique agissait à la manière d’un patronat qui, face à des revendications syndicales, s’efforçait de tenir le plus longtemps possible, pour ne céder que lorsque la grève menaçait. De plus, dans le cas du Congo, les réponses apportées n’avaient plus de sens, des exigences nouvelles ayant vu le jour entre-temps.
C’est ainsi que la mutation se déclencha vers 1957, époque où la stabilité coloniale commença à vaciller. Elle s’acheva vers 1967, à l’aube de la stabilité contemporaine. Trois périodes successives allaient marquer cette crise : d’abord l’effritement de l’ordre colonial à un rythme accéléré, entre 1957 et 1959 ; ensuite, un bref intermède marqué par l’acte d’indépendance en tant que tel ; puis le retour à la crise, avec l’apprentissage de l’autogestion, avec ses hésitations et ses maladresses. Viendront ensuite la quête d’une solution à la crise, les velléités de reconquête de l’indépendance de la part des courants politiques en présence et pour finir, le coup d’Etat militaire qui allait accaparer le pouvoir pour fort longtemps. On notera, d’autre part, que cette époque fut, elle aussi, marquée par la guerre, qu’il s’agisse d’interventions militaires extérieures ou d’oppositions armées entre citoyens. A croire que la « guerre de 30 ans » est le passage obligé de tout changement dans le pays !
1 L’ORDRE COLONIAL EN DÉCOMPOSITION
Le mur colonial s’était lézardé. Cela se ressentit davantage à partir de 1954. On a noté que les oppositions qui se manifestaient à la métropole se répercutaient au Congo. La parution en Belgique d’un « plan de trente ans pour l’émancipation du Congo » provoqua dans le pays le déclic nécessaire à l’apparition des manifestes anticolonialistes. Les élections communales de 1957 constituèrent une dernière répétition générale, avant la mise sur orbite des grands changements politiques. Le déclenchement des hostilités Luba-Luluwa fut également, sur un autre plan, un chant du cygne ; il mit en évidence l’impuissance coloniale, désormais incapable d’imposer la moindre disposition
En 1958, il ne resta plus qu’à faire l’inventaire des fissures créées dans l’édifice colonial et à les multiplier, à la faveur de quelques secousses extérieures : le discours prononcé par le général de Gaulle lors de sa visite à Brazzaville, dont les accents indépendantistes parvinrent jusqu’à Léopoldville, la participation congolaise à l’Exposition internationale de Bruxelles puis au Congrès panafricain d’Accra, qui permit la découverte d’un monde nouveau, sans oublier les nouvelles de l’indépendance déjà accordée de manière effective au Ghana et à la Guinée…
Situons chacune de ces étapes.
1.1 La tropicalisation des dissensions belges
La société belge avait ses problèmes et ses contradictions internes. Mais les Congolais en étaient si peu conscients, qu’ils continuaient à penser, du moins pour la plupart, que les Belges « étaient tous frères ». S’ils n’étaient pas ignorants de l’existence d’une langue flamande distincte du français, ils supposaient que cette seconde langue constituait le dialecte des Belges, de tous les Belges, et qu’ils en faisaient usage lorsqu’ils ne voulaient pas que les évolués comprennent le sens de leurs paroles. On supposait aussi, pour n’avoir pas eu la preuve du contraire, que tous les Blancs étaient des chrétiens, des collaborateurs des missionnaires. Les colons, les fonctionnaires coloniaux et les missionnaires s’étaient arrangés pour mettre cette solidarité apparente en avant. Pourtant la réalité n’était pas aussi sereine ; mais les observateurs autochtones s’en apercevaient à peine.
Tout changea après la guerre. Les colons, jusque-là exemptés de la participation aux élections métropolitaines, furent admis à s’occuper de la politique. Aussi, chaque syndicat, puis chaque parti politique se préoccupa de trouver son insertion dans la colonie, parmi les sujets belges d’abord et parmi les autochtones ensuite. Les affaires du Congo cessèrent ainsi d’être gérées à l’abri des passions politiques métropolitaines. L’opinion belge commença à se mêler de tout. Tout se passa comme si les différents partis… « prenaient brusquement conscience de leur paternel devoir de protéger les Congolais de la perdition dont l’horrible vision se profilait dans les programmes des autres partis » (Young C., 1968 : 95).
La gauche, jusque-là absente, jugea utile de s’impliquer à son tour et à sa manière dans l’aventure coloniale. Si elle s’intéressa plus particulièrement à l’enseignement, c’est parce qu’elle avait été jusque-là totalement écartée de ce secteur, qui constituait la chasse gardée de l’Eglise catholique, le cœur même de la politique de la droite. Les premiers remous datèrent de 1946, à l’avènement de Godding à la tête du ministère des Colonies. Il instaura un enseignement officiel laïc pour Blancs, ce qui incita les évolués à réclamer le même droit, pour se soustraire quelque peu au règne de la dictature cléricale. Mais la préoccupation du ministre se limita à répondre aux souhaits de certaines familles belges qui exigeaient la liberté du culte. Après la guerre, en effet, des Belges de toutes tendances politiques et philosophiques étaient venus s’installer au Congo ; ils faisaient pression pour échapper au carcan religieux mis en place dans la colonie. Les protestants en profitèrent pour faire subsidier leurs écoles, malgré la vive opposition de l’Eglise catholique. Le régime colonial ne pouvait oublier le rôle déterminant joué par les protestants anglo-saxons (Angleterre et USA) pendant la guerre pour la libération de la Belgique. 11 fallait donc leur manifester de la reconnaissance, surtout à une époque où les positions belges s’étaient suffisamment consolidées et où l’intervention de chacun s’avérait nécessaire.
La brèche s’élargit considérablement à partir de 1954, avec l’avènement au pouvoir, en Belgique, d’une coalition gouvernementale des libéraux et des socialistes, présidée par Achille Van Acker. Auguste Buisseret, libéral et franc-maçon, fut nommé ministre des Colonies. Son cabinet comptait plusieurs éléments anticléricaux, et il porta son action essentiellement sur l’enseignement. Une « mission pédagogique » fut aussitôt chargée d’enquêter sur la situation scolaire de la colonie. Elle ramena un rapport incendiaire, critiquant avec véhémence le monopole de l’Eglise catholique et soulignant avec vigueur les abus et situations scandaleuses que ce monopole avait suscités. Tout cela provoqua la réforme qui mit fin au monopole missionnaire en matière d’éducation par le développement de l’enseignement officiel laïc. Le réseau d’écoles officielles naquit dès 1954 avec la création des premiers « groupes scolaires » pour Africains à Léopoldville, Luluabourg, Stanleyville et Elisa- bethville ; chaque « groupe » comprenait des écoles primaires, une école technique et une école de moniteurs. En 1955, un second réseau fut créé à Lodja. Bukavu, Coquilhatville et Jadotville.
Le second secteur auquel Buisseret s’attaqua au cours de sa « guerre scolaire » fut le budget. Les missionnaires catholiques se taillaient la part du lion en matière de subsides, alors que les protestants n’avaient rien reçu jusqu’en 1946 et que le réseau officiel laïc était pratiquement inexistant. 11 décida de réduire sensiblement l’intervention financière de l’État dans les frais de fonctionnement des écoles missionnaires, y compris dans les salaires du personnel enseignant et les dépenses d’internat.
La réaction de l’Eglise fut vive. Les évêques, dans une déclaration publique, firent savoir qu’ils « se verraient dans la douloureuse nécessité de fermer toutes les écoles aussi longtemps que le gouvernement se dérobait à ses obligations » (Kita K.M.,1982 : 229). Face à une telle menace, la négociation s’imposait. Elle s’engagea à Léopoldville, entre le corps des évêques et le ministre lui-même. Un compromis fut adopté en faveur des missions qui conservèrent tous les droits acquis jusque-là en matière d’aide financière gouvernementale.
Mais l’œuvre majeure de Buisseret fut l’instauration d’un réseau officiel d’écoles, qui permit la réduction des prétentions missionnaires ; elle précipita aussi l’évolution des programmes et des structures scolaires de la colonie vers le modèle métropolitain. En effet, les écoles laïques n’eurent guère le souci d’adapter l’enseignement. Elles optèrent, dès le départ, pour les programmes belges. Aussi les athénées, créés en 1955, et les écoles normales officielles en 1958 furent-ils calqués sur le modèle des établissements belges du même genre. Cette situation faisait le bonheur des évolués, malgré la propagande menée contre ces écoles [1]. Les Congolais se réjouissaient de la création de ces écoles laïques, non pour des raisons idéologiques, mais parce qu’elles constituaient un apport en établissements d’enseignement et donc, une chance de plus pour la formation et la promotion de la jeunesse locale. La métropolisation du programme était pour eux la garantie d’un enseignement de qualité, censé mener au niveau des étudiants belges. Le succès des écoles laïques amena les missionnaires à se préoccuper à leur tour de réajuster les programmes de leurs écoles. La métropolisation des programmes se généralisa, les cycles d’humanités gréco-latines et modernes furent enfin ouverts aux Africains.
L’action de Buisseret avait ses limites. Sa position était délicate face à la question du racisme. Puisque les programmes étaient les mêmes, pourquoi ne pas fusionner les écoles entre Blancs et Noirs ? Il fallait montrer aux Noirs que l’on combattait le racisme, tout en ménageant la susceptibilité des Blancs. Cela se concrétisa par la création de deux types d’écoles coexistant dans chaque ville où l’enseignement laïc s’était implanté : l’athénée « royal » et l’athénée « interracial ». Même si les programmes étaient les mêmes, le premier était réservé aux Européens seuls, et le second aux Européens et non-Européens. Les autres écoles, créées avant Buisseret, fermées aux non-Européens, adoptèrent également ce système pour ne pas être en retard. Les enfants non européens, fils d’immatriculés ou de détenteurs du mérite civique qui fréquentèrent ces établissements, augmentèrent en nombre. Déjà en 1958, on dénombrait quelque 2 564 non-Européens dans les écoles interraciales (Kita K.M., 1982 : 237). Les écoles « laïques » étaient mixtes. Elles assurèrent ainsi, pour la première fois, la promotion de la jeunesse féminine, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes exigences que la jeunesse masculine. En 1955-56, les filles représentaient 20,3 % des effectifs ; en 1958-59, elles atteignirent 28,2 % (Mutamba M., 1977 : 280). L’introduction du modèle métropolitain ne fit aucune concession aux autochtones : non seulement les réalités de leur milieu ne furent pas prises en compte mais l’enseignement de la langue néerlandaise leur fut imposé comme aux enfants belges. Buisseret s’était gardé d’éveiller la susceptibilité des électeurs flamands en offrant un prétexte quelconque à un sursaut de la querelle linguistique. Du reste, les Congolais comprenaient à présent de mieux en mieux le déroulement de la querelle existant dans la métropole, et dont certaines phases se déroulaient sous leurs yeux. Il y avait deux grands types d’opposition : Flamands contre Wallons, et libéraux et socialistes contre catholiques.
L’avènement de Buisseret avait souligné les dissensions qui pouvaient exister entre Bruxelles et Kalina, entre le ministre des colonies et le gouverneur général [2]. Les deux hommes en présence, Léon Pétillon à Kalina, Auguste Buisseret à Bruxelles, n’avaient rien en commun. L’un était un pur produit de l’administration coloniale, ancien chef de cabinet du gouverneur Pierre Rijckmans (1936), ancien vice-gouverneur général (1946), devenu secrétaire général au ministère puis gouverneur général du Ruanda-Urundi (1949) avant de remplacer Jungers en janvier 1952 à Léopoldville. L’autre était d’origine sénatoriale, gestionnaire des affaires coloniales pour un temps, hiérarchiquement supérieur, ayant la mainmise sur l’administration, le budget et le portefeuille colonial. Le conflit psychologique était aggravé par leurs origines politiques différentes ; il s’ajoutait à un antagonisme des pouvoirs : le ministre était membre du gouvernement et le gouverneur général était le représentant du roi dans la colonie. Le ministre, favorable à l’innovation, était freiné par l’administration coloniale, plutôt favorable aux missions. Il eut recours au « courrier parallèle », c’est-à-dire à des attachés de cabinet du ministre communiquant directement avec des fonctionnaires du gouverneur général, initiative que ne cessait de dénoncer Léon Pétillon. Buisseret fit systématiquement usage de son droit de contreseing sur les discours et les allocutions officielles de son gouverneur général qui, à ses yeux, n’avait pas de politique personnelle à faire prévaloir. Les divergences furent telles que le gouverneur général menaça de démissionner en juillet-août 1956 (Pétillon L., 1967 : 81-82, 108, 122-123, 200-303) [3].
Il faut surtout noter que ce conflit n’était pas inconnu des évolués les plus informés ; il constituait une preuve supplémentaire de la vulnérabilité du régime colonial.
C’est en pleine période de « guerre scolaire » qu’eut lieu la visite du roi, dans le but entre autres de reconstituer une unanimité coloniale déjà bien entamée. Les lettrés zaïrois suivirent cette pérégrination avec intérêt et circonspection. Les prédécesseurs de Baudouin Ier, à l’exception de Léopold II, avaient tous séjourné au Congo ; le prince Albert et la princesse Elisabeth s’y étaient rendus en 1908-09, et y retournèrent en tant que souverains en 1928 ; Léopold III avait effectué ce voyage, en 1925 et 1932 ; le prince régent Charles s’y rendit en 1947.
Le voyage de Baudouin fut reporté plusieurs fois, en 1952 puis en 1953 ; il l’effectua sous le signe de la réconciliation nationale, en mai-juin 1955. Ce fut incontestablement un succès, car « Bwana Kitoko » gagna effectivement la sympathie des Congolais. Ce succès personnel auprès des Congolais, Baudouin Ier allait le garder car, même au plus fort de la crise qui surviendrait ultérieurement, on manifestait un certain respect dès qu’il était question du roi [4]. Toutefois, ce voyage n’apporta aucun résultat concret malgré les nombreuses doléances présentées au roi, considéré comme le dernier recours pour apporter des solutions humaines à la situation des Congolais. Leur déception fut à la mesure de leur premier enthousiasme. Du moins le roi comprit-il que le problème le plus grave se ramenait à une question de relation entre Blancs et Noirs. Pour améliorer les conditions de logement, il créa le Fonds du roi, institution fondée par arrêté royal du 18 octobre 1955 (financée par le budget du Congo belge) dont le but était de « contribuer par des libéralités à l’amélioration de l’habitat des autochtones du Congo belge et du Ruanda- Urundi, appartenant tant aux milieux coutumiers qu’extra-coutumiers » (Derkinderen G., 1958 : 64-65). Mais ce programme était trop vaste pour être opérationnel. Aucun changement véritable ne se produisit. La visite royale fut surtout pour Baudouin une occasion de se faire apprécier. En définitive, les Congolais apprirent surtout au cours de cet épisode qu’il existait une pluralité de tendances parmi ceux qui les dominaient.
1.2 L’avènement de l’université
L’avènement du phénomène universitaire correspond à cette époque. Il s’est réalisé malgré le pouvoir colonial et grâce à la conjonction de deux volontés, celle des Congolais désireux d’être davantage instruits, à l’instar des ressortissants des colonies françaises et celle des catholiques de l’université de Louvain, décidés à prendre au sérieux leur mission d’universitaires et de citoyens belges au Congo. Puisque la genèse du phénomène universitaire au Congo est liée à la naissance de l’université Lovanium elle-même, il faut interroger des représentants de l’université de Louvain sur cette question [5].
D’après Monseigneur Luc Gillon, c’est à l’époque de l’EIC que remonte l’origine de la vocation «congolaise» de l’Alma Mater louvaniste, qui l’amena en 1886 à fonder le séminaire africain destiné à former des prêtres séculiers pour le service outre-mer. Cet établissement fut annexé ensuite par la congrégation de Scheut.
Une initiative plus précise dans ce sens date de 1924. A l’occasion des conférences du temps de l’Avent, l’orateur de l’année, un jeune jésuite dynamique, le Père Pierre Charles, souleva un enthousiasme tel pour les oeuvres missionnaires qu’on mit en place une structure concrète, l’Association Universitaire Catholique pour l’Aide aux Missions (AUCAM). Impatiente de montrer sa vitalité, la nouvelle association suggéra l’idée d’« une fondation médicale à ériger en terre congolaise » [6]. C’est ainsi que démarra à Kisantu, en 1927, la FOMULAC (Fondation médicale de l’université de Louvain au Congo), hôpital-école assurant à la fois la formation du personnel médical local et les soins de santé dans cette région où sévissait la maladie du sommeil. En 1931, la FOMULAC se dota d’un centre annexe à Katana sur les bords du lac Kivu ; un troisième centre devait voir le jour en 1939 à Kalenda, au Kasaï.
Un nouveau pas important fut franchi lorsque l’UCL décida de créer en 1932 un autre réseau de centres, agronomiques cette fois, estimant qu’il fallait non seulement guérir les malades mais aussi aider les populations à mieux vivre. Le premier CADULAC (Centre agronomique de l’université de Louvain au Congo) ouvrit ses portes à Kisantu en 1933. Les deux institutions cheminèrent ensemble et ambitionnèrent de former des assistants médicaux (1937) et agricoles (1949), le plus haut niveau de formation existant à l’époque pour les autochtones [7]. Pour soutenir ces initiatives, les anciens de Louvain oeuvrant comme coloniaux au Congo créèrent en mai 1942 une association appelée Louania, qui eut pour objectif de soutenir financièrement les fondations de leur Alma Mater. L’association édita également une revue du même nom (Yakemtchouc R., 1982 : 17). Mais on était encore loin d’une implantation universitaire proprement dite.
C’est alors qu’en 1945, le professeur Guy Malengreau de la Faculté de droit de Louvain proposa la création d’une Ecole supérieure des sciences administratives et commerciales, pour préparer les Congolais à assumer des fonctions administratives dans la colonie. Ce projet se concrétisa en 1947, et Kisantu se vit ainsi dotée d’une section administrative et commerciale, à côté des sections médicale et agronomique existantes. Les trois composantes furent alors qualifiées, à partir de 1948, de « Centre universitaire congolais Lovanium ». C’est à la suite de certaines pressions que ce centre put se transformer peu à peu en une véritable université. Déjà, son existence en tant que telle était un fait accompli que le système colonial se devait d’assumer.
L’Eglise catholique, quant à elle, fut à l’origine d’une autre initiative, sans doute plus directe : la création d’une université, grâce à l’intervention du premier délégué apostolique, Mgr J. Dellepiane. Sa motivation était strictement religieuse : il estimait que l’Eglise catholique devait poursuivre son oeuvre d’évangélisation dans l’enseignement en se préoccupant de former l’élite universitaire du pays, sous peine de voir ce rôle pris en main par les protestants ou les agnostiques. Il préconisa la création d’une « Université catholique du Congo belge et du Ruanda-Urundi » qui serait placée sous l’autorité des évêques du Congo belge et du Ruanda-Urundi et dirigée par les Jésuites en collaboration avec Louvain (Yakemtchouc R., 1983 : 19- 20). Son action servit à tout le moins à amener Rome à accepter une telle idée.
Un autre courant favorable à l’université provenait de la base des Congolais eux- mêmes. En effet, depuis 1947, devant l’insistance des évolués, le pouvoir colonial avait donné son accord pour la mise en place par les missions d’un réseau d’établissements d’enseignement secondaire général, distincts des petits séminaires. Les premiers « collèges » pour Noirs furent ainsi créés. Les Jésuites ouvrirent les collèges de Kiniati dans le Kwilu (août 1947), et Mbanza-Mboma dans le Bas-Congo (août 1948), les Scheutistes en ouvrirent à Kamponde dans le Kasaï (janvier 1949), les Pères Dominicains à Dungu en Uélé (février 1949) et les Pères Blancs à Mugeri dans le Kivu (février 1950) (Yakemtchouc R., 1988 : 21). Au fil des ans, une question se faisait de plus en plus pressante : que ferait-on des diplômés de ces collèges, dont la première promotion était prévue pour 1953 ? Fallait-il les envoyer en Europe pour y poursuivre des études universitaires ou… créer une université sur place ?
A Louvain, on opta pour la création d’une université sur place, qui accueillerait non seulement les fils de colons, dont les collèges étaient opérationnels depuis des années (le collège Albert Ier existait depuis 1935), mais également les Congolais. Les plus grands défenseurs de ce grand projet étaient non seulement les Malengreau, père et fils, mais aussi le recteur de l’université, Mgr Waeyenbergh, qui s’employa à convaincre les évêques de Belgique (Gillon L., 1988 : 67-75). Il fallut attendre 1953 pour que le pouvoir colonial donnât formellement son accord. Cette autorisation s’accompagnait d’une réserve extrêmement significative : le ministre des Colonies de l’époque, André Dequae et son gouverneur général, Léon Pétillon, se mirent d’accord pour interdire absolument la création au Congo des Facultés de Droit et de Philosophie et Lettres (Monheim F., 1985 : 27).
L’avènement d’Auguste Buisseret faillit retarder encore les choses. Dans son souci de lutter contre le monopole de l’Eglise catholique, il souhaitait que la future université soit une institution d’Etat soutenue par les quatre universités belges (UCL, université de Gand, université libre de Bruxelles, université de Liège). Le débat qui s’engagea tourna court grâce à Achille Van Acker, soucieux, en tant que chef du gouvernement, de maintenir un climat d’entente avec Louvain. L’université Lovanium ouvrit ainsi ses portes en octobre 1954 sur la colline de Kimwenza (mont Amba actuel) sous l’administration d’un prêtre séculier issu de l’université de Louvain, Mgr Luc Gillon, qui prenait ainsi la relève des Jésuites. La pose de la première pierre du premier bâtiment académique de l’université (Faculté des Sciences) fut effectuée par le ministre des Colonies, Auguste Buisseret, le 26 septembre 1954 [8].
Le phénomène universitaire était né. L’émulation ferait le reste. Le ministre Buisseret, dans la mouvance des écoles laïques, pensa doter le pays d’une université non confessionnelle. On voulut d’abord la situer à proximité du Ruanda-Urundi, pour répondre aux critiques des Nations Unies, déplorant l’absence d’un cycle de formation supérieure dans les territoires sous tutelle. On opta finalement pour la capitale du cuivre. L’université officielle du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi, créée par le décret du 26 octobre 1955, ouvrit ainsi ses portes en novembre 1956. Puisque, dans ce contexte gouvernemental, il était de bon ton de ménager toutes les susceptibilités, Buisseret n’hésita pas à ouvrir à grands frais une section flamande, même si celle-ci ne comptait que deux étudiants [9].
Une élite nouvelle naquit ainsi, non seulement en Belgique mais aussi au Congo. En métropole, on comptait déjà en 1956 une poignée d’étudiants ; à côté de Thomas Kanza qui terminait sa licence en sciences psychologiques et pédagogiques, il y avait Paul Mushiete, Mario Cardoso (devenu depuis M. Losembe), Jonas Mukamba, Albert Mpase, Evariste Loliki, Albert Bolela, Charles Bokonga, Joseph Mbeka, Marcel Lihau à Louvain ; Justin Bomboko, André Mandy et Claude Mafema à l’ULB, tous inscrits de préférence dans des facultés interdites à Léopoldville : droit, sciences politiques et économiques, philosophie et lettres. Ces jeunes gens se retrouvèrent dans le sillage de quelques belges, « tiers-mondistes » acquis à l’idée du changement au Congo ou paraissant l’être : Guy Malengreau, le « créateur » de l’université Lovanium, Jacques Leclercq, professeur de droit naturel, Paul de Visscher, professeur de droit public, Jean Ladrière, philosophe. A Bruxelles, il y avait Arthur Doucy, professeur d’économie sociale et directeur de l’Institut de sociologie Solvay ; Jef Van Bilsen, l’homme du « plan de 30 ans », successeur spirituel d’Alfred Marzorati, premier gouverneur du Ruanda-Urundi qui devint professeur à l’ULB vers 1931 et dont les idées furent éclairantes quant à l’avenir de l’empire colonial belge. Van Bilsen avait fondé une cellule de réflexion dénommée « groupe Marzorati », pour étudier la question de la décolonisation au Congo. Un autre groupe actif fut celui de l’ « Association des Amis de Présence africaine » qui ouvrit une librairie (Livre africain) et une maison d’édition (Remarques africaines) : celle-ci accueillit les premiers écrits des Congolais, mais aussi des Belges qui osaient faire prévaloir l’optique résolument congolaise [10]. La cheville ouvrière avait pour nom Jan Van Lierde, déjà connu en Belgique pour son respect de la non-violence et son refus, en tant qu objecteur de conscience, de faire le service militaire. Avec Jules Gérard-Libois, ancien éditeur belge de « Témoignage chrétien », il créa en 1958 une société coopérative, dénommée « Centre de Recherche et d’Information Socio-Politique » (CRISP). La direction des publications fut confiée à Van Lierde. Dès l’année suivante, les premiers travaux sur la décolonisation congolaise furent publiés. Benoît Verhaegen allait s’illustrer comme le principal animateur de cette précieuse collection, de même que J. Gérard-Libois [11].
A Kinshasa, une élite universitaire prometteuse était en préparation. En 1954, Lovanium comptait 33 étudiants ; ce nombre passa de 87 en 1955-56, à 169 l’année suivante. En 1957-58, il atteignait déjà 249 et en 1958-59, 365. Les premiers licenciés furent diplômés en 1958, tandis que les premiers ingénieurs civils et docteurs en médecine ne furent inscrits au palmarès qu’en 1961 (Gillon L., 1988 : 113) [12]. En 1961, deux Congolais faisaient déjà partie du corps enseignant (Mulago V. et Lebughe D.). Quelques autres ne tardèrent pas à les rejoindre, notamment Mario Cardoso, Paul Mushiete, Martin Ngwete, et bien entendu, Thomas Kanza, le premier diplômé universitaire [13].
En fait, le pouvoir colonial ne savait que faire de ces premiers universitaires. C’est pourquoi l’université les engageait à son compte. Ainsi, Thomas Kanza fut d’abord engagé, à son retour d’Europe, comme enseignant à l’Institut Saint-Joseph et à l’Institut d’éducation physique. Mais il ne bénéficia pas du même traitement que ses collègues européens. Les étudiants de Lovanium protestèrent : aussi, pour mettre un terme à cette affaire, les autorités coloniales crurent-elles bon d’octroyer à Kanza une carte d’immatriculation, ce qui n’arrangea pas les choses. Pour finir, il fut intégré à l’université.
En 1958 commença à paraître Présence universitaire, la fameuse revue des étudiants de Lovanium qui servit de mode d’expression et de prise de conscience de cette jeune élite, et subsista jusqu’en 1971. Dès le début, son comité de rédaction compta les premiers acteurs universitaires du Congo contemporain : J. Mbeka, E. Tshisekedi, Th. Tshibangu (futur Mgr Tshibangu Tshishiku). Les premiers articles, émanant tant des étudiants que de quelques professeurs, posèrent les questions du développement de l’Afrique et du devenir de la société congolaise (Masala B., 1986) [14]. Du reste, c’est l’ensemble de l’université, y compris son recteur, qui fut mêlé au processus de décolonisation à venir. Déjà en 1956, plusieurs professeurs faisant partie des groupes et cercles d’études belgo-congolaises étaient préoccupés par des questions de décolonisation, notamment le « Cercle d’étude de Binza » (dont faisait partie le recteur lui-même) et le mouvement « Conscience africaine » où l’on retrouvait, parmi les conseillers, des personnalités telles que les professeurs Jean Nicaise, Jean Buchmann, Benoît Verhaegen. On sait que certains contribuèrent à la rédaction de la « déclaration gouvernementale » qui fut rendue publique en 1959 (Gillon L., 1985 : 151-152). Deux années plus tard, en juillet 1961, l’université aurait même à abriter une importante rencontre nationale – le Conclave de Lovanium – à l’issue duquel un gouvernement d’union nationale allait être créé après des mois d’une contestation provoquée par la révocation du premier chef de gouvernement. P.E. Lumumba, par le Président Kasa-Vubu.
Mais l’un des faits les plus marquants de l’histoire de l’université fut de posséder, dès 1959, un réacteur atomique, grâce au statut particulier du pays qui abrite Shinkolobwe, région originaire de l’uranium qui donna la victoire aux Alliés. Mgr Gillon lui-même nous a raconté la raison d’être de cette aventure. » Je savais qu’en compensation pour l’uranium cédé par l’UMHK durant la guerre, les Etats-Unis avaient mis à la disposition de la Belgique des sommes importantes pour le développement pacifique de l’énergie atomique. Il me paraissait normal que le Congo belge, d’où provenait cet uranium justifiant l’octroi des fonds, reçoive une part de gâteau » (1988 : 127). Mais il n’y eut pas de part pour le pays producteur de cet uranium. Le recteur, docteur en physique nucléaire, parvint quand même à obtenir l’achat par la colonie d’un réacteur de recherche de type TRIGA (Training and Research Reactor for Isotope production General Atomic) qui fut installé sur le terrain de l’université et qui allait fonctionner grâce à 50 kg d’uranium enrichi à 20 % obtenus des Etats- Unis, en réciprocité des services que la Belgique (et non le Congo) lui avait rendus pendant la guerre [15]. Premier pays africain à être doté d’un tel réacteur, le Congo fut ainsi propulsé dès la veille de son indépendance au rang des pays membres de l’Agence internationale de l’Energie nucléaire, avant l’Egypte (qui ne le fut qu’à partir de 1961) et l’Afrique du Sud (à partir de 1965). Le fait essentiel fut la montée de cette nouvelle élite autochtone qui, en 1961, allait déjà être confrontée à la dure réalité de la gestion de la crise, quand elle serait appelée à exercer le pouvoir en tant que commissaire général.
Le coup d’envoi de la revendication de l’indépendance fut donné en 1956, année charnière où cette revendication quitta définitivement le champ des pourparlers. Une conjoncture particulière s’y prêtait. Les évolués, friands de nouvelles internationales, étaient loin d’ignorer ce qui se passait, conscients du mouvement anticolonialiste qui prenait forme à l’ONU. Ils suivaient ce processus d’émancipation qui, après l’Asie, touchait l’Afrique : la Côte d’Or, futur Ghana, disposait déjà de son autonomie interne depuis 1951 ; des troubles graves secouaient le Kenya et l’Algérie, depuis 1953-54 ; la Tunisie, le Maroc, le Soudan avaient acquis leur indépendance au cours de l’année ; les souvenirs de la Conférence de Bandoeng qui avait eu lieu l’année précédente étaient encore vivants dans les mémoires.
Plus proche encore, la politisation de la colonie, inaugurée par A. Buisseret, faisait du chemin et la guerre entre les différentes factions coloniales était à présent effective. La visite royale, en s’efforçant de résoudre un problème, en avait créé d’autres ; non seulement son bilan était fort léger mais elle fut suivie de bien d’autres visites d’autorités belges. Chaque fois, rencontres et discours remuaient le couteau dans la plaie, sans jamais mettre fin résolument à ce jeu dangereux. Soulignons enfin que certains événements n’arrangeaient guère les choses. En effet, la France adopta à cette époque, plus précisément le 25 juin 1956, la loi Gaston Defferre pour ses territoires d’outre-mer et donc, pour le Congo-Brazzaville. L’ABAKO allait invoquer dans son contre-manifeste quelques dispositions de cette loi-cadre. De quoi s’agissait-il ? Depuis des décennies les colonies françaises avaient leurs représentants qui siégeaient à l’Assemblée française, au Conseil de la République, au Conseil économique et à l’Assemblée de l’Union française. De Gaulle n’avait-il pas déclaré, à la Conférence de Brazzaville (1944), qu’il n’y aurait aucun progrès tant que les ressortissants des colonies « ne pourront s’élever peu à peu jusqu’au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires » [16] ? Cette ouverture d’esprit créait déjà un réel complexe chez des évolués vis-à-vis de leurs collègues d’en face. Avec la loi-cadre de 1956, le fossé s’accentuait encore. A Brazzaville, on parlait de suffrage universel dans le choix des représentants au grand conseil de l’AEF, d’africanisation des cadres, et d’autonomie des territoires (Mutamba M., 1977 : 423). Puisque, au Congo belge, aucune réforme n’était en vue, il devenait plus que nécessaire d’en envisager une.
Les Congolais saisirent l’opportunité qu’offrait la parution du « Plan de trente ans » de Van Bilsen pour faire sentir la nécessité d’un changement, plus précisément pour faire prendre conscience à l’autorité coloniale que, là aussi, les choses devaient bouger. Ce complexe de Léopoldville à l’égard de Brazzaville n’aurait de cesse d’activer le processus de décolonisation. Ce qui était acquis sur une rive du fleuve devait l’être sur l’autre. « L’occupation de l’Afrique centrale a été commencée la même année par Stanley et Brazza ; sa libération doit, sans faute, être envisagée également à la même époque » [17].
2.1 Le plan de trente ans
C’est en décembre 1955 que paraît la version flamande du fameux « plan de trente ans » de Van Bilsen. Sa version française sortit de presse en février 1956. Ce texte, qui allait défrayer la chronique, suscitant un tollé général, n’était pas le premier projet élaboré par un Belge pour l’émancipation politique de la colonie. Son mérite provenait du fait qu’il était le premier texte du genre à avoir été utilisé et donc assumé comme tel par les autochtones noirs. En réalité, les idées émancipatrices ont toujours émaillé, ici et là, la période coloniale. Il suffit de rappeler ici les idées de P. Otlet qui, avant la fin du siècle précédent, préconisait l’autonomie de l’État léopoldien, forte d’une modernité qui aurait pu être amenée au cœur de l’Afrique par d’autres nègres, les Noirs Américains.
On ne s’arrêta pas là. Au cours de l’entre-deux-guerres, Paul Salkin, magistrat à Elisabethville, mena une étude prospective en tant que témoin des bouleversements causés par des poussées messianiques (Salkin P, 1926). « Ce livre, explique Delafosse dans la préface, n’est point une œuvre d’imagination, ni un roman prophétique ; c’est un aperçu, mûrement réfléchi, de l’aboutissement d’une évolution sociale dont la progression normale se trouve contrariée par des forces inadaptées au milieu dans lequel elles agissent ». Chose curieuse, la physionomie de ce « Congo dans cent ans » évoque l’image de ce que le Congo contemporain se proposera d’être : un pays africain développé suivant les principes qui lui sont propres.
La fin de la Deuxième Guerre mondiale vit apparaître dans les rangs des Belges un autre « prophète » de l’indépendance du Congo… en la personne d’un journaliste du « Courrier d’Afrique », Georges Caprasse. Dans la publication du 2 juillet 1946, on put lire cet article de sa plume :
L’État indépendant du Congo redeviendra un jour l’État indépendant du Congo, après s’être éloigné de ce statut dans le secteur de l’annexion et s’en être approché dans le secteur de la tutelle… Dans combien de temps ? De cette cadence accélérée de notre progression dans le passé, nous augurons que l’avenir prendra l’allure d’une course. Cent ans après la proclamation de Vivi, nous verrons la proclamation de Léo. Ce rythme est- il trop rapide ? Est-il souhaitable ? Nous n’en sommes pas les maîtres. De nous ne dépend qu’une chose ; que cette course s’accomplisse avec nous et non contre nous, que le galop ne donne à personne le vertige, mais laisse à tout le monde son sang-froid [18].
A l’époque, qui accorda la moindre attention à cette prédiction ? On sait que, dix ans après, cette analyse inspira Van Bilsen qui en retira plus d’une idée, y compris celle du délai de cent ans après Berlin, ce qui revenait exàctement à trente ans après 1955 ; l’échéance visée était celle de 1985.
Il y eut d’autres prémonitions encore. En effet, rappelons ici certaines réflexions d’universitaires belges qui, vers 1950-52, mirent en évidence l’importance de préparer les coloniaux à la gestion politique, l’imminence de l’autonomie de la colonie étant pour eux un fait acquis. Jean Nicaise, professeur au Centre universitaire de Kisantu, lors des « Journées académiques coloniales » (Koloniale Academische Dag) de l’université de Gand en 1949, ne mâcha pas ses mots. Dans la conférence qu’il donna sur « La formation politique des indigènes du Congo », il insista pour que la Belgique se mette à préparer l’émancipation du Congo, partant des obligations qu’elle avait contractées en 1946 en ratifiant la Charte de San Francisco. L’Association des anciens Etudiants de l’Institut universitaire des Territoires d’outre-mer (INUTOM), convaincue de l’importance extrême de la question, lança une enquête dans les pages du journal de l’association, « Problèmes d’Afrique centrale » pour connaître l’opinion des spécialistes de la question coloniale. Les réactions furent nombreuses [19], la plus critique étant celle de G. Malengreau qui, très réaliste, estima que l’émancipation politique se ferait avant terme (De Schrevel M., 1970 : 218). L’idée fit son chemin mais hélas, toujours limitée aux cercles universitaires. Les premières journées interuniversitaires d’études coloniales furent organisées en décembre 1952 ; M. Marzorati y traita de l’évolution constitutionnelle, G. Malengreau de la participation des indigènes à la vie politique, et G. Van der Kerken aborda la question du développement de l’économie congolaise (Mutamba M., 1977 : 397- 401).
Jef Van Bilsen se situait dans ce courant d’idées. Il eut le mérite de faire le point sur les problèmes de l’époque, mais aussi de se battre pour faire entendre, diffuser et surtout réaliser les solutions trouvées. Héritier d’un combat entamé avant lui, il passe pour avoir acquis, dans l’histoire, des mérites qui ne lui revenaient pas de droit. A se demander si ne s’est pas développé ultérieurement un mythe Van Bilsen (De Schrevel M., 1970 : 309). En fait, tout tient dans son fameux « Plan de trente ans », dont il est et demeure le créateur. Sa motivation ? Il voulait calmer les critiques de l’ONU contre son pays. La Belgique, bien que signataire de la Charte de San Francisco, ne manifestait aucun empressement à se conformer aux recommandations de l’ONU pour encourager la promotion politique des territoires sous sa domination. C’est donc pour préserver les intérêts de la Belgique qu’il entreprit sa croisade, donnant de nombreuses conférences et publiant des articles dans de nombreuses revues.
Bien avant la parution du Plan, il avait donc commencé à s’exprimer dans ce sens [20]. C’est dans son discours du 4 octobre 1954, lors de la séance d’ouverture de l’année académique de l’Institut de Formation sociale coloniale à Bruxelles, qu’on trouve les premières traces de son projet ; il y prônait la recherche de « solutions audacieuses et pacifiques devant les menaces qui s’accumulent depuis la guerre contre les régimes coloniaux » (1954 : 1). A partir de là, il ne cessa de multiplier ses écrits ; il commença par remanier le texte de la conférence et publia ce second article dans la Revue nouvelle [21]. On y retrouve les idées essentielles : la nécessité d’une politique « de rechange » et d’une attitude plus positive à l’égard des critiques de l’ONU, la mise au point d’un « timing » en vue de l’émancipation de la colonie.
Il faut que nous sachions où nous en serons dans cinq ans, lorsque les premiers universitaires seront formés, et dans dix ans et dans vingt ans. Nous devons avoir un plan précis et souple à la fois qui canalise les immenses espoirs qui germent et se développent dans les agglomérations indigènes grouillantes et dans les savanes de notre Afrique… Un plan du développement politique et de l’émancipation du Congo et du Ruanda-Urundi, un plan de trente ans serait aussi d’une immense portée psychologique intérieure et mondiale et contribuerait à nous dédouaner comme puissance coloniale dans un monde anticolonialiste (p. 409).
En 1955, à l’issue d’un voyage en Afrique où il visita aussi l’Afrique française et britannique, il consigna par écrit ses impressions de voyage, préconisant que l’Afrique belge s’efforce de combler son retard, notamment par l’organisation de conseils municipaux, la formation d’élites locales, l’adoption de statuts des villes. Il plaçait volontiers l’avenir de la Belgique et de ses anciennes colonies dans la perspective d’une confédération entre celle-ci et une grande fédération congolaise à édifier progressivement. C’est ici qu’il avança une idée qui inspirerait plus tard l’ABAKO et la CONAKAT, à savoir une reconnaissance progressive de l’autonomie de certaines régions au sein d’une fédération [22]. L’émancipation politique pourrait donc s’étaler dans le temps, et varier d’un territoire à l’autre, pour s’achever au terme des trente ans. Viendrait alors le temps de l’autonomie politique (Mutamba M., 1977 : 413).
Peu après, parut le « plan de trente ans » proprement dit, reprenant plus systématiquement les idées d’évolution émises jusque-là, avec l’argumentation évoquée plus haut. Pourquoi trente ans à priori ? Il semble que ce délai soit nécessaire à la bonne formation d’une génération de cadres. C’est du moins ce que l’on prétend (Monheim F., 1985 : 39). Nous avons vu que cela reprenait les délais évoqués par Caprasse. S’agit-il d’une simple coïncidence ? Nous ne le pensons pas. Ceci vérifie une fois de plus que les propos de Van Bilsen récapitulaient des idées préexistantes.
L’auteur de ce plan prévoyait également des étapes et les dispositions nécessaires. Il se prononça aussi pour l’introduction de partis politiques métropolitains et l’extension des activités syndicales belges à la colonie. Tout cela relevait, à ses yeux, de la préparation à l’autogestion.
Van Bilsen s’adressait là à ses compatriotes. Mais l’imprévu se produisit. Son discours fut entendu également par les colonisés et connut un plus large écho auprès de ces derniers. Ses propos se situaient à contre-courant, mais ils ne furent pas trop critiqués. C’est après coup, que Van Bilsen fut considéré comme un traître et un défaitiste, après que l’on eut appris l’accueil favorable que les Congolais avaient réservé à ces propos.
2.2 Le « Manifeste Conscience africaine »
La réaction la plus « constructive » aux idées de l’auteur du « Plan de trente ans » vint de Léopoldville, d’un groupe qu’il ne connaissait pas. Joseph Iléo, Albert Nkuli, Dominique Zangabie, Antoine Ngwenza, Victor Njoli et Joseph Ngalula formaient la Conscience africaine, une association constituée en 1951 autour de l’abbé Joseph Malula, vicaire à la paroisse Christ-Roi qui, répondant au vœu des évolués, donnait des cours du soir à ceux qui le souhaitaient. Les matières enseignées étaient la philosophie, la logique, la psychologie, l’économie et la sociologie. Le groupe devint finalement un « cercle de réflexion » ; tous étaient d’anciens élèves des Pères de Scheut. Du reste, ce qui n’était qu’une initiative ponctuelle devint un programme d’action. En 1954, en effet, à l’exemple des Amicales socialistes et de la FGTB- Congo, on créa dans les milieux catholiques de la capitale un Centre d’Etude et de Recherche Sociales (CERS) destiné à former une élite congolaise catholique. Cette formation se faisait en cours du soir, animés par certains professeurs de l’université Lovanium, notamment J. Buchmann, J. Nicaise, F. Herman et B. Verhaegen. Il va sans dire que les membres de Conscience africaine étaient les élèves les plus assidus de ce programme de cours et séminaires. Déjà en août 1953, le groupe décida de lancer un vrai journal bimensuel, dénommé également Conscience africaine, qui devait prendre la place des feuillets ronéotypés qu’il diffusait jusque-là. Trois ans après, le 30 juin 1956, veille de l’anniversaire de la proclamation de l’EIC, parut un numéro spécial. Sur la première page, un seul mot se détachait en manchette : « Manifeste ». Ce document, connu depuis lors sous le nom de « Manifeste
Conscience africaine » (combinaison du titre du texte avec celui du journal), fut tiré à 10 000 exemplaires et diffusé dans tout le pays, y compris au Katanga où il aurait été tiré une nouvelle fois à 10 000 exemplaires (Yakemtchouc R., 1983 : 45).
Personne ne s’y était trompé, l’événement était de taille. Jamais un document semblable n’avait été produit : il donnait le coup d’envoi de la revendication… à l’indépendance, même si le mot n’était pas encore à la mode [23]. De quoi était-il question dans ce document ? Les rédacteurs l’avaient subdivisé en 13 paragraphes ayant chacun un titre particulier : Notre vocation nationale, Unité dans la diversité, Une tâche exaltante à poursuivre, Communauté belgo-congolaise, Emancipation progressive mais totale, Emancipation politique, Emancipation économique et sociale, Notre attitude à l’égard de la Belgique, Ordre et respect de l’autorité, Appel aux Européens, Nécessité de l’union nationale, Comment réaliser cette union de tous ?, Appel aux Congolais.
En raison de l’importance historique de ce texte, qui constitue le premier discours politique des Congolais, une brève analyse en est nécessaire. Les rédacteurs commencèrent par situer l’importance de leur discours écrit par « un petit groupe » … mais exprimant « les aspirations et les sentiments de la majorité des Congolais qui réfléchissent » (p. 1). Leur représentativité ne pouvait donc être mise en doute. Le texte ne permet pas d’affirmer que les rédacteurs avaient effectivement pu lire le « Plan de trente ans » ; ils n’y font aucune référence précise et ne se prononcent pas sur les différentes opinions de Van Bilsen. Ils en avaient assurément entendu parler et exprimèrent surtout ce qu’ils en attendaient – preuve supplémentaire qu’ils n’avaient pas eu connaissance du texte de Van Bilsen, pour qui le plan n’était pas à élaborer mais déjà élaboré. Ce plan, écrivirent-ils, devait exprimer la volonté sincère de la Belgique de mener le Congo à l’émancipation politique complète dans un délai de 30 ans. Une déclaration sans équivoque sur ce point est le seul moyen de conserver la confiance des Congolais à l’égard de la Belgique (p. 2). Ils y apportèrent une exigence de taille, celle d’être associés à son élaboration. Ils prévinrent l’autorité coloniale en ces termes : … Sans cette participation, un tel plan ne pourrait avoir notre assentiment. Et d’ajouter : nous ne voulons pas que l’indépendance politique ne soit en réalité qu’un moyen de nous asservir et de nous exploiter (p. 2).
Plus loin, ils proclamaient leur foi en l’avenir :
Le Congo était appelé ‘à devenir’ une grande nation. C’est aux Congolais seuls qu’il revenait d’entreprendre cette oeuvre, aidés par les Européens qui pouvaient être intégrés à condition de renoncer à des préjugés et à des privilèges. La couleur de la peau ne confère aucun privilège. En dehors de ce principe, l’Union est impossible (p. 1).
Les élections devaient remplacer le système des nominations. Le manifeste se prononça contre la nationalisation des grandes entreprises mais sollicita des crédits en faveur « des classes moyennes », dont le salaire minimum devait être relevé rapidement et sensiblement.
Au chapitre des rapports ultérieurs entre le Congo et la Belgique et donc, à propos de la communauté belgo-congolaise, l’analyse était des plus lucides. Ils émirent le vœu qu’une telle communauté … soit un jour le fruit d’une libre collaboration entre deux nations indépendantes, liées par uné amitié durable (p. 3). Enfin, comme dans une encyclique ou une lettre épiscopale, le manifeste se terminait par deux « appels » successifs. « L’appel aux Européens » fut rassurant, expliquant que ces idées étaient inspirées, non pas par la haine mais par la fraternité et la justice. Les Européens qui le souhaitaient pourraient devenir Congolais à part entière. Quant à « L’appel aux Congolais », il était un hymne à l’unité entre Congolais et Européens de bonne volonté. « Unis nous sommes forts, divisés nous serons faibles. C’est l’avenir de la Nation qui est en jeu » (p. 4). Cet impératif amenait à prendre position contre l’introduction du multipartisme belge au Congo. « Notre position est nette : ces partis sont un mal et ils sont inutiles » (p. 4). « Conscience africaine » recommandait plutôt la création d’un vaste mouvement national populaire : « Nous sommes convaincus qu’il est fort bien possible à des païens, à des catholiques, à des protestants, à des salutistes, à des musulmans… de s’entendre sur un programme de bien commun… ». Le multipartisme était relégué à une étape historique ultérieure et, à ce moment-là, « les partis spécifiquement congolais ne se calqueront pas sur les partis de Belgique » (p. 4).
Ce document fut un événement, non seulement par la compréhension des faits qu’il manifestait, mais surtout par le courage dont il faisait preuve et la justesse de ses vues, mis en évidence par le ton modéré qui avait été adopté. Ce qui est sûr, c’est qu’il surprit et mit mal à l’aise. L’autorité coloniale préféra se taire sur son contenu. Tous les commentaires se portèrent sur l’identité des signataires, qui furent considérés comme les auteurs présumés du texte. On chercha les « vrais » rédacteurs « coupables » du document parmi les Belges, les professeurs de Lovanium négrophiles : Nicaise et Buchmann, auxquels fut joint l’animateur de la JOC, M. Meert. Iléo et ses amis expliquèrent que l’initiative et la rédaction leur appartenaient, mais qu’ils avaient sollicité la collaboration de ces quelques Belges pour la correction du langage et la mise en forme du document.
Le fait de chercher les véritables rédacteurs en dehors des rangs congolais prouvait une fois de plus que l’autorité coloniale continuait à minimiser les élites autochtones et à sous-estimer leur prise de conscience. A cause de ce manque de réalisme, la Belgique rata encore une fois le rendez-vous que lui offrait l’Histoire. « Il faut que les Belges comprennent dès maintenant que leur domination sur le Congo ne sera pas éternelle » (p. 2). Tout tient à cette vérité qui ne fut jamais perçue. En effet, treize jours avant la parution du manifeste, Pétillon ne réagissait toujours pas aux signes du temps ; il fit une brève allusion aux « suggestions utopiques de certains » [entendez Van Bilsen] [24]. Plus tard, l’ancien gouverneur général s’expliquera dans son Témoignages et réflexions à propos de l’audience que l’auteur du « Plan de trente ans » ne pouvait pas avoir à l’époque. « 11 faudrait ne pas avoir le sens des réalités pour considérer que le simple énoncé d’idées d’un homme (Van Bilsen) encore peu connu à l’époque, suffirait à provoquer, au profit d’une politique dont la perspective faisait peur, le renversement immédiat de celle qu’on avait jusqu’alors poursuivie » (Pétition L., 1967 : 361). Un fait est certain : si l’indépendance avait été préparée dès ce moment par une politique hardie de promotion des élites autochtones, la colonisation belge, de toute évidence, aurait connu un sursis. Mais il n’en fut rien. Les événements allaient se précipiter.
2.3 La Déclaration de l’Episcopat du Congo
La veille de la parution du » Manifeste Conscience africaine », le 29 juin, parut un autre document de portée historique. Il s’agit de la « Déclaration de l’Episcopat du Congo belge et du Ruanda-Urundi » qui touchait également aux problèmes socio- économiques de l’époque [25]. La double publication le 2 juillet dans la presse kinoise du « Manifeste Conscience africaine » et de la Déclaration de l’Episcopat ne manqua pas de faire sensation, surtout que dans l’un et l’autre document, il était question de l’« émancipation » du peuple congolais. Le silence était rompu brutalement par deux discours de contestation, issus des milieux catholiques.
Comment comprendre le point de vue des 37 Ordinaires de l’Afrique belge à l’issue de leur Conférence plénière qui s’ouvrit le 21 juin sous la présidence du délégué apostolique ? L’Eglise du Congo, plus lucide que le système colonial, se rendait bien compte qu’une mutation était en cours et que tôt ou tard, et sans doute plus tôt qu’on ne pensait, les Africains allaient prendre en main le destin de leur pays. Il ne fallait pas être prophète pour le savoir. Dans le nord du continent, le Maroc et la Tunisie venaient d’accéder à l’indépendance les 2 et 20 mars. La guerre pour l’indépendance faisait rage en Algérie depuis deux ans. Plus proche encore, le Soudan (anglo-égyptien) avait accédé lui aussi à l’indépendance dès janvier ; la Côte d’Or (futur Ghana) de Kwame Nkrumah venait d’obtenir son autonomie et allait devenir indépendante quelques mois plus tard, le 6 mars 1957… L’Eglise du Congo était sensible à ce courant, comme elle l’était à la propagande islamique lancée depuis Le Caire, qui touchait particulièrement les populations du Congo oriental. Ce danger communiste qu’on confondait volontiers avec l’anticolonialisme, acquérait une plus grande consistance, suite à l’apparition du groupe afro-asiatique depuis Bandoeng (Guitard O., 1969). Tout cela était dans l’air. Aussi l’Eglise jugea-t-elle bon de prendre ses distances par rapport au pouvoir colonial, espérant ainsi se soustraire à la débâcle, au moment où celle-ci surviendrait. Cette lucidité tardive se manifestait à la faveur de l’avènement de Buisseret et de l’existence du conflit scolaire. L’Eglise catholique était longtemps restée pieds et poings liés, à la merci du pouvoir colonial. Les évêques proclamèrent enfin :
Tous les habitants d’un pays ont le droit de collaborer activement au bien général. Ils ont donc le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques. La nation tutrice a l’obligation de respecter ce droit et d’en favoriser l’exercice, par une éducation politique progressive. Les autochtones ont l’obligation de prendre conscience de la complexité de leurs responsabilités et de se rendre aptes à les assumer. L’Eglise n’a pas à se prononcer sur les modalités de l’émancipation d’un peuple. Elle le considère comme légitime du moment qu’elle s’accomplit dans le respect des droits mutuels de la charité (p. 452).
Ils condamnèrent le racisme, critiquant « les outrances d’un paternalisme qui, à la longue, risque de réduire dangereusement les libertés de l’homme et de sa famille ».
La déclaration eut pour effet de distendre de plus belle les liens qui subsistaient entre l’Eglise et l’État, déjà plus lâches depuis la guerre scolaire. L’État ne s’en retrouva que plus isolé, incapable de se concilier les bonnes grâces des protestants trop longtemps négligés.
Quant à l’Eglise, passant des paroles aux actes, elle amorça une politique sensiblement nouvelle, plus bienveillante à l’égard de la promotion des autochtones. Cette même année, Pierre Kimbondo fut sacré évêque (novembre 1956). Deux autres prélats allaient l’être trois ans plus tard : J. Nkongolo (juillet) et J. Malula (septembre 1959). Dès juillet 1956, l’Eglise s’octroya une agence de presse autonome, le « Bureau de Presse pour la Documentation et l’Information en Afrique » (DIA).
En Belgique, la position de l’Eglise catholique du Congo fut considérée comme une « fuite en avant », après le coup de poignard porté dans le dos au pouvoir colonial (Mutamba M., 1977 : 458). Les Congolais, quant à eux, se réjouissaient de ce renfort inespéré. En réalité il n’était valable qu’au niveau des vicaires épiscopaux. Le missionnaire moyen ne pouvait opérer une telle reconversion en quelques jours, et même pas au long des quatre années que la colonisation allait pouvoir encore vivre. Aussi le quotidien demeura-t-il inchangé.
On peut s’interroger sur les motivations profondes de ce changement d’attitude. Il semble avoir été purement tactique, histoire de se soustraire au camp des perdants, puisque pendant des décennies, on n’avait rien trouvé à redire au comportement colonial ni à son action. Les attaques scolaires de Buisseret ont pu fournir le prétexte nécessaire à cette volte-face. Malgré son caractère démagogique, la position de l’Eglise ne faisait que confirmer l’effritement de l’ordre colonial, miné par les assauts menés par des autochtones mais aussi par ses propres contradictions et les dissensions de la métropole [26].
2.4 Le manifeste de l’ABAKO
Le manifeste de l’ABAKO est appelé généralement le « Contre-Manifeste », parce qu’il voulait prendre le contre-pied du « Manifeste Conscience africaine ». Effectivement « Conscience africaine » avait conclu son manifeste par une invitation à la réflexion et au dialogue, notamment sur l’opportunité de créer un « mouvement national populaire ». Le 16 juillet, une assemblée générale extraordinaire de l’ABAKO est convoquée dans le but d’étudier ce manifeste et de déterminer le point de vue du groupe. Le rapport de cette concertation fut lu au cours de l’assemblée générale du 23 août par le président du comité central, Joseph Kasa-Vubu, en présence du commissaire de district urbain, M. Tordeur, et d’un représentant du gouverneur général. Le contre-manifeste adopta un profil plus radical encore, manifestement en guise de réponse au groupe « Conscience africaine » qui était son adversaire objectif en tant que porte-parole de la cause congolaise. Elle craignait de voir l’autre groupe s’emparer de ce leadership. La concurrence était de taille, d’autant que « Conscience africaine » était composée de « Bangala » et de « Baluba », ces « étrangers » qui détrônaient les autochtones bakongo sur leur propre terrain avec la complicité de l’autorité coloniale.
La réaction abakiste se voulait une œuvre d’érudits et, en tant que telle, comportait une série de citations, ce qui n’était pas le cas de la première parution. En effet, on invoquait ici l’autorité morale de plusieurs personnalités, notamment Pierre Ryckmans, J.J. Rousseau, A. Marzorati, Léopold II… et surtout J. Van Bilsen dont le « plan » avait été étudié de manière fouillée. Outre l’introduction, l’exposé comprenait deux parties : l’une consacrée aux questions politiques (plan de trente ans. Union congolaise, communauté belgo-congolaise), l’autre plus restreinte portait sur des questions socio-économiques (cadres, politique scolaire, etc.) [27].
Sur plusieurs points, l’ABAKO clama son désaccord avec « Conscience africaine », ainsi à propos du multipartisme, qu’elle considérait, à l’inverse de l’autre groupe, comme une nécessité. Prôner l’émancipation totale en prenant position contre l’introduction des partis politiques était à ses yeux une contradiction. Elle ne voyait pas d’inconvénient à ce que les premiers partis soient une émanation de ceux de la métropole, les partis spécifiquement congolais ne pouvant émerger que plus tard. Le second désaccord concernait le « plan de trente ans ». Si « Conscience africaine » reconnaissait sa pertinence et sollicitait seulement d’être associée à son élaboration, le contre-manifeste rejetait l’idée même d’un plan. Pour nous, nous n’aspirons pas à collaborer à l’élaboration de ce pian mais à son annulation pure et simple parce que son application ne ferait que retarder le Congo davantage… Puisque l’heure est venue, il faut nous accorder aujourd’hui même l’émancipation plutôt que de la retarder encore de trente ans. C’est ici que la citation de P. Ryckmans intervenait : « Des émancipations tardives, l’Histoire n’en a jamais connu, parce que quand l’heure est venue, les peuples n’attendent pas ».
La revendication pour l’émancipation immédiate n’était pas un euphémisme. L’ABAKO s’estimait prête à ce que l’indépendance soit accordée du moins sur le Bas-Congo. Il n’est donc pas invraisemblable, comme le note M. Gilis, que l’ABAKO ait adressé une pétition aux autorités coloniales dans laquelle elle réclamait l’autonomie du Bas-Congo, sous l’égide directe des Nations Unies (Gilis M., 1964 : 78-80). Le projet n’avait rien de farfelu ni peut-être de sécessionniste, si l’on tient compte de la vision globale que cette formation avait de l’avenir du pays. En effet, l’ABAKO prônait le fédéralisme – ce qui constituait un troisième désaccord avec « Conscience africaine » – et concevait assez aisément que chaque Etat fédéral accède en temps voulu à l’autonomie, jusqu’à ce que tous atteignent ce stade, et que l’Etat fédéral puisse ainsi s’autogérer de manière effective [28].
Là où les deux documents se rejoignaient, c’était d’abord sur la nécessité de mettre fin au régime colonial, et d’amorcer une politique d’émancipation qui devait se traduire au moins par l’octroi des droits politiques et des libertés fondamentales, l’africanisation des cadres et l’évolution des institutions existantes. Ils étaient unanimes aussi pour rejeter le projet d’établissement d’un lien institutionnel devant unir le Congo à la Belgique. Un tel lien, estimaient-ils, ne pouvait s’amorcer sans l’accord explicite du futur Congo indépendant. Enfin, les deux manifestes s’accordaient aussi pour réclamer la révision de la politique salariale, la suppression de la discrimination raciale et du paternalisme (De Schrevel M., 1970 : 339).
Dans l’ensemble, la revendication était la même, seuls les tons étaient différents. Certes, les modalités de gestion de cette autonomie étaient perçues différemment. Mais qu’à cela ne tienne, cela relevait d’un autre débat, en principe, qui ne concernait pas le colonisateur. Le pouvoir colonial avait au moins compris une chose : qu’il devait de toute urgence lâcher du lest, pour atténuer les effets des revendications.
3 DANS LA MOUVANCE DE L’INDÉPENDANCE
3.1 Les signes du temps
Les Congolais avaient parlé et posé, de manière explicite, le problème de leur autonomie. Ce nouveau discours continua à prendre forme dans la rue, dans la chanson, dans les graffiti. La mutation se propagea dans le secteur de la presse, où un clivage se marqua entre la presse officielle, qui reflétait la vision gouvernementale et se montrait accommodante à son endroit, et la presse privée, anti-conformiste, empruntant volontiers le langage frondeur.
La presse officielle était la mieux représentée. Au recensement du 1er mars 1958 du commissariat général à l’Information, il existait 332 publications de presse, dont un tiers était composé de publications gouvernementales (12 publications officielles et 97 bulletins d’information générale), un quart de publications religieuses et scolaires, un sixième de publications professionnelles, techniques et culturelles, un huitième de publications d’information générale privée (9 quotidiens et une vingtaine d’hebdomadaires) et un huitième de publications variées. Quelques autochtones se trouvaient à la tête de certains organes contrôlés par le gouvernement, les missions ou les intérêts privés. Il s’agissait entre autres, outre la Voix du Congolais et de Etoile-Nyota, du bimensuel Nos images et de l’Actualité congolaise qu’éditait le gouvernement, du bimensuel Nsango ya biso de la Force publique ; de l’hebdomadaire catholique La Croix du Congo que dirigeait José Lobeya ; de Kongo ya sika que les Scheutistes lancèrent le 1er janvier 1948 ; de Présence congolaise qui démarra en 1957 comme supplément hebdomadaire au Courrier d’Afrique, dirigé par Joseph Ngalula, ancien rédacteur de « Conscience africaine » ; de Hodi des Pères Blancs, dirigé depuis Bukavu, où il était édité par Jean-Marie Kititwa (Artigue P., 1961 : 159 ; Mabi M. et Mutamba M., 1986 : 313-314).
Il faut noter aussi que la presse coloniale, destinée au public européen, ouvrit ici et là ses colonnes aux collaborateurs africains. C’est ainsi qu’Evariste Kimba fut admis à l’Essor du Congo à Elisabethville dès 1954 et que Mwissa Camus fit ses premières armes au » Couraf » avant de s’occuper de Horizons à partir de juillet 1959, une nouvelle appellation de La Croix du Congo. L’Avenir, quotidien kinois d’opinion libérale, accueillit aussi dès 1956 une série de collaborateurs africains, parmi lesquels Philippe Kanza, fils de l’un des conseillers de l’ABAKO (Artigue P., 1961 : 125-128) et Joseph Désiré Mobutu à partir de 1957, après son service de sept ans dans la Force publique (Artigue P., 1961 : 216-219 ; Mabi M. et Mutamba M., 1986 : 13-18).
La presse dite « locale », dans laquelle commença à s’exprimer le langage de l’indépendance comprenait, outre Conscience africaine, les périodiques de l’ABAKO, l’association culturelle la plus organisée : Kongo dia Ngunga (1953) et Congo pratique (1954), qui furent remplacés en 1959 par Kongo Dieto et Notre Kongo [29].
Mais le périodique à retenir comme témoin véritable de l’époque, c’est en réalité Congo. Il fut lancé en mars 1957 par six jeunes intellectuels congolais, parmi lesquels Mathieu Ekatou et les frères Kanza, Philippe et Thomas. Le journal se considérait comme le « premier hebdomadaire congolais appartenant aux Africains » et le « premier hebdomadaire indépendant dirigé uniquement par des Noirs ». Son ton nouveau tranchait nettement avec celui, plus classique, de la « Voix du Congolais », qui se voulait déférent vis-à-vis de l’autorité coloniale, voire obséquieux. Ici, point de style emphatique ni de lyrisme naïf et bon enfant. Les rédacteurs n’avaient guère le temps ni le loisir de faire de l’art pour l’art. On faisait de la politique, recourant volontiers à des pseudonymes pour signer des chroniques aux titres fort révélateurs : « La mwamba du samedi », « Les conseils désintéressés d’un nègre », « La voix des nègres de Mwene Ditu », « Les notes de Moto-Kodi sur la loi du plus fort », « Molangi- ya-pembe a remarqué », « Azanga Nzungu a vu » … [30]. Ce journal effrayait le pouvoir en place. Aussi, l’autorité coloniale constitua-t-elle une équipe de journalistes congolais modérés, à qui on donna les moyens de lancer un journal qui s’appela Quinze, hebdomadaire africain illustré lancé le 12 juillet 1957. On relevait, parmi ces modérés, quelques noms connus, entre autres Denis Sakombi et Jean-Jacques Kande, un dissident du premier groupe (Artigue P., 1961 :122 ; Mabi M. et Mutamba M., 1986 : 162-163). De toute évidence, le pouvoir colonial cherchait une occasion pour mettre un terme à la parution du Congo. Elle se présenta en août 1957, lorsque Kande fit pour Quinze un reportage sur « Les fumeurs de chanvre à Léopoldville ». Il expérimenta le stupéfiant et s’en vanta dans son article, concluant que le chanvre n’intoxiquait pas et que c’était un puissant tonique qui « donne le goût au travail et ouvre l’appétit » [31]. Il fut arrêté et on le somma de dénoncer ses complices, ce qu’il refusa de faire, prétextant le secret professionnel. Aussitôt une pétition fut adressée au gouverneur général, protestant pour qu’on délivre le journaliste. Congo eut la mauvaise idée de publier cette lettre dans son numéro du 24 août, tandis que Quinze consacrait son n° 7 à l’affaire Kande. Le pouvoir colonial trouva là une raison suffisante pour mettre fin à ces publications : il retira aux deux périodiques l’autorisation de paraître. Il ne revint pas sur sa décision, malgré les protestations de l’ABAKO et le recours introduit auprès du ministre Buisseret. Le numéro 22 du 24 août demeura la dernière parution du journal (Mutamba M., 1977 : 490-510).
Au-delà des discours, une autre forme de combat s’instaura dans les rapports avec l’autorité coloniale. La mutation qui s’opéra à cet égard dans le domaine syndical est très révélatrice. En 1956-57, sa manière d’opérer changea du tout au tout. Pendant longtemps, la revendication s’était située au niveau de la constitution de syndicats mixtes ; il s’agissait de combattre la discrimination et de prôner une égalité des avantages sociaux entre Blancs et Noirs. Mais les choses changèrent. L’APIC prit conscience de sa spécificité d’être le seul et vrai syndicat des Congolais et elle entendit exercer pleinement sa responsabilité.
La lutte pour l’instauration de la liberté syndicale absolue au Congo, tant pour les Noirs que les Blancs, fut le fait non seulement des Congolais mais aussi des milieux des syndicats belges. C’est suite à la menace de la FGTB de faire proclamer par le Parlement belge la liberté syndicale au Congo que Buisseret, craignant de se faire prendre de vitesse, déposa un projet de loi dans ce sens au conseil de gouvernement. Le 25 janvier 1957, deux Décrets furent prononcés, consacrant la légalité des syndicats tant pour les agents de l’administration et de l’ordre judiciaire que pour le reste des habitants. C’est ainsi que la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGCL) s’installa au Congo en avril 1957, et que les sections congolaises de la Fédération générale des Travailleurs de Belgique (FGTB) et la Confédération des Syndicats chrétiens du Congo (CSCC) s’instaurèrent en syndicats mixtes. Certains Congolais parvinrent à une position élevée au sein de ces structures, notamment Alphonse Nguvulu, Cyrille Adoula, Raphaël Bintou (FGTB) et Jacques Massa, Albert Nkuli et Dominique Zangabie (CSCC).
Mais cette grande victoire syndicale cachait un inconvénient qui fut dénoncé par l’APIC. Les factions congolaises de la CSCC et de la FGTB étaient trop liées aux maisons mères, ce qui devenait fâcheux dans un combat qui opposait de plus en plus colonisés et colonisateurs. En tant qu’unique instance syndicale à ne pas recevoir ses consignes de l’étranger, l’APIC-Léopoldville que dirigeait Arthur Pinzi depuis 1954, devint menaçante dans ses revendications de juin 1956 au Conseil de gouvernement. Buisseret, secoué d’autre part par la parution du « Manifeste Conscience africaine », adopta une attitude démagogique. Il invita une délégation de cinq membres de l’APIC pour un échange de vues à Bruxelles. L’APIC réclamait que les Congolais qui occupaient des fonctions exercées jusque-là par des Blancs aient droit à des avantages égaux à ceux accordés aux fonctionnaires engagés sur place. Le voyage en Belgique fut une simple opération de charme qui ne changea rien au fond du problème. Elle contribua tout au plus à aggraver le conflit existant entre Kalina et Bruxelles et obtint une augmentation de salaire pour les grades inférieurs de l’administration publique. L’essentiel pour l’APIC était quelle entendait hausser le ton en tant que seule structure pouvant se permettre d’aller loin dans le durcissement des positions. Il était donc nécessaire quelle s’organisât mieux.
Elle obtint, pour la première fois, de tenir son Congrès national. Il eut lieu du 30 avril au 6 mai 1957, regroupant des délégués venant des six provinces et qui jusque-là, ne se connaissaient que de nom : Pascal Luanghy (Katanga), Alphonse Songolo (Province orientale), Dominique Manono (Kasaï), Edmond Rudahindwa (Kivu) (Artigue P., 1961 : 174-175, 200, 286-287, 295-296). A l’issue du congrès, le comité de la province de Léopoldville qui résidait à la capitale devint le comité central de l’APIC. Arthur Pinzi devint donc le président général, Maximilien Liongo vice-président général adjoint, Damien Kandolo secrétaire général, Ambroise Salumu trésorier général, Paul Bolya trésorier général adjoint et Armand Bobanga secrétaire de rédaction du bulletin de l’association (Artigue P., 1961 : 355-356, 169,123, 288-289,47-48, 39).
En juin-juillet, l’APIC se fit représenter par son président général et son adjoint au Conseil supérieur de Consultation syndicale à Bruxelles. Consciente de ses responsabilités en tant qu’interprète de l’opinion congolaise, elle fit des réclamations précises qui furent percutantes : instauration d’un statut unique entre agents belges et congolais ; réunion du barème suivant le principe « à qualification égale, travail égal et salaire égal » ; abolition de la prime d’expatriation. Elle fit même davantage ; dans une lettre adressée au ministre Buisseret, elle prit position contre la persécution des kimbanguistes, réclamant la libération de 37 000 chefs de famille tenus en relégation uniquement pour leurs convictions religieuses. Il n’y eut pas de suite concrète à ces différentes revendications pertinentes dont certaines pourraient être considérées aujourd’hui comme utopiques – l’égalité de salaire entre personnel autochtone et expatrié – parce qu’elles ont continué jusqu’au seuil de la quatrième décennie de l’indépendance. Mais une chose était cependant acquise : la revendication des autochtones avait cessé d’être misérabiliste, implorant la pitié du Blanc tout-puissant ; elle avait acquis des accents syndicalistes.
3.2 Le premier exercice de la démocratie
Le symbole le plus représentatif de ces temps nouveaux fut sans conteste la première expérience des élections que les Congolais eurent à vivre en 1957. Non seulement elle constitua en soi un acte inédit mais, de plus, elle conditionna la mise en place des institutions nationales des années 1960.
Le fait même des élections constituait l’aboutissement de certaines réformes annoncées depuis de nombreuses années, le soubassement de la fameuse « communauté belgo-congolaise ». Cette communauté avait beau être contestée, l’administration Pétillon était tellement convaincue de sa pertinence quelle voyait dans sa réalisation un remède aux tensions, même les plus intempestives. Mais c’était là l’ère des « réponses tardives », qui eurent pour seul mérite celui d’avoir existé (De Schrevel M., 1970 : 374-403).
S’étant enfin décidé à entamer, comme promis, la construction d’un État congolais, futur partenaire de la Belgique dans la Communauté à venir, on s’était imposé de commencer par la création de la structure organique de base ; d’où les deux Décrets du 26 mars et du 10 mai 1957, établissant les institutions urbaines et rurales. La nouvelle organisation urbaine, après de multiples tergiversations, s’était fixée en une structuration par communes, chapeautées par un conseil urbain. Bien qu’il existât trois types de communes, africaines, européennes et mixtes, elles devraient toutes comprendre un conseil communal élu et un bourgmestre nommé par le gouverneur de province sur proposition du conseil communal. Ainsi, Léopoldville fut subdivisé en huit communes indigènes (Kintambo, Saint-Jean, Kinshasa, Barumbu, Dendale, Kalamu, Ngiri-Ngiri, Bandalungwa), une blanche (Kalina) et deux mixtes (Ngaliema et Limete). Au-delà des communes, il existait un conseil urbain regroupant les différents bourgmestres mais dirigé par un premier bourgmestre qui, lui, était un fonctionnaire d’État et par définition, un Belge.
Cette gestion décentralisée supposait donc l’organisation des élections en vue de la désignation des membres des conseils communaux. Pour contourner l’objection juridique de l’article 22 de la Charte coloniale qui interdisait la délégation du pouvoir législatif, on parla de « consultations », bien que le contenu fût, effectivement celui des élections. L’ordonnance d’exécution du 29 septembre 1957 accordait en effet le droit d’éligibilité à toute personne de sexe masculin ayant atteint l’âge de 25 ans (Young C., 1968 : 75-80). On décida que cette importante réforme serait mise à exécution progressivement. L’expérience pilote fut prévue pour décembre 1957 à Léopoldville, Elisabethville et Jadotville. Elle fut étendue en 1958 à quatre autres cités : Coquilhatville, Stanleyville, Bukavu, Luluabourg et continua à Léopoldville dans deux nouvelles communes : Matete et Ndjili.
La grande énigme résidait dans les modalités de désignation des candidats à élire. Le pouvoir colonial, opposé à toute politisation de la colonie, estima qu’il fallait interdire le regroupement en partis politiques, surtout qu’on risquait d’y retrouver une réplique fidèle des partis de la métropole. Mais dans la mesure où l’on exportait en Afrique des recettes d’origine belge, pourquoi ne pas laisser ce mode d’organisation s’exporter lui aussi et constituer un mode de regroupement au Congo ?
En définitive on eut recours, pour ces premières élections, au seul mode de regroupement pertinent déjà existant – le regroupement tribal – auquel on apporta ainsi une vigueur nouvelle. On se rappellera que le milieu urbain avait été, dès sa genèse, le lieu privilégié d’expression d’un sentiment ethnique de type nouveau – le tribalisme – qui s’était imposé comme une manière de combattre les frustrations de ce nouveau milieu. A cela, étaient venus se superposer d’autres réseaux de solidarité, telles la référence au même réseau scolaire, l’appartenance au même cercle d’études ou d’agrément. Mais la solidarité d’essence traditionnelle ne fut pas pour autant oubliée. Dans la première moitié de la décennie 50, elle revint à la mode avec la création de vastes fédérations intertribales. Ainsi l’ABAKO se créa et se consolida. Les ressortissants du Kwango et du Kwilu estimèrent nécessaire, dès 1953, de regrouper leurs différentes associations tribales en une fédération kwangolaise (Fedekwaleo), dirigée jusqu’en 1956 par Gaston Midu, célèbre animateur des programmes de la radio du Congo belge (Artigue P., 1961 : 212). Quant à la Fedekaléo, la Fédération kasaïenne, elle regroupait en 1957 quarante-trois associations plus restreintes et était dirigée par Paul Kabayidi et Joseph Ngalula. Mais au cours de la même année, elle connut une crise interne, suite à certaines contestations, qui refusaient l’usage exclusif du ciluba comme langue de la fédération. Ce courant centrifuge fut soutenu par l’existence, depuis 1951 déjà, de Lulua-Frères, qui encouragea les autres groupes à rechercher l’autonomie. C’est ainsi que les Basongye créèrent l’Assobaleo (Association des basongye) à Kinshasa et l’Assobakat au Katanga ; les Tetela s’organisèrent sous le signe de la Fedebate (Fédération des Batetela) au sein de laquelle une lutte d’influence éclata entre Lumumba, Ghenda et Okuka. La Fédération de l’Equateur et du lac Léopold II, la Fedequalac, prit forme en juillet 1956 à partir des chapitres de la Fédération mongo (Iso Mongo) qui existait depuis 1940. En 1958, la Fedequalac comprenait une trentaine d’associations primaires ; avec son leader Paul Bolya, assistant médical de 1re classe ; cette fédération était jalouse, par moment, de son autonomie, par rapport au grand regroupement des Bangala, Liboke lya BangaIa (Mutamba M., 1977 : 371-372).
Basé sur le tribalisme, le modèle adopté pour l’organisation de ces élections, présentait des dangers ; les polémiques fréquentes qui le caractérisaient, annonçaient des luttes qui allaient faire et défaire les premiers partis politiques constitués sur cette base unique, à défaut du clivage idéologique que le pouvoir colonial se garda bien d’exporter, pour ne pas accentuer les divisions déjà existantes dans ses propres rangs.
Le résultat de ces élections constitue le premier cas de manipulation des données traditionnelles à des fins modernistes. Le tribalisme fit la démonstration de sa pertinence comme élément de stratégie politique. A Léopoldville, les Bakongo furent les plus motivés dans la conquête d’un leadership que le pouvoir colonial avait contrecarré par la nomination en 1945-46 de deux chefs de cité non originaires du Bas-Congo. C’est ainsi que l’ABAKO s’organisa pour véritablement monopoliser l’administration urbaine naissante : sur 170 sièges dans les communes africaines, elle en remporta 133. L’administration, prise à son propre piège, fut contrainte d’accepter ce verdict et investit de la fonction majorale les six candidats de l’ABAKO proposés par les conseils communaux à majorité kongo : Pierre Canon (St-Jean, actuellement Lingwala), Alphonse Tshinkela (Kintambo), Oscar Ngoma (Bandalungwa), Joseph Kasa-Vubu (Dendale, actuellement Kasa-Vubu), Gaston Diomi (Ngiri-Ngiri), Arthur Pinzi (Kalamu).
Au Katanga, les résultats furent semblables mais avec des conséquences plus graves. Les Luba du Kasaï furent les vainqueurs des élections dans les deux villes. Avec beaucoup moins d’enthousiasme, le pouvoir colonial se résolut à respecter les choix des conseils communaux à Elisabethville, deux Luba du Kasaï à la tête des communes de Kenya (Armand Tshinkulu) et de Katuba (Mukendi Thadée), un Songye du Kasaï à la Rwashi et un Kusu du Maniema à la commune Albert (Kamalondo actuel) (Pascal Luanghy). Aucun ressortissant du Katanga ne fut élu. Il en fut de même à Jadotville où l’administration coloniale ne se gêna pas pour faire un petit écart par rapport au règlement de la démocratie naissante. Pour empêcher que Victor Lundula, considéré comme opposé aux Blancs, ne soit élu, on le muta en tant qu’assistant médical à Kamina. Malgré ce transfert de dernière minute, il fut élu à la commune de Kibula. Le gouverneur du Katanga refusa cette désignation et nomma purement et simplement quelqu’un d’autre.
A Coquilhatville, on enregistra aussi une tension de type tribal entre les Mongo, la grande majorité de la population et les Ngombe. Etant donné les oppositions entre groupes mongo – ce qui amena certains d’entre eux à soutenir le groupe opposé – les Ngombe l’emportèrent.
A Luluabourg, la victoire revint aux Luluwa, soutenus, comme on l’a dit plus haut, par l’administration coloniale, pour contrecarrer les ambitions des Luba jugés peu coopérants et moins dociles que par le passé (Muya Bia L.L., 1980).
La première expérience électorale fut à l’origine de nombreuses frustrations, qu’il s’agisse de la victoire de minorités sur des majorités ou encore de celle d’émigrés (les étrangers) sur des autochtones. Cette situation inattendue fut à l’origine de changements qui apparaîtraient lors de la création des partis, phénomène des années 1958-59. En Equateur, l’Unimo (Union Mongo) entendit conquérir le pouvoir que les Mongo avaient quelque peu perdu sur leur propre terrain ; quant à la « Confédération des Associations tribales du Katanga », la CONAKAT, elle fut fondée le 4 octobre 1958, comme structure de concertation des katangais authentiques, indispensable pour repousser l’invasion des étrangers, les Luba du Kasaï. Elle regroupa plusieurs associations plus restreintes, entre autres, le Gassamel (Groupement des Associations mutuelles de l’empire lunda), l’Association des Bahema et des Batabwa, la Fetrikat (Fédération des Tribus du Haut-Katanga), l’Assobakat (Association des Basonge du Katanga), l’Union des Bwami des Basumbwa-Bayeke, l’Association des Cokwe du Katanga, etc. Il va sans dire que le résultat des élections était à l’origine de ces initiatives. Godefroid Munongo, à qui l’on confia la direction de ce parti, mais qui préféra céder ce privilège au commerçant Moïse Tshombe, fit à l’époque cette observation significative :
Les Katangais d’origine se demandent avec raison si les autorités ne font pas exprès en accordant le séjour définitif aux gens du Kasaï dans nos centres pour que les ressortissants de cette province puissent, grâce à leur nombre toujours croissant, écraser ceux du pays [32].
Pourtant la victoire des Luba du Kasaï aux élections était essentiellement due à leur audace et à leur goût du risque.
Les élections, expliqua l’un d’eux, étaient chose nouvelle pour nous tous, mais les gens du Kasaïse sont précipités nombreux en premier lieu, comme ils le font toujours, même pour courir un risque. C’est ainsi qu’ils ont eu la majorité aux conseils. Ces votes n’étaient pas influencés par un électorat tribal.
Il est vrai que les Luba n’étaient pas dépourvus de structures de concertation. En effet, la Fegebaceka, la Fédération Générale des Baluba du Centre au Katanga, était en activité depuis 1955. En raisons de son radicalisme elle fut dissoute mais pour être aussitôt remplacée le 1er décembre 1958 par une nouvelle association constituée exclusivement des originaires du Kasaï : la Fédération des Associations des Ressortissants du Kasaï, ou Fedeka. La dissolution de la Fegebaceka, opérée sous le prétexte de la collusion de cette organisation avec les « nationalistes » de l’ABAKO et de Rhodésie, s’accompagna de perquisitions, d’emprisonnements et d’exil en milieu coutumier (Gérard-Libois J., 1963 : 17). Le fait que cette « chasse des Luba » du Kasaï s’effectuât à l’époque où la CONAKAT déployait ses ailes, soutenue à la fois par l’UMHK et les colons du Katanga, confirma la thèse selon laquelle la CONAKAT s’était créée avec la bénédiction de l’autorité coloniale, soucieuse de réhabiliter les Katangais authentiques. La tactique était à présent connue ; l’autorité coloniale, en cette période de débandade, se retournait contre les groupes qui lui avaient servi jusqu’ici de fidèles auxiliaires, sous le prétexte qu’ils constituaient les bastions de la contestation ; on attisait ainsi les conflits internes latents, quand on n’en créait pas de toutes pièces.
Traqués dans les villes minières par les « Katangais authentiques », les Luba du Kasaï ne connaissaient pas de répit ; ils avaient beau être présents dans les districts du Kasaï, et implantés dans la plupart des vingt-deux territoires de la région, notamment à Lodja, Port-Franqui (Ilébo), Mweka, Tshipaka, Demba, Lusambo, Kazumba, Luebo mais surtout à Bakwanga, Gandajika, Mwene-Ditu et Dibaya, leur position était toujours vulnérable y compris au Kasaï. Et pour cause : ils n’étaient pas les premiers maîtres de Luluabourg, la capitale, et se retrouvaient ainsi dans la position inconfortable d’ « étrangers », bien que supérieurs en nombre. Les élections communales de 1958 leur réservèrent une surprise désagréable. Ils furent évincés par les Bena Luluwa, encadrés par l’association Lulua-Frères. Sur 4 278 Luba et 2 531 Luluwa votants, les Luba obtinrent 17 conseillers, les Luluwa 16, les Songye 1, les autres tribus 2, à l’exception des Tetela et des Bena Konji qui n’eurent aucun poste de conseiller (Mabika K., 1959 : 14). Concrètement, les Luba n’eurent qu’un bourgmestre sur deux. La leçon fut vite tirée de leur côté, où les différentes associations existantes (celles de Kalonji ka Mpuka, des Kalonji ka Tshimanga entre autres) se regroupèrent pour former le « Mouvement Solidaire Muluba » (MSM). Théoriquement, cette nouvelle association avait pour objectif l’unité, la fraternité et la solidarité entre les ressortissants de Nsanga a Lubangu, mais dans la pratique, elle se savait opposée à Lulua-Frères et ne se faisait pas d’illusions quant à l’adhésion de ses « frères ennemis ». Les deux associations campèrent donc l’une en face de l’autre, bien décidées à conquérir le leadership sur la ville de Luluabourg.
La politisation des dernières années de la colonisation ne facilita pas les choses. Des frères ennemis ne pouvaient cohabiter au sein d’un même parti. Les membres du MSM adhérèrent en bloc au MNC de A. Kalonji, ce qui en écarta les autres. Le conflit se sclérosa en 1959 quand le résultat des nouvelles élections donna une avance confortable aux Luba, tant par rapport aux Luluwa que par rapport aux membres de la COAKA, la « Convention kasaïenne » qui regroupait les autres ensembles ethniques : Kuba, Kete, Leele, Bakwa Mputu, Bena Nkamba, Salampasu, Bindji, etc. L’inquiétude des Luluwa s’accrut, face à cette majorité écrasante qui les laissait impuissants [33].
C’est alors que certaines coutumes anciennes, admises jusque-là ou du moins tolérées par les Luluwa, commencèrent à être contestées. On revendiqua des droits fonciers non seulement en ville, mais également dans les régions annexes ainsi que pour les terres dites vacantes, sur lesquelles le pouvoir colonial avait placé des agriculteurs luba pour les mettre en valeur. On exigea de l’administration qu’elle reconnaisse une entité politique luluwa distincte, et placée sous la tutelle coutumière du seul chef Kalamba Mangole. Etant donné l’imminence des élections, cette réclamation prit l’allure d’une déclaration de guerre :
Ou bien les Baluba ne votent pas parce qu’ils sont étrangers ou bien ils votent pour et sous le contrôle de Luluwa (Mabika Kalanda, 1959 : 21-34).
La Conférence de Matamba, capitale de Kalamba, qui réunit les chefs coutumiers luluwa le 22 août 1959 pour examiner la situation créée par le conflit tribal les opposant aux Luba, confirma cette prise de position. Tous réclamèrent le départ des Luba pour le 15 septembre 1959 au plus tard, sans quoi ce serait le « déclenchement de la guerre » (Muya Bia L., 1980 : 102). Entre-temps, l’occupation de deux sièges de bourgmestre par les Luba en 1959 suscita une vague de mécontentement, qui se traduisit par des troubles à Luluabourg et dans d’autres centres : Demba, Mikalayi, Kabwe, Luebo, etc. Cette confusion, dans laquelle l’autorité coloniale percevait surtout la mainmise des partis nationaux, aboutit à l’arrestation des leaders politiques luba, qui connurent le chemin de la relégation : A. Kalonji, le futur mulopwe à Kole, E. Kalonji à Lomela et A. Nyembwe à Dekese.
Pour les Luba, la partialité belge ne faisait pas l’ombre d’un doute. D’autres faits vinrent corroborer ce point de vue, par exemple lorsque le pouvoir colonial prit l’initiative d’une concertation des deux partis sous sa présidence, en vue de trouver une solution au conflit. La Convention du lac Mukamba (11 janvier 1960), résultat de ces négociations entamées le 12 décembre 1959 sous la présidence d’un haut magistrat venu de Léopoldville, fut ni plus ni moins une confirmation de la thèse luluwa (Muya Bia L., 1980 : 108). Reprenant à son compte les conclusions du rapport Dequenne établi en juillet 1959 qui prônait la reconnaissance des droits des autochtones luluwa, cette convention conclut à la nécessité d’assurer le transfert des 140 000 sujets luba installés. Ainsi les litiges fonciers et politiques seraient définitivement réglés. En ce cas, le district luluwa compterait environ 600 000 Luluwa. 75 000 Luba et 100 000 personnes d’origines diverses. En somme, on conserverait une juste proportion avec un avantage numérique concédé aux autochtones.
Les Luba se concertèrent lors du Congrès de Tshipasa, capitale de Mutombo Katshi, qui se tint en l’absence de A. Kalonji et J. Ngalula retenus à la Table ronde de Bruxelles ; il aboutit en février 1960 à l’élaboration d’un véritable code de solidarité d’application stricte pour organiser les migrations vers les terres ancestrales, au cas où les Luluwa et leurs complices mettraient leur décision à exécution.
Des tentatives de solution plus impartiales furent proposées, notamment par le groupe d’étudiants de Lovanium, originaires du Kasaï. Dans les couloirs de la Table ronde de Bruxelles, une convention fut même signée par les délégués luba (Kalonji et Ngalula) et luluwa (F. Luababwanga, A. Ilunga, E. Wafwana), déclarant la neutralité de la ville de Luluabourg et de ses zones annexes. Mais le conflit était trop engagé pour comprendre ces nuances de dernière heure. Officiellement, les hostilités éclatèrent le 11 octobre 1959, au stade, à l’issue d’un match de football. Le même jour, les Luluwa attaquèrent les Luba dans la périphérie, surtout à Demba. Un climat d’insécurité s’installa dans les principaux centres de la région. La guerre Luluwa- Luba avait éclaté (Muya Bia L., 1980 : 87-115).
Les associations tribales furent donc toutes mises à l’épreuve, quand elles furent confrontées à la réalité électorale. D’une façon ou d’une autre, les partis naissants allaient procéder de ces associations tribales et des réseaux de solidarité existants. Au niveau de la stratégie, on se préoccupa de corriger les échecs de 1957. Du reste, les perdants de 1957 ne manquaient pas d’accuser les premiers élus de trop favoriser leurs groupes tribaux dans la gestion courante des communes. Ainsi en était-il à Léopoldville des Bangala à l’égard des Bakongo, à Elisabethville des Katangais authentiques à l’égard des Kasaïens, et à Luluabourg des Luba à l’égard des Luluwa. Des tensions intertribales se déclarèrent, partout, avec la complicité du pouvoir colonial. Mais de toute évidence, celui-ci était en pleine décomposition, du fait, principalement, de dissensions internes dans la famille coloniale. Cette dernière connut cependant une situation nouvelle, lors de la victoire d’une coalition socialiste-libérale (1954-58), contrastant avec le règne majoritaire du parti social-chrétien [34]. Du coup l’anticléricalisme vint contester le règne du cléricalisme, ce qui entraîna la rupture de l’alliance Etat-capital-Eglise. Le nationalisme naissant en profita pour se manifester davantage, entre autres par la parution de manifestes.
Le laisser-aller du colonisateur s’expliquait par des perspectives de moins en moins prometteuses sur le plan de la santé économique. A se demander si ce n’était pas là un autre facteur déterminant dans ce déclin. Il est évident que l’idée d’indépendance avait moins de chance de toucher les coloniaux à l’aube d’une dépression économique. C’eût été moins évident en pleine prospérité. En réalité, une crise économique se profilait à l’horizon. Dès 1955, la Belgique intervint dans le budget congolais ; les belles années étaient passées. Les investissements ralentirent en 1956- 57, puis il y eut fuite des capitaux. On vivait un déclin du revenu national, de jour en jour plus sensible, avec l’accroissement du chômage dans les centres urbains (Young C., 1967 : 91-99). Cet affaiblissement « moral » constituait un atout supplémentaire, bien qu’il constituât un problème crucial puisqu’il affectait les populations. Mais l’actualité politique le plaça provisoirement en veilleuse.
3.3 L’accélération
La politique mit l’année 1958 à profit pour fourbir ses armes ; on assista à l’époque, à une accélération du processus de prise de conscience nationaliste, soutenue par une succession d’événements extérieurs : la participation à l’Exposition universelle de Bruxelles, la tournée de de Gaulle en Afrique, le séjour à Accra de certains leaders locaux à la Conférence panafricaine, la longue attente d’une déclaration gouvernementale pour fixer la population sur l’avenir du pays qui provoqua un incident, le 4 janvier 1959, à l’issue duquel le sang coula dans les rues de Léopoldville. L’événement avait son importance et la « déclaration » attendue ne pouvait omettre d’en tenir compte. L’indépendance ! Il fallait désormais la préparer de manière concrète.
Rappelons qu’en 1958, le pays était encore dans la fièvre des élections communales et territoriales. Dans les centres urbains où elles avaient déjà eu lieu, les associations culturelles et tribales étaient en quête de nouvelles stratégies. Quelques autres centres, Coquilhatville, Stanleyville, Bukavu et Luluabourg étaient encore occupés à pratiquer cet exercice civique. Dans le monde rural, l’ordonnance d’exécution des dispositions de 1957 venait seulement d’être promulguée (28 mai 1958). Entamées à la fin de 1958, ces élections allaient se poursuivre en 1959. C’est dire que l’évolué congolais, plongé jusqu’au cou dans les problèmes inhérents à la crise de croissance politique, était en mal d’évasion. L’Exposition universelle de Bruxelles la lui proposa. Sur place, elle s’avéra être plus importante encore qu’on ne l’imaginait : elle fut pour les Congolais un moment d’ouverture, de connaissance mutuelle et de formation au contact avec le monde des idées.
Mais la colonisation avait ses finalités propres : depuis le début de ces grandes expositions universelles – la première Exposition universelle s’était tenue à Londres en 1851 -, les nations colonisatrices avaient pris l’habitude d’associer leurs empires coloniaux à leurs sections nationales, à la fois pour rassurer les consciences métropolitaines et assouvir le goût d’exotisme et d’évasion de leurs peuples (Delhalle P., 1985 : 41-46). La Belgique ne fit pas exception à la règle. Aussi, exhiba-t-elle des spécimens des biens et des hommes qui peuplaient sa colonie à plusieurs reprises, dès la période léopoldienne : en 1885 et 1894 à Anvers ; en 1897 à Tervuren où l’on enregistra plusieurs décès dus aux conditions de vie déplorables réservées à ces « citoyens » de l’EIC ; en 1910 à Bruxelles ; en 1913 à Gand ; en 1930 à Anvers- Liège et en 1935 à Bruxelles.
Le rendez-vous de 1958 au Heysel (Bruxelles) fut exceptionnel, non seulement par la période particulièrement « chaude » pendant laquelle il se tenait – on était en pleine décolonisation – mais aussi par sa durée (six mois, du 17 avril au 18 octobre) et le nombre de Congolais qui y prirent part (environ 700 personnes, hôtes du gouvernement, invités des missions et des institutions privées, soldats de la Force publique). Parmi les hôtes du gouvernement, les « Congolais méritants », on notait la présence de journalistes et animateurs de radio (Joseph Ngalula, René Bavassa), d’assistants médicaux (Paul Bolya), etc. Les missions amenèrent le personnel de leurs stands : Jean Bolikango, Joseph Iléo. Albert Kalonji ; Jason Sendwe, assistant médical au service des missions protestantes… La Force publique était représentée par 312 soldats ; une chorale d’une soixantaine de jeunes gens chanta des refrains des « missa Congo » pendant six mois, non seulement en Belgique mais aussi en Hollande et en Allemagne.
Quel fut l’apport de cette exposition ? Les Congolais eurent une nouvelle occasion de démystifier l’homme blanc en découvrant son univers et la diversité des opinions qui caractérisaient son milieu. Mais le fait le plus marquant de cette expérience est que les évolués de toutes origines eurent l’occasion de se rencontrer pour la première fois, de faire connaissance et se lier d’amitié. Nombre d’entre eux, qui se retrouvèrent dans le premier gouvernement et dans les Chambres des Représentants, allaient avouer plus tard que c’est à Bruxelles, en 1958, qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois. La participation aux conférences organisées en marge de l’exposition contribua à la diffusion des idées. L’abbé Joseph Malula profita de la tribune du Congrès de l’Humanisme chrétien pour donner le 28 mai 1958 sa conférence demeurée célèbre sur l’Ame noire face à l’Occident, prophétique à propos de l’indépendance :
… Les Blancs voudraient donner l’indépendance un quart d’heure trop tard et les Noirs voudraient l’avoir un quart d’heure trop tôt. Mieux vaut un quart d’heure trop tôt que trop tard [35].
Plusieurs journalistes, Evariste Kimba (Essor du Congo), José Luboya (La Croix du Congo), Joseph Mobutu (Actualités africaines), Joseph Ngalula (Présence congolaise) prirent part au Congrès international de la Presse coloniale (28-30 juin) ; d’autres prirent la parole au Cercle des « Amis de Présence africaine » et entrèrent en contact avec certains intellectuels du monde noir : A. Césaire, Alioune Diop, Léon Damas. Plus tard, après l’indépendance, il ne manqua pas de voix pour regretter cette ouverture offerte aux colonisés, considérée a posteriori comme le « méfait de l’Exposition universelle ». Les Congolais en auraient profité pour avoir un premier contact avec les milieux communistes de Bruxelles, de Paris, de Prague et d’ailleurs (De Monstelle A., 1965 : 118-121 ; Delhalle P., 1985 : 44) [36].
Que cette confrontation des opinions ait été bénéfique, cela va sans dire. Cela apparaît notamment dans le maintien des idées lancées par le « Manifeste Conscience africaine ». Du reste, à la suite de ces événements, un groupe de nationaux projeta de créer dès le retour au pays le « Mouvement national » dont il était question dans le manifeste. Son appellation définitive fut même précisée : le Mouvement pour le Progrès national congolais. Ses fondateurs étaient de toutes provenances régionales mais aussi de tous les milieux. En fait, ils allaient être pris de vitesse par leurs compatriotes restés à Kinshasa, qui annoncèrent dès le 10 octobre 1958 la création d’un Mouvement national congolais (MNC) (Mutamba M., 1977 : 534-535).
L’expérience de Bruxelles mise à part, une nouvelle impulsion provenait de la décolonisation du modèle français, que les Kinois vécurent du fait de la proximité de Brazzaville et de certaines colonies françaises. Pendant toute la période de la décolonisation, la France aura été nettement plus progressiste que la Belgique vis-à-vis de ses colonies. Telle était du moins l’opinion des Congolais du Congo belge. En 1958, ces colonies françaises étaient axées sur les préparatifs du référendum, à l’occasion duquel elles devraient se prononcer sur leur avenir au sein de la communauté franco-africaine. Le 24 août, le général de Gaulle, à Brazzaville, n’hésita pas à déclarer :
On dit que nous avons droit à l’indépendance mais certainement oui. D’ailleurs l’indépendance, quiconque la voudra pourra la prendre aussitôt. La métropole de n’y opposera pas [37].
A côté de cette attitude de compréhension, fût-elle démagogique ou purement tactique, la position belge était brutale, et foncièrement impopulaire.
L’initiative la plus progressiste qu’elle put prendre à l’époque fut l’instauration en métropole, en juillet de la même année, d’un groupe de travail pour l’étude du problème politique du Congo belge. Composé de huit personnes, celui-ci comprenait des représentants de trois formations politiques belges (De Schryver : social- chrétien ; Buisseret : libéral et ancien ministre des Colonies ; Housiaux : socialiste) et de quelques experts, parmi les plus avertis en matière de questions coloniales (notamment Pétillon, l’ancien gouverneur général). On ne pensa pas à y intégrer des représentants des populations autochtones, même à cet instant où la France organisait un référendum demandant à ses colonies de se prononcer elles-mêmes sur les options de leur futur. Ce fait choqua les évolués de Léopoldville.
Seize d’entre eux se concertèrent pour faire parvenir une pétition au ministre Pétillon, déplorant vivement l’absence de Congolais dans le groupe de travail et émettant à l’avance des réserves quant aux conclusions qui s’en dégageraient. Les « seize » étaient issus de milieux différents : on y trouvait des rédacteurs du prestigieux « Manifeste Conscience africaine », des bourgmestres, des militants de l’Action socialiste, des représentants de la presse et des membres influents des associations ethniques et syndicales [38]. Inspirés par le modèle de la décolonisation française, les signataires du document revendiquèrent, outre la possibilité de prendre part à ce débat concernant leur avenir, la démocratisation des institutions et l’organisation des élections générales ; iis s’inscrivaient en faux contre l’instauration du fédéralisme au Congo. Plusieurs autres formations réagirent de la même manière.
En réalité, la Belgique considérait que ce groupe de travail devait pouvoir œuvrer en toute indépendance, en dehors de toute pression et de toute entrave liées à la vie publique belge. Après de nombreuses consultations au Congo où il reçut et écouta plus de 400 personnes issues de tous milieux et de toutes catégories, le groupe se retira et travailla en dehors du monde des affaires coloniales. 11 conclut que le courant indépendantiste était irréversible, qu’il fallait entrer sans hésiter dans la voie de l’émancipation politique. Cette décision fut prise dès le 24 décembre 1958.
Restait à l’annoncer. Le gouvernement projeta de le faire lors d’une grande déclaration solennelle prévue pour le 13 janvier. Trop sûr d’avoir été un colonisateur modèle, le Belge voulait conserver ce qu’il croyait être une certaine supériorité jusqu’au bout. Il continuerait à faire mieux que les autres, à réaliser une décolonisation réussie, à vivre un cas d’indépendance inédit, obtenue non pas dans les pleurs et les grincements de dents, mais dans l’amitié, en tendant la main à ceux-là mêmes qui réclamaient la liberté de leur pays (Stengers J., 1989 : 242-244). Le 13 janvier allait être une grande célébration de cette idée généreuse et donc, un grand coup de barre politique par rapport à ce qui s’était fait jusque-là. Une fois de plus, c’est une question de délai qui fit problème : entre le 24 décembre 1958 et le 13 janvier 1959, il y avait à peu près trois semaines de trop. A cause de ce retard, la montagne allait accoucher d’une souris.
Quatre jours après que l’option eut été arrêtée en cénacle à la métropole pour l’indépendance du Congo, Lumumba revenait d’un séjour à Accra où il avait pris part, avec un certain nombre d’amis, à la Conférence du Rassemblement des Peuples africains. Le Ghana de Nkrumah, indépendant depuis quelques mois à peine, avait en effet estimé qu’il ne pourrait se dérober à la responsabilité historique de servir de rampe de lancement aux mouvements de libération nationale des pays encore colonisés. Aussi Nkrumah rassembla-t-il, du 5 au 13 décembre, dans sa capitale, les délégations de plus de soixante organisations nationalistes, politiques et syndicales venues tant des pays indépendants que de ceux qui étaient encore colonisés ; ces derniers constituaient la grande majorité des participants.
Quelques évolués de Léopoldville firent le déplacement d’Accra : Patrice Lumumba, Gaston Diomi et Joseph Ngalula. Jean-Pierre Dericoyard, en voyage à Accra, dans le cadre de ses affaires ou comme espion de l’administration coloniale, prit également part aux travaux en tant qu’observateur (Mutamba M., 1977 : 609). Quant à Joseph Kasa-Vubu, il n’avait pu effectuer le voyage. Officiellement, il avait été autorisé à s’y rendre mais en pratique on l’en empêcha, pour une question de vaccins non conformes aux exigences du règlement sanitaire international. En réalité, l’autorité coloniale le considérait à l’époque comme dangereux à cause des positions anticolonialistes de son mouvement, l’ABAKO. Elle jugea donc inopportun de favoriser le contact entre Nkrumah et ce porte-flambeau de la contestation politique locale.
La Conférence d’Accra porta sur l’étude de « la stratégie et des tactiques d’une révolution africaine pacifique ». Les débats portèrent sur l’analyse des obstacles à l’émancipation et à l’unification de l’Afrique. Parmi ceux-ci, on releva notamment la dépendance vis-à-vis de l’extérieur, le racisme, la diversité ethnique exploitée par le tribalisme et les oppositions religieuses. La conférence préconisa entre autres la révision des frontières africaines et le regroupement des États en ensembles régionaux pour créer les États-Unis d’Afrique. L’ensemble du credo de Nkrumah s’y retrouvait déjà [39].
La Conférence d’Accra situe ainsi la genèse politique d’un des principaux leaders de la décolonisation du Congo, devenu le « héros national », Patrice Emery Lumumba. Ce bref séjour à Accra fut pour lui et pour ses compagnons une école politique. Il découvrit entre autres la dimension continentale de sa lutte, restreinte jusque-là à la simple dialectique belgo-congolaise, corde à son arc comme il le confirme lui-même :
Cette conférence historique… nous révèle une chose : malgré les frontières qui nous séparent, malgré nos différences ethniques, nous avons la même conscience, la même âme qui baigne jour et nuit dans l’angoisse, les mêmes soucis de faire de ce continent africain un continent libre, heureux, dégagé de l’inquiétude, de la peur et de toute dénomination colonialiste (Van Lierde J., 1963 : 11-12).
Dans cette internationalisation de la lutte pour l’indépendance, Lumumba et ses compagnons firent également la connaissance à Accra de quelques frères d’armes (non des moindres) issus d’autres colonies. Il s’agissait notamment de Roland Moumié du Cameroun, Tom Mboya du Kenya, J. Nyerere du Tanganyika, Kenneth Kaunda de la Rhodésie du Nord, Joshua Nkomo de la Rhodésie du Sud, Holden Roberto de l’Angola. La délégation eut bien entendu des contacts fructueux avec quelques-uns de ceux qui venaient de sortir vainqueurs de cette lutte anticoloniale (Sékou Touré, Nkrumah), sans oublier quelques grands penseurs des problèmes du monde noir présents à la conférence (Georges Padmore, Frantz Fanon). L’indépendance leur parut alors dans l’ordre du possible. Le meeting que Lumumba tint à son retour à Léopoldville, le dimanche 28 décembre, sur la place communale de Kalamu, fut la célébration de cette assurance acquise à Accra ; l’événement marquait à la fois le début fulgurant de sa carrière politique et celui de son parti, le MNC, qui n’avait encore que deux mois d’existence.
Devant une foule extrêmement nombreuse, il fit part de ce qu’il avait vécu à Accra, à savoir que « l’indépendance, loin d’être un cadeau, était un droit ‘fondamental, naturel et sacré’ et qu’il fallait rejeter l’autonomie-cadeau que prépare et lui promet le gouvernement ». Et le tribun du MNC d’ajouter qu’« il invitait les Congolais des deux sexes, des différentes ethnies, de toute condition et de toute opinion religieuse, les Congolais des centres urbains et des milieux ruraux, les individus et les associations déjà organisées à s’unir autour du MNC … Le Congo, conclut-il, est notre patrie. C’est notre devoir de rendre cette patrie plus grande et plus belle » (Mutamba M., 1977 : 610-611). Lumumba avait pris au sérieux une recommandation de la conférence qui, semble-t-il, prônait qu’aucun pays en Afrique ne reste sous domination étrangère au-delà de 1960 [40]. Désormais, il allait s y employer activement et fiévreusement.
Comment allaient se combiner le projet du groupe de travail de Bruxelles et l’impulsion nouvelle que Lumumba ramenait d’Accra ? Les événements du 4 janvier apportèrent une réponse à cette question, compromettant en quelque sorte la liturgie que le groupe de travail était occupé à mettre au point ; banalisée, la décolonisation belge perdait par là toute chance d’être aussi « modèle » que l’avait été la colonisation.
A la base de cet incident, se trouvait un projet de meeting de l’ABAKO annulé en dernière minute. Après le grand succès remporté par le MNC le 28 décembre, l’ABAKO devait se manifester, pour ne pas se laisser devancer dans la compétition qui s’instaurait. Visiblement, l’autorité coloniale se situait du côté du nouveau groupe. C’est ainsi que le meeting de l’ABAKO fut prévu pour le dimanche qui suivait le 28 décembre, dans le même cadre de la commune de Kalamu, à la place de YMCA. Les thèmes programmés seraient sensiblement les mêmes. On allait suivre le rapport de mission d’Arthur Pinzi revenu de Bruxelles et écouter Kasa-Vubu, le président de l’ABAKO. La section ABAKO-Kalamu écrivit au premier bourgmestre, M. Tordeur, dès le mardi 30 décembre, pour l’informer de cette réunion. La réponse ne vint que le samedi 3 janvier et elle était négative [41]. L’ABAKO décida alors de reporter sa manifestation au 18 janvier, le premier dimanche après le jour prévu pour la déclaration gouvernementale. Mais le plus difficile restait à faire. Comment informer la foule des militants de ce changement ?
Dès les premières heures de la journée du 4 janvier, le foyer protestant de l’YMCA fut pris d’assaut par les militants et sympathisants de l’ABAKO. La nouvelle du report de la manifestation ne réussit pas à les disperser. Vers 15 heures, Kasa-Vubu décida d’y aller lui-même. Il parla en français, lança un appel au calme, annonça que la réunion était reportée après la déclaration gouvernementale. Les dirigeants de l’ABAKO l’étudieraient d’abord. Les Congolais devaient resserrer les rangs et s’unir. L’ABAKO et le MNC poursuivant les mêmes buts, il n’y avait aucun inconvénient à opter pour une double appartenance. Le discours fut traduit en kikongo et en lingala. Mais la foule ne se dispersa pas pour autant et la police intervint. Il y eut quelques échauffourées au cours desquelles on tira des coups de feu en l’air. La bagarre dégénéra en jets de pierres, voitures brûlées et coups de feu tirés sur les manifestants. Vers 17 heures, le groupe des manifestants se dirigea vers Foncobel, le quartier commercial tenu par les Grecs et les Portugais. On se mit à piller leurs boutiques puis on se dirigea vers Kalina, la cité européenne. Plus de doute, l’insurrection devenait plus que sérieuse ; l’autorité fit appel, en plus de la police, à l’armée, à la Force publique. Celle-ci mit six jours, du 4 à 20 h 50’ au 10 à 8 heures, pour remettre de l’ordre dans la ville. On fit appel également à un bataillon d’infanterie, une compagnie de commandos et des éléments blindés. Le gouverneur général Cornelis réquisitionna en plus le bataillon des para-commandos belges à Kamina, tant l’insurrection était évidente.
Quelle fut l’ampleur des dégâts ? Curieusement, les émeutiers s’en prirent aux infrastructures symbolisant le règne triomphant de la trinité coloniale : l’administration avec sa police fut la cible des jets de pierres, les entreprises commerciales, par l’intermédiaire des magasins les plus accessibles, à Foncobel, sur l’avenue Charles de Gaulle (actuelle avenue du Commerce), furent mises à sac. Quant à l’Eglise catholique, avec ses écoles et ses églises, elle ne fut guère épargnée ; le bilan signale sept écoles des missions saccagées, onze bâtiments dégradés, particulièrement à Saint- Pie X (Ngiri-Ngiri), à Saint-Pierre (Kinshasa), à Saint-Gabriel (Yolo) et à Saint- Alphonse (Matete) [42]. Les forces de répression n’y allèrent pas de main morte. Le chiffre exact des victimes, comme d’habitude en pareilles circonstances, fit l’objet de manipulations. Suivant les rapports officiels, il y eut 47 morts et 241 blessés côté congolais ; du côté européen, aucun décès mais 49 blessés. Ces chiffres furent aussitôt contestés : on parla ensuite de 71 morts, puis d’une centaine, puis de deux cents (Mutamba M., 1977 : 636). En définitive, grâce à des témoignages dignes de foi, on peut estimer le nombre des victimes africaines à deux cent cinquante ou trois cents voire même cinq cents, les autochtones s’étant empressés d’enterrer eux- mêmes leurs morts, pour ne pas être inquiétés par l’administration (Marres J. et De Vos P., 1975 : 4-23).
La répression militaire s’accompagna de poursuites judiciaires. Les principaux leaders de l’ABAKO furent arrêtés. Kasa-Vubu chercha d’abord à s’enfuir, grâce à un déguisement qu’il obtint de l’Abbé Loya, aumônier de l’ABAKO [43], puis il décida de se livrer à la justice (8 janvier) qui avait lancé un mandat d’amener contre lui depuis quelques jours. Il fut révoqué de ses fonctions de bourgmestre de Dendale et le 11 janvier, un arrêté ordonna la dissolution de l’ABAKO. Les leaders de l’ABAKO qui avaient pu échapper aux arrestations, alertèrent l’opinion internationale depuis Brazzaville, où ils s’étaient réfugiés. Avec l’aide de l’Abbé Youlou, un avocat français, maître Jacques-Arnold Croquet, s’étant saisi du dossier, exigea la libération de Kasa-Vubu et de ses amis [44]. Le procès, qui se déroulerait à la fin de janvier et surtout en février, allait se prolonger dans un climat de malaise généralisé (Mpoyo Kasa-Vubu Z.J., 1985 : 214-228).
En Belgique, les événements du 4 janvier créèrent la surprise. Entre-temps, le PSC s’était associé aux libéraux, et un nouveau ministre, Maurice Van Hemerlijck, présidait aux destinées du Congo. Ce ministre qui avait déjà annoncé la couleur en décidant de la date de la Déclaration gouvernementale, dès qu’il était entré en possession du rapport du groupe de travail, ne cacha pas sa gêne devant les initiatives de type réactionnaire de son administration à Léopoldville, qui le mettait devant le fait accompli (Bouvier P, 1965 : 203). Dans l’affaire de Kasa-Vubu et de ses amis Daniel Kanza et Simon Nzeza, que l’administration coloniale ne voulait absolument pas libérer, on allait voir le ministre, venu en personne à Léopoldville, négocier lui-même la libération des détenus, pour les inviter ensuite en Belgique. Ce voyage eut lieu le 14 mars.
C’est dire que l’émeute eut lieu au moment même où le gouvernement belge s’apprêtait à annoncer de bonnes nouvelles aux Congolais. Mais elle eut l’effet bénéfique de forcer quelque peu le gouvernement métropolitain à se dépasser. Le scénario même de la journée du 13 janvier fut révélateur. Au lieu d’une seule déclaration, celle du gouvernement qui était annoncée, on en eut deux : celle du roi et celle du gouvernement. A cause de la tension régnante, la métropole jugea utile que le roi se montre, étant donné la bonne impression de « Bwana Kitoko » qu’il faisait aux Congolais. La déclaration gouvernementale fut faite dans un langage neutre, sobre et trop bien dosé parce que sentant le compromis. Elle annonça la mise en place d’une démocratie, apte à exercer les prérogatives de la souveraineté et à décider de son indépendance. Mais le roi tint un langage plus direct, qui cachait mal l’émotion due aux événements récents.
Notre résolution est aujourd’hui de conduire, sans atermoiements funestes mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l’indépendance dans la prospérité et la paix.
Les martyrs du 4 janvier n’étaient pas morts en vain. Sans cet investissement, jamais une promesse aussi nette et aussi ferme n’aurait été faite ; et quand bien même elle l’aurait été, jamais elle n’aurait pu se passer dans un tel calme, dénué de protestations, que ce soit dans la métropole ou la colonie. Pourtant, les patrons des affaires coloniales, administratives et commerciales étaient à la fois atterrés et désorientés. Le roi, symbole de l’unanimité métropolitaine, avait pris position. 11 n’y avait plus qu’à exécuter ses ordres (Stengers J., 1989 : 246-248) [45]. Désormais, le mot « indépendance » sortait de la clandestinité pour entrer dans le vocabulaire officiel ; il restait à la mettre au point.
3.4 La préparation de l’indépendance
Examinons cette préparation, tant du côté des Congolais, les futurs indépendants, que de celui de l’administration coloniale, obligée à présent de préparer brusquement sa succession, alors qu’elle était censée disparaître peu à peu.
Sur le terrain congolais d’abord ! L’après-13 janvier se caractérisa par l’anomie : le relâchement de l’autorité eut pour conséquence le désordre le plus total. En écho aux événements du 4 janvier, quelques incidents éclatèrent çà et là, dans le Bas- Congo, soutenus par le mot d’ordre de désobéissance civile que lança l’ABAKO dans son fief. La conjoncture économique, moins fiable que les années précédentes, offrit un prétexte à de nouvelles revendications salariales. En fait de grèves, il y en eut davantage au cours de la seule année 1959 que dans toute l’histoire de la colonie (Merlier M., 1962 : 289). Celles-ci éclatèrent tour à tour chez les travailleurs des transports en commun de Léopoldville (février), puis chez ceux de l’Office des Transports coloniaux, de la Régie des Eaux et chez les fonctionnaires à Coquilhatville (mars). Au même moment, les coupeurs de noix de palme du Kwilu-Kwango, les travailleurs de l’OTRACO et de la SEDEC arrêtèrent eux aussi le travail pour les mêmes motifs, pendant que dans le Bas-Congo, la Force Publique intervenait à Lukala pour disperser les grévistes de la cimenterie. En avril, ce fut le tour des employés de la Caisse d’Epargne, puis celui des travailleurs de la Compagnie des Chemins de Fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (juin). Les travailleurs de la sucrerie et de la raffinerie dans la plaine de Ruzizi s’arrangèrent pour ne pas faire exception (juillet) suivis des travailleurs civils de la base de Kitona, dont le licenciement provoqua une émeute (septembre). La Force Publique fut à nouveau contrainte d’intervenir à Lukala (septembre-octobre) ; elle ne se gêna pas pour ouvrir le feu à Elisabetha, afin de contenir les grévistes des HCB (octobre). Le même mois, à Matadi, à Léopoldville comme à Stanleyville et à Port-Franqui, les chantiers de l’Office des Transports coloniaux ne faisaient pas exception à la règle. En novembre, il y eut une succession de grèves sauvages à Idiofa (Kwilu), dans les plantations d’hévéa à Opala (Province Orientale), dans les usines de filature et de tissage à Albertville (Katanga). Toutes ces grèves spontanées coïncidaient avec des affrontements interethniques, comme ceux, déjà évoqués, du Katanga et du Kasaï.
A côté de ces réajustements sociaux, l’événement le plus marquant de la période qui suivit la déclaration gouvernementale fut l’irruption des partis politiques. Le phénomène n’était pas totalement nouveau. Dans la chronologie, on a pu noter jusqu’ici l’existence de deux générations de partis politiques : FABAKO, qui joua ce rôle à partir de 1954 est pratiquement le seul survivant de la première génération. Les autres formations culturelles ne parvinrent pas à effectuer la même mutation qui lui permit de s’adapter. Dissous au lendemain du 4 janvier, ce parti fut officiellement réhabilité le 26 juin 1959 sous le nom de l’ « Alliance des Bakongo » (ABAKO).
La deuxième génération était constituée de formations politiques nées avant le 13 janvier 1959, à la faveur des élections communales ou de l’Exposition universelle de Bruxelles : l’Union Congolaise, la CONAKAT, le MNC. La troisième génération regroupait des formations plus récentes, dont la multiplication fut d’une rapidité étonnante. Ce fut alors la bataille pour les sigles, souvent les mêmes ou présentant des ressemblances qui prêtaient à confusion [46]. Plusieurs de ces partis furent éphémères. Les plus prometteurs s’appuyaient sur des associations déjà existantes, dont ils constituaient l’expression politique. Ainsi l’Union kwangolaise était une émanation de la « Fédération kwangolaise », le Parti progressiste katangais était une émanation de l’« Association des Baluba du Katanga», l’Union mongo reprenait les militants de la « Fédération des Mongo», le Mouvement pour l’Unité basongpe celle de l’« Association des Basongye», le Parti de l’Unité nationale recrutait sa clientèle au sein du « Liboke lya Bangala ».
Quelle typologie adopter pour dresser l’inventaire des partis politiques qui ont existé ou émergé à l’époque ? (Congo 1959 : 263-280 ; Artigue P., 1961 : 319- 329, 373-375). Des partis à caractère ethnique pouvaient être distingués des partis supraethniques, ceux visant une audience régionale pouvaient l’être de ceux dont la vocation se situait au niveau national. Selon leurs prises de position, on pouvait distinguer les « modérés » des « radicaux » et enfin, suivant la vision qu’ils avaient du futur État congolais, un clivage était possible entre les « unitaristes » et les « fédéralistes ».
Au point de vue de l’extension géographique, les partis à caractère ethnique étaient les plus nombreux, suivis des partis régionaux ; ceux à prétention nationale n’étaient pas plus de deux ou trois notamment le MNC et le PNP.
Que les formations les plus nombreuses aient été de type tribal et intertribal, cela se justifiait par la forte dépendance vis-à-vis d’associations préexistantes. Ainsi, dans le premier registre, on notait l’existence de l’Alliance des Bakongo (ABAKO), le Mouvement solidaire muluba (MSM), le Mouvement pour l’Unité basongye (MUB), l’Union des Bateke (UNIBAT), l’Union des Mongo (UNIMO), l’Union des Warega (UNERGA), l’Association des Baluba du Katanga (BALUBAKAT), etc. Dans le second, il faut situer les fédérations et autres constructions interethniques : l’Association des Tchokwe du Congo, de l’Angola et de la Rhodésie (ATCAR), la Confédération des Associations tribales du Katanga (CONAKAT), la Coalition kasaïenne (COAKA), la Fédération des associations des ressortissants de la province du Kasaï (FEDEKA), l’Association des Ressortissants du Haut-Congo (ASSORECO), l’Union kwangolaise pour l’Indépendance et la Liberté (LUKA), le Rassemblement démocratique du lac Léopold II et du Kwango-Kwilu (RDLK). D’autres, malgré leurs titres ronflants, n’avaient qu’une audience régionale. Tel est le cas du CEREA (Centre de Regroupement africain) au Kivu, du PSA (Parti solidaire africain) au Kwilu et du PUNA ((Parti de l’Unité Nationale) en Equateur.
Selon qu’ils s’attachaient plutôt à la date ou au contenu de l’indépendance, les partis se divisaient en « modérés » et en « nationalistes ». Ces derniers avaient pour mot d’ordre « l’indépendance totale et immédiate ». Ils employaient un langage virulent, ne craignant pas de dénoncer les manoeuvres odieuses du colonialisme. Ils contribuèrent à raccourcir le délai de l’accession à l’indépendance. Dans leurs rangs, on comptait l’ABAKO, le MNC, le PSA, le CEREA. Les modérés, quant à eux, étaient opposés à toute précipitation. Leur position accommodante à l’égard du pouvoir colonial leur valait d’être accusés de complicité avec lui. Le signe PNP (Parti National du Progrès) en vint à signifier pour certains « Parti des Nègres payés » ou encore « Pene pene » (na mundele), c’est-à-dire « Proche du Blanc ». En réalité, les modérés n’étaient pas hostiles à l’intégration des immigrés européens. L’Union congolaise soutenait que les Belges et autres étrangers pouvaient opter pour la nationalité congolaise. La CONAKAT (qui intégra en son sein l’ « Union katangaise », le parti des colons) défendait dans son programme la reconnaissance du droit de vote aux Européens ; du reste, elle projetait la constitution d’une communauté belgo-congolaise, dans le sens d’une union entre les deux pays.
La distinction la plus délicate – parce qu’elle partageait les « nationalistes » en deux camps – est celle qui démarquait les unitaristes des fédéralistes. La perception du futur n’était pas la même pour tous. L’ABAKO, depuis son Manifeste en août 1956, prônait le fédéralisme, qu’elle trouvait justifié, étant donné l’étendue du pays et la diversité des populations en présence. A plusieurs reprises, en 1958 et 1959, elle confirma cette option et publia en juin 1959 le « plan administratif de la République du Congo central » qui couvrait le Bas-Congo, le Kwango et le Kwilu. La tendance unitariste datait de la même époque. Exprimée dans le « Manifeste Conscience africaine », elle avait trouvé sa tribune dans le MNC, qui rejetait en bloc toute idée fédéraliste car elle risquait de conduire à la « balkanisation » du Congo. Les deux projets avaient leurs racines dans la colonisation même. L’unitarisme était un projet défendu depuis Léopold II et soutenu par l’administration coloniale. Le fédéralisme ou, si l’on veut, la prise en compte de la diversité n’avait jamais manqué de défenseurs parmi les coloniaux, notamment parmi les administrateurs du Katanga. Il devint davantage d’actualité, lorsqu’on envisagea l’autonomie de la colonie. Parmi les partis locaux, les unitaristes se retrouvèrent au Congrès de Luluabourg en avril 1959, congrès qui constitua la première concertation politique de l’histoire nationale. Les fédéralistes se réunirent eux aussi en congrès en décembre 1959. Ce Congrès de Kisantu fut l’une des concertations les plus importantes qui s’élaborèrent avant la Table ronde. Plusieurs partis y déléguèrent leurs représentants : le PSA, reconverti à la thèse fédéraliste, l’ABAZI, le MNC de Kalonji et le BALUBAKAT (avant sa reconversion pour la tendance unitariste). Le PNR bien que fédéraliste, ne fut pas convié à cette rencontre et la CONAKAT, bien qu’invitée, ne fit pas le déplacement [47].
Mais toutes ces formations politiques, à quelques exceptions près, avaient l’inconvénient d’être des créations récentes, donc vulnérables, sans assises solides et perméables à tout changement. En un an, plusieurs partis, qui n’arrivaient pas à obtenir une audience suffisante, se laissèrent absorber. Ce fut le cas des partis qui prirent pour option d’organiser les campagnes par opposition aux villes : le » Mouvement rural de Kabinda », le « Mouvement rural de Lusambo », l’« Union rurale congolaise » de Joseph Okito furent absorbés par I’ (UNIPOCONGO) qui rallia elle- même le PNP (Mutamba M., 1977 : 692). Un conflit entre individus au sein des états-majors, voire même une simple susceptibilité personnelle, constituaient des motifs suffisants pour mettre en cause l’unité de la formation politique dans son ensemble. Dans ce sens, les partis à prétention nationale étaient les plus vulnérables. Le MNC n’y échappa pas puisqu’il se scinda en juillet 1959 en MNC/Kalonji et MNC/Lumumba. Ce dernier, suite à la démission, en avril 1960, de son vice- président Nendaka se scinda en deux : une troisième aile du MNC (le MNC/Nendaka), éphémère, fut ainsi créée (Artigue P., 1961 : 324-325). La personnalité de Lumumba en agaçait plus d’un : sa verve, son titre de membre du Comité permanent de la Conférence des Peuples africains, ses contacts à l’étranger lui donnaient une assurance provocante. Le premier coup de force eut lieu le 16 juillet ; des membres du Comité central du MNC se réunirent sans lui et décidèrent que la représentation légale du mouvement serait désormais collégiale ; le nom de Lumumba ne figurait même pas au nombre des membres de ce collège. Lumumba contre-attaqua le 17 en convoquant une assemblée extraordinaire des comités sectionnaires qui prit fait et cause pour lui ; le comité central fut dissous. Les dissidents Ngalula, Adoula et Iléo préférèrent attribuer la présidence de leur aile à Kalonji, qui revenait d’exil, ce qui accroissait sa notoriété et apportait une plus grande crédibilité à leur initiative.
La fragilité des partis s’exprimait aussi par leur stérilité doctrinale ; ayant répudié les idéologies importées qu’ils maîtrisaient du reste assez mal, ils ne purent en créer d’autres. De même, il ne pouvait être question déjà de programmes de partis dans un contexte aussi nouveau. L’objectif immédiat qui s’imposait à tous, à moyen terme, était l’indépendance du pays, et à court terme, la subsistance en tant que formation politique.
Au danger d’émiettement politique, les dirigeants des partis s’efforcèrent d’opposer la formation de cartels. Cette tendance caractérisa les partis en présence, dès leur naissance. Le Congrès de Luluabourg eut pour ambition de réaliser autour du MNC la cartellisation des partis unitaristes. Cette amorce fut poursuivie par le Congrès extraordinaire du MNC à Stanleyville (octobre 1959) qui se termina hélas par une émeute. Lumumba fut arrêté. Quant aux partis modérés, ils organisèrent un premier regroupement en août-septembre 1959 sous le signe de l’Union pour les Intérêts du Peuple congolais (UNICO). Celui-ci connut un élargissement au Congrès constitutif du « Parti national du Progrès » qui se tint à Coquilhatville du 11 au 14 novembre et parvint à regrouper une vingtaine de partis. Les formations nationalistes fédéralistes se constituèrent en cartel à partir du Congrès de Kisantu. Ce cartel – appelé Cartel ABAKO – adopta comme mot d’ordre « l’indépendance immédiate et totale pour un Congo uni et fédéral » (Weiss H. et Verhaegen B., 1960 : 169-175). Les Forces politiques katangaises, allant par là à l’encontre des ambitions de la CONAKAT, ressentirent le besoin de se constituer en un cartel katangais qui regroupa l’association des Baluba du Katanga, la FEGEBA et l’ATCAR. Ces rassemblements favorisèrent le bon fonctionnement de la vie politique au Congo.
Sur le plan administratif, malgré la crise d’autorité qui caractérisa cette époque, des mesures concrètes furent prises pour marquer le passage à une ère nouvelle. Le 13 janvier même, le statut unique, tant de fois revendiqué par l’APlC, fut promulgué. La politique d’africanisation des cadres assura la promotion de certains nationaux : l’un d’eux (Bolikango) fut nommé commissaire général adjoint à l’information, d’autres devinrent attachés de cabinet des gouverneurs de province. Théodore Idzumbuir devint attaché au cabinet du gouverneur général Cornelis, Julien Kasongo exerça les mêmes fonctions au cabinet du ministre du Congo à Bruxelles. En septembre 1959, la Force publique ouvrit l’Ecole des adjudants à Luluabourg ; celle-ci accueillit ses neuf premiers candidats. Avant la fin du mois de mars, quinze textes furent signés pour mettre fin aux pratiques discriminatoires.
L’essentiel fut le début de mise en place des nouvelles institutions annoncées par la déclaration gouvernementale, notamment les Collèges consultatifs auprès du gouverneur général et des gouverneurs de province et le Conseil de législation. Mais la démission de celui qu’on appelait déjà au Congo le « ministre de l’indépendance », M. Van Hemelrijck, laissa les Congolais déconcertés ; les partis nationalistes y perçurent tout de suite un désaveu par les milieux dirigeants de la Belgique de la politique « progressiste » que celui-ci s’était efforcé de faire prévaloir au cours de son mandat. Ce ministre fut pris, en effet, entre la pression des forces congolaises d’une part, et la méfiance du gouvernement belge à l’égard des initiatives qu’il prenait et des projets qu’il proposait d’autre part. Pourtant A. De Schrijvel, son successeur, reprit ses idées, mais sans le capital de confiance dont disposait son prédécesseur auprès des partis nationalistes. Il annonça la poursuite de l’exécution de la déclaration gouvernementale, notamment par l’organisation d’élections territoriales. Mais l’opinion congolaise, partagée entre plusieurs partis, exigeait d’être éclairée d’abord sur le fait même de l’indépendance, sur les délais de son application, les étapes préparatoires, la constitution du gouvernement, avant d’entamer cette exécution. Le malentendu persista.
Une solution alternative émana du MNC/Kalonji, réuni en congrès à Elisabethville le 1er novembre 1959. Elle subordonnait la participation aux élections à la tenue d’une « Table ronde » réunissant les représentants des partis avec les délégués du Parlement belge ; cette rencontre devait avoir lieu à Bruxelles, dans un climat « dégagé de toutes influences colonialistes » (Congo 1959 : 202). L’idée fit son chemin et finit par être adoptée par tous. Le ministre fut finalement contraint d’y souscrire lui aussi. Le discours qu’il tint le 15 décembre fut une véritable volte-face, bien qu’il passât presque inaperçu ; il préconisa d’écourter la période de transition, accepta l’idée de jumeler les élections pour la constitution des assemblées provinciales avec celles des Chambres des Représentants et parla même du « régime d’indépendance dont le Congo jouira en 1960 » [48].
Indépendance… 1960 ! On ne fit pas grand cas de cette prédiction qui. sur les lèvres du ministre, aurait pu tenir lieu de promesse. Ces propos étaient de bon augure pour la « Table ronde » de Bruxelles. Car il y avait beaucoup de chances que cette déclaration n’ait pas été le fait du hasard. En effet, d’une façon ou d’une autre, face aux réclamations nationalistes, la Belgique avait fait son choix. Elle se trouvait face à un dilemme : ou bien utiliser la force pour faire prévaloir son plan de décolonisation, donc aider le Congo à sa manière et malgré lui, ou bien s’en remettre à la volonté des intéressés eux-mêmes, toujours occupés à réclamer une indépendance « immédiate » et « totale ». La première éventualité, celle d’une décolonisation à l’Algérienne, était techniquement possible. Les bases militaires belges – Kitona, Kamina et Banana – existaient dans la colonie depuis 1953 [49]. Certes, la Constitution belge comportait une clause stipulant que les troupes belges affectées à la défense de la colonie ne pouvaient comprendre que des volontaires [50]. Mais les choses avaient évolué. Pressentant les événements futurs, le ministre de la Défense avait obtenu en 1958 l’autorisation de pouvoir affecter à ces bases d’Afrique tout militaire de son choix, volontaire ou non. Et le gouverneur général, conformément à la Loi du 29 juillet 1953, avait la latitude de convoquer les forces métropolitaines disponibles en cas de désordres graves (Young C., 1965 : 101-102). Cornelis, on l’a vu, ne se priva pas d’user de ses prérogatives lors des manifestations du 4 janvier, et ce, malgré l’avis défavorable du commandant en chef de la Force publique (Janssens E., 1961 : 70) [51]. Il réquisitionna en effet, dès le 5 janvier, le bataillon des para- commandos en poste à Kamina, dans le but, semble-t-il, de rassurer la population belge prise de panique (Mutamba M., 1977 : 627). Mais le gouvernement belge se garda de continuer dans cette voie. Il savait qu’il ne serait pas soutenu par les USA ni par les autres alliés, et qu’il aurait été condamné par l’ONU. Désormais, l’opinion belge s’opposait à ces méthodes ; en effet, l’année 1959 avait vu naître une série de campagnes s’opposant à tout envoi de miliciens au Congo. Le PSB fut à l’origine, dès octobre 1959, d’une campagne contre toute intervention militaire au Congo ; le 3 novembre, le bureau du syndicat FGTB déclara s’opposer à l’envoi, sous quelque prétexte que ce soit, de miliciens au Congo ; les étudiants des universités belges organisèrent des marches contre tout projet de réquisitionner des miliciens ; les chrétiens progressistes, les jeunesses socialistes et communistes distribuèrent des tracts pour prévenir une intervention des troupes métropolitaines au Congo et firent des pétitions opposée à ce projet (Young C., 1965 : 101-102 ; Mutamba M., 1977 : 722-724).
Toujours soucieuse, comme on l’a dit, de faire mieux que les autres, la Belgique devait à présent aller dans le sens de la négociation avec les « extrémistes ». Tel était l’enjeu.
La Table ronde politique belgo-congolaise eut donc lieu à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960. Cette rencontre, en raison de son importance, fut revendiquée par la suite par plusieurs partis congolais et un grand nombre d’instances belges. En réalité, cette initiative était le point d’aboutissement de plusieurs projets, tant s’imposait la nécessité d’un dialogue entre Belges et Congolais sur pied d’égalité.
S’il faut rechercher l’origine lointaine d’un tel projet, il faut remonter aux années 56 quand, après la parution des Manifestes, Lumumba préconisa la constitution d’une « Commission mixte de réforme » composée de responsables de la politique coloniale et de « quelques élites africaines exceptionnellement compétentes » (Michel S., 1961 : 205). Plus tard, en juin 1958, les membres africains du Conseil de gouvernement recommandèrent la création d’une « Commission composée de représentants du gouvernement belge et de ceux de la population congolaise », que l’ABAKO qualifierait en septembre 1958, de « dialogue valable » entre le peuple congolais et la Belgique. Plus tard, en avril 1959, l’Interfédérale préconisa la création d’une « Commission centrale » mixte, chargée de l’application de la nouvelle réforme (Mutamba M., 1977 : 733-734).
Certes, le concept même de « Table ronde » n’apparut pour la première fois qu’en juillet 1959, dans un communiqué du Parti travailliste congolais (PTC) qui prônait l’ouverture d’une discussion franche « autour d’une Table ronde » afin d’examiner ensemble le projet d’émancipation politique (Congo 1959 : 181). En novembre, le MNC/Kalonji reprit ce concept ; l’ensemble du cartel ABAKO ne tarda pas à faire sienne cette revendication.
Pourtant, c’est le PSB qui força la main à la Belgique, après avoir obtenu la convocation d’une session extraordinaire du Parlement. Le ministre, qui adopta cette idée, en fit l’objet de sa déclaration à la Chambre des Représentants le 15 décembre. On précisa alors que cette rencontre aurait une pluralité d’objectifs, entre autres ceux de se prononcer sur la structure politique du Congo, de déterminer la date des élections législatives ainsi que le régime électoral, la composition et l’attribution des assemblées provinciales et centrales sans oublier le calendrier précis de la mise en place des institutions. Les conclusions de la conférence étaient censées être élaborées sous forme de projets de loi, à déposer devant le Parlement » dans le délai le plus bref possible ». Voilà qui était précis.
Il fallut planter le décor. La Belgique était représentée à la fois par le gouvernement et le Parlement. La délégation gouvernementale comprenait six ministres accompagnés de vingt et un conseillers. Le Parlement délégua cinq députés avec douze suppléants et cinq sénateurs, accompagnés eux aussi de cinq suppléants. Au total seize socio-chrétiens, dix socialistes et six libéraux. Quant à la partie congolaise, elle fut dotée de quarante-cinq membres effectifs et quarante-huit suppléants. Le nombre de sièges, au sein de la délégation, fut réparti entre partis et autres sensibilités : 11 au PNP, 11 à la délégation des chefs coutumiers. 11 au cartel ABAKO (3 pour l’ABAKO, 3 pour le PSA, 2 pour le MNC/Kalonji, 1 pour le Parti du Peuple, 1 pour la Fédération générale du Congo et 1 pour l’ABAZI). Les autres délégations, au nombre de 8, se partagèrent les sièges restants : 3 pour le MNC/Lumumba, 2 pour la CONAKAT, 2 pour l’Alliance rurale progressiste et 1 pour chacun des partis restants : CEREA, ASSORECO, Cartel katangais, UNIMO et Union congolaise. Cependant, cette répartition n’avantageait pas les grosses délégations car chacune des onze délégations ne disposait que d’une voix [52].
Dès le départ, les Congolais formèrent un Front commun, après avoir pris l’engagement collectif d’unir leurs efforts (Congo 1960 : 22). On sait que cette unanimité… « déconcerta ceux qui limitaient leur connaissance des Congolais à une succession d’êtres individuels et oubliaient qu’en Afrique comme ailleurs, l’être individuel est toujours transcendé par l’être social » (Dumont G.H., 1961 : 21). La constitution de ce front leur fut recommandée tant par les « amis de Présence africaine » que par l’ « Association des Etudiants noirs du Congo en Belgique » dont le président, Marcel Lihau, était en contact étroit avec la délégation. La présidence de ce Front commun fut tenue par Jean Bolikango, le doyen d’âge du groupe ; ce front fonctionna sans faille, à tel point qu’on eût pu dire que l’ensemble des travaux était dirigé par les Congolais. « Chaque fois qu’ils se mettaient d’accord sur l’un ou l’autre point, les délégués du gouvernement et du parlement belges s’y ralliaient ». « Nous n’avons rencontré aucune opposition systématique de la part des parlementaires belges », s’est exclamé Lumumba (Van Lierde J., 1963 : 164). Quant à l’ensemble des travaux, ils furent présidés par E. Lilar, vice-président du Conseil des ministres belges.
Quelles furent les décisions concrètes adoptées lors de cette Table ronde ? Seize résolutions virent le jour à l’issue des travaux, mais elles peuvent être ramenées à quatre domaines principaux concernant la date de l’indépendance, les institutions du futur État, le régime électoral et la citoyenneté congolaise, et enfin le respect des biens et des personnes.
Le premier problème, concernant la date de l’indépendance, fut sentimentalement le plus important ; il fut posé dès le lundi 25. On le résolut avec une facilité déconcertante, avant même que Lumumba puisse atteindre Bruxelles. Bolikango, au nom du Front, avança la date du 1er juin ; le ministre du Congo estima qu’il était pratiquement impossible d’achever la mise en place des institutions… avant la fin du mois de juin ; il proposa le 31 juillet. Bolikango comprit, suivant la technique de négociation qui a cours dans nos marchés au Congo, qu’il fallait céder un peu, quitte à ce que l’autre partie avance une autre date extrême, conscient que la conclusion qui s’imposerait, serait une synthèse des deux propositions. Aussi, déclara-t-il, sur suggestion de C. Kamitatu, «la date de l’indépendance sera le 30 juin 1960… et nous demandons au ministre de proclamer que le gouvernement fera l’impossible pour qu’elle ne doive plus être modifiée » (Dumont G.H., 1961 : 50-51). A la surprise générale tout le monde applaudit, y compris la délégation belge (De Vos P., 1975 : 60). Comme symbole, la date choisie avait une signification importante, si l’on se réfère à l’indépendance léopoldienne. Mis sous la tutelle des Blancs un certain 1er juillet (1er juillet 1885 : proclamation de l’indépendance à Vivi), on retournait à « l’Afrique africaine », dans « l’avant-1er juillet » … le 30 juin. La période congolo-congolaise (par opposition à la période Congo belge), compromise depuis 85 ans, retrouvait enfin son droit à l’existence. Le 27 janvier 1960, jour où cette décision fut prise, fut donc une date importante, qui mettait un terme à beaucoup d’animosité, d’hésitations et d’hostilités.
On se mit assez aisément d’accord sur le principe de transfert au Congo de la totalité des compétences législatives sans aucune réserve. Suivant la métaphore employée par le sénateur Henri Rolin, l’indépendance ressemblait à une remise de clés : La Belgique doit, le 30 juin, remettre toutes les clés et ce sont les Congolais qui décideront de l’usage qu’ils en feront. Mais ce discours était trop beau pour être vrai, du moins dans sa totalité.
Le deuxième volet des résolutions porta sur les institutions. Le choix se porta unanimement sur un partage du pouvoir entre autorités centrales et provinciales ; à chaque niveau, les attributions furent réparties entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Doté au départ de six provinces, le Congo indépendant avait la latitude de modifier ce nombre. Le chef de l’État devait être élu avant le 30 juin par le congrès de deux Chambres mais ne serait pas responsable de ses actes devant ces mêmes chambres, puisqu’ils devaient être contresignés par un ministre. Le gouvernement congolais entrerait en fonction le 30 juin ; avant cette date, des Collèges Exécutifs seraient constitués pour associer les Congolais à l’exercice du pouvoir : six Congolais seraient nommés auprès du gouverneur général et trois auprès de chaque gouverneur de province, d’autres encore auprès des instances inférieures. Une commission politique de six Congolais résiderait à Bruxelles et aurait pour rôle d’épauler le ministre dans l’élaboration des projets de loi et autres textes légaux dans l’esprit des conclusions de la Table ronde. Le pouvoir législatif serait exercé à la fois par le Parlement et le Sénat, la première assemblée regroupant des députés élus au suffrage universel, à raison d’un membre pour 100 000 habitants et la seconde comportant les membres élus par les assemblées provinciales, à raison de quatorze membres par province. La durée de la première législature ne pouvait être inférieure à trois ans ni supérieure à quatre ans. L’une des premières préoccupations des Chambres congolaises devait être d’élaborer la Constitution du nouvel État.
La vision qui a prévalu réalisait un équilibre savant et donc vulnérable pour la suite entre tendances unitariste et fédéraliste. Chaque province, dotée d’une assemblée provinciale, aurait à sa tête un gouvernement provincial, composé d’un président et de cinq à dix membres. Il fut précisé, en cas de conflit de compétence, que l’arbitrage serait assuré par une mission du Conseil d’État belge, en attendant l’élaboration d’une loi congolaise. Au demeurant, les autorités judiciaires belges œuvrant au Congo allaient continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à la modification des règles d’organisation judiciaire au sein du nouvel État.
Le troisième jeu de résolutions précisa les conditions d’éligibilité et la répartition des sièges. Pour mieux contrôler le déroulement de l’opération électorale, on décida que la présidence des bureaux principaux serait confiée à des magistrats. Le point délicat concernait le cas des colons, qui n’étaient pas représentés à la Table ronde. Pouvaient-ils acquérir la nationalité congolaise et avoir des prétentions à l’électorat ou à l’éligibilité ? Sept des onze délégations congolaises se prononcèrent contre la reconnaissance d’un droit quelconque aux colons et à leur progéniture. La participation aux élections communales fut la dernière obligation civique qui leur incomba. Tout espoir de mise en place d’un État multiracial au Congo venait ainsi d’être écarté.
Les colons, dont la situation était plus complexe que celle des fonctionnaires dont le séjour au Congo n’était qu’une façon de briguer une meilleure insertion dans la société belge, posaient encore un problème. Le dernier complexe de résolutions les concerna quelque peu ; il porta précisément sur les garanties à donner aux biens et donc, sur le maintien de l’ordre et le respect du droit de propriété postérieurs au 30 juin. Les délégations congolaises reconnurent la nécessité d’une conférence plus spécifique portant sur les problèmes économiques, financiers et sociaux, le tout devant se dérouler endéans les cinq mois qui les séparaient de l’échéance du 30 juin. Le programme était donc plus que chargé.
Quant aux futurs rapports entre le Congo et la Belgique, ils devaient faire l’objet d’un traité général d’amitié, d’assistance et de coopération à conclure « le plus tôt possible entre les deux gouvernements ». La Belgique y tenait, pour son honneur, pour que l’indépendance du Congo passe pour être une décolonisation « modèle », conclue dans l’amitié et la concorde entre les deux partis et non pour la « démission modèle » d’une ancienne métropole qui, face aux pressions indépendantistes, n’aurait manifesté qu’un défaitisme généralisé [53].
Les délégués congolais revinrent de Bruxelles rayonnants et triomphants. La Table ronde avait une importance plus grande qu’elle n’y paraissait. Que le rêve soit devenu réalité, on en était conscient. Malgré l’existence d’un front mis en place contre l’adversaire commun, qui avait permis de minimiser bien des problèmes internes, le déroulement des travaux avait entre autres confirmé et consacré une certaine redistribution des forces. Lumumba continuait à être privilégié par rapport à Kasa-Vubu, visiblement moins apprécié par les Belges. L’incident que ce dernier provoqua à Bruxelles permit à ses détracteurs de l’enfoncer davantage. En effet, il exigea que la Table ronde devienne une « Constituante », devant procéder à la mise en place d’un « gouvernement provisoire » [54]. Devant le refus de la partie belge, il décida de quitter la Table ronde le 25 janvier et ne reprit sa place à la table de négociation que quinze jours plus tard. Cette initiative l’a desservi. Elle a fait prendre conscience aux uns et aux autres qu’il n’était pas indispensable. 11 fut désavoué, même par la délégation de l’ABAKO, et ne fit plus l’unanimité au sein du Cartel dont il était le président.
La Table ronde marqua donc l’éclatement du Cartel et, en même temps, la fin d’une collaboration étroite entre le PSA et l’ABAKO. Son succès marqua également la fin du « Front commun », vu que l’ennemi commun commençait à disparaître. Dans la liesse populaire qui caractérisa le retour des héros de la Table ronde, chacun prétendit auprès de son électorat avoir joué un rôle prépondérant, sinon le premier rôle à Bruxelles. Les alliances furent bouleversées ; dans cette atmosphère de réappropriation des destinées nationales, se dégageait de plus en plus la rivalité entre Lumumba et Kasa-Vubu, l’un symbolisant la tendance unitariste, et l’autre, la tendance fédéraliste.
Il faut remarquer aussi que la Table ronde ne fit pas grand cas du problème katangais. Ne connaissant pas chez eux comme les Katangais l’existence d’une présence européenne si imposante, et ignorant le problème spécifique des colons, les autres délégations congolaises les mirent rapidement à l’écart. Les Katangais repartirent incompris, pire encore, marginalisés. En les renvoyant ainsi à leurs problèmes, les autres délégations fournissaient des armes, sans s’en rendre compte, au démon de la division. Il ne restait plus aux Katangais qu’à gérer eux-mêmes leurs problèmes. Mais on n’en était pas encore à la sécession qui allait éclater cinq mois après.
En attendant, la liesse populaire avait tous ses droits. African Jazz, qui avait fait le déplacement de Bruxelles, prit à sa manière une part active à la Table ronde. Il se chargea d’immortaliser la liste des partis politiques et les noms de leurs principaux leaders en les gravant dans le vinyl des microsillons.
Refrain
Indépendance cha cha to zui e
O Kimpuanza cha cha tubakidi
O Table ronde cha cha ba gagner O
O dipanda cha cha to zui e
1 Assereco na Abako bayokani moto moko
Na Conakat na Cartel balingani na Front commun Bolikango, Kasa-Vubu, mpe Lumumba na Kalonji Bolya, Tshombe, Kamitatu, 0 Essandja, Mbuta Kanza
2 . Na MNC, na UGECO, Abazi na PNP
Na PSA, African Jazz
Na Table ronde mpe ba gagner.
Traduction
Refrain
L’Indépendance cha cha nous l’avons eue
Oh ! l’indépendance cha cha nous l’avons eue
C’est à la Table ronde cha cha qu’elle a été gagnée
Oh ! l’indépendance cha cha nous l’avons eue
- Assoreco et l’Abako se sont entendues telles un seul homme
Et la Conakat et le Cartel au sein du Front commun
[Il en est de même de] Bolikango et Kasa-Vubu, Lumumba et Kalonji
Bolya, Tshombe, Kamitatu
Essandja et le vieux Kanza
- Le MNC, l’UGECO, l’Abazi et le PNP Le PSA, l’African Jazz
A la Table ronde ils l’ont aussi emporté.
3.5 Les derniers décors
La Table ronde politique était enfin terminée. Restait à appliquer ses conclusions et à assurer les préparatifs immédiats de cette indépendance, enfin promise à une échéance précise. Les étapes à parcourir étaient fort bien déterminées : d’abord continuer le débat déjà engagé sur des questions économiques et financières, ensuite mettre en place une disposition constitutionnelle pour autoriser une première gestion de l’État, puis organiser les élections pour la mise en place des assemblées provinciales et nationales. L’étape ultime serait la mise en place d’un gouvernement, suivie des élections présidentielles. Avant cela, il fallut mettre en place les structures chargées de la gestion de la transition.
La présence d’une équipe congolaise à Bruxelles était nécessaire aux côtés du ministre du Congo, pour s’occuper de l’organisation de la conférence. A Bruxelles, le Front commun désigna les membres de cette commission politique, à raison d’une unité par province. Cette commission fut dominée par les représentants des partis modérés : Justin-Marie Bomboko (UNIMONGO) pour l’Equateur, Ignace Kanga (PNP) pour la Province Orientale, Sébastien Kapongo (PNB) pour le Kasaï, Jean-Marie Kititwa (PNP-UNERGA) pour le Kivu, Jean-Baptiste Kibwe (CONAKAT) pour le Katanga, Sylvain Kama (PSA) pour la province de Léopoldville [55]. Cette commission eut à rédiger, entre autres, l’avant-projet de la Constitution et celui des accords de coopération entre le Congo et la Belgique.
Le noyau dur des partis politiques préféra ne pas siéger dans cette commission à Bruxelles, pour être davantage présent sur le terrain. Pour ce faire, il choisit de s’investir dans le Collège Exécutif Général et les Collèges Exécutifs Provinciaux. Instituées par la Loi du 8 mars 1960, ces structures permettaient un exercice collégial des pouvoirs dévolus jusque-là, de manière exclusive, au gouverneur général et aux gouverneurs de province. Le principe de la collégialité avait au moins l’avantage de rendre inopérant tout boycottage des travaux par l’une des instances représentées. Le Collège Exécutif Général installé le 14 mars comprenait, en plus du gouverneur général, six membres responsables chacun d’un domaine bien précis. Ainsi Paul Bolya du PNP (Equateur) fut chargé plus particulièrement du plan décennal, de l’Institut géographique et des services médicaux. Joseph Kasa-Vubu de l’ABAKO (province de Léopoldville) se spécialisa dans les questions économiques et financières. Anicet Kashamura (CEREA) du Kivu s’orienta vers les dossiers de l’information, la Force publique et le travail. Lumumba (MNC/L) de la Province Orientale se spécialisa dans les affaires politiques, administratives et judiciaires ainsi que dans la sécurité et la jeunesse. Remy Mwamba (BALUBAKAT) du Katanga choisit les domaines scolaire et agricole. Pierre Nyangwile (MNC/Kalonji), le représentant du Kasaï, eut la responsabilité des affaires intérieures et des travaux publics. Une des premières décisions du pseudo-gouvernement fut d’interdire les milices privées et le port d’armes ; il se pencha sur la situation dans les provinces, prépara la Table ronde économique et assura le choix des stagiaires qui seraient envoyés en Belgique.
Les Collèges Provinciaux furent installés peu après. Leur composition tint compte des partis non représentés dans le Collège Exécutif Général, afin de ne pas mécontenter la métropole « modèle » et de garantir son impartialité. Chaque exécutif provincial était composé de quatre membres : le gouverneur de province et trois Congolais. Les sièges congolais furent donc occupés par F. Kimvay (PSA), L. Lombo (UNILAC), D. Kanza (ABAKO) dans la province de Léopoldville ; au Katanga, ils le furent par G. Munongo (CONAKAT), le syndicaliste P. Muhona et G. Kitenge (Union congolaise) ; en Province Orientale, ces fauteuils revinrent à L. Embal (PNP), F. Bumba (PNP puis MNC/L) et J.P. Finant [56] ; et au Kivu, à A. Kabare, fils du Mwami, J. Tshomba-Fariala (MNC/L), J.B. Shango (Union congolaise). Dans l’Exécutif de l’Equateur, on retrouva S. Ikolo (MNC/L), L. Eketebi (PUNA), L. Engulu (Unimongo) et à celui du Kasaï, D. Manono (Songye), J. Luhata (Otetela) et D. Mubanga (Mwena Konji).
Enfin, pour clôturer cette gestion de transition, le gouvernement belge jugea utile de nommer à partir de mai un « ministre résidant au Congo », en la personne de W.J. Ganshof Van der Meersh. Le ministre de la décolonisation avait naturellement pour tâche de veiller à la mise en place des institutions nouvelles. Le colonisateur « modèle » ambitionnait décidément d’être le champion de la décolonisation en Afrique.
La première action concrète, après l’implantation du décor de la décolonisation, fut la convocation de la « Table ronde économique, financière et sociale » suivant les recommandations de la Table ronde politique. Cette seconde réunion se tint elle aussi à Bruxelles, du 26 avril au 16 mai. La délégation belge fut pratiquement la même. Elle comprenait cinq ministres, parmi lesquels A. Lilar, De Schrijver et Scheyven, des conseillers et des représentants des deux assemblées législatives. La nouveauté se situa chez les observateurs, parmi lesquels figuraient des représentants du secteur privé : la Fédération des entreprises congolaises, les Chambres de commerce de Léopoldville et Elisabethville, la Fédération des Associations des colons, etc. Du côté congolais, les acteurs étaient nouveaux ; au lieu des leaders de première ligne, ce furent leurs compagnons et leurs lieutenants – recrutés essentiellement parmi des étudiants en Belgique – qui occupèrent les premières places [57]. Très satisfaits de la victoire de la première Table ronde, ces leaders ne comprirent pas que la vraie négociation avait seulement commencé et que l’essentiel demeurait à faire. Cette Table ronde fut donc le rendez-vous des malentendus : le crédit qu’on y accorda fut inversement proportionnel à la conscience qu’on se faisait du succès de la réunion précédente. Si elle fut minimisée par la partie congolaise, la Table ronde économique fut prise très au sérieux par la partie belge, qui voyait en elle la conférence de la dernière chance. L’enjeu pour elle consistait à placer des garde-fous, pour atténuer l’effet du geste trop facilement posé.
La partie congolaise ne put refaire son unité du « Front commun », en dépit de l’initiative de constituer un « Front national ». Les deux réalités n’avaient pas la même consistance. Entre les deux événements, plusieurs divisions s’étaient faites, notamment la dislocation du Cartel ABAKO. Le malentendu persista au plan des travaux. Alors que la Belgique souhaitait une discussion de fond, les Congolais n’attendaient de la conférence qu’un « inventaire » des biens dont le transfert, selon eux, allait de soi. La discussion de fond eut tout de même lieu, même si elle se déroula entre partenaires de forces et de compétences inégales.
Dix-huit résolutions en sortirent, prenant surtout en compte les préoccupations du gouvernement et des milieux d’affaires belges : affirmation du libéralisme économique, garantie contre les nationalisations, nécessité du maintien de l’ordre, liberté des transferts financiers, stabilité du régime fiscal, établissement d’une zone monétaire belgo-congolaise, contrôle des investissements par le biais d’une société belgo- congolaise à créer [58]. Tout fut mis en place pour favoriser la fuite des capitaux, dans une coopération belgo-congolaise prétendument privilégiée, les deux nations s’étant mises d’accord pour s’attribuer ce statut dans les relations commerciales et les échanges de services à venir. Après le Congo, satisfait depuis janvier par la promesse de l’indépendance, la Belgique, était satisfaite, à son tour.
Dès mai 1960, le portefeuille de l’État connut ses premières érosions, au profit de l’État belge ou des privés belges ou internationaux. En effet, conformément aux décisions de la Table ronde économique, un décret décida que le Comité National du Kivu se retirait du Congo. L’État congolais dut payer une indemnité, pour pouvoir récupérer les droits d’intervention et de gestion que ce comité s’était octroyés. La Compagnie des CFL reçut également une indemnisation en raison de la cession à l’État congolais de son pouvoir concédant. La CSK préféra déclarer sa dissolution, pour partager son portefeuille entre le Congo et la « Compagnie du Katanga » ; le retrait de cette dernière compagnie du Congo fit perdre à l’État la majorité des voix aux assemblées de l’UMHK. Une loi votée par le Parlement belge offrit aux sociétés commerciales belges de droit colonial d’opter pour le droit belge ou le droit congolais. Cette loi donna lieu à des spéculations. Trente des cinquante grandes compagnies représentées au portefeuille national optèrent pour le droit belge. Le Congo fut ainsi spolié de ses importantes participations, notamment dans la Caisse de Sécurité sociale et l’Union nationale des Transports fluviaux, qui devinrent des compagnies de droit belge. De plus ce transfert des biens s’effectuait sans contrôle des changes. Qui, à l’époque, pouvait accorder à ce phénomène la moindre attention ? Au demeurant, le gouvernement belge lui-même participait à ce mouvement de transfert, notamment par le déplacement des dépôts d’or du Congo en Belgique. Ce transfert d’or serait encore revendiqué par les dirigeants zaïrois même après l’indépendance, mais en vain.
A côté de ce cas particulier, c’est l’ensemble du problème du portefeuille de la colonie (évalué à 35 ou 37 milliards de francs) qui se posait. Il fut considéré comme un patrimoine commun à gérer ensemble au bénéfice des deux parties. Belle astuce pour tromper les néophytes en gestion économique qu’étaient les Zaïrois de l’époque, quand on sait que les comptabilités des deux pays, depuis la période léopoldienne, étaient bien distinctes. Cette situation, rendue volontairement confuse, situait le début du contentieux qui allait s’ériger, dans l’avenir et sur un rythme saisonnier, en pierre d’achoppement dans les rapports entre les deux pays. Pour les colons le transfert des fortunes en Belgique prit également la forme d’un marché noir, où chacun s’efforça de transférer au plus vite ses avoirs dans la métropole (De Vos P., 1975 : 81-83).
Qui, au Congo, se souciait de ces phénomènes ? Au moment où la Table ronde économique prenait fin, le 16 mai, on était à deux mois de la date de l’indépendance. Les populations se trouvaient en pleine période électorale, depuis quelque temps. L’importance de ce dossier n’échappait à personne au sein des partis en présence. Ceux-ci s’étaient investis à fond dans la campagne. Dans le domaine de la diffusion, bon nombre de formations politiques disposaient de leurs organes de presse, qui servaient d’« instruments de propagande ». L’ABAKO, on le sait, éditait Kongo Dieto et Notre Kongo [59] ; le MNC/L possédait L’Indépendance ; le MNC/K disposait de la Voix du Peuple à Léopoldville et de l’Abeille au Kasaï. Le Parti du Peuple se faisait entendre dans Emancipation ; le PSA dans Solidarité africaine et la PUNA dans la Nation congolaise. La cause du PNP était défendue dans Liberté et celle de CEREA, dans la Vérité etc. On assista aussi à une véritable compétition d’emblèmes : la coquille de l’escargot (nkodia) symbolisant la force tranquille pour l’ABAKO et pour le PSA, le palmier (diba) enroulé d’un serpent et une main prête à en trancher la tête, etc.
Dans le cadre des préparatifs, certains partis, pour consolider leur cohésion interne, organisèrent des congrès préparatoires. Tel fut le cas des MNC/L qui tinrent plusieurs congrès, en associant chefs coutumiers et autres forces locales, à Luluabourg (3-4 mars), à Coquilhatville (10-11 avril), à Inongo (1-2 mai) et à Stanleyville (22 mai). Les programmes électoraux n’étaient pas vraiment distincts d’un parti à l’autre. Ils pouvaient tous être ramenés aux deux tendances déjà énoncées : la tendance « nationaliste » dont les programmes avaient pour constantes la défense de l’unité, l’insistance sur l’inviolabilité de la souveraineté nationale et le neutralisme à l’égard des deux blocs de l’Est et de l’Ouest (ce qui serait interprété comme une sympathie à l’égard de l’Est), la condamnation de l’exploitation de l’individu au profit des classes privilégiées. Cette « gauche » était incarnée de manière idéale par le MNC/L ; mais elle s’exprimait aussi dans les campagnes du CEREA et du PSA. Les autres partis avaient des vues moins tranchées. Tout en ayant des accents « nationalistes », par opposition à l’ennemi commun qu’était le colonialisme, ils se réclamaient de la vision fédérale et étaient partisans de la sauvegarde des liens belgo-congolais. C’est la seconde sensibilité, qualifiée de « fédéraliste » et de « modérée » qu’incarnaient particulièrement la CONAKAT et, dans une moindre mesure l’ABAKO, bien que celle-ci ne fût pas toujours modérée dans ses prises de position.
Les résultats des élections qui se déroulèrent dans un climat houleux, confirmèrent la primauté de la tendance nationaliste, tant au scrutin provincial qu’au scrutin national. Le MNC/Lumumba, nullement affecté par la dissidence de Nendaka (qui créa le MNC/N), en sortit grand vainqueur, représenté dans toutes les provinces, en particulier dans la Province Orientale. Cette victoire a surpris ; elle pouvait pourtant s’expliquer aisément. Elle tenait à la personnalité même de Lumumba et à son statut, mais aussi à une conjoncture qu’il avait su exploiter. Grand tribun, Lumumba avait un sens aigu de la politique, capable de trouver chaque fois le mot juste pour susciter l’engouement de la foule. A tout cela s’ajoutait encore un atout : son identité ethnique. Les Tetela-Kusu, à cause des vicissitudes de l’histoire, se trouvaient dispersés aux quatre coins du pays, à Léopoldville comme à Elisabethville, où ils constituaient un nombre important d’émigrés. Dans le Haut-Congo, les Kusu du Maniema formaient un groupe suffisamment distinct ; au Kasaï, les Tetela et autres populations de Sankuru voulaient être différenciés de la grande masse des Luba. Donc, Lumumba, à cause de son identité de Tetela, avait son électorat « naturel » dispersé dans l’ensemble du pays, ce qui l’obligeait à jouer la carte nationaliste. Seul son concurrent Kalonji pouvait se prévaloir d’un tel avantage, s’il avait pu susciter l’unanimité des peuples luba du Kasaï, du Katanga et ceux de la diaspora. La sensibilité nationaliste de Lumumba constitua donc encore un atout, qui vint enrichir considérablement cet électorat « naturel », d’autant plus que le PNP, l’autre parti supra- ethnique, était discrédité, du fait qu’il était soutenu par l’administration coloniale.
Les grands partis ethniques et régionaux furent également confirmés dans leur succès, mais dans le cadre restreint de leurs fiefs : l’ABAKO dans le Bas-Congo et la capitale ; le PSA au Kwilu, le CEREA dans le Nord-Kivu, la CONAKAT dans le Sud- Katanga, etc.
Les élections terminées, restait à procéder à la mise en place des organes du pouvoir du Congo indépendant. Aux conseillers provinciaux revenait, outre la mise en place de leurs bureaux, l’élection des sénateurs appelés à représenter la province puis les membres du gouvernement provincial. Ce qui fut fait, non sans difficultés, spécialement au Katanga, à Léopoldville et au Kasaï où l’état d’exception, décrété depuis 1959 fut maintenu. En dépit de cela, les présidents provinciaux furent mis en place : C. Kamitatu (PSA) à Léopoldville, L. Eketebi (PUNA) en Equateur, J.P. Finant (MNC/L) à la Province Orientale, J. Miruho (CEREA) au Kivu, Dominique Manono (MUB) au Kasaï, M. Tshombe (CONAKAT) au Katanga.
A l’échelon national, Lumumba prit les devants en revendiquant le poste de formateur de gouvernement, pour contrecarrer les tentatives de Bolikango (ASSORECO), Delvaux (LUKA-PNP) et Iléo (MNC/K-UNIMONGO) de créer un « Cartel d’Union nationale » dirigé contre lui. Ce cartel se proposait, d’après les intéressés eux-mêmes, de regrouper les « vrais nationalistes », « ceux pour qui la dignité humaine n’est pas un vain mot, ceux dont le comportement n’est pas uniquement dirigé par la soif du pouvoir ». L’action « dirigée contre la dictature » visait sans aucun doute Lumumba [60].
En effet, depuis quelques mois déjà, la bête noire de l’administration avait cessé d’être Kasa-Vubu pour devenir Lumumba. Cette politique de soutien des « modérés » pour les opposer aux « extrémistes » menait à des positions apparemment contradictoires. Ainsi, pendant que se montait un cartel anti-Lumumba, Kasa- Vubu, la bête noire d’hier, se faisait désigner par le Collège Exécutif Général, pour inviter le roi à se rendre aux fêtes de l’indépendance. Lumumba sentait l’étau se resserrer sur lui. Il émit des revendications de plus en plus nombreuses : le retrait des troupes belges fraîchement débarquées au Congo soi-disant pour la sécurité des populations blanches, le retour en Belgique du ministre-résident, l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct. A son tour, il constitua un cartel avec le PSA, le CEREA et le BALUBAKAT, dénonçant à qui voulait l’entendre, les intrigues et machinations de-dernière minute dont il était l’objet, visant à l’empêcher de jouir de sa victoire électorale. « Si les manoeuvres actuelles se poursuivent, déciara-t-il devant les jeunesses MNC, nous serons bien obligés d’inviter le peuple à proclamer lui- même son indépendance » (Congo 1960 : 280).
Est-ce à cause de ces pressions ou volontairement qu’il tint, le 13 juin, le rôle d’informateur en vue de la constitution du premier gouvernement [61] ? Les pourparlers s’engagèrent. Devant l’ampleur de la tâche, il demanda une prolongation du délai de sa mission ; elle lui fut accordée mais le lendemain, le ministre-résident changea d’avis, le déchargea de sa mission. Le 17 juin, il nomma Kasa-Vubu non plus informateur, mais formateur du gouvernement. Lumumba dénonça encore les manœuvres occultes qui avaient présidé à ce changement. Kasa-Vubu connut les mêmes difficultés, et ne parvint pas à former le gouvernement. Une rencontre entre les deux hommes, le 19, n’apporta rien de plus. Kasa-Vubu, formateur de gouvernement mais briguant plutôt le portefeuille présidentiel, proposa à Lumumba la présidence du conseil dans l’équipe gouvernementale qu’il allait former. Celui-ci refusa. Il menaça de demander à son parti et à ses alliés de s’abstenir lors de l’élection du chef de l’État ou alors de voter pour Bolikango. Si cette menace était mise à exécution, Kasa-Vubu raterait le portefeuille présidentiel, ce qui n’arrangerait pas les choses, car l’ABAKO décréterait automatiquement la sécession du Bas-Congo. De menace en menace, un compromis fut trouvé : il suffisait de remettre Lumumba au poste de formateur de gouvernement. Ce fut chose faite le 21, où il fut désigné « formateur » et non plus « informateur ». Le même jour, le MNC/L remportait le poste de président de la Chambre en la personne de Joseph Kasongo.
Tout finit par s’arranger. Le 24 juin 1960 demeure une journée mémorable, marquée au cours de ses premières heures par le vote de confiance du Parlement au premier gouvernement du Congo indépendant par 74 voix sur 137. Le soir même, le premier chef d’État fut enfin élu : le scrutin donna la majorité avec deux tiers des voix.
L’équipe gouvernementale était démesurée mais elle était le résultat d’un savant calcul et d’un dosage astucieux. Des départements ministériels avaient été morcelés volontairement, histoire de contenter les différents partis. Six ministères revenaient au seul MNC (Défense nationale, Intérieur, Communications, Agriculture, Affaires foncières, Jeunesse et sports) ; huit autres ministères furent attribués à ses alliés : le PSA (vice-primature, Travail et Education nationale), le CEREA (Information et Commerce extérieur), le BALUBAKAT (Justice), la COAKA (Santé publique), l’U.N.C. (Travaux publics) et le MUB (Coordination économique et plan). Les « modérés », notamment ceux du Cartel national, se partagaient les quelques autres postes restants. Il faut noter que, pour des raisons probables de stratégie, les postes nécessitant des contacts avec l’extérieur furent confiés aux représentants des modérés ; Albert Delvaux (PNP) ministre-résident en Belgique, Thomas Kanza (sans parti mais proche de Lumumba) ministre délégué à l’ONU et surtout J. Bomboko (UNIMONGO) ministre des Affaires étrangères et Mandy, son secrétaire d’Etat. Trois étaient des universitaires et le quatrième, un mulâtre [62]. Les dix secrétaires d’Etat furent répartis de même : trois d’entre eux étaient d’origine MNC/L (J. Mobutu, A. Kiwewa, A. Bolamba), trois furent recrutés dans le cartel des modérés (A. Nyembo, R. Batsikama, J. Lumbala respectivement de CONAKAT, ABAKO et PNP). Quatre autres furent choisis en tant que techniciens : A. Nguvulu, candidat malheureux aux élections, M. Liongo de l’APIC, les universitaires A. Mandy et A. Tshibangu. Les ministères d’Etat sans portefeuille servirent à équilibrer le quota : on y trouve un seul élément du MNC/L contre trois issus des partis modérés.
Il ne restait plus qu’à vivre la grande fête de l’indépendance, qui s’annonçait comme une simple pause dans une situation de tension qui n’avait pas connu de dénouement véritable. A l’intérieur, plusieurs problèmes demeuraient en suspens. Le Sud-Katanga, pratiquement négligé dans la composition du gouvernement, rêvait de faire sa sécession, soutenu dans ce projet par une grande majorité de colons. Déjà le 14 juin, on avait saisi à la rédaction de l’ « Essor du Congo » à Elisabethville le texte de la proclamation d’indépendance que Moïse Tshombe devait lire le soir même (Mutamba M., 1977 : 793) [63]. Au Kasaï, les tensions ethniques étaient encore sensibles, et Lumumba n’avait réservé aucun poste à A. Kalonji, en raison du différend qui les opposait. Bolikango, qui avait misé jusqu’à la dernière minute sur la présidence de la République et dont le costume présidentiel, aux dires du peuple, était déjà confectionné, n’aboutit nulle part [64]. Les mécontents s’inscrivirent a priori en faux contre l’action de Lumumba ; l’entente des deux grands leaders, Lumumba et Kasa-Vubu, serait éphémère. Il ne pouvait en être autrement, car ces deux personnages, avaient incarné deux visions diamétralement opposées.
Les tractations pour la composition du gouvernement avaient préoccupé plusieurs pays indépendants d’Afrique. Dans un message téléphonique, l’Empereur Haïlé Selassié avait invité les politiciens congolais à enterrer une fois pour toutes la hache de guerre, dans l’intérêt de leur peuple. Sur le plan international, les attitudes étaient suspectes à l’égard du Congo. Ainsi, quelques mois plus tôt, à l’issue de la Table ronde politique, la France avait rappelé à la Belgique son droit de préemption sur le Congo, chose curieuse, étant donné que celui-ci ne pouvait être valable qu’en situation de cession du Congo de la Belgique à une autre puissance étrangère. Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, le savait fort bien. S’il exhumait un tel droit, c’est que cette indépendance accordée vaille que vaille devait, dans les prévisions de la France, aboutir à une récupération de la colonie par une autre puissance . [65]Pour confirmer cette inquiétude, Ralph Bunche, secrétaire général adjoint de l’ONU, venu à Léopoldville pour prendre part aux festivités de l’indépendance, reçut l’ordre du secrétaire général de demeurer sur place. L’envoyé spécial de Eisenhower, président des USA, qui parcourut le pays la veille de l’indépendance, aboutit lui aussi à la conclusion que la situation était explosive (Murphy R„ 1965).
Tableau 21 — Premier gouvernement du Congo indépendant
| I Premier ministre et ministres |
| Premier ministre et ministre de la Défense nationale : Patrice Lumumba (MNC/L) |
| Vice-premier ministre : Gizenga Antoine (PSA) |
| Ministre des Affaires étrangères : Bomboko Justin (UNIMO) |
| Ministre du Commerce extérieur : Bisukiro Marcel (CEREA) |
| Ministre résidant en Belgique chargé des relations entre la Belgique et le Congo : Albert Delvaux (LUKA) |
| Ministre délégué à l’ONU : Thomas Kanza (Université) |
| Ministre de la Justice : Rémy Mwamba (BALUBAKAT) |
| Ministre de l’Intérieur : Gbenye Christophe (MNC/L) |
| Ministre des Finances : Pascal Nkayi (ABAKO) |
| Ministre des Affaires économiques : Joseph Yav (CONAKAT) |
| Ministre de la Coordination économique et du Plan : Aloïs Kabangi (MUB) |
| Ministre des Travaux publics : Alphonse llunga (UNC) |
| Ministre des Communications : Alphonse Salongo (MNC/L) |
| Ministre de l’Agriculture : Joseph Lutula (MNC/L) |
| Ministre du Travail : Joachim Masena (PSA) |
| Ministre de la Santé publique : Grégoire Kamanga (COAKA) |
| Ministre des Mines : Edmond Rudahindwa (REKO) |
| Ministre des Affaires foncières : Alexandre Mahamba (MNC/L) |
| Ministre des Affaires sociales .-Antoine Ngwenza (PUNA) |
| Ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts : Mulele Pierre (PSA) |
| Ministre de l’Information et des Affaires culturelles : Anicet Kashamura (CEREA) |
| Ministre de la Jeunesse et des Sports : Mopolo Maurice (MNC/L-CEREA). |
| II Secrétaires d’État |
| A la Présidence : J.-D. Mobutu (MNC/L) |
| Aux Affaires étrangères : André Mandy (Université) |
| Au Commerce extérieur : Antoine Kiwewa (MNC/L) |
| Aux Finances : André Tshibangu (Université) |
| A la Justice : Maximilien Liongo (APIC) |
| A l’Intérieur : Raphaël Batshikama (ABAKO) |
| A la Coordination économique et au Plan : Alphonse Nguvulu (PP) |
| A la Défense nationale : Albert Nyembo (CONAKAT) |
| A l’Information et aux Affaires culturelles : Antoine R. Bolamba (MNC/L). |
| III Ministres d’État |
| Charles Kisolekele (ABAKO) |
| André Ngenge (PUNA) |
| Paul Bolya (PNP) |
| Georges Grenfell (MNC/L). |
Le prix de la mutation, il fallait donc le payer, et gérer une transition dont on ne venait de vivre que le premier épisode. En attendant, la fête avait ses droits, auxquels il fallait satisfaire. La mutation en cours méritait bien une pause, le temps d’évaluer le chemin accompli sur le sentier de la décolonisation, et de considérer l’itinéraire qui restait à parcourir.
Texte. Le premier gouvernement central congolais
Le témoignage de Thomas Kanza (Congo 1960 ? Tôt ou tard, ata ndele : 20-24) sur le premier gouvernement central congolais situe les causes de sa paralysie, et l’impossible fonctionnement auquel il était voué.
Le premier gouvernement central congolais était moins qu’un gouvernement. Ce fut un célèbre et historique mariage de raison entre toutes les différentes tendances et toutes les différentes personnalités marquantes des cercles politiques congolais.
Il a fallu contenter tout le monde, ne froisser personne et n’oublier personne. En effet, faire partie du premier gouvernement congolais ou bien y être représenté par un homme de son bord était considéré comme un droit naturel tant par les partis politiques que par les éminents leaders politiques. La notion même de parti d’opposition était impensable. La masse congolaise, elle, n’y voyait que l’heureux avènement d’une nouvelle autorité qui se substituait aux colonialistes pour mieux servir les intérêts de quatorze millions de Congolais.
Le mariage fut tellement idyllique qu’il était inconcevable que le premier gouvernement congolais résistât aux premières sollicitations extérieures.
Rien de plus exigeant qu’un complice et sympathique regard d’un futur amant lancé vers une jeune fille devenue épouse par obligation et non par conviction encore moins par amour. Il en est de même des tentations irrésistibles qui suscitent les regards prometteurs d’une ancienne maîtresse vers son ex-amant forcé par l’Histoire et la société à devenir officiellement et légalement époux soi-disant fidèle.
Ce que l’on appelle abusivement « immixtions étrangères » dans les affaires internes du Congo ne sont rien d’autre que ces « regards complices à la fois sympathiques et rapaces » venant de la part de ceux qui, plus que les Congolais, sont intéressés au Congo. Non à son bonheur, encore moins à celui de ses millions d’habitants mais bien à l’utilisation du Congo et de ses richesses pour des fins qui restent souvent inconnues de certains de nos compatriotes très haut placés.
La campagne électorale d’avant la proclamation de l’Indépendance fut très coûteuse pour presque tous les hommes politiques congolais. Les frais engagés et les dépenses faites de façon seigneuriale ont fort mal cadré avec les modiques salaires dont bénéficiaient les futurs élus du peuple.
Il faut croire que plus d’un d’entre eux s’était dorénavant rendu tributaire des largesses financières extérieures. Après le 30 juin 1960, les hommes politiques congolais durent faire face aux sollicitations de leurs différents créanciers exigeant avec un sourire malicieux et intransigeant le remboursement sous d’autres formes de leur bienveillante collaboration au succès électoral.
Loin de moi l’idée de dire que nos leaders politiques seraient des honorables « vendus ». Comme dans toutes les jeunes nations sous-développées bon nombre de ceux qui conquièrent le pouvoir politique sont seulement de très braves gens « très reconnaissants » vis-à-vis des personnes physiques ou morales qui les estiment.
La reconnaissance est un sentiment humain très naturel mais qui présuppose un bien reçu ou un service dont on a bénéficié soit directement soit indirectement.
C’est déjà tragique d’être un tremplin ; c’est encore plus tragique d’être un tremplin inconscient car on est fidèlement les ennemis de son peuple avec la conviction et la volonté de ne servir que les intérêts supérieurs de sa nation et de ses compatriotes.
Le premier gouvernement central congolais devait nécessairement être de courte durée. Par sa composition même, par la répartition des portefeuilles ministériels et par la constitution des différents cabinets ministériels, il remplissait toutes les conditions pour succomber rapidement. Le torpillage allait se faire aussi bien du dedans que du dehors. Cela fut savamment dosé, systématiquement calculé. La mise au point des différents scénarios était scientifiquement conçue et toutes les péripéties allaient se dérouler comme prévu. Déjà le 30 juin 1960 tout le dispositif était en place et n’attendait que le signal prévu pour entrer en action. Il faudrait toujours reconnaître à son adversaire et à son créancier plus d’intelligence qu’à soi-même et à son ennemi plus d’imagination et des moyens d’action plus efficaces que les siens propres. Cela éviterait bien des catastrophes impardonnables.
L’ignorance est admissible mais elle devient un défaut quand on y persiste alors que les possibilités de s’informer sont à sa portée.
Ceux parmi les membres du premier gouvernement central congolais qui crurent un instant à la cohésion et à la solidarité gouvernementales auront appris à leurs dépens qu’ils n’étaient pas préparés pour affronter l’épreuve. Ils ont qualifié certains silences calculés comme étant des signes de haute diplomatie et de grande intelligence de la part des collègues ministres dont la mission secrète consistait en fait à : « être toujours présent, entendre et bien entendre, ensuite rapporter le plus fidèlement possible ».
Les âmes les mieux intentionnées auront du mal à croire qu’il se tint des réunions très privées et ultrasecrètes – en dehors des réunions du Conseil des ministres régulièrement convoquées par le chef du gouvernement – qui ne furent que des secrets de polichinelle.
Le gouvernement congolais portait, comme on dit, en son sein, les germes de sa propre destruction.
L’appel pathétique lancé par les autorités congolaises à l’Organisation des Nations Unies était motivé par l’ignorance dans laquelle se trouvaient ces autorités sur le rôle et le fonctionnement réel de cette organisation. Le président Bourguiba qui n’est certainement pas naïf n’a jamais pensé faire appel aux troupes de l’ONU pour résoudre le différend entre la France et la Tunisie au sujet de Bizerte. Le secrétaire général de l’ONU qui fut pourtant invité à se rendre compte sur place de l’état de choses n’a jamais osé suggérer pareille idée au gouvernement tunisien.
Le premier gouvernement central congolais brillait par sa crédulité dans l’efficacité et la sincérité des sentiments de l’ONU qui, légalement et normalement, devait être du côté du peuple congolais contre les « Grands » de ce monde. Il oubliait que ce sont précisément les « Grands de ce monde » qui finançaient l’opération ONU au Congo. Quand il découvrit tardivement que cet organisme était nocif pour le salut de l’indépendance congolaise, le gouvernement s’appliqua très mal pour l’éconduire très poliment et très fermement. Quand on n’a pas réussi à empêcher un serpent venimeux de pénétrer dans un immense building en construction, il faut éviter d’étendre les dégâts en le pourchassant à tort et à travers, car le serpent qui dorénavant dispose de plusieurs cachettes dans la maison peut se replier et rebondir de temps en temps pour mordre.
L’Histoire dira que l’ONU fut invitée au Congo par les autorités légalement établies ; c’était un mal inévitable. Mais à cause d’elle plusieurs actions clandestines devenaient possibles. L’immixtion étrangère dans les affaires internes du Congo devenait moins apparente et hautement légale du point de vue international. La façon dont l’ONU allait interpréter et appliquer les résolutions du conseil de sécurité était aussi prévisible. Certains naïfs ne l’ont pas compris et là où cela devient impardonnable, c’est qu’ils n’ont pas voulu comprendre quand on le leur a expliqué.
L’opération ONU au Congo, de même que toute charité bien ordonnée, devait être d’abord profitable à ceux qui la finançaient avant de servir les Congolais.
[1] On osait déclarer, dans les milieux missionnaires, qu’il s’agissait des écoles « des enfants du Diable » et de « ceux qui n’aiment pas Dieu ».
[2] Kalina fut un fonctionnaire hongrois au service de Léopold II, qui trouva la mort dans les chutes en aval de Kinshasa ; on donna son nom au quartier administratif de Léopoldville, où se situaient les bureaux du gouverneur général et qui s’appelle de nos jours la Combe.
[3] En 1958, la dissidence de deux voix libérales accorda l’investiture au gouverneur social chrétien Gaston Eyskens ; son ministre des colonies fut alors… Léon Antonin Marie Pétillon, qui succéda ainsi à Buisseret.
[4] Au Congo, les enfants qui naquirent après ce voyage reçurent presque invariablement le prénom de Baudouin en souvenir de ce périple ; les filles de leur côté, étaient prénommées « Joséphine-Charlotte » (sœur aînée de Baudouin, qui deviendra la Grande-Duchesse de Luxembourg).
[5] En ce qui concerne la genèse de l’université, voir en particulier les Mélanges offerts à G. Malengreau. Problèmes de l’enseignement supérieur et de développement en Afrique centrale, Paris, 1975, spécialement les textes de G. Van Der Shueren (« La naissance de l’université Lovanium », pp. 13- 36) ; de Luc Gillon (« Aspects financiers de la réalisation et du fonctionnement de l’université Lovanium », pp. 37-66) ; de Louis Bruyns {« La fondation FOMULAC-Lovanium à Kisantu », pp. 67- 72) ; ainsi que l’étude de R. Yakemtchouk sur la Faculté de Théologie (1983) sans oublier le témoignage de Mgr Gillon (1988). Pour des études plus systématiques, consulter Bernadette Lacroix (1972) et de B. Verhaegen (1978).
[6] Parmi les principaux promoteurs du projet, on trouve les professeurs Léon Dupriez et Fernand Malengreau. Le fils de ce dernier, Guy Malengreau allait jouer un rôle déterminant dans la mise en place de l’université Lovanium à Kinshasa.
[7] Après 1960, les assistants médicaux et agricoles eurent accès à [‘Université et devinrent d’excellents médecins et ingénieurs agronomes.
[8] L’Arrêté Royal reconnaissant officiellement l’existence de l’université Lovanium ne fut signé que le 3 février 1956.
[9] A ses origines, l’université « officielle » fut essentiellement européenne. Ce n’est qu’en 1963 qu’elle sortit ses premiers diplômés universitaires. Mais à l’époque, son fonctionnement était déjà compromis par la sécession du Katanga, au sein de laquelle elle eut le statut d’université d’Etat. Jusque-là ses effectifs estudiantins restèrent limités. En 1960-61, Lovanium comptait 440 étudiants et l’UOC 143 ; en 1962-63, Lovanium avait 998 étudiants et l’UOC 246 ; en 1963-64. Lovanium en atteignait 1 066 et l’UOC 424 (Mudimbe V.Y., 1980 : 381). C’est dire que Lovanium constituait à l’époque la plus importante pépinière de l’intelligentsia du pays.
[10] Voir notamment les premiers écrits de Jules Chômé : La passion de S. Kimbangu (1959), Le drame de Luluabourg (1959), La crise congolaise (1960), etc. ; de Thomas Kanza : Congo 1960. Tôt ou tard. Ata Ndele (1959) ; de Auguste Mabika : (Kalanda) Baluba et Lulua, une ethnie à la recherche d’un nouvel équilibre (1959).
[11] Ce centre est à l’origine de la publication d’une précieuse collection de documents de base sur la décolonisation de 1959 à 1967 (cf. Congo 1959, Congo 1960, en 2 vol., Congo 1961, Congo 1962, Congo 1963, Congo 1964 en coédition avec Princeton University Press et l’I.N.E.P., Congo 1965 avec les mêmes collaborations, Congo 1966 en coédition avec l’I.N.E.P., Congo 1967 en coédition avec l’I.N.E.P.). D’autres études ont été menées notamment sur les partis politiques PSA (1963) et ABAKO (1963), sur la Sécession du Katanga (1963), sur les Rébellions au Congo (2 tomes) et sur les Cinquante derniers jours de P. Lumumba (Seuil, 1976, 2“ édition).
[12] Les premiers licenciés furent : Tshibangu André (1958), Kisuka Gustave (1960), Madrandele Prosper (1960) en Sciences politiques et administratives ; Kazadi Fernand et Takizala Henri en Sciences sociales ; Ndele Albert (1958), Malimba Paul (1960), Ngoie Venant (1960 en Sciences économiques ; lyandja Joseph (1958), Mpanda Joseph (1958), Bizala Cléophas (1959), Izia Crispin (1959), Bakole Martin (1960) en Sciences pédagogiques. Le premier ingénieur agronome fut Pierre Lebughe (1959) ; la première génération des ingénieurs civils électriciens vint plus tard : Bisengimana Barthélemy (1961), Malu Félix et Mutombo Elias (1962). Quant aux premiers docteurs en médecine, ils avaient pour noms Tshibamba Marcel et Ilunga Félicien (1961), Dudula Joseph et Kabamba Nicolas (1962) (cf. Annuaire de l’Université).
[13] Le premier juriste du corps académique, Marcel Lihau, ancien diplômé de la Section administrative de Kisantu ne poursuivra des études de droit à Louvain qu’après plusieurs « détours » (passage à la philologie romane, étude du grec) ; il ne put terminer son droit qu’en 1962. L’université Lovanium venait alors de diplômer son premier juriste, en la personne d’Etienne Tshisekedi.
[14] Citons entre autres « L’utilisation religieuse de la musique et de l’art chorégraphique africain » (n° 1. 1959 : 27-30), » Le christianisme en Afrique » (n° 1, 1959 : 11-19), « Un témoignage. La promotion africaine » (n° 2, 1959 : 21-26) de Th. Tshibangu ; « Culture et adaptation » (n° 6. 1961 : 31- 3 »), « Le gigantesque effort à entreprendre » (n° 7, 1961 : 40-44), « Faisons confiance à l’Afrique » (n° 7, 1961 : 77-78) de F. Malu ; « L’Afrique face aux systèmes économiques modernes » (n° 3, I960: 43-49) de L. Nussbaumer ; «Socialisme… mais lequel?» (n°7. 1961 : 19-24) de B. Verhaegen ; « La grande misère des campagnes congolaises » (n° 8, 1962 : 16-22), « Conscience nationale et développement » (n° 11,1963 :17-27), « Vers la sud-vietnamisation du Congo » (n° 16, 1964 : 76-78) de B. Kalonji ; etc.
[15] Cette distinction avait son importance. A l’accession du pays à l’indépendance, le réacteur fut mis en état de non-fonctionnement, jusqu’à la signature d’une convention de transfert des USA à la République du Congo de cet uranium enrichi.
[16] Cf. Discours d’ouverture de Charles de Gaulle, président du Conseil français de Libération nationale à la Conférence de Brazzaville (1944).
[17] Vital Moanda, président de l’ABAKO-Kalamu (28 septembre 1958).
[18] Texte repris dans la Revue coloniale belge, n° 21, 15 août 1946, p. 118 et sv. ; il est cité par Van Bilsen J. (1977 ; 229 et sv.).
[19] La conférence et les réactions qu’elle suscita furent publiées dans Problèmes d’Afrique centrale, 1951, n° 12 (article de M.J. Nicaise) ; n° 13, pp. 172-174 (réaction de A. Sohier) ; pp. 174-177 (celle de G. Moulaert) ; pp. 177-181 (de Van der Kerken) ; pp. 181-184 (de P. Coppens) ; n° 14, pp. 260-268 (de H. Depage) ; pp. 296-278 (de G. Malengreau).
[20] Cf. Van Bilsen J., « Een dertigjarenplan voor de politieke ontvoogding Belgisch Africa », De Gids op maatschappelijk Gebied, décembre 1955,12, pp. 999-1028 ; » Un plan de trente ans pour l’émancipation politique de l’Afrique belge », Les dossiers de l’Action sociale catholique, février 1956, n° 2, pp. 83-111. L’ensemble des interventions de l’auteur concernant cette question ont été rassemblées dans son ouvrage Vers l’Indépendance du Congo et du Ruanda-Urundi. P.U.Z., Kinshasa-Bruxelles, 1977, pp. 164-202.
[21] Cf. Revue nouvelle, XX, 1954, 11, pp. 395-411.
[22] Cf. Van Bilsen A.A.J., « Après un voyage en Afrique noire », La Revue générale belge, avril 1955, pp. 927-945 ou encore 1977, pp. 40-62.
[23] Le mot « indépendance » n’apparaît qu’une fois dans le Manifeste. Cet extrait est cité plus loin.
[24] Compte rendu analytique du Conseil de gouvernement, session 1956, p. 25.
[25] Le texte de cette déclaration fut publié dans la Revue du clergé africain, XI, septembre 1956, n° 5, pp. 449-454) ; le Père G. Mosmans en a dégagé la portée véritable dans son article sur « Les impératifs de l’action missionnaire en Afrique belge », La Revue nouvelle. XXIV. 7-8, juillet-août 1956, pp. 3-21.
[26] Les trois principaux partis belges, le PSC (Parti social chrétien), le PSB (Parti socialiste belge), le P.L. (Parti libéral) ont relevé, au cours de leurs congrès annuels, de grosses divergences de vue non seulement entre partis mais aussi au sein des partis eux-mêmes. Les manifestes syndicaux (CSCC, FGTB, APIC) de l’année confirmèrent le malaise que connaissait la société coloniale (De Schrevel M„ 1970 : 345-357, 357-368).
[27] Le Contre-Manifeste de l’ABAKO a été publié dans plusieurs documents. Dans l’Avenir (24, 25, 26 août 1956) et dans le livre de Jean Labrique (1957 : 266-275) ; Congo 1959 (2e éd.) a reproduit la version que R. Batsikama avait remise à B. Verhaegen. Une autre reproduction peut être trouvée dans ABAKO 1950-1960, pp. 37-44.
[28] Le professeur A. Doucy de l’ULB établira un projet similaire, estimant que face à l’échéance de l’indépendance, « à la notion même de Congo, devaient être substituées des notions nouvelles ». Au lieu d’une colonie, on devait concevoir l’existence de » plusieurs colonies », chacune accédant à l’autonomie suivant quelle atteignait le degré voulu de modernisation. Dans cette perspective, une organisation nouvelle devait remplacer l’ancienne (cf. « Sociologie coloniale et réformes de structures au Congo belge », Revue de l’Université de Bruxelles, 9′ année, janvier-avril 1957 : 212-229). Cette vision rejoint celle-là même qui poussait le Bas-Congo à revendiquer son autonomie.
[29] Des recherches en sociolinguistique (initiée par V.Y. Mudimbe) sont encore en cours sur le vocabulaire politique zaïrois et son évolution à travers les organes de presse du pays. En 1972, quatre mémoires de licence de philologie romane ont étudié ce vocabulaire à travers Notre Kongo (Losso- Gazi), L’Essor du Katanga (Nyangombe, Ohilila), Le Congo indépendant (Nyunda ya Rubango et Djumah Wilondja). D’autres organes de presse furent dépouillés par la suite. Il s’agit notamment en 1974 de la Voix du Congolais (Eloko-a-nongo), Présence Africaine (Ibanda Mvunzi), Notre Kongo (Matadi Munima K.), Congo (Biongo Lokoba et Badibanga K.) et en 1976, de L’Essor du Kongo (Katundu Mbuyi), de Katanga Express (Mpamba Kamba K.) puis en 1977, du Quotidien de l’Action nationale (Sambo Sefu S.), La Voix du Katanga (Kambala Muleba K.), de L’Essor du Katanga (Kongolo Buanga). Il existe deux thèses consacrées à ce sujet, de Nyunda ya Rubango (1977) sur L’essai sociologique « immédiat » et de Matumele Malira M.B., 1980 sur le vocabulaire politique de Notre Kongo (1980).
[30] Le nègre de Mwene Ditu (ciluba) veut dire le « non évolué », le « sans voix » ; Moto Kodi (lingala), le « têtu » ; Azanga Nzungu, l’infortuné, celui qui… n’a même pas une marmite.
[31] Quinze, 1″ année, n° 6, 16 août 1957.
[32] Lettre du président de la CONAKAT, G. Munongo, au gouverneur Shoeller, 13.2.1959 (Gérard LiboisJ., 1963 : 15).
[33] La population de Luluabourg était à l’époque répartie comme suit : 56 % Baluba, 5,8 % Bena Konji, 2,7% Tetela, 25% Luluwa, 4% Songye, 1,6% Binji, 4,3% autres, 0,6% indéterminés (d’après les études de A. Lux, 1958 : 675-724).
[34] A partir de 1946, les gouvernements successifs à Bruxelles furent une coalition PSC – Parti Libéral (1946-1950), un gouvernement PSC (1950-1954), une coalition PSB – Parti Libéral (1954-1958).
[35] Malula J., « L’âme noire face à l’Occident », Afrikakring (Louvain), n° 4, 1958, pp. 217-233. Texte repris dans L’Evêque africain aujourd’hui et demain, Kinshasa, 1979, pp. 42-63. La bibliographie complète du Cardinal Malula a été établie par Léon de Saint Moulin et Luyeye Loboloko (Une vie pleinement donnée à Dieu et aux hommes, Kinshasa, 1990 : 117-144).
[36] Le général Janssens (1961 : 46) prétendra que » … tous ces Congolais furent soumis à la propagande subversive des sans-patrie de gauche et de droite (…]. Nous avons notamment fait interroger les quelque trois cents militaires de la Force publique qui séjournèrent en Belgique à cette occasion. Il n’en est pas un qui n’ait été poussé, ne fût-ce qu’une fois, à la révolte ».
[37] Cf. Chronique de politique étrangère, vol. XI, 1958. n° 4-6. p. 629).
[38] Le groupe de « seize » était composé des personnes ci-après : Patrice Lumumba, Arthur Pinzi. Gaston Diomi, Joseph Ngalula, Albert Nkuli, Joseph Iléo, Cyrille Adoula. Alphonse Nguvulu. Antoine Ngwenza, Pierre Tona Masesa, Maximilien Liongo, Makuta, Gabriel Makoso, Joseph Mbungu, Laurent Bariko et Jean Motingia. Six semaines plus tard, dix des seize signataires se regrouperont pour former et constituer justement le Mouvement National Congolais (MNC)
[39] Cf. Kwamé Nkrumah, Africa Must Unité. L’Afrique doit s’unir, Payot, 1964 ; voir aussi Edem
Kodjo, … Et demain l’Afrique, Stock, 1985.
[40] Cf. Présence Congolaise, 3 janvier 1959.
[41] La lettre de mardi 30 décembre, à cause des fêtes de fin d’année, ne fut réceptionnée par le premier bourgmestre que le vendredi 2 janvier ; sa réponse négative, qui fut une surprise, ne parvint à l’ABAKO que le samedi 3, la veille du jour prévu pour la manifestation.
[42] Les missionnaires imputèrent ce fait à l’action des kimbanguistes au sein de l’ABAKO. Pourtant les insurgés n’étaient pas composés uniquement des militants de l’ABAKO.
[43] Dans la biographie quelle a donné de son père, Z. J. Mpoyo Kasa-Vubu restitue les épisodes de cette fuite la nuit, « en soutane » jusqu’à Kimwenza ; quant aux enfants et à leur maman, ils quittèrent la maison familiale sur Inzia pour se réfugier à Bandalungwa chez S. Kini. De là, ils gagnèrent Brazzaville et ne se retrouvèrent à Léopoldville qu’aux environs du 30 juin 1960. en tant que « famille présidentielle» (1985 : 217-218).
[44] Arthur Pinzi qui fut suspendu, et Gaston Diomi, révoqué, sollicitèrent les services de trois avocats belges de la métropole : Jules Chômé, Jules Wolff et Jean Terfuve. La magistrature coloniale manœuvra pour que ces avocats soient récusés ; bien qu’arrivés à Léopoldville, on ne les laissa pas assurer la défense de l’accusé.
[45] Il semble qu’en dernière minute, il y avait eu un contrordre émanant de Bruxelles pour que le message royal (arrivé à Léopoldville sous forme de bande magnétique) ne soit pas diffusé. A cause des difficultés de communication, l’instruction fut réceptionnée après 13 heures, alors que la voix royale résonnait déjà à travers les rues de la capitale coloniale.
[46] Le PTC désignait tout aussi bien le « Parti travailliste congolais » de Jean-Pierre Dericoyard que le « Parti traditionaliste congolais » de Jean Bokufi, à distinguer du PDC (Parti démocrate congolais) de Sébastien Kini. Dans le même ordre d’idées, il fallait s’efforcer de distinguer l’UDICO de l’UNICO, de l’UNACO et l’UNECO. Ils renvoyaient à des réalités politiques divergentes : Union pour la Défense des Intérêts congolais (UDICO), Union pour les Intérêts du Peuple congolais (UNICO), Union économique congolaise (UNECO), Union nationale congolaise (UNACO).
[47] Le PNP ne fut certainement pas invité à cause de ses accointances avec l’administration ; quant à la CONAKAT, elle traitait l’ABAKO d’extrémiste et n’a sans doute pas voulu composer avec elle (Weiss H., 1994).
[48] Cf. Chronique de politique étrangère. 1960, XIII, 4-6, p. 470.
[49] Kamina fut créée dès 1950 dans le contexte de la guerre de Corée, afin de servir de base de repli aux forces belges. Elle devint opérationnelle en décembre 1953.
[50] Le Corps des Volontaires européens fut institué le 29 juin 1932. Il comprenait des résidents de toutes nationalités. Sa mission était de rétablir l’ordre en cas de révoltes ou de troubles graves. Son effectif passa de 763 unités en 1938 à 3 259 en 1959.
[51] Un conflit de prestige opposait la Force publique (dépendant du gouvernement général) aux Forces métropolitaines (dépendant directement du ministre de la Défense nationale) ; l’intervention de ces dernières signifiait l’échec de la Force publique qui demeurait l’instance première chargée de la répression des révoltes.
[52] La délégation du MNC/Lumumba exigea, le 20 janvier, la libération de son président, emprisonné à Stanleyville ; le 21, il fut jugé dans la capitale du Haut-Congo et condamné à six mois de prison ; le 22, plusieurs autres délégations réclamèrent sa libération ; le 24, il fut libéré et arriva à Bruxelles le lendemain.
[53] Au lendemain de l’accord sur l’indépendance, M. de Schrijver préconisa une « association durable » sur le plan économique et sur le plan général, adoptant là un ton nouveau (cf. Intervention du ministre le 28 janvier 1960).
[54] Le « gouvernement provisoire » qu’il réclama fut finalement accordé, lorsque Lumumba fit la même demande. Il s’agit des fameux « Collèges Exécutifs » (De Vos P., 1975 : 65-66).
[55] Sylvain Kama fut remplacé en avril 1960 par Norbert Leta du PSA.
[56] La fille de Jean-Pierre Finant deviendra une chanteuse célèbre : Betty Finant (alias Abêti Masikini). Ce lumumbiste, qui connaîtra une fin tragique, sera aux prises avec Gilbert Mpongo, dont la fille allait, elle aussi, devenir une chanteuse célèbre : Mpongo Nlandu (alias Mpongo Love).
[57] Seuls Kamitatu (PSA), Nguvulu (Parti du Peuple), Tshombe (CONAKAT) et Sendwe (Cartel katangais) prirent une part effective aux travaux. Le MNC/Lumumba fut représenté par des étudiants : Mario Cardozo et J.D. Mobutu.
[58] Voir texte résolutions : Chronique de la politique étrangère, vol. XIII, 1960, n° 4-6, pp. 512-542.
[59] L’aile dissidente de D. Kanza (ABAKO-Mwinda) s’exprimait dans le Congo.
[60] Cf. Déclaration de J. Bolikango le 3 juin 1960 dans le Congo 1960 : 273-274.
[61] Dans la tradition belge importée pour la circonstance au Congo, l’« informateur » avait pour rôle de prendre des premiers contacts en vue de la formation d’un gouvernement. Après cette étape, un « formateur « est nommé.
[62] Albert Delvaux, dans l’authenticité, deviendra Mafuta Kizoia.
[63] Le texte de cette proclamation d’indépendance avortée est repris dans le livre de W.J. Ganshof Van der Meersch (1963 : 570).
[64] Une version populaire explique cet échec par une question d’argent. Lumumba lui avait réclamé une somme d’argent en échange du soutien de son parti. Mais ce dernier minimisa cette demande, sûr de sa victoire, promise par l’administration coloniale.
[65] Voir à ce sujet, la thèse de Jyoni wa Karega (1983) et sa réflexion sur cette question particulière (1986 : 219-225).



