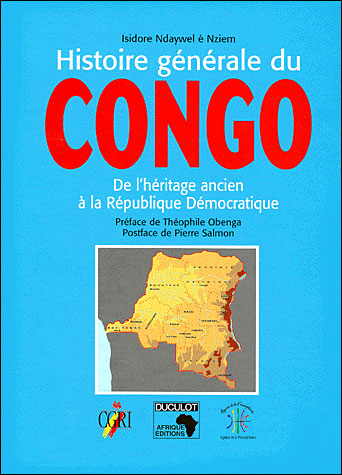
Partie 6 - Chapitre 1 : L’éveil
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 1
L’éveil
On l’a dit, la gestion coloniale belge portait en elle les germes de sa propre destruction. Cette évolution se manifestait d’ailleurs d’une manière de plus en plus évidente. On a vu comment les malaises sociaux, pris en charge par les christianismes noirs, donnèrent lieu à la naissance d’une conscience politique durable. Restait à voir à quel rythme elle allait se développer. Son évolution fut l’enjeu d’influences extérieures. La réaction peu « progressiste » des milieux coloniaux face à ces phénomènes extérieurs, le souci de la colonisation belge d’isoler sa colonie pour ne pas la perdre, et qui rendit encore plus attrayante toute infiltration du dehors, tout cela hâta l’éclosion du nationalisme. Parmi ces phénomènes extérieurs, on retiendra particulièrement les effets de la solidarité afro-américaine et surtout ceux de la Deuxième Guerre mondiale, qui offrirent les conditions nécessaires à la prise de conscience de l’existence d’une classe de lettrés autochtones, appelés à jouer le rôle de l’élite moderne.
Le Congo s’éveillait peu à peu à la réalité de la décolonisation.
1 AU SECOURS DU NATIONALISME NAISSANT
1.1 Le mythe du communisme
On peut affirmer que les mouvements de grève et les sectes messianiques fondèrent leur action sur des revendications sociales. S’ils acquirent une coloration politique, c’est d’abord parce qu’ils furent perçus en tant qu’actions politiques et réprimés – à tort – comme tels. A la base de ces réactions brutales du pouvoir colonial résidaient la crainte de l’influence communiste et celle des Noirs américains. Quelle était la part de ces deux courants dans le vécu colonial congolais ?
La crainte d’une ingérence communiste au Congo date des années 20, époque du lancement de la propagande communiste dans le monde. En effet, au 2e congrès du Komintern tenu à Petrograd en 1920, une stratégie de « Front uni » fut adoptée comme instrument de lutte révolutionnaire à travers les pays coloniaux, par l’intermédiaire des partis communistes européens, chaque parti s’intéressant plus particulièrement aux colonies de son pays. Dans cette optique, on estimait qu’au Congo belge, les communistes devaient s’efforcer de soutenir les mouvements de protestation et d’exploiter les points faibles du régime colonial, notamment l’exploitation du prolétariat, le travail et les recrutements forcés ainsi que les brutalités coloniales.
On aurait pu s’attendre à ce que cette vision « progressiste » remette en question en Belgique les modalités de gestion de la colonie ou qu’elle y crée une situation de tension entre les procommunistes et les autres. On préféra porter la lutte sur le terrain congolais. Pour contrecarrer la diffusion du journal communiste Le drapeau rouge, distribué auprès des lettrés congolais, une campagne anticommuniste systématique fut lancée dans la colonie au départ d’Anvers. Dans cette ville, porte d’entrée et de sortie du pays, une Société d’Etudes Politiques, Economiques et Sociales (SEPES) fut créée, dans le but de lutter contre les infiltrations communistes au Congo belge. Cet organisme disposait d’un office de documentation, de cercles d’études, de publications occasionnelles et d’un bulletin bimensuel qui parut régulièrement entre 1920 et 1940, dont les articles étaient toujours anonymes. Il s’agissait à l’évidence d’une production d’un organisme d’extrême droite, ayant pour devise : « la défense de la Patrie, de la Famille, de la Morale, de l’Ordre, de la Prospérité et de nos libertés ». Les documents de la SEPES dénonçaient l’intérêt suspect des communistes belges pour le Congo et les diverses voies d’accès qu’ils empruntaient pour répandre leurs idées, après qu’un savant russe eut déclaré que le Congo belge occupait une place de « leader » dans l’Afrique coloniale. Dans le « Communisme », la SEPES rangeait pêle-mêle les actions du Parti communiste (PCB), des jeunesses communistes de Belgique, de la Section belge du Secours Rouge International (SRI) et enfin, celles de la section belge de la Ligue contre l’impérialisme et pour l’indépendance nationale [1].
Cependant, on est obligé de reconnaître aujourd’hui que l’influence communiste, dont il fut tant question [2] vers les années 20, fut limitée. Ce sont plutôt les méfaits de la lutte anticommuniste qui inspirèrent aux Congolais une certaine sympathie à l’égard de ce mouvement qu’ils ne connaissaient pas. Le kitawala, particulièrement, fut combattu avec d’autant plus de zèle que sa propagande anticoloniale paraissait suspecte et donc empreinte de communisme. En 1932, on prétendit démanteler des « cellules communistes » chez les mineurs de Kilo-Moto alors que rien n’indiquait que ces accusations étaient fondées (Bakonzi A., 1982 ; Vellut J.L., 1987 :47).
Les marins de Matadi étaient les premiers suspects dans cette chasse aux communistes. Matadi, en effet, en tant que port international, était l’unique point d’ouverture du Congo au monde et les marins constituaient le groupe le plus exposé, vu leur mobilité. Lors d’une perquisition effectuée le 25 juin 1925 à bord du Thysville, on trouva auprès des marins noirs le journal Le drapeau rouge contenant des articles de fond tels « Simon Kimbangu, le martyr de la cause nègre », « L’exploitation de la main-d’œuvre noire » (Sabakinu K., 1981 : 499). Ici au moins, une certaine action de conscientisation est attestée et paraît normale, dès lors que les marins congolais arrivaient en Europe et effectuaient des séjours assez prolongés au port d’Anvers. Un club belge des marins révolutionnaires fut constitué à Anvers en 1928, dont le siège était établi au « Café central », lequel avec le « Café congolais » et le « Café star», était souvent fréquenté à l’époque par des marins congolais (Sabakinu K.. 1981 : 500).
A Matadi, l’existence d’une cellule communiste semble dater de 1930. L’unique preuve dont dispose l’administration locale pour la justifier tient dans le fait que des révoltes des marins africains éclatèrent cette même année. Les nouvelles grèves de 1935 donnèrent lieu à des recherches sur les causes profondes de ces mouvements. L’administration locale s’y employa et découvrit que c’était la situation sociale de ce corps de métier qui en était le moteur. N’empêche qu’on a pu lire le fameux « Drapeau rouge » à Matadi et peut-être même à Léopoldville. L’étude minutieuse de ce courant de révolte des marins a permis d’établir que ceux-ci sont entrés en contact avec les milieux politiques de la gauche belge ; toutefois, rien n’atteste qu’on ait établi chez eux un réseau de propagande communiste, ce qui n’exclut pas qu’ils aient pu servir de relais entre les « Evolués » de Matadi et certains milieux belges, et que des revues aient été diffusées par leur entremise (Sabakinu K., 1981 : 592).
Dans cette affaire, l’autorité coloniale ne se laissa pas faire. Elle prit l’initiative de gérer les loisirs des marins congolais à Anvers en vue de limiter leurs contacts et de les contrôler. Sur le conseil d’un prêtre, le Père Cruyen, la CMB créa à Anvers le 14 avril 1928 une association dénommée Ndako ya biso (« notre maison »), ayant pour but d’offrir aux marins africains en séjour à Anvers un appui moral et une aide matérielle. Cette « maison africaine » comprenait un café, un restaurant, un salon, une salle de lecture, et s’occupait de l’hébergement. L’animation était confiée à l’initiateur du projet, le Père Cruyen ; un règlement strict limitait les sorties et les contacts extérieurs et exigeait que chaque marin qui débarquait à Anvers signalât sa présence. C’est entre autres contre ce régime d’internat que les marins se rebellèrent en 1930.
Paradoxalement, c’est à cause de ces premiers mouvements de révolte que l’ordre colonial considéra l’œuvre d’éducation du Père Cruyen comme utile dans le milieu des marins. En effet, en 1931, on décida de l’ouverture d’une extension de « Ndako ya biso » à Matadi. « Cette œuvre », estimait-on, « devait être encouragée […]. Non seulement elle est appelée à améliorer le niveau moral des marins, mais […] elle facilitera la surveillance des éléments susceptibles de répandre des idées subversives. Les incidents survenus en 1930 nous indiquent une ligne de conduite ; il faut l’appliquer avec tact et habileté ». C’est le CDD du Bas-Congo qui adressait ce plaidoyer au gouverneur de province. Ce home des marins de Matadi fut financé à la fois par la CMB et la CCFC en conformité avec le devoir de collaboration des éléments de la « trinité coloniale ». L’Arrêté royal du 12 septembre 1933 accorda la personnalité civile à « Ndako ya biso ». Les objectifs de cette association, désormais patronnée par la mission catholique de Matadi, débordèrent le cadre restreint des marins. C’est à toute la population africaine de Matadi qu’elle entendait à présent offrir un appui moral et une aide matérielle. « Ndako ya biso » devint un lieu de rencontre de tous les courants culturels (associations tribales, corporations des métiers, associations sportives, etc.), dirigé par un comité européen dans lequel étaient représentés les grands organismes de la ville (Sabakinu K., 1981 : 506-507).
Il faut donc retenir, à propos du courant communiste au Congo, vers les années 20-40, que son impact fut réduit, mais qu’il provoqua une grande mobilisation coloniale. Certains Congolais, parmi lesquels les marins, eurent l’occasion d’être en contact avec la propagande communiste, voire même d’y être sensibilisés. Ils découvrirent l’existence d’une certaine Belgique, distincte de la Belgique coloniale et combattue par elle. D’autres n’y virent qu’une guerre entre Belges et eurent ainsi l’occasion de percevoir très tôt l’existence de clivages entre Blancs. D’autres encore, victimes de ces oppositions, purent au contact avec d’autres relégués politiques, dans des camps de relégation, mesurer l’ampleur de la contestation contre le pouvoir colonial.
1.2 Le mythe de l’Amérique
Plus inquiétant encore que celui du communisme, le spectre de l’Amérique a toujours hanté la colonisation belge. Vers les années 20, il était souvent question, dans l’imaginaire collectif, du retour (éventuel) des Américains Noirs, actualisé également par les enseignements du kimbanguisme et du kitawala. Qui aurait prédit que ceux qui avaient quitté le continent, quatre siècles auparavant, dans la misère et le désespoir, allaient à ce point demeurer présents dans l’histoire de la décolonisation de l’Afrique ? Au Congo belge, leur évocation était synonyme de libération et donc, de la fin de la suprématie des Blancs. On considérait le phénomène comme imminent. Dans le Bas-Congo, vers les années 20, un missionnaire protestant surprit un cortège de villageois qui se rendait au fleuve… la rumeur les avait avertis de l’arrivée des missionnaires noirs américains venus pour sauver le Congo. Même attente dans le Katanga où en 1925 des groupes de kitawala attendaient l’arrivée imminente des sauveurs américains. En 1932, des missionnaires afro-américains et antillais, en route vers la Rhodésie, furent accueillis à Elisabethville par une foule enthousiaste. Vers les années 40, ce mythe des libérateurs américains s’amplifiera, surtout sur les lèvres de Simon Mpadi. « La première raison pour laquelle nous devons prier pour [que] les Américains [viennent] est qu’eux sont nos propres frères […]. Du fait qu’ils ont quitté notre pays, ils sont allés en Europe, prendre une grande intelligence pour faire tous les genres de travaux et aussi ils sont allés prendre l’autorité et la force […]. C’est pourquoi si nous, Noirs, nous voulons avoir règne et autorité, il faut que les Américains viennent pour être à la tête de tout avec nous ; c’est alors que l’autorité sera forte [3] ». Pendant la guerre, une centaine de militaires noirs américains débarquèrent effectivement à Matadi ; le gouvernement belge intervint auprès des autorités américaines pour que ce contingent soit retiré de sa colonie. A Elisabethville, un sous-officier congolais profita du passage d’un officier américain pour lui présenter un manifeste plein de revendications, rédigé par un « clerc » de la ville (Vellut J.L., 1987 : 68). Les Américains étaient considérés comme plus forts que les Belges et favorables à la cause congolaise. Ce mythe eut un impact sur les revendications locales, ne fût-ce que parce qu’il apportait une plus grande assurance à la partie congolaise, convaincue de l’existence d’une instance supérieure à l’autorité coloniale et susceptible de lui être favorable.
Chose étrange, les colonisés du Congo belge n’étaient pas seuls à se référer ainsi à l’Amérique, puisque le pouvoir colonial lui-même a toujours regardé vers elle pour trouver des techniques de mise en valeur du Congo. Cette intuition, on se le rappellera, venait de Léopold II qui, à la fin du siècle précédent, avait fait appel à des compagnies concessionnaires, à l’exemple de l’Amérique. Son territoire africain, il pensa dans un premier temps à le structurer en une association d’États à l’exemple des États-Unis, avant d’en faire un État unitaire et « indépendant », suivant le modèle libérien auquel il se référa fréquemment. Il ne manqua pas en Belgique d’esprits indépendants pour poursuivre la réflexion dans ce sens. En 1888, un jeune sociologue, P. Otlet, plaida pour que le développement et la modernisation de l’Afrique soient confiés aux Noirs américains. Rien que le titre du document adressé à Léopold II – L’Afrique aux Noirs – est un écho aux idées répandues dans la diaspora noire américaine, une application à l’Afrique du principe « L’Amérique aux Américains » prôné par le Président Monroe [4].
Au début du siècle, on pensa s’inspirer du modèle afro-américain, considéré comme adapté à leur état d’infériorité, pour éduquer les Noirs du Congo. C’est Booker T. Washington qui, face à la ségrégation raciale, proposa ce plan défaitiste et attentiste qui eut la faveur des Blancs (De Craene P., 1961 : 13). L’établissement d’enseignement technique (Industrial Education), qu’on instaura à Hampton et à Tuskegee, fut considéré comme le seul modèle adapté du cycle supérieur auquel pouvaient accéder les Noirs. Le même programme fut envisagé pour le Congo.
L’école de Kimpese fut un exemple de mise en application de ce programme par l’ABFMS (American Baptist Foreign Mission Society). La Belgique coloniale s’intéressa officiellement à ce modèle. L. Franck, alors futur ministre des Colonies, visita Tuskegee avant la Première Guerre mondiale de même que Leplae, le directeur du service de l’agriculture coloniale (Vellut J.L., 1987 : 57-58). Il faut souligner que l’analogie avec l’Amérique se marqua également dans la pratique du racisme. Visiblement, on ne se souciait guère de sauver les apparences, auprès des étrangers noirs. On sait qu’en 1917, le futur romancier martiniquais René Maran se vit refuser à Léopoldville l’accès à un hôtel « interdit aux personnes de couleur ». Une aventure semblable arriva en 1921, à Thysville ; on reprocha à Félix Eboué, guyanais d’origine et haut fonctionnaire français de l’A.E.F. d’« être un homme de couleur » (Vellut J.L., 1987 : 61).
L’influence afro-américaine se mesura surtout lors des infiltrations garveyistes et au rôle déterminant que joua WEB Dubois dans la prise de conscience de certains Congolais. Marcus Garvey passa pour être le père du « sionisme noir ». Né en Jamaïque le 7 août 1887, de parents africains (noirs de sang pur ?), il fut très marqué par le mépris qu’inspiraient les Noirs. Arrivé aux USA en 1916, il avait gardé de sa Jamaïque natale une véritable haine vis-à-vis des Blancs et des mulâtres. Il effectua un séjour à Londres avec un Egyptien nationaliste, Mohamed Ali, rédacteur dans un magazine anti-impérialiste. C’est à son retour aux USA qu’il lança un mouvement populaire – L’Association universelle pour le Progrès des Noirs – qui fut revendiqué par des milliers de Noirs. Démagogue, il lança le slogan « L’Afrique pour les Africains d’Afrique et d’ailleurs ». Se prenant pour le Moïse de sa race, il affichait un orgueil insolent à l’égard des Blancs et ne cessait de réclamer le retour de tous les Noirs en Afrique, leur « mère patrie ».
L’action de Garvey avait une implication politique et religieuse. En 1920, appuyé par les Noirs de Harlem que ses discours galvanisaient, il fonda l’« empire noir », censé regrouper tous les Noirs d’Afrique et d’Amérique et fut proclamé président provisoire de l’Afrique, résidant à la « Maison Noire » par opposition à la « Maison Blanche ». Il nomma les membres du gouvernement et instaura une noblesse d’empire porteuse de titres ronflants : Duc du Nil, Comte du Congo, Vicomte du Niger, Baron du Zambèze, etc. Ces initiatives surprennent, mais dans ses souvenirs de jeunesse, le futur président explique lui-même pourquoi il décida de bâtir une nation nègre solide et puissante :
[Quand j’étais enfant] j’ai demandé ; où est le gouvernement du Noir ? Où est son royaume ? Où est son président ? Et son pays et son ambassadeur ? Son armée et sa flotte ? Où sont ses hommes d’affaires ? Je n ‘ai pas pu les trouver et j’ai alors déclaré : je veux aider à les faire (Padmore G., 1960 : 98).
Comme l’Afrique devait être encore libérée, avant d’être prise en charge par son président et le gouvernement, il lui fallait une armée pour chasser les usurpateurs. Avec les fonds énormes qu’il ne cessait de récolter, Garvey put la former (La Légion universelle africaine), de même que ses services annexes, les Infirmières de la Croix « noire » universelle, le Corps motorisé panafricain, le Corps juvénile, le Corps volant d’Aigle noir, tous avec leur commandement, leurs officiers et leurs uniformes. Pour organiser le retour des Noirs en Afrique, on rassembla également une flotte – la Black star Line – avec ses propres vaisseaux. Quoique catholique de naissance, Garvey fonda un christianisme pour Noirs – l’African orthodox Church (Eglise orthodoxe africaine) avec, pour patriarche, un brillant théologien antillais…
Ces projets peuvent paraître farfelus mais ils avaient un impact sur la masse. En tout cas, ils firent de Garvey une figure mondiale dont les moindres faits et gestes étaient suivis par toutes les puissances européennes ayant des possessions en Afrique. Son périodique The Negro World, publié en anglais, en français et en espagnol pour sensibiliser les Noirs de par le monde, fut déclaré publication séditieuse et proscrit par plusieurs gouvernements coloniaux, notamment au Congo. Ce personnage dérangeait aussi, par son tempérament violent ; plutôt que de chercher à trouver un terrain d’entente avec les autres leaders du monde noir, il les combattait même, notamment et surtout Dubois qu’il qualifiait volontiers de… « mulâtre paresseux et vendu, ennemi déclaré de la race noire ». Aussi, contrecarrée de tous côtés, sa quête d’une « terre promise » en Afrique ne put aboutir. Il misa sur le Liberia qui, dans un premier temps, fit bon accueil à son projet de recueillir les colonies afro- américaines de retour à la « mère patrie ». Toutefois, le gouvernement de ce pays ayant été informé des intentions politiques de Garvey d’annexer le Liberia en tant que sous-administration de son « empire », changea d’avis et s’arrangea pour faire échouer le projet.
Garvey mourut en 1940, sans avoir pu aboutir à une réalisation concrète de ses ambitions [5]. Il reste toutefois une grande référence panafricaine, dont l’influence fut déterminante par la suite, en Amérique comme en Afrique. Non seulement il fit entrevoir aux Afro-Américains la légitimité de leur fierté d’appartenir à une Afrique libre et originale mais il mit aussi en lumière la possibilité d’une égalité avec les Blancs, ainsi que la perspective de l’indépendance et les moyens pour y parvenir – entre autres, la lutte. (Padmore G., 1960 : 97-113 ; Decraene P., 1961 : 16-17 ; Nguyen Van Chien, 1975 : 24).
L’impact de l’œuvre de Garvey en Afrique, bien que difficile à évaluer, fut profond ; il se manifesta notamment par la prédiction du « retour des frères américains » et son intégration dans les prophéties locales. Le christianisme garveyiste (avec un Christ et une Vierge Noirs) fut sans doute à l’origine de certaines créations du même genre qui se propagèrent en Afrique pendant l’entre-deux-guerres. En tout cas, au Congo, à cette époque, le mythe de l’arrivée des Américains fut généralisé ; aujourd’hui encore un adage populaire y fait référence : le « conte de l’Amérique » qualifie une promesse toujours attendue mais irréalisable.
Le kitawala est vraisemblablement le mouvement qui fut le mieux informé de la doctrine garveyiste par les pasteurs noirs-américains d’Afrique méridionale ; l’arrivée des Américains et le départ des Blancs étaient confirmés, d’après eux, par certains passages bibliques. Ainsi le verset 4 du chapitre 1 de l’Ecclésiaste, parlant de la « génération future » devant surpasser la « génération actuelle », est interprété comme le remplacement du règne des Blancs par le règne des Noirs. La « fin du monde » était comprise comme « la fin de la colonisation », « le départ des Blancs ». Le kitawala prêchait que, dans ce monde nouveau (le Congo indépendant), régneraient la paix, la justice et l’abondance et que disparaîtraient l’oppression de l’homme blanc colonisateur et toutes les injustices. Les Noirs seraient « blancs » (métaphore) c’est-à-dire, indépendants, puissants et riches parce qu’ils seraient eux-mêmes maîtres de leur destinée et de leur pays (Anyenyola W., 1972 : 20-21). Le journal The Negro World faisait l’objet d’une saisie systématique de la part de l’administration belge, bien que nulle part au Congo on ne relevât la trace d’une activité spécifiquement garveyiste. On préféra confondre volontairement garveyisme avec kimbanguisme et kitawala, par stratégie ou plus sûrement encore pour prévenir tout débordement. Les étrangers noirs vivant au Congo étaient, quant à eux, tous soupçonnés d’être des relais de cette propagande.
Pendant ce temps, un autre aspect de la solidarité afro-américaine et africaine se manifestait à un autre niveau, auprès des Africains de la diaspora européenne, parmi lesquels quelques Congolais. L’initiateur de cette tendance était W.E. Burghardt Dubois. Né dans le Massachussetts en 1868 et fier de son doctorat de sociologie à l’Université allemande de Heidelberg, ce mulâtre, professeur à l’Université d’Atlanta, reconnaissait volontiers qu’il était un aristocrate et en aucun cas un tribun. Son action intéressa donc l’élite intellectuelle noire : il s’employa à subordonner le problème du Noir américain au grand idéal panafricain. En 1908, avec l’aide des Blancs libéraux, Dubois fonda le National Association for the Aduancement of Coloured People (NAACP) et prit la fonction de rédacteur de son organe officiel Crisis (créé en 1910). Sur le plan africain, il préconisa, en 1920, le remaniement de la carte politique de l’Afrique. Mais le grand mérite de Dubois fut d’avoir fait évoluer le projet panafricaniste énoncé par Silvester Williams par l’organisation des premiers Congrès panafricains ; il joua un rôle primordial dans la mise au point de leurs programmes et dans l’élaboration d’une stratégie d’action progressiste, qui permette enfin au panafricanisme de trouver un foyer sur le sol africain lui-même (Decraene P., 1961 : 13-14, 19).
Le premier Congrès panafricain eut lieu à Paris en 1919, au lendemain de l’armistice. Ce congrès revendiqua le droit des peuples noirs à disposer d’eux-mêmes et mit en avant l’importance de la contribution que les Noirs avaient apportée pour que l’Europe retrouve sa liberté. En effet, non seulement les troupes africaines noires mais également une centaine de milliers de soldats noirs américains avaient participé aux combats. Dubois obtint aussi l’appui de Biaise Diagne, premier député du Sénégal, qui siégea pendant vingt années consécutives au Parlement français. A l’issue des travaux, une pétition adressée à la SDN entérina le projet de Dubois de ne pas remettre ses anciennes colonies à l’Allemagne. La suggestion fut retenue et les colonies furent confiées à une gestion internationale [6].
Le deuxième congrès qui s’ouvrit au Central Hall de Londres, le 28 août 1921, se déroula en trois sessions : la première eut lieu à Londres (du 28 au 30), la deuxième à Bruxelles (du 2 août au 5 septembre) et la troisième à Paris. Ces assises insistèrent sur l’égalité des droits entre Noirs et Blancs.
Le troisième congrès, qui eut lieu en 1923, se fit également en plusieurs étapes : la première à Londres (7-8 novembre) et la seconde à Lisbonne (1-2 décembre) où des intellectuels africains lusophones, regroupés au sein de la Liga Africana, formèrent un noyau dynamique dans la revendication de leurs droits sociaux et politiques.
Le quatrième congrès eut lieu à New York en 1927. Les délégués y revendiquèrent le droit pour les Africains de faire entendre leur voix auprès des gouvernements qui dirigent leurs affaires ; ils proclamèrent le droit des Noirs à la terre d’Afrique et à ses ressources. Il n’y eut pas de nouveau congrès avant longtemps car la crise de 1929 déferlant sur le monde et surtout aux USA fit obstacle à toute nouvelle initiative du même genre (Jouve E., 1984 : 25) [7].
1.3 Paul Panda Farnana ou le protonationalisme congolais
L’influence de Dubois sur le Congo s’exerça dans le cadre de la lutte que mena Paul Panda Farnana pour la reconnaissance des droits de ses compatriotes congolais. Depuis la fin du XIXe siècle, de jeunes Congolais étaient emmenés en Belgique pour y étudier. De ce premier contingent de « Belgicains », Panda est incontestablement l’un des seuls qui parvint à faire parler de lui à cause de Faction nationaliste qu’il mena dans la défense des droits et des aspirations des « sans voix », c’est-à-dire la population du Congo belge.
Panda naquit à Nzemba, près de Banana, en 1888 ; fils du chef médaillé Luizi Fernando (Luis Fernao), il hérita vraisemblablement de son nom « Farnana » (Franao). Il aurait été baptisé à la colonie scolaire de Borna, où il entama son instruction. Ce qui explique le fait qu’il ait été admis aussitôt à Bruxelles à l’Athénée d’Ixelles. Le jeune Panda arriva en Belgique le 25 avril 1900, à l’initiative de son patron belge qu’il accompagnait mais, deux ans plus tard, celui-ci mourut, laissant son protégé congolais aux soins de sa sœur qui habitait Bruxelles. A l’Athénée d’Ixelles, il fit des études secondaires jusqu’en 3e moderne [8]. En octobre 1904, il réussit l’examen d’entrée à l’Ecole d’horticulture et d’agriculture de Vilvorde où il fut diplômé avec « distinction » le 7 septembre 1907 et obtint en plus le « certificat de capacité » de Cultures tropicales. Ensuite, pour compléter sa formation, il s’inscrivit, l’année suivante, comme élève régulier à l’Ecole supérieure d’Agriculture tropicale à Nogent-sur-Marne, près de Paris en France, où il obtint le « certificat d’études » ; il alla suivre également des cours à l’Ecole supérieure commerciale et consulaire de Mons, ce qui lui permit de maîtriser l’anglais et de le parler convenablement. Ces études terminées, le ministère des Colonies l’engagea en qualité de « chef de cultures de 3e classe ». De retour au Congo à Borna (1er juin 1909), il fut affecté au jardin botanique d’Eala près de Coquilhatville où il s’occupa de l’instruction théorique des élèves et fut confirmé dans son grade. Arrivé au terme de son mandat, il s’embarqua sur le Bruxellesville (21 juin 1911) et, sitôt arrivé (12 juillet), reçut la distinction de l’« Etoile service ». Après cela, il réembarqua pour le Congo (16 décembre 1911) où il fut nommé directeur de la station agricole de Kalamu, après quelques séjours dans d’autres services. Mais ce fut pour une courte durée. A la suite de difficultés avec son supérieur hiérarchique et comme il ne pouvait pas encore occuper ses nouvelles fonctions dans la territoriale, il obtint un congé anticipé et repartit pour la Belgique.
Entre-temps, la guerre éclata. Il s’engagea dans le Corps de Volontaires congolais qui se constituait de fonctionnaires de la colonie et de compagnies coloniales, au côté de deux autres « Congolais authentiques » : Joseph Adipanga et A. Kudjabo. Tous furent faits prisonniers par les Allemands. Panda le resta jusqu’à la fin de la guerre. Enfin libéré, il put regagner la Belgique et obtenir une mise en disponibilité, à partir d’avril 1919, pour convenances personnelles.
Ancien fonctionnaire, il devint homme politique et s’installa à Bruxelles, où il resta en contact tant avec les milieux coloniaux de la capitale qu’avec ses compatriotes résidant en Belgique. Avec ces derniers, il fonda au début du mois de novembre 1919 une « société de secours et de développement moral et intellectuel de la race congolaise » appelée l’Union congolaise. Regroupant une douzaine de Congolais, cette association fut mise sous la haute protection de Louis Franck, ministre libéral des Colonies et d’Emile Vandervelde, leader socialiste et ministre de la Justice (Bontinck F., 1980 : 591-597). Cette première initiative inaugura son combat politique.
On retrouvait une influence particulière dans l’intitulé même de l’association ; en effet, le concept de « développement moral et intellectuel » était un essai de traduction de l’expression « Advancement » utilisée pour qualifier le but de la NAACP, la « National Association for the Advancement of coloured People ». En effet, d’après Bontinck, un contact avait dû s’établir avec Dubois, à l’occasion, quelques mois plus tôt, du premier Congrès panafricain à Paris (février 1919). On sait qu’une délégation du Congo belge s’y trouvait ; on suppose que l’Union congolaise n’a pu être représentée que par son président, Panda Farnana (1980 : 598). Apparemment, Panda avait à présent atteint le degré de conscience auquel le colonisé n’accède, à en croire Franz Fanon, qu’après avoir franchi deux étapes préliminaires. Dans un premier temps, en effet, l’intellectuel colonisé aspire à assimiler la culture du dehors et il en est fier. Par la suite, il se met à « se souvenir » de son passé et il est gêné de son état. Puis, il atteint l’étape dite « de combat » où il se pose en « réveilleur » de conscience et accepte d’assumer sa différence (Fanon F., 1968, 2e éd. : 153 et sq.). Ainsi, chaque année, rapporte un témoin, le 1er juillet, à la cérémonie commémorative de la prise de Tabora par la Force publique (16 septembre 1916), Panda s’avançait fièrement sur la Grand-Place de Bruxelles, à la tête des membres de l’Union. Et le témoin d’ajouter : « Il ne perdait aucune occasion de fulminer contre l’occupation européenne au Congo » [9]. C’est sur ses insistances qu’un « monument du souvenir congolais » fut inauguré à Léopoldville le 11 juillet 1927 en hommage aux soldats congolais morts pendant la guerre [10].
Les témoignages les plus vivants de son action sont ceux relatifs à sa contribution aux grands débats concernant l’avenir de l’Afrique. On conserve aussi certains pamphlets qu’il adressa à la presse, en réponse aux attaques dont il était l’objet.
A propos des débats cités plus haut, signalons qu’il prit personnellement part au premier Congrès colonial national (18-20 décembre 1920) et au deuxième Congrès panafricain, du moins aux deux premières sessions (28 août-5 septembre 1921). Le premier Congrès colonial avait un ordre du jour précis, où devaient être évoquées, de manière successive, des questions d’ordre humanitaire et civilisateur (première journée), des questions économiques (deuxième journée) et des questions administratives (troisième journée). Le président de l’Union avait des points de vue à faire prévaloir dans chacun de ces domaines. Il faut noter que c’est à ce Congrès que Panda fit la connaissance de l’abbé Stefano Kaoze, alors secrétaire du vicaire apostolique du Haut-Congo. Les deux hommes purent apparemment se rencontrer et sympathiser ; toujours est-il que Panda soulignera souvent, lors de déclarations ultérieures, que Kaoze partageait son opinion à tel ou tel propos.
Voilà quelques-unes des positions défendues par ce nationaliste.
A propos de l’éducation, il n’hésita pas à dire [11] :
Dans chaque province, on devrait avoir une école centrale normale, une dans chaque district et plus tard, une dans chaque grande chefferie… Notre budget de l’instruction devrait être plus élevé ; il était environ d’un million de 1919. Si l’autochtone était convaincu que l’impôt serait destiné à l’instruction de ses enfants, il paierait certainement un ou deux francs de plus par tête et par an. Il faut que les Congolais comptent sur eux-mêmes pour répandre d’une façon rationnelle l’instruction partout.
En ce qui concerne le travail forcé, il rappela ceci :
Nous avons protesté parce qu’il fallait assurer au Noir la sécurité… Pour y arriver, la Belgique devra veiller à ce que l’exécution des décrets et des ordonnances soit mieux garantie.
Quant à la politique indigène, elle eut droit à des considérations précises et judicieuses :
Les indigènes ne peuvent… être dépouillés de leurs biens. Ils sont véritablement maîtres de leurs terres et leurs chefs conservent leur pouvoir […].
Dans une protestation que j’ai adressée à la Commission permanente de colonisation et au Conseil colonial, j’ai exprimé le vœu de voir mes compatriotes participer à la politique et à l’administration de la colonie et préconisé la création d’un Conseil chargé des affaires indigènes. En effet, au Congo, l’aborigène n’est représenté nulle part au sein des divers conseils de la colonie….
On a peine à croire que de pareilles déclarations aient pu être faites en 1920, en face de la fine fleur du régime colonial belge.
Pour Panda Farnana, les Congrès panafricains ont dû être une occasion de s’exprimer mais aussi d’apprendre, au contact avec des Noirs d’autres régions du monde. Bien qu’il n’y ait aucune indication précise qui le confirme, on pense qu’il prit part au Congrès de Paris en 1919 ; en revanche, on est sûr qu’il fut absent au troisième Congrès à Londres (1923) et au quatrième qui se tint à New York (1927). A l’époque, il n’occupait plus la présidence de l’Union congolaise.
Au deuxième Congrès, on suppose qu’il fut présent dès la première session au Central Hall à Londres ; puisqu’il affirma plus tard avoir visité l’« Albert Hall Muséum ». Cela ne pouvait être qu’à cette occasion (Bontinck F, 1980 : 604). Quant à sa participation à la session de Bruxelles, elle n’offre aucun doute puisqu’il fit même partie du bureau du Congrès où il siégea aux côtés de Biaise Diagne qui en assurait la présidence, de Dubois, le belge P. Otlet et de la noire américaine Miss Jessie Fauset, tous membres du bureau. A la session d’ouverture, Panda prit la parole pour dénoncer les accusations parues dans la presse allemande contre les troupes noires qui faisaient partie des contingents d’occupation de l’Allemagne. Lors de la séance du 11 septembre, Panda fit un exposé sur « l’historique de la civilisation nègre sur les rives du Congo » où il s’appuya sur l’existence, dans le passé, de relations égalitaires pour proposer l’admission de chefs noirs au sein des conseils de gouvernement au Congo belge ; il exprima le souhait, sur un plan plus général, que des diplomates nègres soient présents au sein des commissions internationales, comme celles de Genève, afin de surveiller l’administration des mandats [12].
Panda prit part également à la session de Paris au cours de laquelle Dubois déclara que nulle part au monde un Noir ne pouvait être en sécurité, aussi longtemps que des Noirs seraient exploités en Afrique ou lynchés aux États-Unis.
Les rapports de Panda avec la presse coloniale et les fonctionnaires coloniaux en général ne furent jamais bons. Le journal L’Avenir colonial belge s’illustra par des propos injurieux envers lui, du fait de ses interventions au Congrès colonial et devant d’autres tribunes. Habitués à des comportements paternalistes, ces coloniaux prétendaient savoir mieux que Panda ce qu’il fallait faire pour décoloniser. Ils poussèrent l’audace jusqu’à lui faire la leçon : « Quand, comme vous, on est intellectuel noir ; quand, comme vous, on a un diplôme de Nogent-sur-Marne et un autre de Vilvorde ; quand, comme vous, on aime ses frères de race et que l’on désire se vouer à son émancipation ; quand, comme vous, on aime le Congo – votre pays d’origine – et que l’on désire sincèrement travailler à sa grandeur et à son développement, on n’habite pas Bruxelles… » (ACB du 30 janvier 1921).
L’importance des interventions de Panda dans l’affaire Kimbangu n’est pas clairement définie. Il est possible qu’il ne se soit pas limité au simple conseil qu’il donna à la Belgique coloniale de ne pas répondre au prophète par la violence mais plutôt en le convainquant des buts humanitaires de la colonisation (Vellut J.L., 1987 : 56). Etait-ce de l’ironie ?
Panda revint au Congo, dans son village natal, en 1929, où il y fit construire une chapelle et une école dédiée à son saint patron : saint Paul. Apparemment le système colonial n’eut pas besoin de lui comme commissaire de district, bourgmestre de cité ou fonctionnaire d’entreprise. Le 12 mai 1930, Panda mourut dans son village, moins d’un an après son retour d’Europe [13]. On ne connaît pas les circonstances de sa mort, survenue alors qu’il n’avait que 41 ans. Peut-être faut-il la mettre en rapport avec la grève des marins, qui éclata au même moment dans le « Léopoldville », en route vers Anvers (Kanku B., 1972-1973 : 23).
De toute évidence, Panda est l’une des figures de proue du processus de lutte contre la colonisation. Pourquoi le souvenir de son action ne s’est-il pratiquement pas transmis aux générations congolaises qui suivirent ? Je n’y vois qu’une explication : l’action coloniale préféra taire ce nom, trop évocateur. Ce n’est pas un hasard si, quelques jours après, en juin 1930, le gouverneur général A. Tilkens signa une circulaire relative à « l’émigration des Noirs en Belgique ». Le texte en est laconique et les termes particulièrement bien choisis :
J’ai l’honneur de porter à la connaissance du personnel de la colonie, qu’eu égard aux inconvénients multiples, voire aux dangers résultant du séjour des Noirs en Belgique, j’ai décidé d’interdire désormais aux fonctionnaires et agents rentrant en congé, d’emmener des Noirs avec eux [14].
Quant aux Evolués, ils ne purent cultiver la mémoire de Panda. Soucieux de demeurer dans les bonnes grâces du pouvoir colonial, ils ne purent en évoquer le souvenir, sous peine d’aggraver leur situation.
L’entre-deux-guerres avait été une période importante dans le réveil du nationalisme congolais. La Deuxième Guerre mondiale devait y contribuer d’une manière aussi décisive, sinon davantage.
2 LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE ET LA SITUATION NOUVELLE
La guerre a toujours été un moment favorable aux mutations. Le général De Gaulle le souligna dans son discours en 1941. Il déclara : « le philosophe grec disait que la guerre engendre tout. Certes, il est bien vrai que sa dure lumière met souvent en plein relief des nécessités jusqu’alors mal reconnues et que sa dévorante activité impose des réalisations que les époques pacifiques rejettent… ». Dans le cas de l’Afrique, De Gaulle percevait déjà avec lucidité le rôle unificateur de la guerre. « Les terres africaines, plus ou moins séparées (…), s’aperçoivent qu’elles sont dans une large mesure complémentaires les unes des autres. C’est ainsi que l’on voit se nouer par exemple, entre l’Afrique française libre, le Nigeria, le Congo belge, l’Afrique du Sud, l’Angola, mille liens nouveaux d’échange » (cité par Jouve E., 1984 : 22-24).
Déjà la Première Guerre avait modifié plusieurs données importantes pour le Congo belge. Le fait d’avoir été isolée de la métropole a obligé la colonie à chercher d’autres partenaires commerciaux. Ainsi, à la fin de cette Première Guerre, le Congo se retrouva pratiquement en situation de dépendance économique vis-à-vis de l’Afrique australe et, de manière plus générale, vis-à-vis de la zone économique de la livre sterling. Bref, des nouveaux partenaires commerciaux firent leur entrée sur le marché congolais. Certains chiffres de l’époque l’indiquent. En 1919, la part de la Belgique sur le commerce du Katanga n’était que de 0,5 % alors que celle de la zone de la livre sterling était de 70 % et celle des États-Unis d’Amérique de 27 % ; en 1920, ces chiffres sont respectivement de 9 %, 79 % et 10 % [15]. La colonie sortit ainsi quelque peu du giron belge. Après les efforts de récupération de la mainmise coloniale de l’entre-deux-guerres, ce mouvement reprit de plus belle lors de la Deuxième Guerre. Vers les années 20, nous l’avons vu, un grand mouvement de contestation sociale épuisa littéralement les populations déjà fort éprouvées par la guerre. Tout le monde avait des raisons d’être mécontent : les anciens soldats de la Force publique, les ouvriers européens qui lancèrent les premiers mouvements de grèves connus dans la colonie, enseignant ainsi aux autochtones le fonctionnement de cet instrument de contestation, les paysans qui ne pouvaient réprimer davantage leur mécontentement face au joug des corvées et de l’imposition des cultures « éducatives ». Autre indice révélateur, on vit apparaître des revendications messianiques avec le kimbanguisme et le kitawala [16].
La Deuxième Guerre eut des conséquences d’une autre importance. Précisons d’abord que telle qu’elle fut vécue à la colonie, cette guerre eut deux phases. La première coïncida avec la capitulation de la Belgique conquise, le 27 mai 1940. La colonie fut mobilisée pour assister la métropole dans ses tentatives de libération. Le mot d’ordre vint du gouverneur général Pierre Ryckmans lui-même (Vanderlinden, J., 1994) : « Nous sommes ici au Congo-Belgique sur cette grande terre belge que l’ennemi n’a pas violée et qu’il ne violera pas. La Belgique est meurtrie mais elle reste vivante partout où flotte son drapeau… » (Ryckmans P., 1945 : 18).
Cette première optique, essentiellement militaire, fut poursuivie jusqu’au bout. On décréta la mobilisation générale. Dix-huit mille soldats et quatre mille porteurs furent engagés. Mais cette grande mobilisation laissa sceptique les anciens combattants, ceux qui avaient lutté en 14-18. En écho aux propos de Ryckmans, ils se demandaient :
En 14-18, nous avons combattu pour eux et nous n’avons reçu aucune récompense sinon de simples médailles. Maintenant où veulent-ils encore amener nos cadets ? [17].
Fort heureusement, ce scepticisme n’était pas encore partagé par tous et le mot d’ordre colonial fut respecté. Albertville (Kalemie) fut aménagée comme site de départ pour les campagnes militaires à l’est ; le 6 février 1941, les premières troupes quittèrent le Congo belge vers l’Abyssinie pour seconder les Anglais dans la guerre contre l’Italie fasciste. Le 11 mars 1941, celle-ci remporta la victoire d’Assosa et le 23 du même mois, elle occupa Gambela ; le 3 juillet, le général italien Gazera se rendit avec neuf autres généraux et quinze mille hommes. Un an après la campagne d’Abyssinie, deux corps expéditionnaires furent envoyés en Afrique de l’Ouest (Nigeria) où ils se positionnèrent face au Dahomey vichyssois (octobre-Novembre 1942) ; puis ils furent envoyés en Egypte (18 mars-20 juillet 1943) et au Moyen-Orient (juillet 43-juillet 44) où ils participèrent à la construction d’un aéroport en Cyrénaïque et sillonnèrent la Palestine, le Liban, la Syrie, l’Irak et la Transjordanie ; l’effort de guerre se concrétisa aussi par les déplacements de l’hôpital militaire de campagne, d’abord en Afrique orientale (1942), à Madagascar (septembre 1942-février 1943) puis en Birmanie (mai-novembre 1944) (Mabiala M.N.. 1980 :156 ; Mutamba M., 1977 : 17-18). Bref, la Force publique fut mêlée à tout et aurait tout naturellement participé au débarquement sur le continent européen si le gouvernement belge en exil ne s’y était opposé, sans doute par crainte de ternir aux yeux de ses colonisés le prestige de l’Européen.
La deuxième phase de la participation congolaise fut essentiellement économique. En effet, le 7 décembre 1941, les Japonais détruisirent une partie de la flotte américaine de Pearl Harbour et entrèrent en guerre contre les USA et la Grande- Bretagne. En janvier 1942, la Malaisie fut conquise et le 15 février, la garnison britannique de Singapour capitula ; l’Indonésie et la Birmanie furent occupées dès mars. L’imprévisible se produisit. Les Alliés, à cause de ces défaites, furent privés de certaines matières premières essentielles comme le caoutchouc, l’étain, l’huile de palme, la quinine, etc. C’est alors que le Congo belge acquit une importance de premier ordre car il pouvait et devait assurer désormais un approvisionnement qui en temps normal incombait à une pluralité de colonies (Willame J.C., 1983 : 223 ; Verhaegen B., 1983 : 443). Ryckmans donna une fois de plus le ton par son message radiodiffusé du 10 mars : « Après les victoires japonaises : les devoirs nouveaux » […] « cette brèche dans le front allié de l’Equateur asiatique, il n’y a que l’Equateur africain pour la combler. L’équilibre des ressources rompues au profit de l’ennemi par la poussée japonaise, on compte sur nous pour le rétablir dans toute la mesure de nos forces, jusqu’à l’extrême limite de nos moyens » (Ryckmans R., 1945 : 88-89). La mobilisation militaire fut doublée d’une mobilisation civile pour maximiser la production agricole et minière dans un souci constant d’adaptation aux priorités imposées et sans cesse revues en fonction des aléas de la guerre. Tantôt on réclamait l’or ou le diamant avant tout, tantôt du bois en grume, du copal, du caoutchouc ou encore de l’uranium ou des oléagineux. Le tableau ci-après rend compte de ces fluctuations de la production :
Tableau 17 — Production du Congo belge pendant la guerre
| 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |
| Cuivre (t) | 122.000 | 148.800 | 162.200 | 166.000 | 156.900 | 165.500 |
| Etain (t) | 9.800 | 12.600 | 14.300 | 13.300 | 17.100 | 17.300 |
| Or (kg) | 18.200 | 19.500 | 19.600 | 17.870 | 15.100 | 14.000 |
| Zinc (t) | 19.600 | 21.100 | 29.100 | 16.650 | 40.900 | 31.030 |
| Diamant (et) | 8.360.000 | 9.602.800 | 5.865.750 | 6.018.200 | 4.881.700 | 7.533.360 |
| Bois (m3) | 75.600 | 106.400 | 118.600 | 160.000 | 170.000 | 175.000 |
| Café (t) | 21.700 | 23.242 | 23.318 | 23.792 | 22.000 | 29.600 |
| Caoutchouc (t) | 1.142 | 800 | 1.500 | 1.800 | 9.000 | 12.000 |
| Copal (t) | 11.110 | 10.900 | 14.350 | 15.300 | 17.350 | 16.080 |
| Coton (t) | 42.040 | 44.000 | 47.200 | 40.150 | 44.150 | 31.150 |
| Fibre (t) | 4.900 | 7.200 | 5.500 | 11.230 | 13.100 | 8.200 |
| Noix de palme (t) | 88.700 | 44.650 | 30.200 | 75.600 | 74.960 | 65.780 |
(Lederer A., 1983 :134)
Tout ceci contribuait à accabler de travail les populations affectées à la production, qui la réalisaient sans trop savoir à quoi elle pouvait servir puisqu’elles étaient totalement étrangères au conflit. Il est impensable d’évaluer les conséquences de cette guerre lointaine et ce, à tous les niveaux.
On peut affirmer que le Congo belge en sortit complètement transformé. Ainsi, sur le plan économique, la nouveauté s’exprima sur trois tableaux. D’abord le Congo confirma son ouverture à d’autres partenaires que la métropole, avant tout à l’Angleterre et aux USA. L’Afrique du Sud conserva une position importante et l’Allemagne, bien que nazie, continua à bénéficier, par l’Angola et le Portugal, d’un certain nombre de produits, notamment le diamant industriel. De plus, le Congo acquit de l’importance par son rôle économique stratégique. Les puissances alliées traitèrent plus directement avec lui et c’est grâce à lui que la Belgique consolida ses positions. Cette inversion de la hiérarchie allait avoir des implications politiques précises (Willame J.C., 1983 : 213-253).
L’économie congolaise se retrouva dans l’obligation d’assurer un certain nombre de transformations des produits sur place. Les difficultés d’importation, en effet, obligèrent à recourir aux moyens de bord ; grâce à cela, des industries nouvelles ouvrirent leurs portes et certaines, déjà existantes, se développèrent. Ainsi, on créa une industrie métallurgique au Katanga pour le traitement des minerais non ferreux ; on développa également la fabrication métallique dans les ateliers de grandes sociétés vu les nombreuses demandes de réparations et de pièces de rechange. C’est dans ce cadre qu’à Kinshasa, la société Chanic (Chantier naval et industriel du Congo) connut à l’époque un développement prodigieux (Vanderlinden J., 1983 : 525-578). L’industrie chimique fut développée et diversifiée entre autres avec la production d’oxygène comprimé, d’acide carbonique, d’explosifs, de couleurs et de vernis. Les industries de biens de consommation (textiles, bière, savon, sucre, ciment, etc.) implantées vers les années 20 furent accrues. Ainsi par exemple, les brasseries qui produisaient 28 000 hectolitres de bière au début de la guerre, passèrent à 130 000 à la fin de celle-ci. Les brasseries du Katanga doublèrent leur fabrication de bouteilles. On produisit également localement la quinine et la pénicilline ; la production de savon passa de 448 tonnes en 1939 à 15 811 en 1945 : le métrage de tissu local produit fut évalué à 18 700 milliers en 1945 contre 11 500 en 1939. La société Tabacongo, créée en 1939, lança ses premières cigarettes fabriquées au Katanga au début de 1944. Incontestablement l’isolement de la colonie belge favorisa son industrialisation.
La guerre permit également la réalisation de plusieurs projets d’amélioration des infrastructures de base notamment, dans le secteur du transport. L’Office d’exploitation des Transports coloniaux (OTRACO), créé en 1935 pour faire face aux problèmes de transport aggravés par les effets de la grande crise économique, dut accroître son rendement alors qu’il connaissait des problèmes à cause de la diminution de son personnel européen et l’insuffisance de son approvisionnement en matières premières. Quant au transport aérien, il était opérationnel depuis longtemps : en novembre 1939, peu avant le début de la guerre, la SABENA accomplissait sa centième liaison aérienne entre l’Europe et l’Afrique. A cause de la guerre, cette compagnie dut mettre tous ses avions à l’abri au Congo. Ce fut l’occasion d’établir plusieurs lignes intérieures. A la fin de la guerre, on comptait 47 aérodromes dans la province de Léopoldville. 28 à l’Equateur, 17 au Katanga et 27 au Kasaï (Lederer A., 1983 :131-212). ce qui multipliait les possibilités de communication par voie de surface.
La guerre eut également des conséquences politiques. La première fut cette sensation de vide politique, davantage ressentie à cause de la double défaite de la métropole, à la fois militaire vis-à-vis de l’Allemagne et économique par rapport au réseau anglo-américain (USA, Angleterre, Afrique du Sud).
A ce vide politique, vint s’ajouter un courant anticolonialiste, né au début de la guerre et qui ne cessa de se déployer de par le monde. On se rappellera ces quelques points de repère : dans la Charte de l’Atlantique signée le 14 août 1941 entre Roosevelt et Churchill et qui déterminait les prescrits devant régir désormais les relations entre nations du monde libre, une des dispositions concernait les colonies, à propos du « respect du droit pour tous les peuples de choisir la forme de gouvernement sur lequel ils désiraient vivre ». Pour les Américains, cette clause concernait toutes les colonies. Toutefois en tant que puissance colonisatrice, l’Angleterre fit nuancer cette clause et cette version corrigée prévalut finalement lors de la Conférence de Yalta lorsque les deux hommes se rencontrèrent à nouveau avec Staline. Toutefois, le courant anticolonialiste était né et allait compter de plus en plus d’adeptes. En Angleterre, par exemple, les milieux travaillistes ne cachaient pas leur sympathie pour ce mouvement. Quant à l’Union soviétique, elle était « naturellement » anticolonialiste selon le principe marxiste de l’internationalisme prolétaire ; déjà Lénine avait prédit que l’affranchissement des colonies provoquerait la perte des grands pays d’Occident (Petillon L.A., 1985 : 157-188). Le paysage de la vie internationale contemporaine fut donc esquissé avant l’effondrement de l’Allemagne nazie et la capitulation du Japon ; il se précisa encore lors de la Conférence de San Francisco qui aboutit à la signature le 26 juin 1946 de la Charte des Nations Unies par cinquante Etats. Cette charte qui se caractérise par la volonté de promouvoir les droits des « territoires non autonomes » – le terme « colonie » ayant été banni du langage de l’ONU – est considérée à juste titre comme un tournant dans 1’ère de la colonisation, comme le précise clairement l’article 73 :
Les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prospérité dans le cadre du système de paix et de sécurité internationale établi par la présente charte, et à cette fin :
a) d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus.
b) de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement… (cf. Charte des Nations Unies).
Avec cette disposition et l’obligation qui fut faite aux puissances colonisatrices, toujours par cette charte, « de communiquer régulièrement des renseignements statistiques et autres, de nature technique, relatifs aux conditions économiques, sociales et à l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables… », la colonisation devint officiellement un problème international. Tout le monde avait son mot à dire, y compris ceux qui n’avaient pas de possessions outre-mer. Le poids des membres non européens, américains, latino-américains, afro-asiatiques à l’ONU allait constituer dès cette époque un paramètre important dans la pression qui s’exercerait sur les puissances coloniales.
Quelle fut l’attitude de la Belgique dans tout cela ? Sur le plan formel, elle joua le jeu en signant la charte qu’elle fit approuver par la Loi du 14 décembre de la même année. Mais dans la pratique, elle adopta un comportement réservé, estimant que l’anticolonialisme de l’ONU n’était qu’une manière pour les pays sans colonies d’exprimer leur jalousie à l’égard de ceux qui en possédaient. Longtemps, elle estima que l’on ne pouvait envisager l’autonomie du Congo, dès lors que cette autonomie ne faisait même pas l’objet d’une réclamation de la part des autochtones eux-mêmes. On verra plus loin que cette vision des choses était pure méprise. D’ailleurs la mauvaise conscience de la Belgique à l’issue de la guerre en était une preuve : elle se préoccupa de récompenser les populations indigènes, consciente d’avoir été trop loin dans l’exploitation des hommes et du pays. La métropole reconnut en effet la participation énorme – même si elle était involontaire – de ces populations à la victoire des Alliés, par ses minerais, ses produits végétaux et la somme du travail fourni. Le gouverneur général Ryckmans était le premier à reconnaître l’existence de cette dette morale…
Cette créance à laquelle la Belgique devra faire honneur. […] Une créance s’ajoutait à toutes les autres […] Car à toutes nos réalisations, les Noirs ont collaboré par leur humble et multiple labeur. Tous les capitaux que nous avons investis dans la colonie, ils les ont multipliés en investissant leur travail (Ryckmans P., 1946 : 196).
Ce n’était que justice, par rapport à l’ampleur de l’exploitation subie au cours de l’entre-deux-guerres et pendant les années de guerre. Cette opinion était aussi une stratégie, une façon de ménager sa monture, au risque de susciter des mécontentements, histoire de « soutenir la confiance et mériter l’attachement des populations indigènes par la preuve effective de la haute conscience qu’a la métropole de ses responsabilités coloniales… ». Ce conseil gratuit émanait du prélat d’Elisabethville, Monseigneur De Hemptinne, particulièrement bien placé pour émettre une opinion sur l’évolution des populations urbaines (Denuit D., 1946 : 130) [18].
Tout se jouait en faveur d’un fléchissement de la position coloniale. Cette attention plus bienveillante à l’égard des autochtones donna à ces derniers l’espoir d’être remerciés d’une façon encore plus équitable. Après tout, la guerre avait offert l’occasion aux Congolais, du moins à ceux qui avaient fait partie des corps expéditionnaires, de découvrir la vulnérabilité des Belges : il existait d’autres nations européennes plus importantes, plus fortes et plus riches que la Belgique. Des propos « subversifs » comme ceux-ci, repris dans cette note du délégué de l’administrateur de la Sûreté d’Elisabethville au gouverneur de province en date du 26 janvier 1946. ne devaient pas être rares.
Il m’est signalé que le chauffeur du garage militaire d’Elisabethville, Tshikuya Kamuna, ayant fait partie du corps expéditionnaire, tient des propos subversifs, tels que :
– les Belges sont des nyangalakata [19].
– Boula-matari est bulé [20].
– Il n’y a que les Anglais qui sont intéressants et ce serait un bienfait si eux étaient les maîtres du Congo.
– Ce sont les Anglais qui nous avaient remis de bons habits, que les Belges nous ont enlevés.
– Dans la guerre, les Belges ne font rien et ils ne sont que des froussards.
Il tient aussi certains propos au sujet des relations qu’il aurait eues en Egypte avec des femmes blanches [21]
Le dernier propos est également « subversif » car la colonisation, par l’entremise du missionnaire, faisait croire que le Blanc avait une moralité parfaite et que la prostitution était l’apanage des négresses. La guerre avait donc permis de découvrir d’un coup que le Blanc, en définitive, n’était qu’un homme… comme un autre.
Les Blancs travaillaient de leurs mains ; ils suaient, ils faisaient l’amour ; ils avaient faim et soif comme le premier venu ; d’autres tremblaient de peur, torturaient, haïssaient… (Ki-Zerbo J., 1972 : 470).
Cette réalité était connue depuis longtemps, en principe. Mais il y avait une grande différence entre cette connaissance théorique et h découverte concrète de la réalité.
Ceci nous mène aux implications sociales de la guerre, qui introduisirent dans la colonie des comportements nouveaux qui subsistèrent même après la guerre. Pour la première fois, on vit les Blancs s’en prendre aux Blancs, alors qu’on avait toujours cru qu’une entente parfaite régnait entre eux. Cette réalité, on ne la vivait pas seulement de manière théorique, par des nouvelles des batailles entre Blancs (Allemands-Français, Allemands-Belges, etc.), mais les combattants envoyés au front les vivaient et en faisaient état à leur retour.
Au Congo même, il y eut des combats entre Blancs, et on arrêta des sujets allemands ou italiens qui travaillaient dans le pays. Dans les souvenirs de la guerre recueillis auprès des populations de Kisangani, Verhaegen a retrouvé ce genre de propos. Dès que la nouvelle de la guerre en Europe parvint au Centre extra-coutumier de Stanleyville (10 mai 1940), les sujets allemands furent arrêtés. L’un d’eux réussit à prendre la fuite par la route de Buta et fut arrêté au bac de Banalia. Des Italiens furent arrêtés en novembre de la même année et parmi eux des missionnaires. Deux faits frappèrent l’imagination de la population : on leur enleva les souliers et ils restèrent pieds nus. Ils furent également obligés de préparer eux-mêmes leur nourriture à l’extérieur, sur des feux de bois.
Voir les Blancs traiter d’autres Blancs comme des Congolais fut un sujet d’étonnement (Verhaegen B., 1983 : 475-476).
D’autre part, le nombre réduit d’agents coloniaux – pendant quatre ans il ne fut plus possible d’aller en Europe ni d’en revenir – obligea les entreprises à confier aux Africains certaines tâches réservées jusque-là aux ouvriers européens. Ce fait joua en faveur de la promotion des « lettrés » autochtones. L’émergence des évolués, cette première élite autochtone issue de la colonie, constitue en effet le plus grand acquis de cette période de guerre, et des années qui la suivirent. Le rôle prépondérant que ce groupe allait avoir dans l’évolution générale de la colonie, nous amène à préciser les conditions de son émergence et l’importance qu’il prit au cours de cette période d’éveil.
A chaque époque historique correspond une élite. Les transformations sociales introduites depuis la fin du XIXe siècle, quand le Blanc commença à s’intéresser à l’arrière-continent, avaient favorisé l’apparition d’une élite nouvelle. Celle-ci, après quelques décennies, avait accompli toute une évolution. La première génération de cette élite acculturée constitua au premier âge colonial les premiers « compagnons » du Blanc : domestiques (appelés boys), plantons, maîtresses, cuisiniers ; et puis les auxiliaires de son action : capita, catéchistes, etc. Avec les efforts de la première scolarisation, l’élite regroupa un autre type d’hommes : les moniteurs, les auxiliaires administratifs, appelés « clercs » ou en langues locales, « kalaka ». Il faut y inclure aussi d’autres catégories d’auxiliaires : infirmiers, sous-officiers de la Force publique, agents commerciaux, ouvriers qualifiés, etc. Le prêtre (Monsieur l’Abbé) faisait l’objet d’un classement particulier, étant donné son haut niveau d’études et son privilège de partager la vie du Blanc, privilège qui ne lui fut pas accordé dès le début mais qu’il acquit assez rapidement.
3.1 L’impossible mimétisme
L’importance de ces « évolués » devint manifeste vers les dernières années de la guerre ; mais en réalité, le groupe avait pris forme pendant l’entre-deux-guerres avec l’apparition des premières associations pour Congolais. La première disposition juridique en la matière date du 11 février 1926. Dans les centres extracoutumiers où l’on se retrouvait en situation de brassage ethnique, les gens se regroupaient volontiers par ethnies ou groupes d’ethnies. Comme on l’expliquera plus loin, une certaine parenté d’un type nouveau avait pris forme. Moins formaliste, elle regroupait les ressortissants de même village ou de même terroir ou encore ceux qui parlaient la même langue ethnique ou des dialectes semblables. D’autres prétextes au ralliement furent ensuite adoptés par analogie, notamment le fait de partager les mêmes références quant à la mission d’origine ou encore quant à la congrégation missionnaire qui avait assuré l’évangélisation. Ainsi, les deux plus puissantes associations du genre datent de cette époque ; il s’agit de l’ADAPES (Association des anciens Elèves des Pères de Scheut) [22] et de l’ASSANEF (Association des Anciens des Frères des Ecoles chrétiennes) créées respectivement en 1925 et 1929. L’association des Mulâtres date des années 1931-32, patronnée par les prêtres sous la direction d’Albert Mbuyi (Mutamba M., 1977 : 53-54). Le groupe d’évolués fut encore agrandi pendant la guerre, entre autres grâce à la promotion massive du personnel auxiliaire local qui fut appelé à remplacer les Blancs absents et aussi grâce à l’isolement de la colonie par rapport à la métropole.
On prit alors vraiment conscience, tant du côté du pouvoir colonial que de celui des intéressés eux-mêmes, de l’existence d’un groupe particulier qualifié d’« évolué ». On en vint à ressentir la nécessité de préciser les contours de ce concept, sans doute pour éviter une « inflation » d’évolués. Ceux-ci se définissaient comme des « Européens à peau noire » (mundele ndombe). Certains d’entre eux cherchaient même à se démarquer des autres « indigènes » traités de « primitifs » (basenji, bahuta) en adoptant le comportement des civilisés qu’étaient les Blancs. L’évolué s’estimait « réussi » si ceux qui l’observaient pouvaient conclure que son comportement était… « comme celui du Blanc ». A l’inverse d’aujourd’hui, « être comme le Blanc » (« kama muzungu » en swahili ; « lokola mondele » en lingala, « bonso mundele » en kikongo, « bumutoka » en ciluba) était le meilleur compliment qui pouvait se faire. Il fallait donc se rapprocher au maximum de ce modèle. Certains se révélèrent fort habiles à ce jeu, allant jusqu’à marcher comme le Blanc, parler comme le Blanc et même rire comme le Blanc. On se plaisait même à « européaniser » son identité : « Likwangola » devint Dericoyard et Léon Kasa, Léon de Cassa [23].
Les conditions d’accès à ces castes de privilégiés étaient assez imprécises. On finit cependant par établir qu’il fallait répondre au moins aux critères suivants : avoir un certain degré d’instruction, un revenu mensuel minimum, un certain degré de conscience professionnelle, une moralité irréprochable et s’efforcer d’assimiler le mode de vie européen. La première condition requise supposait que le candidat ait fréquenté une des « grandes écoles » de l’époque : école moyenne, école normale, petit séminaire, etc. Ce diplôme donnait droit au plus grand confort dont pouvait rêver un autochtone, c’est-à-dire la possession d’une maison en dur, l’acquisition d’une bicyclette, d’un phonographe, d’une lampe à incandescence (lampe coleman de préférence) et parfois même d’une machine à coudre.
Mais l’évolué devait également être doté de qualités professionnelles qui faisaient de lui un agent « modèle » du Blanc. Cela élargissait le champ des candidats à la classe d’évolué car cette élite professionnelle pouvait se recruter dans différents domaines, même les plus inattendus : les domaines des animateurs de radio, des anciens combattants, des greffiers et juges de tribunaux, des chefs de gare, sous- percepteurs de poste, etc.
Une autre condition concernait la morale nouvelle qu’on devait s’engager à suivre, notamment et surtout par le respect de la monogamie et le rejet de la polygamie. Le dernier principe à adopter sous-entendait que l’évolué devait se mettre totalement à l’école du Blanc. Aussi demeuraient-ils en ce sens des apprentis, qui continuaient à « apprendre » pour se rapprocher le plus possible du maître. Cet apprentissage se réalisait dans le cadre de « cercles pour évolués », qui furent créés un peu partout par les missions, l’administration, les entreprises ou certains coloniaux bénévoles. Le « cercle » poursuivait la formation intellectuelle des adhérents et leur offrait des divertissements « sains », parce qu’exotiques par rapport à la culture locale : théâtre, musique, sport, jeux d’esprit, etc. Ces « cercles » étaient animés par des coloniaux, qui gardaient ainsi un certain contrôle sur l’évolution des idées de ces premiers lettrés.
L’évolué était un pur produit de la colonisation mais le colonisateur n’en voulut point. Il critiquait volontiers ces « parvenus », ces « demi-savants », « fiers du pauvre bagage scientifique dont leur cerveau était garni » et qui étaient tentés de « se croire les égaux des Blancs et capables de les remplacer » (Mutamba M., 1977 : 62). Telle était l’opinion de la plupart des coloniaux, missionnaires, agents administratifs et commerçants sur ce groupe. Ce mépris n’était qu’une manière d’exprimer leur crainte face à la naissance de ce corps nouveau qui ne fit que se développer après la guerre, à en juger par le nombre de nouveaux cercles créés. D’après le Rapport annuel présenté aux Chambres Législatives sur l’administration de la colonie, il en existait 118 en 1946, 153 en 1953, 171 en 1954, 204 en 1955, 244 en 1956, 258 en 1957 et 317 en 1958. On aura noté la progression accélérée à partir des années 50. Le nombre d’évolués a bien sûr suivi cette courbe ascendante ; ainsi, d’après Van Wing, il y avait 5 609 évolués au 31 décembre 1946 (Verhaegen B., 1974 : 4) ; Lemarchand estime leur nombre à 7.661 au 1er janvier 1952 (1964 : 179) et 11 572 à la fin de 1954 (Young C., 1965 : 199). Pour 1956. Lumumba estime qu’ils étaient 100 000 (1961 : 57) [24].
Dès 1945, le groupe se sentit assez important en nombre pour penser à se préoccuper de son statut au sein de la colonie. En fait, ce souci existait déjà lors de l’émergence même du groupe. Mais il devint évident au cours des années 45-50 et se confirma dans la décennie suivante. Déjà en mars 1944, quelques semaines après la mutinerie de Luluabourg, les évolués de ce centre remirent un mémorandum au commissaire de district dans lequel ils réclamaient la reconnaissance de l’existence de la « classe » des évolués, intermédiaire obligé entre les Blancs et la « masse des indigènes arriérés ». L’autorité coloniale minimisa cette requête, contestant du reste sa paternité congolaise. Un Noir du Congo belge ne pouvait être seul à l’origine d’un tel document (Mutamba M., 1977 : 63-64). Pourtant un autre écrit du même genre fut établi à la même époque par les évolués de Stanleyville (De Schrevel M., 1970 : 71, note 62).
La parution du n° 2 de la « Voix du Congolais », quelques mois après, apporta la preuve que cette revendication était générale. Dans ce numéro, un évolué dont le nom demeurera dans les annales de l’histoire, Paul Lomami-Tshibamba, aborda la question de la reconnaissance d’un statut spécial des évolués, qui les placerait dans « une situation non confondue à celle de n’importe quel indigène, mais le plus possible assimilée à celle des civilisateurs » (Lomami-Tshibamba P., 1945 : 50). Banal en apparence, le problème était cependant d’ordre existentiel. A l’époque, le « colour bar » battait son plein. Blancs et Noirs étaient séparés dans une discrimination considérée comme la plus sévère d’Afrique ; le plus féroce des coulour bars anglo-saxons n’a jamais édité de mesures de ségrégation aussi rigides (Rubbens A., 1949 : 503-513). Tous les témoignages vont dans le même sens : « les Noirs et les mulâtres sont rigoureusement exclus des cités qu’habitent les Blancs, des endroits que ceux-ci fréquentent. Les Blancs ont leur cité, leurs lieux de divertissement et de repos, leurs wagons en chemin de fer, leur quartier dans les bateaux. Les Noirs et les mulâtres ont aussi les leurs, mais ils sont séparés, ils ne sont admis dans les lieux et endroits qu’habitent ou fréquentent les Blancs que dans l’exacte mesure où leur service le requiert » (Pauwels H., s.d. : 66). Dès lors, l’angoisse de la nouvelle «classe» est compréhensible, étant donné qu’elle est à la fois rejetée par le système, tout en étant différente de la masse locale, et soucieuse de ne pas compromettre les efforts d’assimilation fournis ou en cours de réalisation. Lomami-Tshibamba a expliqué ces sentiments divers, comme on le lira à la fin de ce chapitre [25].
A défaut d’être assimilés, les évolués demandaient à tout le moins une reconnaissance de la « différence » de leur statut par rapport à celui des autres Noirs, cette différence étant perçue soit comme une antichambre avant l’état de civilisation, soit comme un premier stade de cette civilisation. L’évolué, en ceci, demandait simplement qu’on le respecte en tant qu’humain à savoir, la dispense du fouet, des gifles et coups de pieds, et des insultes [26]. A.R. Bolamba s’interrogeait à ce sujet :
Est-ce trop revendiquer que de demander d’être considérés plus humainement ?… Que chacun se persuade donc que, hommes à peau d’ébène, nous n’en sommes pas pour cela moins hommes (Bolamba A.R., 1948 : 448).
Pour hâter la reconnaissance officielle de ce statut spécial, un groupe d’évolués mirent au point un projet de statut qu’ils proposèrent à l’autorité coloniale à la fin de l’année 45 [27]. Les signataires réclamaient un traitement préférentiel par rapport au reste de la population. Ce statut particulier était revendiqué tout particulièrement par l’Union des Intérêts sociaux congolais (UNISCO), un organisme créé en 1945 à l’initiative de l’ADAPES et qui ne regroupait que les responsables des associations d’anciens élèves. Son premier président fut Eugène Kabamba. En tant que chef de cité, un des tout premiers, il épaulait le chef de service de la population noire chargé du recensement [28]. Jean Bolikango lui succéda pendant que Joseph Kasa-Vubu, un autre commis de l’administration, jouait le rôle de porte-parole. En 1946, il prononça un discours retentissant sur le thème du « droit du premier occupant ». On y devine déjà une certaine prétention kongo sur le territoire de la cité de Léopoldville (Mutamba M., 1977 : 68).
L’année 1947 apporta quelques faits nouveaux : la programmation du projet de statut des évolués à l’ordre du jour du Congrès Colonial, et la déception née du rejet de ce même projet par ce conseil. La même année, une mission sénatoriale belge organisa une tournée au Congo ; les évolués en profitèrent pour lui remettre des mémorandums notamment à Kinshasa et à Isiro (Paulis).
L’opinion contemporaine a surtout retenu de l’action des évolués la volonté d’accéder à des avantages matériels particuliers et le désir de ne pas être confondus avec la masse pour qui ils n’avaient que mépris (De Schrevel M., 1970 : 74). « Tout pousserait à croire, note Kadima-Nzuzi, qu’ils voulaient instaurer, entre eux et les autres Congolais ‘non évolués’, un apartheid analogue à celui qui existait entre Blancs et Noirs » (1984 : 64). La littérature coloniale, particulièrement critique à l’égard de l’évolué, nous a poussé à percevoir essentiellement l’aspect égoïste de cette lutte qui misait sur un clivage évolués/masse. En réalité, il faut resituer cette revendication dans son contexte, celui d’une grande discrimination, la plus sordide de tous les systèmes coloniaux. La démarche des évolués constituait la genèse d’un combat qui ne s’estomperait qu’avec la fin de la colonisation. En ce sens, cette initiative posait le problème de la reconnaissance de l’existence de l’évolué en tant qu’homme moderne, à l’instar du Blanc, en dépit d’une différence de couleur d’épiderme. Le système colonial comprit parfaitement l’importance et le danger de ces prérogatives puisqu’il n’allait cesser de tourner les évolués en dérision et qu’il ne lâcherait du lest que progressivement, suivant l’ampleur de leurs assauts. Le mépris des « évolués » à l’égard des autres Noirs n’était qu’une conséquence du système colonial lui-même. Il s’expliquait par la peur de perdre la seule arme dont ils disposaient, c’est-à-dire l’identification au Blanc grâce au niveau de confort culturel, intellectuel et matériel et donc aussi par un certain clivage par rapport au Noir traditionnel, enfermé dans ses coutumes et ses traditions, considéré comme une antithèse du Blanc.
Cette réclamation avait donc, malgré son caractère matérialiste et corporatif, une connotation politique. Si elle avait été satisfaite immédiatement, elle aurait sans doute précipité l’accession à l’indépendance.
3.2 La réponse coloniale ou la civilisation toujours inachevée
Les faits évoluèrent assez rapidement à partir de la guerre. En quinze ans, la colonisation belge avait pris conscience de sa vulnérabilité, ce qui se concrétisait par sa double préoccupation de s’acquitter des « dettes de la guerre » à l’égard de sa colonie et de faire bonne figure à l’ONU pour ne pas perdre sa colonie. Ainsi, elle s’employa à atténuer la vague de mécontentement qui gagnait les différents groupes d’évolués. Elle fit d’ailleurs bien davantage que gratifier simplement les anciens combattants et les décorer avec toute la solennité nécessaire pour frapper les esprits : d’année en années, des réponses furent apportées aux revendications des évolués, sous forme d’initiatives coloniales nouvelles ou de réformes sur les plans culturel, syndical et social.
Au plan culturel, la nouveauté se traduisit par l’ouverture, le 12 octobre 1944, au sein du service d’information du gouvernement général, de quatre sections : presse, radio, cinéma et bibliothèque. L’administration s’engageait ainsi à assumer désormais la vie culturelle et intellectuelle des évolués, dans ces quatre domaines [29]. On créa, en outre, un bimensuel intitulé La Voix du Congolais, qui se voulait un périodique animé, d’après son sous-titre, par et pour les Congolais. Le gouvernement fit ainsi une incursion dans un secteur que l’Eglise occupait seule depuis le début du siècle. En effet, depuis des années, l’apostolat missionnaire publiait un certain nombre de revues en langues locales, oeuvre tant protestante que catholique. Les plus connues furent les suivantes :
– en kikongo : Se Kukianga (depuis 1891 à Ekongo), Minsambu Miapenge (depuis 1893, SMF). Ntetembo Eto (depuis 1901 à Kisantu par les Jésuites), Ku Kiele (depuis 1908 à Matadi puis à Tumba par les Rédemptoristes), Tsungi Mona (depuis 1921 à Moanda par les Pères de Scheut), Lukwikilu Lweto (depuis 1933 à Wombali par les Jésuites), Longete, journal dia Balongi (depuis 1934 à Wombali par les Jésuites) et Lutondo Lweto (depuis 1953 par les Oblats Marie Immaculée-Idiofa) ;
– en lingala : Lokasa la Catep (édité à Nouvelle-Anvers par les Pères de Scheut), Ekim’ea nsango (depuis 1914 à Bolenge), Lokasa la Biso (depuis 1938 à Umangi, Lisala par les Pères de Scheut) ;
– en ciluba : Dikendji dia Mission (depuis 1930 à Wembo Nyama par les Méthodistes), Nkuruse (depuis 1916 par les Pères de Scheut, série Otetela à Tshumbe, série ciluba à Kamponde), Dibeji dipiadipia dia mamueto Maria (depuis 1930 irrégulièrement, depuis 1932 bimensuel à Luluabourg-St-Joseph par les Pères de Scheut), Tshisumbu tshia balongi ba Kali (depuis 1932 à Kabinda par les Pères de Scheut), Lumu lua Bena Kasaï (depuis 1932 à Luebo par l’A.P.C.M., devenu à l’indépendance Tugaga Kungi), Dibeji dia Balongi ba Kale (depuis 1937 à Lusambo par les Frères de la Charité) ;
– en swahili : Kirongozi (depuis 1922 à Kisangani par les Frères Maristes), Shauri na Hadisi (depuis 1933 à Baudouinville par les Pères Blancs), Hodi (depuis 1942 à Bukavu par les Pères Blancs, swahili-français), Habari ga Bogulu (depuis 1934 à Bafwansende) [30].
La presse française missionnaire datait des années 30 avec la première parution du Courrier d’Afrique le 12 janvier 1930. Ce quotidien d’inspiration chrétienne fut confié à des journalistes de métier, G. Caprasse et A. Gille (Pirotte J., 1973). Le public du « Couraf » fut en premier lieu européen mais très vite les évolués prirent l’habitude de le lire [31]. Par la suite parut l’hebdomadaire La Croix du Congo. Le numéro un date du 1er juillet 1933 et fut diffusé également au-delà de Léopoldville, notamment à Elisabethville, Matadi, Lisala. Avec la création du bimensuel gouvernemental, la Croix prit comme sous-titre Journal des Evolués congolais, à partir du numéro du 4 février 1945. Une manière subtile de faire remarquer à l’administration que l’Eglise l’avait précédée de treize ans dans la volonté de donner la parole aux évolués (Bontinck F., 1983 : 406-412). La Voix du Congolais qui fut animée pendant quatorze ans (de 1945 à 1959) par Antoine-Roger Bolamba, devint au fil des ans la caisse de résonance de l’opinion des évolués, dans sa recherche, ses hésitations, ses aspirations et ses contradictions internes [32]. C’est, affirme le n° 2 (mars-avril 1945), la revue qui ouvre aux évolués une tribune libre et leur permet ainsi de « s’engager dans des discussions d’une haute portée patriotique et de remplir un devoir civique ».
A l’autre extrémité du pays, un autre périodique de la même veine fut créé en 1946 avec un titre bilingue L’Etoile-Ngota dans le souci « de toucher spécialement les populations de la province d’Elisabethville, ou plutôt des régions que comprend l’espace qu’il est convenu d’appeler le Katanga » (Mukala Kadima Nzizi, 1984 : 46).
Les évolués tirèrent largement profit de ces périodiques pour échanger leurs idées et présenter leurs réflexions et leurs griefs. Et c’est la Voix du Congolais particulièrement qui se fit le fidèle interprète des aspirations de ce groupe [33].
L’évolution syndicale du pays, autre domaine qui suscita les réclamations des évolués, fut beaucoup moins fulgurante, de par sa nature. L’histoire locale du syndicat démarra, comme on l’a dit, en 1920, avec la création de l’AFAC (Association des Fonctionnaires et Agents de la Colonie), réservée exclusivement aux travailleurs blancs. Pendant la Deuxième Guerre, une Confédération générale des Syndicats (CGS) prit forme, à la suite de la fusion des multiples organisations existantes. Mais tout cela ne concernait que les Blancs.
La première organisation du genre pour « indigènes » date de février 1946. L’initiative ne fut pas gouvernementale car elle provenait des milieux syndicaux qui suscitèrent la création de « Syndicats des Travailleurs indigènes congolais spécialisés » (STICS). Née à Léopoldville, elle s’étendit à Elisabethville puis à Borna. De leur côté, les évolués de Léopoldville émirent le souhait de s’organiser en une Confédération générale des Syndicats indigènes (CGSI) dont les statuts parvinrent au gouverneur général en mars 1946. Face à cette pression, et désireuse de contrôler et donc de limiter une telle effervescence, l’autorité coloniale autorisa l’existence du syndicalisme noir et en fixa elle-même les conditions [34].
Le règlement mis en place fut totalitaire, tant on était convaincu que le Congolais n’était pas encore mûr pour ce genre d’activités. L’éventualité d’un syndicat interracial fut écartée ; les autochtones ne pouvaient se permettre ce genre de regroupement qu’entre collègues exerçant la même profession ou des professions semblables. Le droit de grève n’était pas reconnu, si ce n’est sous des conditions pratiquement impossibles à remplir. La création du syndicat indigène avait été ni plus ni moins une manière d’étouffer dans l’oeuf la constitution d’une section indigène de la CGS, qui était en voie de création en 1946.
Entre-temps, la CGS qui, idéologiquement parlant, s’alignait sur le socialisme, fut minée par de graves divergences alimentées par des querelles personnelles entre dirigeants. En mai 1946, elle fut rejointe par une autre formation syndicale, d’une autre tendance, la Confédération des Syndicats chrétiens du Congo (CSCC). Au départ, elle ne regroupa que des Européens puis peu à peu, elle favorisa la création de chapitres réservés aux Noirs. C’est la première expérience de syndicat interracial au Congo. En 1949, un Congolais, Jacques Massa, fut placé au poste de secrétaire permanent de cette confédération.
Quant à la CGS, devenue moribonde, elle accepta en 1947 de devenir la centrale coloniale de la « Fédération générale du Travail de Belgique » (FGTB), formation implantée dans la métropole. C’est ainsi que fut mise au point et en même temps sauvegardée l’initiative syndicale des coloniaux au Congo. Dès 1952, la FGTB créa des écoles pour former des cadres syndicaux à Léopoldville, Elisabethville et Stanieyville.
L’Association du Personnel indigène de la Colonie (APIC) découlait également des dispositions officielles de 1946. Elle ne regroupa que des auxiliaires de l’administration, commis et clercs. Leurs revendications portèrent sur le statut professionnel et les avantages y afférents. Jusqu’en 1957, l’APIC n’eut des sections qu’à Léopoldville, Stanieyville et Bukavu.
En définitive, on peut considérer que l’activité spécifiquement syndicale connut un succès limité ; elle ne s’implanta véritablement qu’en quelques points du pays : Léopoldville et le Katanga. En 1956, Léopoldville à elle seule englobait la moitié des Congolais syndiqués tandis que le Katanga en comprenait un peu moins d’un tiers ; de 1949 à 1956, le Kasaï et l’Equateur ne connurent aucune activité syndicale (Mutamba M., 1977 ; 92-102).
Plus effective et plus dynamique fut la représentation des autochtones dans les différents conseils d’entreprises ou de l’État. A partir de 1946, son évolution fut significative, à la suite des Ordonnances des 6 avril et 10 mai qui instaurèrent différentes instances, notamment les conseils indigènes d’entreprise, les comités locaux des travailleurs indigènes, les commissions régionales et provinciales du Travail et du Progrès social (TPSI).
Le « Conseil indigène d’Entreprise » [35] réunissait trois à douze représentants des travailleurs en présence de l’employeur ou de son délégué et traitait des questions strictement professionnelles. Le « Comité local des Travailleurs » fut instauré par le gouverneur de province avec pour tâche la coordination et l’examen des revendications des conseils d’entreprise. Le nombre de délégués allait de cinq à douze, élus parmi les conseils d’entreprise ou les comités syndicaux. La Commission du Travail et du Progrès social indigène tenait ses assises à la fois au niveau du district (commission régionale) et de la province (comité provincial). Trois instances y étaient représentées : l’administration, les employeurs et les travailleurs. Les différents délégués étaient nommés par l’administration.
La consultation professionnelle mise à part, la participation des autochtones à des conseils consultatifs au niveau des provinces et du pays date de 1946, année de première représentation « noire » à la session du Conseil de province de Léopoldville. Le mouvement se poursuivit en se généralisant. En 1948 et 1949, quatre Congolais siégèrent au Conseil de province de Léopoldville, deux au Conseil de l’Equateur, trois en Province Orientale, deux au Kasaï et un au Katanga. Le Conseil de province du Kivu invita trois Congolais à assister à ses travaux [36]. En 1951, le nombre de délégués autochtones de Conseils de province augmenta sensiblement au Conseil de gouvernement ; les huit délégués des « Indigènes » furent effectivement tous des autochtones et non plus des missionnaires ou autres Européens représentant les enfants du pays. C’était là un réel progrès car jusque-là, un seul Congolais, parmi sept autres délégués, assurait la défense des intérêts indigènes. Ce fut l’abbé Stéphane Kaoze qui, le premier, prit part en 1947 au Conseil de gouvernement [37]. En 1948, Kaoze fut remplacé par Massa et l’abbé Jean Loya, deux Africains dans une assemblée de 43 personnes [38]. Le Conseil colonial qui se réunissait à Bruxelles demeura fermé aux Congolais.
C’est dans le domaine social qu’on nota le plus d’innovations de la part du colonisateur, décidé à faire la promotion du régime colonial belge pour rendre vaines les réclamations des évolués.
En juillet 1947, un Fonds du Bien-Etre indigène (FBI) fut institué, avec pour objet, l’action médico-sociale, le développement de l’enseignement de base, l’action culturelle et sportive, l’exécution des travaux publics et la promotion de l’économie en milieu rural. Le 31 août, une autre disposition fut arrêtée, qui dispensait (enfin 1) du fouet les autorités et les juges indigènes, les gradés de la Force publique, le clergé noir et les agents auxiliaires de l’administration. Pour les autres, il a fallu attendre 1951 pour que le nombre réglementaire de coups de fouet infligés à titre d’exemple dans les prisons soit ramené de huit à quatre. Cet instrument fut utilisé dans les lieux de détention jusqu’en 1959 ; à la Force publique, il fut supprimé par l’Arrêté royal de novembre 1958.
La dispense du fouet pour certains annonçait la reconnaissance d’un statut spécial aux évolués. La première mesure concrète en ce sens avait été l’institutionnalisation d’une « carte de mérite civique » [39]. L’octroi de la carte dépendait de critères très précis. Le candidat ne pouvait être polygame, ni avoir fait l’objet d’une mesure de relégation ou d’emprisonnement, ni avoir encouru depuis cinq ans une peine de servitude pénale égale ou supérieure à 6 mois. De plus, il devait savoir lire, écrire, calculer et faire preuve d’une bonne conduite, manifestant son désir sincère d’atteindre un degré plus avancé de civilisation. Chaque candidature était soumise à l’appréciation d’une commission qui, après enquête, devait statuer sur le comportement du candidat et de sa famille, sur ses possibilités financières et sur son respect des prescriptions en matière d’hygiène.
Mais cette carte de mérite civique présentait moins d’intérêt et de prestige que le statut d’« immatriculé ». Celui-ci prit forme suite au décret du 17 mai 1952. En réalité, l’immatriculation ne constituait pas une création coloniale puisqu’elle avait existé au temps de l’EIC, où elle avait été instituée par décret le 27 décembre 1892 et le 4 mai 1895. Elle consistait à faire inscrire au registre de la « population civilisée » les Africains qui ralliaient l’EIC. Ce statut était accordé aussi à ceux dont la naissance ou le mariage était porté sur les registres d’état civil.
En 1900, le statut d’Immatriculé fut accordé d’office aux soldats qui avaient fait preuve d’assiduité à la Force publique, aux travailleurs « stabilisés » au service d’une entreprise, aux enfants mulâtres non reconnus et aux enfants sous tutelle de l’État ou des missions. L’avantage était que ces Congolais immatriculés jouissaient (en principe) de tous les droits civils reconnus aux Belges par la législation. Parmi les Congolais, une véritable barrière existait donc entre immatriculés et non immatriculés. Les premiers étaient assimilés aux non indigènes, bien que dans les faits ils n’eussent droit qu’à une reconnaissance fort aléatoire. C’est la raison pour laquelle cette distinction était tombée en désuétude.
A la demande des évolués, ce statut revint à l’honneur mais sous une forme améliorée. On entendait… « reconnaître, par l’octroi d’un statut légal d’assimilation, les efforts tenaces grâce auxquels certains Congolais, dont le nombre certes est encore très restreint, atteignent en fait un stade de civilisation égal à celui de leurs tuteurs » [40].
Ce statut rénové d’immatriculé fut donc l’apanage de la seule élite qui avait accédé à un haut degré d’occidentalisation. Les conditions d’accès en étaient donc rigoureuses. Le postulant devait adresser sa requête au président de sa circonscription et le dossier devait comprendre entre autres un certificat de bonne vie et moeurs, une attestation de monogamie délivrée par l’autorité territoriale, une déclaration du consentement de l’épouse, des copies de diplômes. La demande était communiquée au procureur du roi. Des bans étaient publiés, invitant le public à dénoncer les irrégularités éventuelles qui auraient été tués. Une commission se rendait au domicile de l’intéressé pour examiner l’état de sa famille et son hébergement. Cette inspection consistait en plusieurs visites effectuées à l’improviste (De Schrevel M., 1970 : 103-141).
Les Immatriculés, comme les Mérites civiques, jouissaient ensemble du statut spécial d’« élites » mais entre eux, subsistait une différence. L’immatriculation était plus prestigieuse, et son détenteur relevait du seul droit civil européen. Ce statut était valable pour toute sa famille car il s’étendait aussi à l’épouse et aux enfants. Quant au détenteur du mérite civique, il restait tenu par les coutumes, et n’acquérait sa promotion civique qu’à titre purement individuel. Ces privilégiés, Mérites civiques et Immatriculés, avaient droit aux mêmes avantages subsidiaires, tel l’accès aux cliniques, aux salles de cinéma et aux quartiers européens [41]. Ils pouvaient acheter et boire de l’alcool et voyager en bateau, dans des classes intermédiaires, entre celles réservées aux Blancs et aux Noirs [42]. A l’église, ils disposaient des prie-dieu situés derrière ceux des Blancs alors que les autres s’agenouillaient à même le sol.
A partir des années 1950-53, les enfants des Mérites civiques et des Immatriculés furent admis dans les écoles pour Européens mais sous certaines conditions, afin de pouvoir les sélectionner. Le nombre des enfants noirs admis dans ces écoles passa de 21 en 1953 à 75 en 1954, 199 en 1955, 466 en 1956, 909 en 1957, année où les conditions d’accès furent facilitées [43].
Tableau 18 — Mérites civiques et immatriculés (1954 et 1958)
| Province | Mérites civiques | Immatriculés | ||||
| 1954 | 1958 | 1954 | 1958 | |||
| Hommes | F. et enf. | Hommes | F. et enf. | |||
| Léopoldville | 176 | 250 | 44 | 145 | 100 | 350 |
| P. Orientale | 167 | 367 | 10 | 19 | 24 | 54 |
| Kivu | 114 | 258 | 4 | 32 | 11 | 62 |
| Katanga | 128 | 244 | 8 | 15 | 58 | 186 |
| Kasaï | 108 | 202 | 4 | 19 | 19 | 106 |
| Equateur | 76 | 236 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Total | 769 | 1557 | 70 | 230 | 217 | 768 |
(Source : Mutamba ., 1977:128)
Toujours au point de vue social, l’après-guerre, qui s’est caractérisé par le développement des villes, fit ressentir davantage la crise de l’habitat. La question de la construction de logements en matériaux durables se posait depuis l’entre-deux-guerres, sans que l’on tentât d’y remédier. On passa enfin à l’action : dans un premier temps, on relança le Fonds d’Avance, organisme de crédits immobiliers qui fut créé en 1929. Puis, pour rationaliser le développement des agglomérations africaines, on créa des offices de cités indigènes en 1949 et 1950 qui amorcèrent des expériences d’urbanisation à Léopoldville, à Stanleyville et Costermansville (Bukavu). La formule n’eut pas les résultats escomptés ; c’est ainsi que les différents offices furent regroupés en mars 1952 sous une seule et même structure, l’Office des Cités Africaines (O.C.A.). Cet organisme fut à pied d’œuvre pour promouvoir des constructions urbaines. A Léopoldville, il construisit de nouveaux quartiers : Renkin (aujourd’hui Kasa-Vubu), Yolo, Bandalungwa ; à Elisabethville le quartier de la Rwashi vit le jour. Les premiers foyers sociaux furent créés en 1949, animés par des religieuses et des assistantes sociales européennes pour assurer la promotion des épouses des évolués.
Le pouvoir colonial se préoccupa également des loisirs ; en cela, il soutint les initiatives missionnaires déjà prises dans ce domaine. A Léopoldville, les œuvres sportives durent leur développement au concours particulier du Père Raphaël de la Kethulle, qui fut appelé tout simplement « Tata Raphaël ». Dès 1919, il créa un « cercle sportif congolais » avec quatre équipes de football, aux noms évocateurs : Etoile, Union, Standard, Excelsior. En 1931, la Fédération sportive congolaise comptait déjà seize équipes. En 1939, après avoir obtenu le patronage royal, cette institution devint l’« Association Royale Sportive Congolaise » (ARSC) et disposa du stade Reine Astrid aménagé dès 1937 (Bontinck F., 1983 : 404-405).
La colonisation belge demeurait égale à elle-même : son succès ne fit que se confirmer dans le domaine économique et social. Son point vulnérable demeurait toutefois celui de la promotion des autochtones. En dépit des nombreuses réalisations effectuées, les élites congolaises, les Immatriculés comme les Mérites civiques continuèrent à être frustrées : les gens comprirent que le statut spécial dans lequel on les enfermait était ni plus ni moins une nouvelle manière de tisser une différence entre eux et les Blancs. Au lieu d’être une fin en soi, leur statut spécial aurait dû être un processus dynamique, et non, selon l’expression employée par l’un d’eux… « une salle d’attente où l’on reste avec l’espoir d’entrer d’un moment à l’autre dans le salon, un purgatoire où l’on souffre encore, avec l’espoir d’entrer un jour au ciel, un stade de transition qui donnera un jour aux meilleurs de ses bénéficiaires l’occasion d’accéder à la catégorie supérieure l’assimilant complètement à l’Européen » (cité par Mukala Kadima-Nzuji, 1984 : 51). Toute la méprise était là.
De plus, la colonisation n’était pas pressée d’accorder le statut de privilégiés à un nombre de personnes important (tableau 18). L’immatriculation, le grade le plus prestigieux, était pratiquement inaccessible. Ainsi, on peut estimer que cette politique de promotion sociale échoua, n’ayant pu aboutir qu’à un résultat insignifiant qui fit des mécontents à tous les niveaux : ceux qui étaient immatriculés ne savaient que faire de leur « badge » d’immatriculation et étaient déçus ; ceux qui se l’étaient vu refuser étaient aigris (Young C., 1965 : 55). Les petits avantages sociaux qui leur étaient consentis n’étaient qu’une façon de les tourner en dérision et de les isoler du reste de la population.
3.4 La communauté belgo-congolaise ?
Décidément, la Belgique coloniale était toujours en retard d’une guerre… C’est au moment où les évolués, las d’espérer en vain leur assimilation, commençaient à rêver d’un autre avenir que les Belges se décidèrent à instaurer une communauté belgo-congolaise.
L’idée n’était pas neuve ; elle s’inspirait du modèle français, dont les colonies semblaient ne pas poser de problèmes contrairement au Congo belge, où les rapports belgo-congolais devenaient de plus en plus tendus.
L’idée datait des années 50. Le concept de « communauté belgo-congolaise » apparut pour la première fois dans le langage du gouverneur général Jungers lors de son dernier discours au conseil de gouvernement. Plus explicitement, il plaida pour « l’assimilation totale des Congolais immatriculés ». L’idée fut reprise dès 1952, par son successeur le gouverneur général Pétillon qui la défendit avec acharnement à chaque discours annuel (Lukiana M., 1982 : 276). Mais en vain : à Bruxelles, il ne trouva aucun appui, que ce soit auprès de l’administration, du parlement ou des partis politiques. Ce projet fut combattu par les coloniaux qui n’y voyaient qu’une menace pour leurs privilèges. Ceci n’empêcha pas Baudouin Ier, lors de son premier voyage au Congo, en 1955, de mettre l’accent sur l’avènement de cette communauté… où la Belgique et le Congo formaient une nation (Young C., 1967 : 42).
Mais les élites congolaises qui, vers 1942, auraient pu applaudir à cette idée, comprirent bien vite que cette générosité soudaine n’était qu’une simple manoeuvre pour retarder l’accélération de leur émancipation. Pétillon le disait d’ailleurs à qui voulait l’entendre. Il fallait que l’évolution… « se fasse avec nous et non contre nous » (Monheim F., 1985 : 83). Pendant qu’il prônait cette communautarisation, le pouvoir colonial demeurait, sur le terrain, intransigeant, incapable d’adopter les concessions juridiques qui auraient permis aux Congolais de croire à la sincérité d’une telle perspective politique. Ils réalisèrent même que la communautarisation n’était possible qu’entre nations souveraines, capables d’engager leurs libertés respectives dans un choix quelconque. Or le Congo n’était encore qu’une colonie. Pour créer cette communauté, il fallait donc admettre au préalable l’indépendance du Congo. On est porté à croire que cette politique fut mise à profit par la cause autochtone qui y puisa de nouveaux arguments pour étoffer son plaidoyer. La communauté belgo- congolaise n’était donc qu’un simple idéal, irréalisable quant à son fond et à sa forme. Elle n’eut pour seule utilité que de constituer un argument de plus dans la bataille pour l’émancipation politique.
4 LES CONGOLAIS À LA FIN DE LA PÉRIODE COLONIALE
On l’a souligné, la deuxième guerre mondiale favorisa l’impulsion, sinon l’accélération du processus d’urbanisation. Les raisons en étaient multiples : la fuite des corvées, des travaux obligatoires, entamés dans l’entre-deux-guerres ; le processus d’industrialisation et donc, de modernisation, accentué à la fin de la guerre qui eut pour conséquence l’abandon des campagnes au bénéfice des villes. Bref, certaines agglomérations acquirent des tailles gigantesques (tableau 11) ; plusieurs nouvelles villes se créèrent à partir des centres administratifs qui dépendaient des capitales des districts et des territoires [44]. Quelle qu’ait été sa taille, la ville coloniale congolaise comportait deux parties : la cité européenne qualifiée de « ville » qui généralement faisait office de centre administratif doublé du quartier résidentiel des Européens et d’autre part la cité dite « indigène », centre extracoutumier, camp des travailleurs appelé globalement comme par ironie le « Belge ». Le Congolais n’avait accès à la ville qu’à des conditions et heures déterminées. Son domaine était le « Belge » où il passait son temps libre, où il pouvait faire montre de son sens de créativité, du moins dans les limites admises.
Il faut souligner que le quartier de résidences indigènes était un espace extratraditionnel. On y vit émerger une nouvelle forme de vie congolaise, la vie urbaine ; au fil des années, elle continua à s’affirmer et à s’uniformiser d’une ville à l’autre. Il faut mettre en exergue deux aspects particuliers de cette innovation « indigène » : la nouvelle morphologie ethnique et l’apparition du langage artistique moderne.
4.1 Genèse du tribalisme
L’aspect ethnique, on l’a vu, s’est imposé depuis des siècles en tant que mode pertinent d’organisation sociale. Dans les centres urbains, bien davantage que dans les campagnes, il se trouva en contact avec d’autres formes d’organisation qui l’enrichirent tout en engageant avec lui une certaine forme de compétition. L’ordre ethnique fut ainsi appelé à se transformer.
En ville, le regroupement par familles utilisant une même langue et recourant à des usages semblables fut accentué par l’isolement et le besoin d’être sécurisé. Ceci explique l’apparition quasi spontanée d’associations dites tribales, dès que l’on connut une certaine stabilisation vers les années 20, après la mutation marquée par la guerre. La plus ancienne association « tribale » connue date de 1916 à Léopoldville ; il s’agit de la Fédération kasaïenne. La Fédération kwangolaise date de 1925. Quant au regroupement des Kongo, l’Association des Bakongo (ABAKO), il démarra en 1940 sous sa première version. Au Katanga, c’est en 1926 que les premiers regroupements ethniques furent enregistrés. Mais avant cela, on signale quelques formations dès 1920, notamment la Société des Amis de Kasongo Niembo, la Société des Basongye de Tshafe et la Compagnie des Batetela (Lemarchand F., 1964 : 176 ; Young C„ 1967 ; 19-51 ; Lukiana M., 1982 : 279).
L’exercice de la solidarité au sein du groupe était à la fois son mode de fonctionnement et sa raison d’être. Le phénomène était encore sensible en 1950. « Dans toutes les circonstances fastes, les membres se réunissent et se cotisent pour gâter les hospitalisés, les femmes accouchées. Ils se mettent en peine pour accueillir, héberger et diriger les nouveaux arrivés, pour apaiser les conflits entre époux, pour intervenir en cas de maladie prolongée et de chômage involontaire, lors des naissances, mariages ou décès, pour participer aux frais de voyage de ceux qui vont en congé dans les milieux natals, pour soutenir et rapatrier les veuves et les orphelins, etc. » (Grevisse, 1950 : 7).
Après la Deuxième Guerre mondiale, on changea considérablement l’esprit de ces groupements. Alors qu’ils étaient en général d’origine populaire, ils commencèrent à être pris en charge par les nouvelles élites qui s’y affilièrent. Le résultat obtenu fut quelque peu différent d’un bout à l’autre du pays. A Kinshasa où l’impact des structures traditionnelles était déjà fort ébranlé, on n’hésita pas à remplacer les anciens chefs d’origine populaire par des nouveaux venus recrutés parmi les évolués. C’est dans cet esprit que Kasa-Vubu prit les rênes de l’ABAKO en 1954. Au Katanga, pays des empires luba et lunda, où l’autorité coutumière avait encore une mainmise très forte, il s’avéra opportun de ne pas la basculer trop tôt mais plutôt de composer avec elle. Aussi, le leadership fut-il partagé entre chefs traditionnels et nouvelles élites. Cette différence d’une région à l’autre se maintint non seulement pendant la décolonisation mais même jusqu’à l’âge contemporain [45]. Pendant la période de l’après-guerre, le phénomène d’association a donc agi dans le sens du renforcement du facteur ethnique, à cette différence près que le phénomène ethnique revendiqué en ville ne pouvait pas être vécu comme tel au village. Non seulement le contexte était différent mais certaines données faisaient défaut en ville pour reproduire exactement la vie traditionnelle. Par exemple, en ville, toute la parenté n’était pas nécessairement présente. Pour reconstituer le cadre nécessaire à une vie familiale équilibrée, il devint nécessaire de remplacer une partie de la parenté par d’autres personnes puisées dans le cercle de l’association, même si les relations interfamiliales avec les frères ethniques n’étaient pas si intimes qu’elles l’auraient été dans le contexte originel.
Les relations interethniques connaissaient le même type de révision et d’adaptation. Ainsi, des ethnies voisines indépendantes les unes des autres dans leur terrain d’origine se découvraient en ville une fraternité particulière, par opposition à d’autres groupes plus lointains. D’ailleurs, le spectacle d’une si grande prolifération ethnique était en lui-même une nouveauté inhérente au milieu urbain. Dans les campagnes, le « monde connu » était plus limité, et la gestion des relations interethniques existait à l’échelle humaine.
Pour organiser cet enchevêtrement de réseaux ethniques qui s’était révélé par la vie coloniale, une simplification était nécessaire. Elle s’imposa en termes de regroupement des identités ethniques en présence. Ainsi, à Léopoldville, l’horizon ethnique connu fut réduit arbitrairement à quelques identités : kongo, ngala, luba, yaka, swahili. L’identité kongo regroupait toutes les références ethniques situées en aval de Léopoldville, « ngala » celles de l’amont ; « luba » qualifiait indifféremment tous ceux qui provenaient du Kasaï ; « yaka » reprenait toutes les références ethniques du Kwilu-Kwango, tampon entre les Luba et les Kongo. Les «swahili» concernaient les références périphériques du Congo oriental qu’elles soient du Kivu, du Maniema ou du Shaba.
Notons que ce regroupement était variable d’une ville à l’autre. En fait, les ethnies situées dans une certaine proximité géographique étaient correctement répertoriées ; ce n’était pas toujours le cas pour celles qui étaient plus éloignées. Ainsi, dans la région urbaine de Léopoldville, les ethnies autochtones (Humu, Teke) furent reconnues comme telles, distinctes des Kongo, des Ngala et des Yaka. Dans le milieu urbain d’Elisabethville, les autochtones furent également bien différenciés : Bemba, Sanga, Yeke, etc. Mais les groupements opérés en fonction de l’éloignement géographique y furent effectués en sens inverse de ce qui était de mise à Léopoldville ; les Luba étaient distincts des Songye ; les Luba Shankadi (les seuls à être qualifiés de Luba) furent démarqués des Luba Lubilanji (les Bakasaï). En revanche, le concept des « Kongo » désigna la périphérie occidentale dans laquelle on classa tout le monde, y compris les Ngala.
L’ethnographie coloniale se mêla à ce courant de révision ethnique en assurant à certains groupements des assises solides par la manipulation des données historiques et linguistiques [46]. Cette tendance était essentiellement le fait des coloniaux flamands – missionnaires ou agents administratifs – qui trouvaient, dans la défense de ces micro-nationalismes, une manière de faire prévaloir outre-mer ce qu’ils s’efforçaient de faire admettre avec peine dans la métropole. Dans leur chef, il s’agissait vraisemblablement d’une seule et même lutte car, non contents de « créer » des ethnies, ils s’efforcèrent d’éveiller la conscience « nationaliste » des intéressés en soutenant les associations du même nom. Les exemples sont nombreux et les cas les plus flagrants de ce type d’intervention se situent dans le Congo occidental et méridional avec les cas Ngala, Mongo, Kongo et Luba.
La création du groupe dit « bangala » a déjà été évoquée ; on a dit qu’elle résultait d’une succession de méprises. Deux éléments y contribuèrent plus particulièrement : d’abord le recrutement de travailleurs-soldats qui furent tous qualifiés de « bangala » pour indiquer qu’ils venaient du haut-fleuve. Par la suite, ce terme devint synonyme d’« agent de la Force publique » comme ce fut jadis le cas pour « tetela ». Un témoignage du début du siècle l’atteste : « Prenez un contingent de travailleurs engagés dans les établissements du haut- et du bas-fleuve, choisissez-les parmi les groupes de ces régions ; ils deviennent tous des Bangala. Ils vous diront : ‘[…] nous Bangala’. Qu’ils appartiennent même à des groupes hostiles, à l’étranger, ils s’uniront » (Van Overbergh C., 1907 : 55). L’autre facteur de consolidation du groupe ngala relève de l’anthropologie, avec la parution d’un volume consacré à cette tribu dans le cadre de l’importante étude ethnographique du Congo dirigée par E. Jonghe (Van Overbergh C., 1907). Ainsi la conscience de l’existence du groupe ngala se renforça sans qu’on insiste sur son caractère macroethnique. C’est cet aspect des choses qui fut retenu à Léopoldville où « bangala » signifiait invariablement « gens d’en haut ». Les intéressés prirent conscience de cette identité et organisèrent une fédération ethnique, liboke ya Bangala, une des plus puissantes associations tribales de Léopoldville au cours de l’ère de la décolonisation [47].
La naissance du groupe Mongo à partir de 1938 provient d’une dissidence au sein de la grande « famille » ngala. L’initiative de la création de cette tribu est essentiellement le fait de quatre coloniaux flamands ; trois missionnaires, E. Bolaert, G. Hulstaert, A. de Rop et un agent administratif G. Van der Kerken. Bolaert fut le premier à défendre l’hypothèse de l’unité mongo. Il fut appuyé par l’ancien gouverneur de l’Equateur, Van der Kerken (1944), qui plaida pour le rassemblement des Mongo en une seule province, tout comme son prédécesseur qui y voyait une préfiguration d’un État mongo (1961 : 382-391). Les études sur la culture mongo ne firent que s’accumuler, et les plus caractéristiques, car les plus abondantes et les plus diversifiées sont celles de G. Hulstaert. L’idée du regroupement mongo se transmit aux nouvelles élites de cette région – notamment Ileo, Bolamba, Bolya et Njoku – qui s’en réclamèrent. Le point fort de cette prise de conscience fut la création d’un parti politique mongo mais surtout la convocation d’un congrès des Ana-mongo à Boende en 1961, où l’on revendiqua, comme on l’a déjà signalé, l’instauration d’entité provinciale distincte où tous les Mongo auraient été regroupés.
Tableau 19 — Grandes tribus congolaises dans la conscience urbaine vers 1958
| LES TRIBUS | LES COMPOSANTES ETHNIQUES | LA PROVINCE |
| Kongo | Ntandu, Ndibu, Besi Ngombe, Yornbe, Solongo, etc. | Léopoldville |
| Yaka | Yaka, Pindi, Pelende, Tsaamba, Hungaan, etc. | Léopoldville |
| Mongo | Sengele, Ekonda, Bolia, Mpama, Kundu, Tetela, Ndengese, etc. | Equateur |
| Ngala | Peuples de l’entre-Congo-Ubangi, Ngombe, Mbudza, Ngbandi, Ngbaka, (Mongo), etc. | Equateur |
| Lokele | Peuples de laTshopo : Lokele, Topoke, etc. | Stanleyville |
| Zandé | Peuples de l’Uélé | Stanleyville |
| Shi | Peuples du Nord-Kivu : Nande, Shi, Haavu, Hunde, etc. | Kivu (nord et sud Kivu) |
| Kusu | Peuples du Maniema | Kivu (Maniema) |
| Lubakat | Peuples du Nord-Katanga, Luba, Hemba, Songye, etc. | Katanga |
| Lunda | Ruund, Cokwe, Ndembo, Salampasu, etc. | Katanga |
| Luba (Bakasai) | Luba Lubilanji, Kete, Kanioka, Luluwa | Kasaï |
Le cas Kongo fut également particulier. Il s’imposait par deux puissants facteurs d’unité, à savoir la communauté d’histoire par la référence au même Kongo-dia- Ntotila, mais aussi la communauté de langages. En effet, les usagers des différents parlers kongo se comprenaient, indépendamment de l’apparition de la lingua franca kikongo ya leta ou monokutuba qui favorisa l’extension de cette communauté linguistique au-delà de l’estuaire du Congo. Un troisième facteur d’unité s’ajouta aux autres, le kimbanguisme, qui fut ressenti comme l’expression religieuse du groupe. L’opposition coloniale à l’égard du kimbanguisme ne fit qu’accentuer la cohésion ethnique autour de cette religion issue du terroir. Dans le contexte général de regroupement par affinités ethniques en milieu urbain, les Kongo ne manquèrent pas de s’organiser.
Avant l’ABAKO, quelques formations ont existé notamment l’AMUBAKO, « Association musicale des Bakongo » fondée en 1940 par J. Mavuela. La véritable organisation kongo – l’ABAKO – date de 1950. Quand il évoque ce qui l’a poussé à réaliser une telle entreprise, son fondateur, Edmond Nzeza Nlandu, ne cache pas qu’il a été influencé par les imposantes « études bakongo » du jésuite Van Wing. La conscience tribale s’exprima d’abord dans le contexte culturel. Il y avait une langue et une histoire glorieuse à réhabiliter, une unité culturelle à reconstruire par-delà des frontières coloniales. Ainsi l’élection du mukongo Fulbert Youlou comme maire de Brazzaville en décembre 1956 fut considérée comme une victoire tribale.
Il faut savoir que la conscience tribale avait ses objectifs propres. Elle se manifesta surtout à Léopoldville, où s’exerça à partir des années 50 la rivalité entre les Kongo qui se considéraient comme autochtones et les « gens d’en haut » (les Bangala), dont la langue (lingala), envahissante, était jugée dangereuse pour la culture kongo. Cette rivalité était d’autant plus vive que l’administration donnait l’impression de soutenir les Ngala. En effet, les deux chefs de cité de Léopoldville, élus depuis la fin de la guerre, avaient été choisis parmi les Bangala. La suite des événements confirma que cette impression était fondée. Dans la mesure où les « gens d’en bas » (les Kongo), à partir de l’élection de Kasa-Vubu en 1954, adoptèrent plus nettement le ton de l’anticolonialisme, l’administration apporta son appui aux « gens d’en haut », plus modérés. Aussi en février 1957, une polémique surgit entre l’agence DIA et l’ABAKO, cette dernière étant qualifiée de « révolutionnaire fanatique » pour ses prises de position (Verhaegen B., 1962 : 10-12 : Young C., 1967 : 118 ; Matumele M.M.B., 1980 ; 85-92).
L’itinéraire des Luba, quant à lui, devait avoir une importance historique dans le devenir social du Congo. Si les Kongo tirèrent leur dynamisme de leur histoire, les Luba le durent avant tout à leur situation géographique. Habitant le centre du pays, ils étaient, avec les Teteia, très mobiles : ils essaimaient aussi bien dans le Congo oriental qu’occidental. Ceci justifie leur réputation d’être présents partout. Déjà en 1910, le Nyimi kuba se plaignait d’avoir trop de Luba dans son territoire (Nicolai J. et Jacques J., 1954 : 81). Leur langue, qui tire ses éléments aussi bien du patrimoine linguistique occidental qu’oriental, a un caractère excentrique et donc hermétique : ceci constitue un élément de cohésion, donc d’intégration. Certes, des divergences internes parfois importantes, existaient. Mais en milieu urbain, à force d’être considérés comme un groupe homogène, ils avaient peu à peu oublié ces subdivisions internes multiples pour ne conserver que les éléments de similitude favorisant la concertation du groupe et donc la constitution de la tribu [48]. Voici pour la genèse du rassemblement luba.
D’autres éléments, généralement d’origine coloniale, vinrent renforcer la cohésion de la tribu naissante. Ainsi, le climat de guerre qui caractérisa la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle fit des Luba des déracinés, et en même temps les premiers auxiliaires des agents coloniaux. Déracinés, ils le furent puisque les « guerres » se déroulèrent essentiellement sur leur territoire ; ils furent dispersés et désorganisés tour à tour par les raids esclavagistes, les campagnes arabes, les rébellions de la Force publique, etc. Hilton-Simpson, membre de la fameuse expédition Torday- Joyce, visita Lusambo en 1908 et nota à l’époque qu’il existait « une quantité d’indigènes mêlés, n’appartenant à aucun village, et que les Blancs du Kasaï appellaient Luba, mais qui en réalité n’appartenaient pas plus à cette tribu qu’à une autre. Tout ce groupe devint les Luba » (Hilton-Simpson MMW, 1911 : 72). Avec la complicité de l’ethnographie coloniale qui les traita volontiers de « nègres supérieurs » sans doute pour leur sens de la débrouillardise, ils furent les privilégiés du Blanc, qu’il fût catéchiste, soldat, messager, acheteur de noix de palme ou de caoutchouc.
La construction du chemin de fer du BCK en 1920 favorisa encore les Luba parce qu’on les recruta très facilement pour les travaux du chemin de fer ; à l’issue des travaux, ils s’installèrent le long de la voie ferrée, disposant ainsi d’un moyen idéal de communication. De là, ils envahirent tous les centres urbains situés le long de la voie ferrée, d’Elisabethville à Port-Francqui (Ilebo actuel) avec une préférence pour les villes minières toujours demandeuses de main-d’œuvre. Leur expansion fut impressionnante : en 1950, il y avait dans les dix villes principales de la colonie plus de 100 000 Luba (Young C., 1967 : 127-128). Une construction tribale gigantesque fut réalisée ainsi, caractérisée par la dispersion géographique de ses membres dans toutes les régions du pays.
Les Luba furent par la suite victimes de leur propre dynamisme, à l’est comme à l’ouest. A l’est, spécialement au Katanga, leur progression démographique et surtout économique fut mal accueillie par les autochtones, en particulier les populations du pays minier, le Sud-Katanga. Même les frères « Lubakat » n’apprécièrent pas toujours la « position envahissante » de ces Luba dits kasaïens, que l’on affublait du sobriquet de « Tshimbulu », du nom de la principale gare à partir de laquelle ils envahissaient le Katanga. Peu à peu, ces immigrants furent combattus, d’autant plus que les Blancs les préféraient aux Katangais du nord comme du sud. Crawford Young rapporte à ce propos une anecdote révélatrice : en 1958, un gouverneur du Katanga qui avait été longtemps en poste au Kasaï crut bon de prononcer son discours d’adieu à Elisabethville en ciluba. Son initiative fut considérée comme une véritable provocation (Young C., 1967 : 133). A l’ouest, la situation était moins préoccupante, vu le caractère cosmopolite de Léopoldville. Pourtant le Luba était de plus en plus considéré comme un marginal, voire comme un excentrique. S’il était rejeté, c’est parce qu’il était à la fois admiré et envié, parce qu’il avait admirablement réussi son intégration dans la modernité. Cette double marginalisation était un élément de plus dans la consolidation de la conscience tribale luba, même si cela n’excluait pas certaines fissures internes.
Le règne tribal supplanta ainsi le règne ethnique, vers les années 45-50. La tribu n’était rien d’autre qu’une ethnie agrandie ou plutôt taillée sur mesure pour répondre aux impératifs nouveaux d’essence extratraditionnelle. En effet, la conscience tribale fut essentiellement une création urbaine, qui connut par la suite une redistribution dans le monde rural où elle s’imposa davantage. Il va de soi que la colonisation y était pour quelque chose. Non seulement l’ethnographie coloniale fournit les matériaux nécessaires à cette élaboration mais le comportement colonial lui-même tint à s’exprimer par le langage tribal, renforçant du même coup ce mode de regroupement. En effet, sur la carte d’identité ou sur tout formulaire figurait la mention « tribu ». Et les gens étaient encouragés à s’identifier à des grands ensembles tribaux plutôt qu’à des sous-groupes. L’on était invité, par exemple, à privilégier l’identité générale de « luba » plutôt que celle plus restreinte de « Bena Kalonji » ou de « Bakwa Tembwe », bien que ces dernières appellations fussent plus évocatrices, pour les intéressés, que le terme générique imposé.
D’autres détails plus marquants peuvent être évoqués pour mettre en évidence l’intervention des pouvoirs publics dans ce processus : ceux-ci manifestèrent plus ou moins d’intérêt aux diverses régions du pays, selon leurs productions respectives. Par exemple la région produisant de l’uranium et de l’étain avait pour eux plus d’importance que celle qui fournissait uniquement de l’huile de palme et de l’urena. Il s’ensuivit une valorisation inégale des régions, donc une inégalité dans l’accès à la modernité. Cet aspect des choses suscita et alimenta des rivalités entre groupes tribaux. Le problème était sérieux car l’Afrique traditionnelle prônait jusque-là une politique de nivellement entre citoyens de même village, entre villages de la même seigneurie et entre seigneuries d’un même royaume. La délicate gestion des susceptibilités entre individus et entre groupes était la règle d’or. A ce propos, C. Young a noté ceci : une fois qu’un groupe avait pris conscience de l’avance prise par un autre, l’impression de se trouver défavorisé venait renforcer son sens ethnique. Ainsi, le moindre événement de la vie quotidienne pouvait apporter une preuve supplémentaire de la discrimination dont il était victime par rapport au groupe plus avancé (1967 : 129). La pratique tribale commençait donc à se développer.
Le système colonial joua un jeu dangereux pour le devenir social du Congo, lorsque, conscient d’être face à un problème délicat, il prit parti pour l’une ou l’autre des tribus en présence. Les Congolais n’étaient pas insensibles à ces procédures. Par exemple, les « Nilotiques » (entendez les Tutsi du Rwanda-Urundi) étaient plus « intelligents » et plus « raffinés », et donc plus proches de la civilisation que les Bantu (les Hutu et par extension les Congolais) [49]. Au Congo, chaque entité administrative connaissait la hiérarchie des ensembles ethniques en présence. Ainsi, à Elisabethville, les immigrants bakasaï étaient plus « intelligents » que les autochtones katangais ; à Léopoldville, les Ngala l’étaient plus que les Kongo, « intoxiqués » par l’ABAKO.
Le cas Luluwa-Luba au Kasaï est révélateur des querelles que pouvaient susciter les ingérences coloniales dans les rapports interethniques. On connaît les origines du clivage luba-luluwa [50]. Lors de la colonisation, il se marqua davantage par leurs positions radicalement différentes vis-à-vis de l’ordre colonial. Ainsi, le poste de Luluabourg avait beau être situé dans le pays luluwa, il fut habité essentiellement par les Luba ; les Luluwa se cantonnèrent dans une attitude de méfiance à l’égard de l’ordre nouveau, préférant s’adonner à la vie traditionnelle du village plutôt que de s’aventurer dans la voie de l’acculturation. Les déracinés Luba, en revanche, s’engagèrent à fond dans l’aventure moderniste : ils occupèrent les places que les autres, par leur indifférence, laissaient dans les entreprises, les écoles, les missions, voire les campagnes, où ces immigrés s’installèrent comme cultivateurs, aux abords des missions et des centres urbains. Par la suite, les Luluwa regrettèrent d’être réduits à une minorité dans leur propre territoire. Vers les années 50, l’importance numérique des Luba à Luluabourg était de l’ordre de 56 %, contre 25 % de Luluwa. Ces derniers étaient persuadés qu’ils étaient victimes des Luba qui les empêchaient, pensaient-ils, d’accéder aux postes dominants dans leur propre ville. Tout cela appelait une réaction qui ne tarda pas. Les Luluwa s’organisèrent dès 1952 en une association – Luluwa Frères – pour tenter de rattraper le retard et de supplanter ces « privilégiés » de la colonisation.
Pourtant, le même pouvoir colonial changea de camp, par la suite pour soutenir les Luluwa contre les Luba. En effet, en 1959, le nationalisme radical pénétra au Kasaï ; il ne le put que par l’entremise de la population acculturée et donc, par les cercles luba où il s’exprimait par la voix des leaders luba comme Kalonji et Ngalula. Par réaction, l’administration coloniale se détourna des Luba et ne dissimula pas ses sympathies – brusques et tardives – pour les griefs des Luluwa, « opprimés » par les « orgueilleux » Luba. Ce réveil des Luluwa, soutenu par le pouvoir colonial, amena la tension « tribale » à son paroxysme. La guerre était inévitable.
L’identification ethnique, partout au Congo, acquit une vigueur nouvelle. En réalité, elle avait réussi à s’intégrer à la modernité coloniale ; elle n’était plus, comme par le passé, un mode d’organisation sociale, mais plutôt un simple mode d’accès à la conquête du pouvoir et à l’acquisition d’avantages nouveaux. La trame politique du Congo contemporain devrait compter avec ce critère, le seul du reste à avoir des assises aussi solides.
4.2 Naissance des arts modernes
Vers les années 50, certaines données importées étaient suffisamment assimilées pour pouvoir servir de mode d’expression aux populations congolaises. La plume et la langue françaises servirent, non seulement à des nécessités primaires de communication mais aussi à produire des oeuvres littéraires. Les instruments de musique d’origine externe – la guitare et la trompette – introduits bien avant, s’imposèrent comme supports de la chanson populaire du pays ; de même, mais dans une moindre mesure, pinceau et burin permirent le développement du langage plastique existant depuis des siècles. Evoquons donc ici la naissance d’une littérature, d’une musique et d’arts plastiques qui, tout en se réclamant d’origine congolaise, furent modernes.
4.2.1 La littérature
La première écriture congolaise a fait usage des langues du pays tout au long des diverses périodes missionnaires qui se sont succédé depuis le début du siècle. Cette écriture première est en fait une retranscription voire une traduction des récits et témoignages de la tradition orale (contes, fables, proverbes, épopées). Cette tendance se développa lorsque la langue française fut bien dominée par les autochtones. La première expérience du genre fut la parution en 1931 du recueil de fables luba transcrites en français, L’éléphant qui marche sur des œufs (Bruxelles, Ed. l’Eglantine). Elle valut à son auteur – un certain Badibanga – une médaille de vermeil de l’Académie française en 1932 [51]. Or, l’identité de cet écrivain fait aujourd’hui encore l’objet de controverses. Pour certains – tel est le cas de Kadima Nzuji – il s’agirait d’un écrivain colonial qui se serait attelé à cet exercice pour s’amuser et amuser le public occidental. Badibanga ne serait qu’un surnom africain qu’il se serait attribué. D’autres, comme Bontinck, sont d’un avis contraire ; ils estiment que Badibanga est un authentique Congolais qui publia d’ailleurs par la suite le conte « L’éléphant qui marche sur des oeufs », qu’il avait omis d’insérer dans le recueil du même nom ; il serait le seul auteur du recueil et non pas tout un groupe [52]. Quoi qu’il en soit, cette parution fut la première du genre [53] et précéda d’une décennie la première grande production littéraire congolaise, qui date des années 40-50.
Trois événements ont favorisé cette production. D’abord le démarrage de la « Voix du Congolais » qui accueillait dans ses pages tous les types de discours, y compris les discours littéraires, qui émanaient des lettrés autochtones. Ensuite l’organisation de concours littéraires, ce qui donna l’occasion à quelques talents de se faire connaître. Enfin, la création d’une bibliothèque de l’Etoile qui permit la parution de certains écrits congolais à partir de 1943.
A côté de ces espaces de production, il faut noter l’existence de certaines initiatives isolées, dont celle de Francisco José Mopila, auteur d’un essai autobiographique, Memorias de un Congoles, publié à Madrid en 1949 (Instituto de Estudias Africanas, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) [54]. Mopila fut au service d’un médecin espagnol qui l’amena en Europe en 1936 où il fut inscrit au lycée (1936-39). Après l’avènement de Franco, Mopila et son protecteur s’installèrent à Madrid où il devint sculpteur, après des cours aux Arts et Métiers ; puis il embrassa la carrière cinématographique. C’est en 1949 que paraissent ses Mémoires, où il parle de son enfance à Bondo, en Uélé, puis des pérégrinations qu’il réalisa au service de ses différents patrons. L’autobiographie se termine au moment où il s’embarque pour l’Europe.
Dans les pages de la « Voix du Congolais », la littérature a emprunté principalement trois genres : l’écriture des oeuvres issues de l’héritage oral, puis l’écriture dramatique dont le chef de file fut Albert Mongita, et enfin la production poétique, dominée par Antoine Roger Bolamba.
Les « classiques » de l’oralité ont inspiré pratiquement tout le monde, y compris les poètes et les dramaturges dont les oeuvres les plus marquantes furent essentiellement des interprétations des mythes et légendes anciens. Dans tous les périodiques, ce genre l’emporta sur la littérature de fiction ; cette littérature « ethnographique » fut exploitée par les anthropologues pour enrichir leurs études. Il est intéressant de noter que les plus grands « écrivains » de cette tendance se recrutèrent au Katanga et au Kasaï, sans doute en raison de la richesse de l’héritage culturel des empires Luba- Lunda. On citera ici pêle-mêle des personnages tels que Alphonse Kalume, Bona- venture Makonga qui s’adonnèrent à la retranscription des traditions historiques des Bena Samba-a-kya Buta [55], Antoine Munongo qui publia de nombreuses traductions françaises des chants et proverbes yeke [56]. Plusieurs monographies ethnographiques coloniales n’étaient en fait que les traductions d’articles publiés dans de petites revues locales par les Congolais eux-mêmes [57].
Quant aux pièces de théâtre publiées dans la « Voix du Congolais », elles furent pratiquement toutes l’œuvre d’Albert Mongita. Il y publia trois œuvres : Cabaret ya Botembe (1957), La Quinzaine (1957) et Au fond je dois tout à ce garçon (1958). L’itinéraire de ce dramaturge, né à l’Equateur de parents originaires de la Province Orientale, fut brillant. D’abord enseignant, il s’orienta ensuite vers la peinture puis trouva sa voie dans l’animation des émissions en lingala à Radio Congo Belge. Sa carrière d’artiste fut jalonnée par la production de plusieurs sketches radiophoniques. Fondateur en 1955 de la « Ligue folklorique kongolaise » (LIFIKO) où il fut à la fois auteur, acteur, danseur, metteur en scène et régisseur, le talentueux Mongita a laissé quelques pièces restées célèbres : Soko Stanley te (pièce à la gloire de Stanley), Mangengenge (inspirée de la légende de cette falaise du Pool, cette pièce prônait la démystification des croyances anciennes), et enfin Ngombe (tragi-comédie inspirée d’une légende de l’Equateur) (Mukala K.N., 1984 : 99-101).
La poésie fut dominée par Bolamba. Mais ce genre est moins significatif sur le plan social car il avait les caractéristiques d’un exercice scolaire… et ses limites. A l’époque de la « carte du mérite civique » et du statut spécial, la poésie était une manière de se faire valoir aux yeux du colonisateur. Aussi les vers écrits de préférence en rimes revêtiront-ils des formes « classiques ». En fait, Bolamba s’adonna très tôt à cet exercice du « bien dire », non sans succès. La « Voix du Congolais » publia ses poèmes isolés à partir de 1945. En 1947, ces différents poèmes furent regroupés en un recueil que les éditions de l’Essor du Congo à Elisabethville publièrent sous le titre de Premiers Essais. L’ouvrage reçut un accueil chaleureux auprès des milieux métropolitains et coloniaux, y compris des meilleurs connaisseurs de la littérature coloniale belge et des lettres congolaises d’expression française qui, à cette période de contestation, y trouvaient la preuve que l’enseignement dispensé aux Noirs du Congo belge était d’un niveau correct, voire même élevé puisqu’ils étaient capables des mêmes performances lyriques que les ressortissants de l’Afrique française (Mukala K.N., 1984 : 83-91). Non seulement le recueil était préfacé par Olivier de Bouveignes (qui était le pseudonyme littéraire de Léon Guebels) mais il fut présenté avec enthousiasme par Gaston-Denys Perier [58]. Chose curieuse, on ne trouve pourtant aucune critique congolaise de ces poèmes ; de plus, l’ensemble du recueil ne se fait guère l’écho du bouillonnement qui caractérisait les années de l’après-guerre parmi les évolués ; il est encore moins porteur des aspirations des intellectuels noirs qui fondent précisément en cette année 1947, la revue Présence Africaine à Paris. Notre poète était-il déjà victime de la marginalisation qui enlisait d’une manière générale l’activité intellectuelle naissante au Congo ? Mais peu importe ! Bolamba eut, peu après, l’occasion de séjourner en Belgique et donc en Europe [59]. Il put s’ouvrir à des réalités qui lui avaient échappé jusque-là. De plus en 1954, il rencontra le poète guyanais Léon Gontran Damas qui, arrivé à Brazzaville, fit la traversée du Pool pour visiter les services d’information du Congo belge. Ces nouvelles influences furent mises à profit : la publication suivante de l’auteur fut totalement différente de la première tant pour le fond, la forme, que pour la maison d’édition et l’auteur de la préface : il s’agissait d’Esanzo, chants pour mon pays, que publia Présence Africaine avec une préface de L.S. Senghor [60]. En 1956, il participa avec Lomami Tshibamba au « Premier Congrès des Ecrivains et Artistes noirs » qui se tint à Paris du 19 au 22 septembre. Bolamba était enfin prêt à produire une littérature qui soit le témoin de son temps et de son pays. Mais après le congrès de Paris, il fut retenu à Bruxelles pour travailler au cabinet du Ministre des Colonies, Auguste Buisseret. De là, il se lança dans la politique active à tel point qu’il n’eut plus le loisir d’écrire [61]. Bolamba demeure malgré tout une figure de proue des lettres congolaises, par sa production littéraire certes, mais davantage encore par le rôle de catalyseur qu’il sut jouer grâce à sa revue la « Voix du Congolais ».
Les écrivains révélés par des concours n’ont pas été nombreux. Cela tient au fait qu’il n’y eut finalement que peu de concours littéraires entre 1945 et 1960 ; en outre, tous les lauréats n’ont pas forcément continué à pratiquer l’art littéraire. Le bilan général demeure mince.
Le premier concours fut organisé à l’initiative du Mwami Charles Rudahingwa Mutara III du Rwanda en 1946, afin de faire prendre conscience aux évolués des richesses de leur peuple. Le concours n’aboutit qu’à primer quelques travaux ponctuels d’ethnographie et de littérature orale. Les lauréats congolais se répartissaient comme suit : un groupe d’élèves de l’école moyenne de Buta (chants, fables, contes et proverbes des Babua et des Zande), Antoine J. Omari (proverbes bakusu), Raphaël Kawande (l’origine des Lukonge et révolutions des Aluba). Les oeuvres primées ne furent pas publiées et n’ont pu être conservées.
Le concours de la « Voix du Congolais » en 1948, deuxième expérience du genre, a obtenu moins de succès que le premier ; toutefois, les textes purent être publiés. Il s’agit d’Elalanga, conte d’inspiration traditionnelle de Joseph Lomboto, infirmier à Coquilhatville (n° 47, 1950 : 66-71) ; d’une nouvelle, Lueur sur le bonheur de Luiz Moraes (n° 48, 1950 : 133-137); d’un conte repris de la tradition orale, Le chasseur, Bombolo et Waedji de Jean Boka (n° 49, 1950 : 209-211), et d’un récit moralisant : Le jeune garçon et les jeunes filles, d’Alphonse Songolo (n° 51, 1950: 328-331).
L’existence d’une « Union Africaine des Arts et des Lettres » (UAAL), créée sous l’impulsion d’Albert Maurice en décembre 1946, offrit à la jeune littérature naissante une occasion de rayonner hors des frontières nationales. La revue créée par cette association, Jeune Afrique, publia pendant quatorze ans, de 1946 à 1960, des oeuvres puisées dans la tradition orale mais aussi des textes issus de l’imagination créatrice des évolués. Quelques talents se révélèrent, parmi lesquels Augustin Ngongo, Alexis Kagame, Kalume, Bolamba. Dans le contexte de cette ouverture, deux prix furent institués, le prix de « la meilleure nouvelle » en 1954 et le prix de la « meilleure pièce de théâtre» en 1956. Le premier révéla l’existence de quelques autres écrivains : Maurice Kasongo qui obtint le deuxième prix (à défaut du premier qui ne fut décerné à personne) avec sa nouvelle Meurtre dans un bar de Léo ; Cyrille Nzau qui reçut le troisième avec une nouvelle d’inspiration traditionnelle Sous les griffes de Ngwakazi ; et enfin Désiré-Joseph Bosembe pour son oeuvre intitulée Drôle d’éclipse. Quant au prix de la meilleure pièce de théâtre, il fut décerné à Albert Mongita pour son Mangengenge. Mais, une fois de plus, ces différents textes primés ne donnèrent pas lieu à une publication, à l’exception de Mangengenge. Ce genre littéraire n’eut finalement qu’une audience limitée (Mukala K.N., 1984 : 179-194).
Le concours qui lança véritablement la littérature locale de langue française fut organisé à Bruxelles, à l’occasion de la Foire coloniale de 1948. C’était l’année où l’on célébrait le centenaire de la suppression de l’esclavage dans les colonies françaises et le cinquantième anniversaire de la construction du chemin de fer de Matadi-Léo ; la Belgique se préoccupa de faire participer des ressortissants de sa colonie au mouvement culturel amorcé à Paris par les intellectuels noirs et d’apporter ainsi un éclat tout particulier à la foire de 1948. Un jeune libraire bruxellois, Georges-A. Deny, fut chargé d’organiser ce concours littéraire réservé aux Noirs des territoires belges. La révélation de ce concours fut Paul Lomami-Tshibamba, qui obtint le premier prix avec son roman Ngando, racontant le rapt d’un enfant par un crocodile sur ordre d’une sorcière. Le roman fut publié en 1948 et inaugura ainsi les éditions Georges- A. Deny [62]. Enfin, une véritable littérature congolaise était née. Même « Présence Africaine », en général critique à l’égard des écrivains de la « Voix du Congolais », salua la consécration de cet écrivain « du terroir » (Mukala K.N., 1984 : 206).
Mais cet écrivain de talent n’était pas un inconditionnel de la colonisation belge, tourmenté qu’il était par la question que tous se posaient depuis les années 45 :
« Quelle sera notre place dans le monde de demain ? ». A Brazzaville où il s’exila, de 1950 à 1960, Lomami-Tshibamba créa et rédigea une revue appelée Liaison, conçue entièrement par les Africains ; cette revue devint l’équivalent de la « Voix du Congolais » en Afrique équatoriale française et le creuset d’une littérature francophone moderne au Congo/Brazza. Des écrivains tels que Sylvain Bemba, Antoine Letembet-Ambily, Tchicaya U Tam’si y firent leurs premières armes. Lomami-Tshibamba fut ainsi un véritable pionnier de la culture écrite sur les deux rives. De retour à Kinshasa, en 1961, il pensait entamer une carrière politique mais son rêve tourna court rapidement. Vingt ans après, il reprit la plume et c’est en écrivain qu’il s’éteignit [63].
Une certaine pratique littéraire vit également le jour dans le cadre des efforts de promotion de la lecture publique au Congo. L’initiative de la création d’une « bibliothèque de l’Etoile » (BDE) date des années 40 et fut le fait du Jésuite Jean Comeliau, touché par la précarité de l’initiation littéraire et de la formation générale dispensée aux jeunes Congolais. Affecté en 1946 à la mission de HCB à Leverville, il tenta d’y remédier en créant d’abord un « cercle d’études », où l’on présenta des exposés sur des sujets divers à l’intention des lettrés autochtones. On pensa éditer le texte de ces exposés. La première brochure – L’Avion – sortit de presse en avril 1943 et inaugura de la sorte l’action de la BDE qui à l’époque se lisait « bibliothèque des évolués ». Son succès fut surprenant. Tirée à mille exemplaires, la brochure fut rééditée deux mois après. Celles qui suivirent furent chaque fois tirées à cinq mille exemplaires. L’objectif poursuivi était de constituer toute une bibliothèque de ces brochures rédigées « spécialement pour Congolais » et qui tenaient compte de « leur ignorance des choses les plus élémentaires ». Dans le contexte de l’époque, l’initiative fut louable malgré son caractère restrictif, et saluée comme telle par les évolués de Léopoldville (Mukala K.N., 1984 : 278-298). De 1945 à 1947, l’activité de la BDE fut interrompue : son directeur, était rentré en Europe pour cause de maladie. L’institution profita de son retour pour faire peau neuve et prendre ses distances par rapport au concept d’« évolué », de plus en plus critiqué par l’opinion. Le sigle par lequel l’entreprise était connue était conservé mais sa signification changea quelque peu. « L’Etoile » remplaça l’« évolué », pour évoquer la perspective d’un objectif à atteindre ; le choix de ce terme était heureux parce qu’il pouvait aussi être interprété comme provenant de « l’étoile d’or » qui ornait le drapeau. Mais pour le missionnaire, elle symbolisait surtout la Vierge, à qui l’oeuvre était dédiée.
L’essor véritable se situa donc en 1948. Les services de la BDE furent répartis entre Leverville et Kikwit. A Leverville, Comeliau conserva la direction et la rédaction et transféra les services commercial et administratif à Kikwit. Le service de distribution fut confié à Paul Zech des éditions « Zech & Fils » de Braine-le-Comte en Belgique. A partir de 1950, le Père fondateur se retira en Belgique pour des raisons de santé ; il confia son œuvre à des collaborateurs, les Jésuites Albert Leysbeth et R. Roelandt ainsi qu’à l’abbé Clément Ngonga, premier prêtre autochtone du vicariat du Kwango.
La BDE continua à s’enrichir. Depuis 1948, elle était répartie en plusieurs collections, au nombre de sept en 1961. Transférée à Kinshasa, elle s’enrichit d’une revue – Documents pour l’Action – qui deviendra cinq ans après en 1966, Congo- Afrique et à partir de 1972, Zaïre-Afrique [64].
La production de la BDE fut impressionnante. En décembre 1945, elle avait déjà publié vingt titres, totalisant 85 000 exemplaires diffusés essentiellement dans le pays. En 1948, 48 brochures avaient été éditées et tirées à 5 000 exemplaires chacune. Rien que pour l’année 1950, 23 titres furent programmés, dont Il en langues congolaises et 8 rééditions. En 1958, la production générale accusait un bilan de 175 titres en français et quelque 37 titres en langues congolaises, tirés chaque fois à 5 000 exemplaires.
Mais dans tout ceci, la participation spécifiquement congolaise fut mince. Comme pour les concours, les évolués étaient d’un niveau de culture générale et de langue trop bas pour s’improviser écrivains de talent. Cette voie ne demeura ouverte qu’à quelques-uns d’entre eux. L’autre explication de cette inertie apparente est que la BDE ne se crut pas obligée de susciter de telles contributions, son objectif premier étant de fournir une lecture adaptée aux Congolais et pas forcément d’exhorter les Africains à produire des écrits qui puissent répondre aux aspirations de leur public. Dans les faits, la part spécifiquement congolaise de la production de la BDE était plus restreinte encore qu’il n’y paraissait. En effet, certains noms d’auteurs congolais figurant sur le catalogue n’étaient que les pseudonymes d’auteurs européens et de missionnaires. Ainsi, le nom à consonance africaine de Nicolas Muketi n’était qu’un pseudonyme utilisé par le Père Roelandt quand il estimait nécessaire de s’attribuer une signature « africaine » ou « laïque ».
En fait, on peut dénombrer tout au plus une demi-douzaine d’écrivains congolais authentiques dans la production de la BDE, entre autres : Pierre Mbaya qui publia un recueil de contes (Contes d’aujourd’hui) ; Dieudonné Mutombo avec son roman Victoire sur l’amour (1954), Paul Mushiete qui publia une anthologie de La littérature française africaine (1957), Thimotée Malembe qui inaugura la collection « L’Afrique raconte » avec le Mystère de l’enfant disparu (1962).
Par le thème abordé, le petit roman de Mutombo constitue une étape dans l’évolution de la jeune littérature nationale. Loin d’être une adaptation d’un conte traditionnel ou un récit qui puise son intrigue dans le champ mythique à l’exemple de Ngando, Victoire de l’amour pose une question d’ordre existentiel, significative d’une prise de conscience des problèmes de la société moderne : l’amour entre deux personnes d’origine ethnique distincte, Aristide Fataki et Marie-Louise Mulunda, combattu par un second prétendant, Albert Kabengele, qui fait prévaloir son appartenance à la même ethnie que la jeune fille. Les amoureux finissent par triompher de tous les obstacles.
La littérature congolaise, on l’a constaté, n’a pas été vraiment significative de ce que le pays aura vécu à cette époque. C’est que ce mode d’expression demeurait aristocratique et bourgeois. Non seulement il n’était accessible qu’à quelques-uns mais de plus, le discours élaboré si laborieusement était à peine compréhensible pour la plupart des Congolais ; il pouvait tout au plus constituer pour le colonisateur une preuve de l’existence des capacités potentielles des Congolais, une esquisse de ce qu’ils seraient capables de produire, une fois qu’ils auraient acquis la maîtrise du français. Heureusement, entre l’artiste et son public, il existait d’autres modes de diffusion, d’autres possibilités de dialogue.
4.2.2 La musique
La musique est l’art populaire congolais par excellence. Ce fait est reconnu par tous, à tel point que la musique congolaise symbolise aujourd’hui à la fois le pays et son peuple. Essayons d’en retracer l’histoire [65].
La musique congolaise moderne vise cette expression musicale urbaine où la chanson, soutenue par la mélodie, est mise en valeur par une orchestration, le tout au service d’une danse particulière qui constitue sa finalité. Ce phénomène complexe a donc deux dominantes : la chanson et son contenu verbal et la danse, message gestuel [66].
Tableau 20 — Danses congolaises modernes
| DANSES | ORCHESTRES | DANSES | ORCHESTRES |
| 1. Agbaya | 49. Mali | Swede Swede | |
| 2. Appolo | T.P.OKJazz | 50. Mambeta | Vox Africa |
| 3. Araka | Swede Swede | 51. Mapeka | Yoka Lokole |
| 4. Atutana | Swede Swede | 52. Maradona | Wenge Musica |
| 5. ORFAZ | 53. Maringa | ||
| 6. Beni-Beni | 54. Marteau Kibota | Zaiko Wawa | |
| 7. Bidunda-Dunda | Sosoliso (Madjesi) | 55. Masasi calculez | Empire Bakuba |
| 8. Bilolo | Chic Choc Loyenge | 56. Mata-kita | Stukas |
| 9. Bionda (la) | Stukas | 57. Mayenu | TP. OK Jazz |
| 10. Bolowa | Zaiko Langa Langa N.M. | 58. Mbiri-mbiri | Langa Langa Stars |
| 11. Bosima | 59. Mitelele | Zaiko Langa Langa N.M. | |
| 12. Boucher | African-Fiesta National | 60. Mobylette | African-Fiesta Sukisa |
| 13. Caneton | Minzoto Wella-Wella | 61. Mokonyonyo | Viva-la-Musica |
| 14. Cavacha | Zaïko Langa Langa | 62. Mombombo | Stukas |
| 15. Cha-cha-cha | OK Jazz | 63. Mosaka | Negro-Succes |
| 16. Choquez retardé | Zaiko Langa Langa | 64. Motors Rétro | Stukas |
| 17. Crapeau-Crapeau | Stukas | 65. Motuka monene | Station Japan |
| 18. Dallas Passeport | Langa Langa Stars | 66. MutetaTeta | Choc Star |
| 19. Disco | Zaiko Langa Langa | 67. Mutwashi | African Jazz/Tshala Mwana |
| 20. Ekondasaccadé | Stukas | 68. Mwambe | |
| 21. Embonga | 69. Nager sous-marin | Empire Bakuba | |
| 22. Engundu | Lay-Lay | 70. Nyekese | Viva-la-Musica |
| 23. Esakala | Groupe Mai-Ndombe | 71. Nzango | |
| 24. Esombi | Empire Bakuba | 72. OTshenge | Libaku de Gina |
| 25. Eza-eza | Viva-la-Musica | 73. Osaka Dynastie | Stukas |
| 26. Fiona-Fiona | Bana Odéon | 74. Parachute | Zaiko Wawa |
| 27. Griffe Dindon | Viva-la-Musica | 75. Patenge | |
| 28. Guaben | Vévé | 76. Pompe bijection | Victoria Eleison |
| 29. Isankele | Swede Swede | 77. Rick Son | Viva-la-Musica |
| 30. Jobs | African-Fiesta National | 78. Rikitele Ja Rwaka | Station Japan |
| 31. Kara-kara | African Jazz | 79. Rumba-Rock | Viva-la-Musica |
| 32. Katakumech | Victoria Eleison | 80. Sengola | Grand Zaiko Wawa |
| 33. Kebo | 81. Silauka | Zaiko Langa Langa | |
| 34. Kede | 82. Silikoti | ||
| 35. Kiri-kiri | African-Fiesta Sukisa | 83. Sonzo-ma | Zaiko Langa Langa |
| 36. Kourou-Bondo | Bella-Bella | 84. Soukous | African-Fiesta National |
| 37. Kuanza | Empire Bakuba | 85. Soum-Djoum | African-Fiesta National |
| 38. Kuku-Dindon | Viva-la-Musica | 86. Suelema | Choc Star |
| 39. Kurunyenge | Viva-la-Musica | 87. Sundama | Swede Swede |
| 40. Kwasa-kwasa | Bana Lingwala / Jeanora | 88. Tara | Zaïko Langa Langa |
| 41. Liyoto | 89. Tora | Station Japan | |
| 42. Lofimbo | Isifi | 90. Toyo Motors | Stukas |
| 43. Longenya | 91. Tsheke-Tsheke | Tsheke-Tsheke Love | |
| 44. Loyenge-Bulubulu | Maquisards | 92. Volant | Zaiko Langa Langa |
| 45. Lubelu Tadi-Tadi | Minzoto Wella-Wella | 93. Watsha-watsha | Zaïko Langa Langa |
| 46. Mabata-Lay | Bella-Bella | 94. Wondo-Stock | Zaiko Langa Langa |
| 47. Machota | Viva-la-Musica | 95. Yeye | Anti-Choc |
| 48. Madiaba | Bana Lemba |
(cf. Lonoh M.B., 1990 :45 ; communications personnelles)
L’histoire de la création musicale moderne au Congo connaît deux étapes dans la période qui nous concerne : la première précède les années 50, la seconde démarre en 1953 avec les grands ensembles tels que le African Jazz et le OK Jazz.
Pour le spectateur des premières exhibitions « mondaines » à Kinshasa dans les années 20, l’effervescence actuelle du quartier Matonge aurait été inconcevable [67]. Dans les années 20-25, on qualifiait invariablement ce phénomène de agbaya, quelles que soient sa composante et l’identité de ses acteurs (Kanza M., 1972 : 36). D’autant plus que le Kinois de l’époque était conscient que cet art était d’origine extérieure et qu’il l’apprenait des coastmen, ces ouest-africains installés à Kinshasa qui avaient l’habitude de se regrouper pour chanter et danser ensemble.
L’espace traditionnel congolais était loin d’être en reste cependant. Bien au contraire, son héritage musical était riche : à chaque groupe ethnique correspondait un type particulier de musique et de danse, qu’on exécutait dans des circonstances particulières. La nouveauté résidait dans la situation de cohabitation ou plus précisément dans les brassages interethniques des centres extracoutumiers. Les circonstances particulières demeurant les mêmes qu’au village (naissance, mariage, décès, retrait de deuil, etc.), il était nécessaire de se regrouper autour du maître du tam- tam. Mais à la différence du village, le répertoire des chants et des danses en ville était nécessairement composite et diversifié, et o y intégrait même un air nouveau, appris du missionnaire, du Blanc ou du capita, pourvu qu’il soit dansant et rythmique. C’est ainsi que la nouvelle pratique musicale prit forme.
Le premier apport significatif en ce sens provint du groupe étranger le plus proche des autochtones, qui partageait sa vie et y jouait le rôle de l’élite. Engagés dans les grandes compagnies pour les travaux de bureau, les Ouest-Africains, appelés invariablement « Sénégalais » ou « Haussa », étaient regroupés en associations comme l’« Amicale togo-dahoméenne » ou encore comme la CAM.DA.TO au Congo français (Association des Originaires du Cameroun, du Dahomey et du Togo). Pour leurs fêtes, les coastmen usaient d’instruments de musique inconnus jusque-là – l’harmonica, l’accordéon qu’on appelait en lingala lindanda et la guitare (kidare) – et se trémoussaient sur les rythmes du high-life, à la grande admiration des autres, surtout des jeunes regroupés dans des cercles de loisir aux noms évocateurs tels que « l’Harmonie kinoise », « Jeune espérance », etc.
C’est dans ce contexte que des pas de danse nouveaux provenant de Loango traversèrent le pool pour devenir la référence des mondains kinois. Ils préférèrent le maringa à la polka et au quadrille, d’origines polonaise et française. Les dancings se multiplièrent. Vers les années 40, il en existait déjà une bonne vingtaine à Léopoldville (Bemba S., 1984 : 64). Dans le langage courant, on faisait la distinction entre le matanga et le maringa. « Aller au matanga » se disait d’une réunion ou d’une fête traditionnelle. On parlait d’« aller au maringa » lorsqu’il était question d’un rendez-vous mondain (Kanza M., 1972 : 39). Dans les bars, on s’initiait volontiers à des danses considérées comme « européennes », valse, tango (d’origine argentine), etc. Un observateur de l’époque en témoigne : « L’un ou l’autre groupe ou association organise une soirée de gala : tenue de soirée obligatoire pour les hommes… invitations des notabilités européennes et atmosphère guindée et cérémonieuse. On demande alors la permission de nuit et la fête se termine aux petites heures » (Bemba S., 1984: 64). Le libertinage urbain faisait son chemin. L’homme, libéré de la coutume, abordait la femme, ou la prostituée (mwasi ya leta), d’une manière plus directe, surtout que celle-ci arborait de nouvelles parures, notamment ces bijoux volumineux destinés à gonfler les hanches (zigida). Les plus audacieuses d’entre elles se regroupaient en association, parfois réputées, comme celle appelée » Diamant », réservées dans l’entre-deux-guerres aux femmes riches (basi ya kilo), pour se livrer à ce nouveau type de loisir.
Il faut dire que ce réseau se constituait de lui-même malgré les assauts des missionnaires. Les protestants préféraient interdire la danse à leurs fidèles tandis que les catholiques, sans être aussi directs, firent des efforts pour détourner les jeunes de ces pratiques mondaines, en organisant des activités sportives et des mouvements de jeunesse tel le scoutisme dont on a déjà parlé. Mais curieusement, les musiciens étaient presque tous issus de milieux missionnaires où ils avaient été des vedettes dans les chorales. Déjà vers les années 20, la musique religieuse disposait d’atouts importants ; elle aurait pu connaître un développement prodigieux si la créativité populaire dans ce domaine avait pu s’exprimer plus librement. Cela n’empêcha pas certains Congolais, notamment Joseph Kiwele, de faire preuve de génie en composant sa « Missa Katanga », accompagnée au tam-tam et d’autres instruments traditionnels (comme la « Missa Luba » du franciscain Guida Haazen). Un autre exemple de cette créativité fut, vers les années 55, de la fameuse chorale « Les Troubadours du roi Baudouin », la création qui récoltera un grand succès en 1958 à l’Exposition Universelle de Bruxelles.
Toutefois, le chant religieux avait ses limites, tandis que dans le domaine profane, toute initiative nouvelle était la bienvenue à condition d’offrir les plus grandes possibilités d’amusement. La musique moderne achevait de conquérir son droit de cité ; elle connut un plus grand rayonnement vers les années 40, par la conjonction de trois innovations : l’avènement des orchestres, l’introduction de la rumba, le règne de la radio et du phonographe.
Le premier spectacle mis sur pied par un orchestre vient d’une initiative des coastmen qui, on l’a dit, mirent à profit l’expérience ramenée de leur pays. Leur orchestre Excelsior jouissait d’un grand prestige par les instruments utilisés. La guerre permit aux Kinois de voir d’autres ensembles musicaux, constitués de groupes de soldats de passage à Léopoldville et à Borna. On les imita et l’on comprend que les premières créations du genre ne purent cacher, même sous les noms qu’elles s’attribuèrent, leurs sources d’inspiration. En effet, parmi ces orchestres, les plus célèbres furent l’Harmonie kinoise, ÏOdéon kinois, l’Amérique, la Martinique. La référence à la France, à sa culture, était évidente. L’évocation plus précise de la Martinique était liée, semble-t-il, au passage du contingent martiniquais de l’armée française à Brazzaville, qui, pour meubler ses loisirs, faisait de la musique. Quant à l’« Amérique », elle évoquait un souvenir similaire lié au souvenir du contingent de soldats noirs américains stationné à Kinshasa. Le regroupement en ensembles musicaux se généralisa donc, à Léopoldville comme à Brazzaville, qui vivaient toutes deux dans ce domaine en étroite symbiose, malgré leurs deux systèmes coloniaux bien distincts.
Entre-temps, la rumba fit son apparition en Afrique centrale ; elle était originaire d’Amérique latine. Cette diffusion se réalisa sans doute à la faveur du cosmopolitisme en vogue au cours des années 40. Elle fut aussitôt adoptée, au point d’enrichir le patrimoine musical préexistant par de multiples variantes allant de la rumba-sukumu du début de la guerre jusqu’à la rumba kiri-kiri des années 80 en passant par la rumba-kara, la rumba-boucher, la rumba-sukusu. En définitive, cette danse caractérise vraiment la musique moderne du Congo, constituée à 75 % d’éléments empruntés à la rumba (Lonoh M.B., 1990 : 35). D’autres danses connurent également un grand succès, notamment le cha-cha-cha à deux rythmes, le merenge, le pachanga, le boléro, le mambo, toutes inspirées des rythmes de l’Amérique latine.
Le développement fulgurant de ce mode d’expression fut favorisé aussi par les possibilités nouvelles de diffusion, qui assurèrent une grande audience à cette musique, et par là son rayonnement. Toutefois, l’influence de la radio était limitée. Puis vers les années 20, un phonographe circula de village en village pour alimenter les programmes de loisir. L’invention d’Edison constituait un progrès prodigieux et ouvrait de nouveaux horizons particulièrement à des sociétés fondées sur une tradition essentiellement orale, comme celle du Congo. Avec l’introduction du phonographe, la reproduction musicale devenait domestique, à la portée du peuple. L’industrie phonographique qui s’installa localement permit de fixer sur la cire les chansons du terroir. Tous les espoirs étaient permis. La première maison de pressage de disques fut installée en 1948 par un Grec, Jeronimidis père : elle s’appelle Editions Ngoma. L’entreprise s’avéra florissante et devint l’apanage des Grecs. Les frères Moussa Benatar créèrent en 1950 les Editions Opika ; A. et B. Papadimitriou fondèrent les Editions Loningisa et en 1957, Antonopoulos lança une autre maison, les Editions Esengo (Bembe S., 1984 : 33).
Que retenir de la production musicale antérieure à 1950 ? Elle connut plusieurs tendances, mises à part celles qui étaient susceptibles d’inquiéter le pouvoir colonial. Comme en littérature, le courant le plus significatif s’attacha à mettre en valeur l’héritage du folklore populaire en l’adaptant aux techniques et aux instruments nouveaux. Cette tendance persista, allant de la naissance de la musique moderne jusqu’à nos jours. Un autre courant, plus significatif de l’époque, fit référence aux questions coloniales et à la vie urbaine. Déjà, sur les chantiers, on avait entendu des refrains populaires inconnus jusque-là, où l’importance du travail exaltée pour plaire au colonisateur dissimulait des injures, des malédictions et des imprécations de toutes sortes, incompréhensibles pour le non-initié. C’est dans ce contexte que prit forme le fameux « salongo alinga mosala » qui rythmait les travaux collectifs. Léon Bukasa (1950) se laissa également tenter par ce thème « civique » de l’époque, dans un refrain où il s’exclamait :
Awa toyaki pamba te
Awa toyaki toyaki mosala
Soki olingi kofanda somele
Wana etali yo bozoba na yo e.
[Ici, nous ne sommes pas venus pour rien
Ici nous sommes venus pour travailler
Si tu veux demeurer chômeur, c’est ton affaire
C’est ton affaire et ta sottise.]
De même, le passage de la campagne à la ville fut marqué par l’avènement des rapports d’intérêt n’engageant ni le cœur, ni la connaissance mutuelle. Une mise en garde de l’orchestre Rock-a-Mambo sera faite contre ce genre d’amitié, le « camarade ya mboka mundele » (camarade de la ville).
Mais la musique servit surtout à développer les thèmes de la femme, du couple et de l’amour. Certaines célébrités féminines furent chantées dès cette époque : « chérie Yvonne », « Maria Tchebo », « Albertine mwasi ya bar » (évoquée par Ngombe dit « maître Taureau ») et surtout « Marie-Louise » de Wendo Kolosoy. Il faut s’arrêter un instant à ce personnage qui brilla de mille feux dès les premiers balbutiements de cette musique. Né à Mushie en 1926, Antoine Kolosoy eut très tôt la possibilité de voyager sur le fleuve grâce à sa fonction de graisseur sur un bateau de la compagnie « Mbila ». Il fut surnommé « Wendo » ; le marin qui lui attribua ce surnom le comparait à un ressort de la marque anglaise « Wendson » (Wendossor en lingala), à cause de ses facilités de contact [68]. Le chanteur s’introduisait facilement dans tous les milieux, où on l’acceptait volontiers à cause de son humeur agréable (Luyela K., 1981 : 37). Wendo se fit troubadour, chantant ici et là, pour ses amis, ou au cours de ses pérégrinations fluviales. Vers les années 40, il voulut donner libre cours à son talent et s’associer avec Henry Bowane, le grand guitariste de l’époque. Sa chanson « Marie-Louise » constitue certainement l’une des plus belles expressions de son talent et un des plus beaux chants d’amour de l’époque. Dans une autre chanson demeurée non moins célèbre, ce poète tenta d’immortaliser le souvenir de son maître et ami. le chanteur congolais Paul Kamba, fondateur de l’orchestre « Victoria Brazza ». Le succès de ce musicien fut tel que Léopoldville eut également son « Victoria », dans lequel évoluait précisément Kolosoy. Incontestablement, cette chanson fait partie du répertoire qui marqua le décollage de la chanson congolaise moderne.
Le lyrisme personnel mis à part, la situation coloniale et ses méfaits, malgré les restrictions de la censure, continuèrent à inspirer les chanteurs de cette époque. La chanson « nzila ya Ndolo » (chemin de la prison de Ndolo) d’Antoine Mundanda (1952) raconte l’histoire d’un jeune pêcheur venu à la découverte de Kinshasa, « l’Europe en Afrique » (sic) où il ne trouve que déception : prostitution, méfiance, préjugés, jugements arbitraires et pour tout dénouement, la prison. Ce récit vaut la peine d’être reproduit dans son intégralité [69]. C’est une mise en garde pour l’auditeur :
Poto-Poto est une grande cité
Mais Kinshasa c’est vraiment l’Europe en Afrique
Je viens de Banningville, une de ces cités des Blancs
A peine ai-je voulu me marier
Qu’il me fallait affronter une dizaine de témoins
Si je suis mal tombé, c’est à cause des filles de rue
Oui, les amis, méfiez-vous de ces filles
Si vous vous y attachez, vous finirez par la prison Que mes pensées soient pour toi que j’aime !
Vous connaissez Maluku, petit village teke
En quittant Maluku, j’ai pris ma petite pirogue « ndeke luka » J’ai ramé et glissé dans l’eau comme dans un poisson sans arête Ayant pris la direction de la Sabena, j’ai tourné à nouveau pour atteindre le port de Ndolo
Arrivé à destination, j’ai amarré mon ndeke luka
Puis je suis descendu au marché pour vendre ma marchandise La marchandise vendue et après avoir fait mes comptes
Je me dirige pour faire les achats mais j’entends derrière moi « Out » !
Je me retourne et on m’exige des papiers
Je veux m’expliquer mais déjà la gifle siffle
Je veux m’échapper mais déjà la matraque m’écorche le dos Vraiment, les amis, le coup a la vigueur d’une décharge électrique Je tombe à terre, me retourne en tous sens et invoque ma mère en me tordant sur le sol
Que mes pensées soient pour toi que j’aime !
A la prison de Ndolo, on m’enlève les habits et m’en enfile d’autres qui ressemblent à ceux qu’on porte pour jouer au ballon
Ah ! Les amis, évitez le chemin de la prison
En prison on vit comme dans une cale de navire
Moi qui voulais me marier, me voilà en prison, ne sachant plus que faire Que mes pensées soient pour toi que j’aime !
Le récit est méthodique et d’un réalisme impitoyable. La voie fluviale est la seule qui soit à la portée du peuple. L’unique ressource du paysan réside dans des navettes entre la campagne et la ville pour vendre les produits de la cueillette et ramener des produits modernes. Mais le contact avec la ville est déroutant à tous points de vue, depuis le dérèglement de la vie coutumière jusqu’à la discrimination raciale, au traitement inhumain en passant par le mirage de la prostitution. Mundanda inaugurait ainsi un ton nouveau qui ferait recette, la peinture des aspirations et des misères de la société ; les injustices seront dénoncées et les excès condamnés. Le second âge de la musique congolaise moderne allait se spécialiser dans cette prise en compte du social et du politique.
Ce second âge démarra précisément vers les années 50 avec la genèse de deux grands orchestres modernes, ceux-là mêmes dont l’influence resterait déterminante pendant plus de deux décennies ; Y African Jazz et YOR Jazz. Tous leurs membres étaient nés dans l’entre-deux-guerres et avaient eu le temps d’intérioriser les différents aspects de la modernité naissance : instruction, urbanisation, instrumentation musicale. Iis se situaient au confluent de deux cultures, d’origines interne et externe.
L’African Jazz est une création de Joseph Kabasele (Kabasele Tshamala) qui se distingua dès 1951 par ses chansons enregistrées aux Editions Opika. A Matadi où il est né le 16 décembre 1930, il avait pu faire des études chez les Pères de Scheut et être initié au chant choral. Sa production artistique garda l’empreinte de cette origine « aristocratique » (kalaka). « Kallé Jef » ou « Grand Kallé » (tels furent ses surnoms) rendit effective la création de son orchestre en 1953 avec l’enregistrement de la chanson appelée précisément « African Jazz ». Déjà Kasanda (surnommé « Nico Mobali » puis « Dr Nico ») est présent, virtuose de la guitare. Le style de l’orchestre se stabilisa dès 1955 avec la création de la maison Esengo (qui remplaça Opika) et s’illustra dans la chanson politique à la grande période de mutation qui se réalisa à partir de 1956 et qui mena à l’indépendance et à la crise qui s’ensuivit. Dans les années qui suivirent, plusieurs autres orchestres de la même veine virent le jour : YAfrican-Fiesta qui se divisa en African-Fiesta Sukisa et YAfrican-Fiesta International (devenu finalement Africa International), Les As, le Super African Jazz, le Vox Africa et les Grands Maquisards, etc.
Quant à l’OK Jazz, il connut un itinéraire à peu près semblable. Son nom s’inspire simplement de son lieu d’origine, en 1956 : YOK-Bar, ainsi dénommé à cause des initiales du propriétaire, O (Oscar), K (Kashama). L’orchestre fut créé à l’initiative de M. Cassier. Le jeune François Lwambo (1939-1989), qui n’avait que dix-sept ans, n’en était pas encore le responsable. Il avait devant lui deux aînés : De la Lune (Daniel Lubelo), le plus âgé du groupe, et Jean-Serge Essous. Introduit dans l’orchestre par son maître Henry Bowane qui le surnomma Franco, il ne tarda pas à s’imposer et porta aussitôt le flambeau de l’orchestre, d’abord pour l’adaptation de la chanson traditionnelle, avant de s’illustrer dans la peinture sociale dans laquelle l’image de la femme était omniprésente, puis dans la satire politique. Il fit école puisqu’une pléiade d’orchestres furent créés par la suite, s’inspirant directement de son oeuvre, notamment le Negro-Succès, le Véué, le Trio Madjesi, le Tembo. etc. Citons encore quelques autres orchestres de sensibilité hybride, parmi lesquels : Rock-a-Mambo de Lando Rossignol, Congo-Succès d’Ebengo et Dewayon et Cobantou de Bokelo Isenge (Bemba S., 1984 :102-108 ; Lonoh M.B., 1990 : 39- 40). Tous s’inspirèrent de ces deux noyaux d’innovation musicale que furent l’African Jazz et l’OK Jazz, qui prirent une part active dans la prise de conscience qui mena à l’indépendance.
Il convient de souligner que c’est déjà en 1955 que les artistes-musiciens commencèrent à entrevoir la possibilité de la chute du régime colonial. La fameuse chanson d’Adou Eyenga « Ata ndele mokili ekobaluka » fut sans aucun doute le manifeste de la mutation qui était en cours. Elle a même le ton d’une prophétie. On est à quelques mois de la publication du « plan de 30 ans » de Van Bilsen.
« Ata ndele, mondele akobaluka
Ata ndele, mokili ekosukwama
Ata ndele, mokili ekobaluka
Ata ndele, mokili ekosukwama »
[Tôt ou tard, il sera renversé le pouvoir blanc
Tôt ou tard, le monde sera purifié
Tôt ou tard, le monde basculera
Tôt ou tard, le monde sera purifié.]
Dans l’ensemble, le langage musical fut plus authentique que le discours littéraire classique, du fait que ce langage s’adressait d’abord et avant tout aux Congolais eux- mêmes. Il n’est donc pas étonnant que les messages qu’il véhiculait aient affiché une sérénité ambiguë qui reflétait de manière plus réaliste les sentiments qui animaient le peuple au cours des années 50.
4.2.3 Arts plastiques
Parmi les arts qui ont subi l’influence de la colonisation, la peinture et la sculpture restent les moins bien connus parce qu’ils ont été moins souvent abordés par la littérature scientifique. D’autant plus que les études réalisées sur les arts africains ont été davantage sensibles à des formes sculpturales anciennes plutôt que modernes [70]. Le premier intérêt qui se manifesta enfin pour les créations plastiques modernes se limita à l’aspect artistique ; et encore, cela ne valait que pour l’art produit dans les académies et écoles artistiques ou sous la protection d’un mécène européen ; on minimisa l’art populaire [71]. Ce n’est que tout récemment que la peinture naïve obtint son droit de cité dans la littérature scientifique. Historiens et sociologues s’efforcent d’en dégager une vision populaire de l’histoire du pays, vision qui n’a pas été suffisamment prise en compte jusqu’ici dans l’histoire officielle véhiculée par les pouvoirs politiques, colonial et post-colonial. Les spécialistes de l’art, quant à eux, continuent à estimer que ces oeuvres populaires ne présentent aucun intérêt sur le plan esthétique. Avec une historiographie artistique aussi limitée et aussi discriminatoire, il est trop tôt pour rendre compte de l’ensemble du message véhiculé par le langage plastique. Contentons-nous de signaler quelques tendances qui passent pour dominantes dans l’état actuel des connaissances, en distinguant l’art officiel, parrainé par les mécènes étrangers ou par le pouvoir colonial, de l’art populaire qui n’est revendiqué par aucune instance officielle et dont la création relève de l’initiative de l’artiste local et est destinée en principe à une clientèle locale [72].
L’évolution de l’art plastique officiel se ramène à l’histoire de l’acculturation dans ce domaine ; elle présente la même succession d’étapes que le processus d’acculturation lui-même jusqu’à la symbiose et l’éclosion d’une expression authentique et nouvelle qui fait la fierté du Congo contemporain sur le plan culturel. Dans la phase coloniale de cet itinéraire, on peut distinguer deux époques qui correspondent grosso modo à la phase qui précède la deuxième guerre mondiale et à celle qui la suit. La naissance de l’art plastique moderne se situe vers les années 20 ; elle fut d’abord le fait de quelques individus, avant la constitution d’ateliers organisés et d’écoles des arts et des métiers.
Quelques pionniers demeurent célèbres parmi lesquels Lubaki, qui dans le Bas- Congo se mit à peindre dès 1926, et fut encouragé par un jeune fonctionnaire de la territoriale. Ses aquarelles furent exposées à Bruxelles en 1929. L’événement fit date, c’était la première exposition de l’art congolais moderne. Aussitôt l’intérêt des Occidentaux amateurs se manifesta pour ce nouvel art africain. C’est ainsi qu’en 1935 se créa la commission de Protection des Arts et Métiers indigènes et celle de l’Association des Amis de l’Art indigène (AAI). Un autre Congolais se distingua également par ses créations artistiques : Djilatembo, originaire d’un village situé dans les environs de Mweka et de Luebo, un sculpteur reconverti en peintre. Il excella dans la décoration aux figures géométriques simples ainsi que dans l’art anecdotique. Voilà les deux noms qui constituèrent les références de l’art congolais moderne : ils furent utilisés comme tels. Ils furent mis à contribution, tous deux, pour illustrer le recueil de contes «L’éléphant qui marche sur des œufs» de Badibanga publié en 1931. Leurs aquarelles furent exposées tour à tour à Genève en 1930. à Bruxelles en 1936 et dans d’autres villes d’Europe.
A côté de ces deux artistes qui s’étaient sans doute attiré davantage les faveurs de la critique, l’exposition de 1968 révéla au public européen deux autres spécialistes, Ngoma pour sa peinture et Masalai pour ses ivoires et ses dessins. Peu après, les Amis de l’Art Indigène de Lubumbashi découvrirent un autre sculpteur d’origine cokwe, Mayele, qui se fit connaître pour sa pratique de l’ « art nègre pour Blancs » ; les thèmes en étaient tirés de la vie africaine, mais les règles relevaient du réalisme naturaliste étranger. Cet art valut à l’auteur d’être installé à Lubumbashi aux frais des AAI. Son cas ne fut pas un fait isolé. En réalité, à partir de la création de la commission de Protection des Arts et Métiers indigènes et de l’association des Amis de l’Art indigène, la défense et l’illustration de l’art « indigène » connurent un nouvel essor. Il se manifesta par la création de nouveaux centres de formation artistique, le développement ou l’encouragement d’ateliers déjà existants, de musées régionaux, l’ouverture de comptoirs de vente de production artistique.
Le phénomène le plus marquant de ce mouvement fut la création de foyers artistiques qui prirent la forme d’ateliers ou d’ateliers-écoles à peu près partout dans le pays. Cet effort de promotion de l’art favorisa, à partir des années 40, une plus grande maîtrise dans la création plastique moderne.
L’essor des années 40 fut soutenu par plusieurs initiatives importantes : l’émergence d’un grand maître, Nkusu Felelo, et surtout la création de deux grandes écoles d’art, à Kinshasa et à Lubumbashi, qui allaient devenir les deux principaux pôles de rayonnement de l’art plastique congolais moderne. Apparemment rien ne semblait destiner Nkusu, originaire de Kabinda, à l’art plastique, s’il n’avait entrepris de s’initier au dessin en 1943. Il y prit goût et, en 1944, à 30 ans, il décida de devenir peintre et réussit dans cette voie : il devint célèbre pour son usage judicieux de la couleur rouge et son exploitation laïque du thème du Christ. Son succès fut surprenant, et son oeuvre inspira plusieurs générations.
Ces quelques cas particuliers mis à part, les autres promotions artistiques se réalisèrent de préférence au sein des ateliers-écoles parrainés ici et là par des mécènes étrangers. Rien que dans la ville de Kinshasa, on en a dénombré une demi- douzaine. Parmi ceux-ci, l’atelier de rénovation du travail de l’ivoire, initié par Van den Bossche, conservateur vers les années 45 au Musée de la Vie indigène, un atelier de céramique où l’on initiait aux techniques modernes autour du céramiste Jacques Laloux ; l’atelier de Laurent Moonens qui, travaillant au bord du fleuve, donna naissance à l’école de Stanley Pool, célèbre pour ses vues du fleuve, qui occupent de nos jours encore une grande partie du marché de l’art congolais ; les ateliers d’Alhadeff, soutenus par cet homme d’affaires soucieux de fournir aux peintres et céramistes congolais le matériel nécessaire et de commercialiser leurs meilleures productions.
Il y eut aussi des initiatives coloniales qui conduisirent à l’élaboration de deux véritables écoles esthétiques. Il s’agit des expériences du Frère Marc Wallenda et de Pierre-Romain Desfossés : le premier est à la base de la création de l’Académie des Beaux-Arts à Kinshasa et le second est à l’origine de la célèbre école de peinture de Lubumbashi.
L’Académie des Beaux-Arts fut fondée à Gombe-Matadi dans le Bas-Congo avec l’ouverture, en 1943, d’une classe de sculpture. L’établissement s’appelait alors Saint-Luc. Winengwane en fut le premier diplômé en 1947, suivi de quelques autres lauréats parmi lesquels Chenge Kanuto. Cet établissement attira l’attention du gouvernement colonial qui en fit une école subsidiée et la transféra à Kinshasa en 1939. Entre-temps un cycle supérieur de sculpture y avait été créé et son premier candidat, Lufwa Mawidi fut diplômé en 1950 en même temps qu’il remportait le prix des écoles Saint-Luc à Liège. Cette même année, l’entreprise du Frère Wallenda s’enrichit d’une section de peinture et, quelques années plus tard, elle comptait déjà de grands noms parmi lesquels Lukoki, Mauinga, Ndamuu, Chenge Baruti, Zowa, Konde, etc. Il manquait encore une composante : la céramique, qu’on intégra en 1953. Bamba Ndombasi allait s’imposer comme un grand maître dans cette discipline.
Pour mieux marquer son souci de s’adapter aux réalités locales en tant que support des créativités plastiques du pays, l’institut troqua sa dénomination de « Saint- Luc » qui en faisait un établissement annexe d’une chaîne d’Instituts St-Luc existant en Belgique contre celle d’ « Académie des Beaux-Arts » en 1957. L’année suivante, en 1958, une nouvelle orientation s’ajouta aux autres : l’architecture. Ce diplôme requérait trois ans d’études théoriques et un an de stage de perfectionnement ; cette discipline fit l’objet de la création d’un institut autonome à partir de 1962. Grâce à ce développement considérable des structures d’enseignement, l’art plastique était promis à un grand épanouissement à Kinshasa. Il constitue aujourd’hui l’une des principales références africaines.
Lubumbashi connut un itinéraire différent, sans doute moins prestigieux et cependant d’une importance aussi grande sur le plan artistique. Cette » école » fut essentiellement l’œuvre de Pierre-Romain Desfossés, un artiste-peintre français épris de voyages. Sa première manifestation publique date de 1943 à Brazzaville, à l’occasion de la publication d’un album illustré sur le Tchad. A Lubumbashi. Desfossés créa l’« Union africaine des Arts et Lettres » en 1945 ; l’année suivante, il découvre les talents de Pili-Pili Mulongoy, un garçon qui était à son service. A son insu et en utilisant les couleurs de Desfossés, le jeune Congolais avait peint des tableaux selon une technique tout à fait originale, alliant des motifs d’animaux à un fond décoratif d’herbes, de fleurs, de petites taches unies ou pigmentées. Cette technique, il la développa en un système immuable, de même que l’objet de son inspiration, l’univers de la flore et de la faune. Pili-Pili fut le premier à être admis à travailler dans l’atelier de Desfossés, appelé « le Hangar » ; cet atelier qui devint l’école ou l’Académie d’Art populaire indigène, compta Mwenze Kibwanga, Nkulu, Kabala, Kilima, etc. parmi ses élèves.
Les plus grandes références de l’école de Lubumbashi furent alors Mwenze Kibwanga, avec sa technique de rayures, et Pili-Pili Mulongoy déjà cité. Ces deux styles étaient pourtant bien distincts. Mwenze était surtout inspiré par les scènes de village tandis que Pili-Pili était attaché aux motifs décoratifs d’origine animale. L’école
de Lubumbashi connut un succès retentissant. Le Prince Régent admira ses œuvres, lors de son passage à Elisabethville en 1947. La même année et la suivante, la commission des Musées nationaux de Belgique constitua sa première collection de peintures modernes congolaises, considérées comme des chefs-d’œuvre. La période des expositions internationales débuta en 1949 avec la présentation des œuvres de l’école de Lubumbashi à Bruxelles, Anvers, Paris, Louvain, New York. En 1950, elle participa entre autres à l’exposition vaticane. A la mort de Desfossés en 1954, son atelier fut annexé à l’Académie des Beaux-Arts et Métiers d’Art de Lubumbashi, créée par Laurent Moonens en 1951. On y dispense encore aujourd’hui l’enseignement d’un art plastique conforme aux techniques privilégiées par Desfossés.
Laurent Moonens, venait de Kinshasa, où il avait participé à la fondation de l’ « école de Stanley-Pool ». L’Académie qu’il créa proposait, en quatre ans, un programme d’enseignement de la peinture, de la sculpture, de l’art publicitaire ainsi que quelques cours généraux. On y intégra l’architecture en 1955, la dinanderie en 1956 et la céramique en 1964. Pili-Pili mais surtout Mwenze Kibwanga y enseignèrent. Quelques élèves poursuivirent leurs études supérieures dans d’autres académies, à Kinshasa ou en Europe. Une nouvelle école de « tendance Moonens » fit son apparition à Lubumbashi, spécialisée en peinture. Elle se rendit célèbre, entre autres, grâce à Mpoy qui y développa la technique de la « ligne continue » et grâce aussi à Mwenze Mungolo, inspiré par son maître Mwenze Kibwanga (Badibanga ne M., 1977 : 13-89). Une production plastique de qualité put ainsi se développer au Congo, caractérisée essentiellement par des thèmes classiques : paysages, flore et faune représentés sous forme de fables, personnages religieux, thème de la femme et surtout de la maternité. Cette production contrôlée par des maîtres européens était destinée aux Européens, surtout les Européens de la couche bourgeoise.
A côté de ce courant dit « officiel « existait un art populaire, même s’il fut longtemps oublié. L’art platisque populaire s’est pratiquement limité à un genre, la peinture, probablement parce qu’elle est d’une exécution facile et qu’elle ne requiert pas beaucoup de matériel. Ce genre est peut-être né de la pratique du dessin à l’école, qui a suscité l’envie d’esquisser quelques figures sur toute surface qui s’y prêtait. Des graffiti de « mauvais garçons » sur les murs des bâtiments publics, école, église, on passa à la décoration des murs des bars, des dancings et parfois même des habitations. La caractéristique de cette peinture est que le dessin en est réaliste et porte sur le vécu, le quotidien ; il est parfois agrémenté d’un texte destiné à compléter le message véhiculé par le dessin. Ce mode d’expression passe ensuite des murs à la toile, autant pour des raisons commerciales que parce qu’on avait découvert que le tissu blanc du sac de farine de blé, vidé, pouvait parfaitement convenir, à peu de frais.
C’est vers la fin des années 60 que la peinture populaire devint un fait de société, à la fois par sa prolifération et par l’audience grandissante qu’elle acquit auprès des Congolais, soucieux d’orner les murs de leurs maisons. La peinture était appréciée pour la qualité du dessin, mais davantage pour les sujets qu’elle évoquait. Sur le plan de la sensibilité esthétique, l’Africain s’attarda à l’univers humain plutôt qu’à l’univers floral par exemple ; les thèmes évoqués seront donc essentiellement humains ce qui explique la fréquence des portraits, souvent exécutés sur commande. La tendance s’orienta ensuite vers le souci de fixer sur la toile les événements récents, tels qu’ils avaient été vécus, compris ou interprétés par le peuple. Et puisqu’on était dans les années 60, les sources d’inspiration ne manquaient pas. D’où la récurrence, dans la peinture populaire, du thème du « départ des Blancs » (l’indépendance) mais aussi de leur « arrivée » (colonisation). Toute l’histoire de la modernisation du pays, depuis la période léopoldienne, se retrouva sur toile. L’intérêt manifesté alors par les intellectuels européens pour ce genre pictural a certainement stimulé cette production, en même temps qu’il contribuait à la « déformer » en « orientant » insensiblement l’inspiration de l’artiste. En tout cas, ce genre de peinture populaire a acquis de nos jours une audience internationale, entre autres grâce à Chéri Samba et Moke.
Outre les portraits, on peut déceler deux autres orientations ; la première est non événementielle et s’attache à la lecture des mythes anciens, à l’illustration d’une sagesse, à la visualisation des interrogations de la société ; la seconde est événementielle, et constitue une sorte de « photographie » de ce que l’artiste a vu de ce qu’il aurait pu voir s’il avait été témoin des événements passés. Ainsi, il nous est donné à voir sur toile, non seulement des scènes de rébellions, de mutineries de la Force publique, l’attaque des parachutistes belges à Matadi… mais aussi la proclamation de l’indépendance de l’EIC à Vivi le 1er juillet 1885, la mort de Bodson à Bunkeya après le meurtre de Mushid Ngelengwa, la condamnation de Simon Kimbangu à Thysville, etc.
Certaines œuvres relevant du premier genre évoqué ont fait l’objet d’une analyse (T.K. Biaya, 1989 : 95-120). Ainsi, les tableaux désignés à Kisangani « Inakale » (qui signifie : tout est bloqué) et à Kananga, » Wansungila Nganyi » ou encore « Nganyi Wangi Wansungila ? » (« Qui me sauvera de cette situation ? », « Qui des miens me tirera de cette impasse ? »). Ces toiles originaires de diverses régions du pays représentent la même scène. Un homme est perché dans un arbre entaillé situé au bord de l’eau ; sur la terre ferme, un fauve le guette et sur le rivage, un crocodile sortant de l’eau la gueule ouverte, l’attend ; sur l’arbre, un serpent venimeux s’avance. Que faire pour se sauver ? Un autre tableau, plus répandu encore, représente une sirène, toujours à peau blanche, au bord de l’eau. C’est le génie de l’eau, une puissance bienfaisante ou malfaisante suivant le cas ; il faut la gagner à sa cause pour acquérir le succès, la richesse ou le pouvoir [73].
La lecture événementielle est tout aussi intéressante. Non seulement elle permet de faire le point sur le niveau de la conscience historique congolaise mais de plus, elle dévoile des pages d’histoire coloniale que la documentation « officielle » avait mises à l’abri des regards indiscrets. Heureusement, la mémoire populaire n’avait pas oublié. Le cas le plus typique est le tableau de ce peintre de Lubumbashi, Tshibumba Kanda, sur la mort de Bwana François. Une première enquête permit de se rendre compte que ce personnage était un héros parmi les domestiques d’Elisabethville, pendant la période coloniale, et que son histoire constitue par elle- même une critique cinglante du régime colonial. En outre, elle met en évidence le clivage entre le monde colonial et le monde congolais, par la distance qui pouvait exister entre l’opinion « européenne » et l’opinion « africaine » à propos d’un même événement [74].
De quoi s’agit-il ? Qui était ce Bwana François ? François Musafiri, âgé environ de 19 ans et originaire de Kabinda, était boy au service d’un ménage européen (les Vanderueken) en 1922. Le matin du 15 août, il vint annoncer à ses employeurs que sa femme (Henriette ?) le trompait avec un Européen. En rage, il se rendit dans la « boyerie » pour y chercher sa femme. Il en ressortit avec elle, la traînant par la ceinture nouée autour de la taille ; il alla ensuite avec elle jusqu’à une maison proche des installations de radio-communication, occupée par deux Européens. Le coupable, Goossens, se trouvait sur le porche. Musafiri courut à lui, le menaçant d’un couteau, mais l’Européen eut le temps de se réfugier dans sa maison. L’autre Européen, A. Censier, qui partageait le même bâtiment, ne sachant pas ce qui se passait, sortit de sa maison et se retrouva nez à nez avec Musafiri. Il prit la fuite à son tour mais fut rattrapé par Musafiri qui le frappa mortellement à coups de couteau. Musafiri se rendit au commissariat de police et, jetant à terre le couteau ensanglanté, il dit simplement : « Voilà, je viens de tuer un Blanc ». Il fut arrêté, jugé sommairement et pendu publiquement le 20 septembre 1922.
Dans la mémoire populaire, Musafiri est un symbole de courage. Il a été capable de se faire justice (l’adultère d’un Blanc avec une femme noire même mariée ne comptait pas) ; il a eu le courage de se présenter lui-même devant la justice des Blancs ; il a accepté sa peine sans manifester la moindre défaillance ni la moindre hésitation, ce qui, lors de son exécution publique, impressionna la foule présente tant du côté des Noirs que des Blancs. Il faut rappeler qu’il était domestique, « l’homme des Blancs », donc de la classe des lettrés de l’époque, chrétien, sachant lire et écrire et s’exprimant raisonnablement en français. On comprend qu’il soit qualifié de « Bwana », à la fois par ce qu’il représentait et par son acte courageux. Cet épisode démontre à quel point la civilisation apportée était ambiguë et combien les colonisés avaient une perception juste de ses contradictions : la « justice » européenne ne sanctionnait pas l’adultère de certains, ne tenait pas compte des circonstances atténuantes et se laissait influencer par l’esprit de vengeance ; la morale chrétienne fermait les yeux, tolérait que tout Blanc soit servi par une ménagère noire, au départ désignée par le chef coutumier puis, peu à peu, choisie parmi les meilleures filles dans les missions… Cette page « marquante » de l’histoire coloniale serait tombée dans l’oubli, si la documentation populaire ne l’avait pas réactualisée.
4.2.4 Epilogue
En conclusion, l’étude des témoignages artistiques permet de se rendre compte que l’itinéraire colonial a laissé des empreintes, auxquelles toutes les couches sociales ont fait écho. Si les évolués optaient volontiers pour l’écriture et les académies pour exprimer leurs conflits intérieurs, le peuple, lui, donnait libre court à son inspiration dans la chanson et la peinture populaire. Ces différents genres allaient désormais compter dans la pratique artistique du pays.
La fin de la période coloniale vit aussi l’éclosion d’un autre art, le cinéma, dont une étude complète vient d’être achevée (Ramirez F. et Rolot C., 1985). Mais elle fut davantage le fait des colons et ne put devenir une technique d’expression à la portée des Africains [75]. Le cinéma colonial signa une production impressionnante (environ un millier de films) qui fut essentiellement l’œuvre des missionnaires. Deux publics étaient visés par cette production : les Blancs de la métropole, à qui étaient destinés en premier lieu les films à tendances ethnographique et géographique ; ceux de la colonie, en mal d’évasion, étaient plutôt avides de films d’aventure, qui leur permettait d’échapper, par l’imagination, à « la prison » de l’Afrique. Ce genre de films fut également produit pour meubler les loisirs des colons.
La catégorie des « films coloniaux » était destinée aux indigènes, et l’on n’hésita pas à pratiquer le cinéma de plein air, dans les missions et les centres extracoutumiers. A lui seul, ce cinéma réunissait plusieurs genres, regroupant des films de loisir du type « Aventures de Mata-Mata et Pili-Pili » (œuvre du P. Haelst) et des films « éducatifs » du genre « Le bonheur est sous mon toit » (Abbé Cornil, 1956) en passant par les épopées retraçant l’œuvre coloniale et missionnaire, dont le point culminant fut le film Tokende (G. De Boe, 1957). A côté des films de fiction, la cinémathèque congolaise comportait aussi des films documentaires, des films sur l’actualité coloniale et religieuse, des documentaires illustrant la fraternité belgo-congolaise, etc.
Il faut retenir qu’un certain sentiment d’éveil a toujours existé parmi les Congolais et que celui-ci s’est développé, dès le départ, en réaction à l’ordre colonial. Certes, cet éveil s’est exprimé de multiples façons, depuis les « résistances » à l’action politique – notamment lors du recrutement de la main-d’œuvre – jusqu’à la bataille des Evolués, en passant par l’opposition messianique, l’exemple type de l’outil d’origine coloniale utilisé pour s’opposer à la colonisation. L’indépendance ne faisait pas encore l’objet d’une revendication, mais du moins la colonisation était-elle dénoncée et combattue. De toute évidence, le système mis en place aurait pu connaître un sursis, s’il avait été capable de se remettre en question et d’être attentif à l’évolution profonde du peuple. Mais une autocritique aussi radicale dépassait ses compétences.
Texte Quelle sera notre place dans le monde de demain ?
« Liberté d’expression accordée aux indigènes du Congo belge et faculté par eux d’user de la presse, vraie ou invraisemblable nouvelle ?
Hier à peine, une telle nouvelle constituait une utopie, un terrain dangereux sur lequel il n’était pas prudent de laisser gambader son esprit. Considérés comme de « grands enfants » et traités comme tels, la maturité d’esprit nous a toujours été méconnue. Il ne nous a, par conséquent, jamais été permis de faire entendre notre voix. Ce musellement a laissé dans nos esprits une telle impression qu’avec du temps nous finîmes par acquérir une grande timidité ; aussi émettre une opinion par la voie de la presse est pour nous une chose pleine d’appréhensions.
Par contre, nonobstant ces appréhensions, de tout temps nous avons déploré l’absence de moyens de nous entraîner au développement de nos facultés. Nous voyions, nous entendions, nous observions, nous lisions des journaux locaux et étrangers, nous suivions par là de près les opinions émises sur nous, nous sentions, mais jamais il ne nous a été loisible de nous exprimer librement. Cette restriction mentale fut et a toujours été pour nous une véritable torture morale qui nous aigrissait chaque jour davantage.
Mais voilà que, brusquement, latitude nous est laissée aujourd’hui d’user de la presse pour librement exprimer nos sentiments…
Vraie ou invraisemblable nouvelle ?
… Si depuis l’Annexion, le Congo n’a plus qu’une seule et même destinée avec la Belgique, désormais sa métropole, n’est-il pas logique que les habitants évolués du Congo belge jouissent de mêmes droits civils que les Belges de la Métropole ?
A cette prétention de notre part, l’on a souvent opposé cette objection que les Belges de la Métropole ne peuvent être mis sur le même plan que nous les évolués du Congo belge, parce que quel que soit le degré de notre évolution, celle-ci ne date que de fort peu de temps, alors que les Belges de la Métropole ne sont arrivés au degré actuel de la civilisation qu’après des siècles d’efforts continus ; que c’est par erreur que, cherchant à précipiter la marche des choses, nous réclamons la jouissance des mêmes avantages qu’eux ; mais qu’au contraire nous devons laisser au temps la charge de notre progression, suivant la loi de la nature.
Tout en reconnaissant la valeur de cette objection, nous avouons qu’elle nous surprend bizarrement, car malgré le peu de temps que nous avons mis pour parvenir au degré d’évolution où nous en sommes aujourd’hui, nos Civilisateurs n’ont pas un instant pensé qu’il incombait au temps la charge de faire de nous des électriciens, des mécaniciens-ajusteurs qualifiés, des menuisiers, des ébénistiers, des cordonniers, des charpentiers, des maçons capables de déchiffrer le secret du plan, des cuisiniers, des tailleurs, des commis de bureau, des mineurs habiles à la manipulation des foreuses pour l’extraction de précieux minerais dans les profondeurs du sol, etc.
D’autre part nous voudrions savoir ce que l’on dirait d’un père qui, après avoir peiné des années durant à amasser une fortune respectable et à se doter des aisances relatives, refuserait à son propre fils d’user et de jouir du fruit de ses labeurs, sous prétexte que son enfant devrait lui aussi passer par des dures épreuves et durant un long laps de temps avant de pouvoir enfin bénéficier des avantages que lui, son père, a tiré de ses sueurs ?
La situation est identique. Devant l’Histoire et aux yeux de l’Humanité, nous, habitants du Congo belge, sommes confiés aux bons soins maternels de la Belgique qui doit veiller à notre heureuse évolution au même titre que ses propres enfants.
En conséquence, forts de cette tutelle et de la conception logique découlant de cette tutelle, nous, indigènes évolués du Congo belge, émettons vivement les vœux suivants :
‘Que le législateur prenne des dispositions telles que soit écarté l’obscurantisme dans tous les domaines et sous tous points de vue ;
Que soit réellement brisée la barrière établie par des considérations ethniques ou raciales ;
Qu’enfin l’horizon de notre Destinée une fois apuré, il nous soit loisible de bénéficier des avantages sociaux et moraux adéquats’.
Mais, afin d’écarter toute équivoque ou confusion, nous croyons devoir nous expliquer.
Par Avantages Sociaux, nous entendons l’accès par nous à des situations précises, engendrant pour nous vis-à-vis de la société tant européenne qu’indigène des obligations et des droits civils, si pas spéciaux, mais du moins nouveaux, nous plaçant dans une situation non pas confondue à celle de n’importe quel indigène, mais le plus possible assimilée à celle de nos Civilisateurs.
Puisque depuis l’Annexion du Congo par la Belgique, notre pays n’a plus que la seule et même Destinée avec la Belgique, nous ne croyons pas qu’il soit déplacé de voir que nous, les enfants de cette deuxième province belge d’outre-mer, ayions une situation civile et des droits civiques les plus équivalents possibles à ceux des enfants de la Mère Patrie.
Nous appelons Avantages Moraux les bénéfices résultant nécessairement de notre accession à la situation ci-dessus esquissée, comme, par exemple, que la manière de nous traiter et les considérations à nous accorder soient sérieuses, susceptibles de nous donner un sens exact de notre responsabilité par rapport aux collectivités de nos concitoyens et par le fait même nous amenant à travailler davantage à notre perfectionnement moral au profit du progrès matériel et social.
En agissant de la sorte, notre maturité dans la civilisation n’en sera que fort heureusement influencée et même hâtée. Et cela éviterait, très certainement, aux Pionniers de la Civilisation cette lassante obligation de sans cesse recommencer la même besogne de génération en génération, ce qui ne manquerait pas, à la longue, de rebuter même aux âmes bien nées qui finiraient par trouver en nous des êtres inaptes au progrès.
Quoi de plus sage et aussi de plus stimulant que de ne pas négliger les résultats, si petits soient-ils, qu’on acquiert au fur et à mesure qu’on travaille ? C’est bien en soignant d’une façon remarquable tes résultats de ses labeurs qu’on arrive aisément à faire mouvoir la chance d’une heureuse réussite. Ce qui, pour te fardeau du Civilisateur, serait un allégement d’autant plus appréciable que nous, génération actuelle, sommes le point de mire de tous ceux qui sont restés en arrière et qui nous observent inlassablement dans nos rapports avec nos Tuteurs. Pour preuve de ce que j’avance, ce récit d’un fait vécu suffit.
Il y a quelques mois, un évolué immatriculé, indigène du Congo belge, a cru devoir signaler à l’autorité du lieu la disparition d’un membre de sa famille revenu du voyage et qu’il n’a pas retrouvé à l’arrivée du bateau. L’agent européen à qui notre homme s’adressait, pour toute réponse, donna à un des policiers présents ordre de faire déguerpir 1e malchanceux garçon sous prétexte qu’il ne devait pas parler en français. Lejeune homme fut poussé et refoulé. Une telle façon d’agir reconnaissons-le est exceptionnelle.
Eh bien, voici le commentaire, entre autres que nous passons sous silence, des badauds qui, de loin, assistèrent à la scène :
‘A quoi bon de faire des études des années durant pour finir, dans la vie pratique et pour des faits insignifiants, par être traité comme n’importe quel primitif ?’…
Pour ceux qui veulent réfléchir, ce commentaire, à lui seul, dit beaucoup et fait voir sous quel angle nous, indigènes évolués, sommes observés surtout à l’occasion des contacts que nous prenons avec les Européens. Ceci fait comprendre aussi qu’il n’y a pas que la compréhension par nous de notre rôle dans la société indigène qui s’impose ; mais qu’il y a surtout la façon dont l’Européen nous traite. C’est celle-ci qui laisse l’impression la plus indélébile et réactionnaire.
Qu’on nous laisse donc libre accès à une certaine situation aisée, avantageuse, sous tous points de vue, et qu’on nous aide efficacement et humainement à nous y comporter avec toute la congruité désirable : ce n’est qu’ainsi qu’on fera de nous de vrais hommes ; notre personnalité respectée, notre patriotisme comme notre loyalisme n’en seront que plus heureusement renforcés pour le bien de nos deux races en fusion.
Trop de restrictions, trop de conditions sévères, des mesures draconiennes, des gestes et des langages brutaux équivalent bien manifestement à une barrière et ne peuvent que nous nuire réciproquement.
Nous ne pouvons arriver à atteindre un niveau de civilisation que si l’on nous laisse de la latitude, que si l’on nous aide en nous faisant accéder à une situation non pas platoniquement avantageuse mais réellement efficiente en tous points de vue.
Voilà notre postulat […] ».
[1] Cf. Rapport de la SEPES Bruxelles, Office de documentation, 1929, Archives Régionales du Shaba (Dossier de la Sûreté). Sur base de la documentation de J.L. Vellut, un mémoire de licence en histoire fut consacré à l’intervention communiste dans l’histoire du Congo belge (Kanku B.M., 1972 ; 1972-73 : 18-24). Une étude exhaustive de la question reste à faire, le travail de A. Wauters (Le communisme et la décolonisation, Bruxelles, 1952) n’ayant pas abordé le cas du Congo belge.
[2] La question du « communisme au Congo » retint l’attention de la presse de l’époque. L’information coloniale publia, le 13 juin 1925, un article paru dans Le Drapeau rouge au titre significatif « Vingt mille Noirs réclament du pain, on leur envoie un Mannequin ». La Libre Belgique (n° 61, 2 mars 1929) publia un article sous le titre « La crise de la décolonisation en Afrique ». En 1938, le Courrier d’Afrique publia un article intitulé « La propagande anticoloniale du Parti communiste ».
[3] Voir Courrier Africain du C.R.I.S.P. (traduction de H. Matota), Bruxelles, 80-81,15 octobre 1968. p. 34 (cité par Vellut J.L., 1987 : 67).
[4] Dix ans après P. Otlet, le même slogan sera repris par J. Booth (Africa for the Africans), Baltimore, 1897. Panda Farnana dont on parlera plus loin fit une lecture attentive de P. Otlet. Lui-même (1864-1944) fut l’auteur de nombreux projets d’avant-garde. Il invita W.E. Burghardt Dubois à tenir une des sessions du IF Congrès panafricain à Bruxelles en 1921 et préconisa la transformation du Palais mondial (où se tint le congrès) en une cité mondiale qui pouvait abriter un jour la S.D.N. et même un futur gouvernement mondial (Vellut J.L., 1987 : 60).
[5] L’idée de l’empire africain fera son chemin, sous le nom d’ « États-Unis d’Afrique » ; l’appellation « Black Star Line » fut reprise par le Ghana indépendant.
[6] C’est l’origine du statut des « territoires sous mandat » qui sera accordé aux anciennes colonies allemandes : Togo, Cameroun, Rwanda-Urundi, Tanganyika, Sud-Ouest africain (Namibie actuelle).
[7] Ce 5e congrès ne put se tenir qu’en mars 1945, après la guerre et eut lieu à Manchester. On y retint la participation d’un certain nombre de futurs leaders de l’Afrique anglophone : Dr Kwamé Nkrumah, Jomo Kenyatta ; George Padmore des Antilles britanniques, futur conseiller de Nkrumah, qui commençait à se révéler comme l’un des théoriciens du mouvement (voir son ouvrage Panafricanism or Communism [Panafricanisme ou Communisme], P.A., 1960).
[8] Ce qui correspond plus ou moins à la 4° Math-Physique ou Commerciale.
[9] Cf. Dellicour M.F., « Une vieille question », Bulletin IRCB, t. 22, 1941, pp. 8-26 ; la citation est tirée de la p. 8 ; voir aussi Idem, Les propos d’un colonial belge (Etudes et portraits), Bruxelles, 1956, pp. 182-183.
[10] Lors de la première guerre mondiale, les troupes de la Force publique soutinrent d’abord les Anglais pour repousser une attaque allemande en Rhodésie du Sud (1915) puis les Français pour la conquête du Cameroun (janvier 1916) ; en un mois elles envahirent la totalité du Rwanda et du Burundi (mai 1916) et s’emparèrent enfin, avec les Anglais, de Kigoma (28 juillet) et de Tabora (19 septembre 1916) (De Saint Moulin L„ 1983 : 105).
[11] Pour les citations qui suivent, voir Congrès colonial, Bruxelles. 18-19-20 décembre 1920), Compte rendu des séances, Bruxelles, 1921, pp. 138 et 212.
[12] J.L. Vellut (1987 : 62), faisant allusion à l’exposé de Panda, souligne que le « bon mukongo » ne put s’empêcher de parler de son terroir. Cette interprétation est sans doute excessive à l’endroit de ce nationaliste qui vivait en dehors du cadre étroit de l’ethnicité congolaise.
[13] Au Congo belge, l’événement passa inaperçu. A Bruxelles, l’Union congolaise fit célébrer une messe à l’église de l’abbaye de la Cambre (Bruxelles), le 18 juillet 1930. Il y eut une assistance nombreuse : un fort contingent de l’Union avec drapeau, une délégation de la Fraternelle des Volontaires coloniaux, avec drapeau, des Vétérans coloniaux, etc. Une gerbe de fleurs fut déposée ensuite sur la tombe du soldat inconnu par les membres de l’Union à la mémoire de leur président honoraire défunt.
[14] Cette circulaire n’était qu’une confirmation de « l’interdiction provisoire » qui avait déjà été ordonnée par son prédécesseur, le gouverneur général E. Fuchs (voir la Circulaire du 13 juin 1913).
[15] Estimations établies par B. Jewsiewicki.
[16] Cf. chapitre précédent.
[17] Propos recueillis auprès d’un ancien combattant à Lubumbashi (2 mars 1980) (Mabiala M., n., 1980 : 154).
[18] On peut citer d’autres témoignages prouvant que cette opinion était générale, et partagée tant par les coloniaux (cf. Vermeulen V., 1947 : 115 ; Compte rendu analytique du Conseil de gouvernement, année 1948, p. 19), les vétérans coloniaux (cf. ce périodique n° 35, juin 1945), que les membres du gouvernement belge, comme en témoigne la déclaration du ministre des Colonies, A. De Vleeschauwer (Denuit D., 1946 : 106).
[19] Vauriens.
[20] Foutu.
[21] Sûreté d’État du Congo belge, Lettre FS/BS/n0 821.
[22] AEEK (Anciens élèves des Ecoles de Kinshasa) à ses débuts, elle devient l’AADEPS (Association des Anciens Elèves des Pères de Scheut) puis l’ADAPES (Bontinck, F., 1983 : 411).
[23] Le nom de « Dericoyard » se transformera à nouveau dans l’authenticité des années 70 pour devenir » Dericoye ».
[24] Cette évaluation a procédé d’un autre critère, celui du répertoire des « travailleurs intellectuels » (contremaîtres, agents à responsabilité de commandement) ; en 1957, ils étaient estimés à 143 865 et à 176 896 en 1958 (cf. Rapport aux Chambres législatives sur l’administration de la colonie du Congo belge pour l’année 1956, Bruxelles, p. 95).
[25] Victime d’exactions coloniales, cet évolué ne trouva son salut que dans la fuite à Brazzaville, ville où il était né et où il avait fait ses études au Petit Séminaire. Ses écrits – notamment le roman Ngando – marquent le début de la littérature congolaise (cf. Editions Georges-A. Deny, 1948, 119 p.).
[26] A propos des violences physiques, l’idéologie coloniale s’était arrangée pour sanctionner moralement toute velléité de riposte de la part des autochtones. Frapper un missionnaire et donc, un Blanc, était considéré comme un péché ; c’est dans la fièvre de la décolonisation que ce « dérapage » deviendra plus fréquent.
[27] Ce projet de statut fut reproduit dans L’Avenir colonial belge (26e année, n° 348, vendredi 14 décembre 1945).
[28] Kabamba était commis principal dans l’administration coloniale ; il devint en 1946 président de l’APIC (Association du Personnel Indigène de la Colonie), le syndicat des Fonctionnaires noirs de Léopoldville.
[29] Des comités d’information furent constitués parmi les Evolués de Léopoldville. La section « presse », sous la présidence de Bolamba, comptait entre autres Michel Mongali et Dominique Zangabi. La section « radio » avait entre autres pour membres Jean-Pierre Dericoyard et Fernand Essandja. La section « bibliothèque » enfin était composée de Jean Bolikango, Eugène Kabamba, Joseph Kasa- Vubu et Paul Lomami-Tshibamba.
[30] Nous reprenons ainsi avec ses hésitations la liste établie par J.L. Vellut (1974 : 61-93) retravaillée par Mukala Kadima-Nzuzi (1984 : 20-21). Pour des renseignements complémentaires, consulter la bibliographie de H. Kassels et J. Hacha (Congo, n° 1, 1936 pp. 85-95) et celle de Jean Berlage (1959).
[31] La gestion de l’information au Congo belge dans le cadre des agences de presse a fait l’objet d’une étude systématique (cf. Lonoh Malangi Bokelenge, 1982, 2 tomes).
[32] Antoine-Roger Bolamba (alias Bolamba Lokole) se révéla aussi un brillant littéraire et un essayiste de talent. Ses autres publications, en plus de ses articles, en font foi (cf. L’Echelle de l’araignée, Léopoldville, s.d., 43 p. ; Premiers Essais, poèmes. Elisabethville, 1947. 61 p. ; Esanzo, chants pour mon pays, poèmes. Présence Africaine, 1955, 45 p. L’édition bilingue (français-anglais) de ce dernier ouvrage a été publiée par Jean Pallister aux Editions Naaman, Scherbrooke, Québec, en 1977, 78 p. Pour sa biographie, consulter Gérard A., « Antoine-Roger Bolamba ou la révolution subreptice », Revue Nouvelle, n° 22, 1966, pp. 286-298) ou encore Mukala Kadima-Nzuzi (1984, chap. IV : 103-157).
[33] L’itinéraire des Evolués à travers cette revue a fait l’objet de quelques études de la part des intellectuels locaux (cf. Lisobe J., « L’analyse du contenu de la Voix du Congolais, 1945-59 », Cahiers congolais de la Recherche et du Développement, vol. XV, n° 3, 1970, pp. 46-70 ; Ngandu Nkashama, « La Voix du Congolais et la prise de conscience des évolués », ; Lectures Africaines, CELRIA, Lubumbashi, 1972-73 ; Eloko, 1975).
[34] Cf. Ordonnance législative n° 82/AIMO du 17 mars 1946 complétée par les Ordonnances n° 98, 99, 100 et 128/AIMO des 6 avril et 10 mai instituant les « conseils d’entreprise», les «comités locaux », les » commissions régionales et provinciales du Travail et du Progrès social indigènes ».
[35] Cf. Ordonnance n° 98/AIMO du 6 avril 1946 modifiée par les Ordonnances n° 21/18 du 20 janvier 1948 et n° 21/357 du 13 octobre 1948 (cf. Bulletin Administratif, 1946 et 1948).
[36] Cf. Compte rendu analytique des Conseils de province (1948, 1949) de ces provinces.
[37] Stefano Kaoze, tabwa d’origine, fut le premier Congolais ordonné prêtre en 1917. Encore étudiant à Baudouinuille, il rédigea un essai sur la « psychologie des Bantu » qu’il publia, précédé d’une introduction dans la Revue Congolaise (1910-11, pp. 401-437 et 1911-12, pp. 56-63). Auteur de nombreuses lettres rédigées en français ou traduites du kitabwa ou du swahili (par le P. Colle) qu’on peut lire dans la Revue congolaise (1911-12, pp. 141-161) et dans Missions d’Afrique des Pères Blancs (1922, 1929, 1934), Kaoze a également publié une note ethnographique : « Le métier à tisser chez les Batabwa » dans Congo, 1928,1, pp. 515-519. Il fut le premier Noir à siéger au Conseil du gouvernement de la colonie. Le diocèse de Moba a publié sa biographie (Stefano Kaoze, prêtre d’hier et d’aujourd’hui, Editions St-Paul, 1982).
[38] Jacques Massa deviendra une personnalité politique éminente après 1960, tandis que l’abbé Loya, originaire de Kimpako, fut aumônier des évolués ; sur lui, l’ABAKO eut beaucoup d’espoir… à l’instar de l’abbé Youlou à Brazzaville. Il mourut par accident peu de temps avant le 30 juin 1960 (cf. Pierre Détienne, Communication personnelle).
[39] Cf. Ordonnance n° 21/258 du 12 juillet 1948 (Bulletin Administratif, 1948).
[40] Discours du gouverneur général Jungers au conseil du gouvernement, session 1951.
[41] Suivant l’Ordonnance n° 42/AIMO du 7 avril 1937 concernant la circulation nocturne, il était interdit aux indigènes de circuler dans le quartier européen… « entre dix heures du soir et quatre heures et demie du matin » (art. 1).
[42] Le bateau avait 4 classes. La première réservée aux Blancs ; la deuxième aux Asiatiques, mulâtres, prêtres ou séminaristes noirs ; la troisième aux évolués ; la quatrième aux autres Congolais.
[43] Rapport annuel à la Chambre des Représentants sur l’administration du Congo belge (années 1953, 1954, 1955, 1956, 1957).
[44] Sous la conduite de L. De Saint Moulin, une série d’études furent entamées au Département d’histoire de l’Université de Lubumbashi sur les villes et centres urbains du Congo. On citera entre autres, les travaux de Kambalume K.M., Matadi Ute-Useng, Obotela Rashidi, Pili-Pili Kagabo, Rugagi N., Sita N. (1973) respectivement sur Butembo, Kikwit, Bunia, Bukavu, Elisabethville et Matadi ; Sebihene M.B. (1974), Mikombe ye K., Kayemba Mulumba, Tenda K. (1976), Bompate A. Mbula, et Fazili M. (1977) sur Goma, Kamina, Kananga, Kindu, Mbandaka, Kongolo. Le point fort de cette recherche fut la thèse de Sabakinu Kivilu sur la ville de Matadi (1981).
[45] Léopoldville et Elisabethville sont retenues, non seulement pour leurs situations géographiques respectives mais aussi parce qu’elles regroupent des populations différentes subissant des contacts extérieurs également différents. Léopoldville est proche du Congo et donc de l’Afrique équatoriale française tandis que Elisabethville est aux portes de la Rhodésie du Nord (Zambie) et donc de l’Afrique du Sud.
[46] On se rappellera que c’est l’ethnographie linguistique qui révéla aux Africains leurs identités interethniques de « bantu », « soudanais » et « nilotiques ». Si le concept de » semi-bantu » n’avait pas été combattu, il aurait constitué une autre identification interethnique.
[47] En 1957, cette fédération comprenait, semble-t-il, 48 associations tribales affiliées et 50 000 membres (Young C., 1967 : 116).
[48] Dans ce processus de construction tribale, il reste encore une démarche à accomplir, celle de la construction d’une fédération entre les Luba du Shaba et ceux du Kasaï. Plusieurs tentatives ont été menées en vain. Le clivage demeure, de même qu’il en existe un autre avec les Tetela, groupement tribal qui partage le même territoire géographique que les Luba.
[49] Cette appréciation eut un effet particulièrement destructeur au Rwanda et au Burundi où les « nilotiques » (Tutsi) furent confortés dans leur opposition avec les Bantu (Hutu). Il en résultera des guerres « tribales » après les indépendances.
[50] Voir partie 2, chapitre 3.
[51] On se référera ici à l’œuvre de Mukala Kadima-Nzuji sur la « littérature zaïroise de langue française » (Karthala, 1984) particulièrement les pp. 83-296 et à l’étude de Joseph-Marie Jadot sur les écrivains africains du Congo belge et du Rwanda-Urundi (ARSC, BX. 1959).
[52] Bontinck s’est exprimé dans deux textes : « Badibanga, Blanc ou Noir ? », Zaïre-Afrique, 206, juin- août 1986, pp. 369-373 et « Badibanga, singulier ou pluriel ? », Quaghebeur M. (ed.). Papier blanc, encre noire, Bruxelles, Labor, 1992, pp. 146-170. La dernière confusion provient de ce que le mot « badibanga » signifie en ciluba « combien sont-ils ? ». Ainsi « Badibanga ne Mwine » signifierait « Combien sont-ils ? (il est) tout seul ».
[53] Les lettrés d’avant Badibanga n’ont pas laissé de textes littéraires.
[54] La traduction française en a été établie et publiée par Jaime Castro-Segovia et Jacques Lanotte : cf. Mopila, Ed. du Mont Noir, Coll. « Objectif 80 », 1972.
[55] Ce texte parut d’abord dans le journal Etoile-Nyota avant d’être publié dans le BJIDCC (14e année, n° 10, juillet-août 1948, pp. 304-316 ; n° 11, septembre-octobre 1948, pp. 321-345).
[56] En 1967, Munongo publia ses « chants historiques des Bayeke » dans Problèmes sociaux congolais, n° 77, pp. 35-140.
[57] Une étude systématique reste à faire sur les écrits coloniaux. On sait que l’ouvrage du P. Van Zijndijke (Pages d’histoire du Kasayi) est essentiellement la » traduction » d’une étude faite en ciluba par un Congolais. Il existe par ailleurs une importante littérature « de fiction » d’origine coloniale (cf. notamment la contribution de P. Halen, Le petit belge avait uu grand, Bruxelles, Labor, 1993) qui mériterait d’être exploitée comme une « source » disponible de l’histoire culturelle de la Belgique et du Congo.
[58] Cf. la Voix du Congolais, Léopoldville, n° 20, novembre 1947, p. 871 ; texte repris de la Revue coloniale belge du 15 septembre 1947.
[59] En 1953, Bolamba fit partie d’une délégation » officielle » de Congolais qui visita la Belgique : elle fut composée du Mwant Yav des Lunda, du grand chef des Bashi, d’Henry Bongolo, chef de la cité de Léopoldville, de Joseph Kiwele organiste-compositeur, de Bonaventure Makonga de l’Etoile-Nyota et de Bolamba. Ce dernier publia ses impressions et celles de ses compagnons à l’issue de ce « premier » séjour (cf. Nous nous y sommes sentis chez nous : quinze congolais découvrent la Belgique, Kalina, Editions de l’information du gouvernement général, juin 1953).
[60] Mais ce recueil présentait encore des différences importantes par rapport au reste du langage poétique négro-africain de l’époque. Un écrivain sénégalais contemporain, David Diop d’heureuse mémoire, s’en est fortement étonné. « Est-ce la prudence (nous connaissons la particulière… sévérité de l’administration royale) qui incite Bolamba à s’éloigner des thèmes trop dangereux ? Car il est impossible qu’il n’ait vu de son pays que ce qu’il raconte… » (P.A., III, août-septembre, 1955, p. 79).
[61] En décembre 1959, il se présenta aux élections législatives à l’Equateur sous l’étiquette de MNC-L ; il fut battu. A l’accession du Congo à l’indépendance, cet intellectuel, qui avait joué un rôle déterminant, de surcroît président de l’ASSANEF ne fut nommé que secrétaire d’État. En août 1960, il remplaça Philippe Kanza et Mathieu Ekatou à la tête de l’Agence congolaise de Presse (ACP) et fut remplacé peu après par Pascal Kapella.
[62] Le concours de la Foire coloniale de Bruxelles connut une deuxième édition (1949) puis une troisième (1950). A la deuxième, le prix fut remporté par Joseph Saverio Naigiziki avec son récit « Mes pénibles souvenirs » (publié en 1950 par Georges-A. Deny sous le titre d’Escapade ruandaise ») ; à la troisième édition, aucun prix ne fut décerné à cause de la qualité insuffisante des manuscrits. Une mention honorable fut cependant attribuée aux textes de Bolamba, Kabasubabo et Mutombo. Sur ce « temps fort » littéraire et éditorial, voir Marc Quaghebeur (ed.), 1992, particulièrement les contributions de E. Van Balberghe et de P. Haffner.
[63] En 1973, il publia La récompense de la cruauté aux Editions du Mont Noir puis Ngemena (Editions CLE, 1981) ; il mourut en 1987, en laissant un texte inédit : « Ah Mbongo ».
[64] Les sept collections étaient intitulées : Lumière et Vie, Eveil. Elite, La Vérité, Etoile. Beaux Métiers et Collection en langues vernaculaires. Dans le catalogue de 1966, on note l’existence de trois nouvelles créations : la collection « Construisons le pays » animée par l’INAS (Institut national pour Animateurs sociaux), » Memento » et « L’Afrique raconte ». Pour l’analyse du contenu de la revue Congo-Afrique, se reporter à l’article de Sumaili « Congo-Afrique et la culture 1966-1970, un bilan de cinq années », Congo-Afrique, n° 54, avril 1971, pp. 211-219 et à la contribution d’André Cnockaert « La revue Zaïre-Afrique. Trente ans de chronique littéraire » dans le collectif de Marc Quaghebeur, 1992, déjà cité pp. 519-536.
[65] Il est dommage que ce phénomène « social » important n’ait pas encore fait l’objet d’une étude systématique. Signalons quelques études sommaires de Bwantsa Kafungu (Congo en musique, Léopoldville, 1965, ronéo) ; de Lonoh (Michel) Malangi Bokelenge (Essai de commentaire sur la musique congolaise moderne, Léopoldville, 1969 ; Négritude, Africanité et musique africaine, Kinshasa, 1990) ; de Kanza Matondo (Musique zaïroise moderne, Kinshasa, 1972, ronéo) et de Luyela Kikedi [Les débuts de la musique zaïroise moderne à Kinshasa (1935-1953), mémoire de licence en histoire, Lubumbashi, 1981], Pour l’étude des aspects thématiques, on dispose des travaux de Tshonga Onyumbe dans Zaïre-Afrique, notamment « La femme vue à travers la musique zaïroise moderne, de 1960 à 1980 », 1982, pp. 83-93 ; « Nkisi, nganga et ngangakisi dans la musique zaïroise moderne, de 1960 à 1981 », n° 169, 1982, pp. 555-556 ; « L’homme vu par la femme dans la musique zaïroise moderne de 1960 à 1981 », n° 184,1984, pp. 229-243 ; « L’homme dans la musique zaïroise », n° 186,1984, pp. 357-365 ; et de quelques autres contributions (Mabengo K. L’impact de la musique zaïroise, Essai d’analyse sociologique des œuvres de Lwambo Makiadi,Lubumbashi, mémoire de licence en sociologie, 1985 ; Kiley T.L.D., Valeurs et antivaleurs à travers les chansons africaines, Lubumbashi, mémoire de licence en philosophie, 1987 ; Mula E.B., La symbolique de la production discographique deZaïko Langa-Langa, Lubumbashi, mémoire de licence en sociologie, 1991).
[66] Nous n’aborderons pas ce dernier sujet dans le cadre de notre exposé. L’étude de P. Ngandu Nkashama (« Ivresse et vertige : les nouvelles danses des jeunes au Zaïre», L’Afrique littéraire et artistique, n°51, s.d., pp. 94-102) n’analyse ce contenu que pour la décennie 1970-80. Cette étude permet de se convaincre de la pertinence de ce genre d’analyse pour la compréhension de l’évolution « sociale » du Congo. L’inventaire des danses fait l’objet du tableau 20.
[67] Nom du quartier populaire le plus animé de Kinshasa. Ce terme désigne également le quartier bruxellois où sont installées les boutiques congolaises. A l’origine, le mot « matonge » (du singulier « litonge ») désigne un fruit sauvage, sans doute fort répandu dans la région.
[68] Il n’est pas impossible, note Sylvain Bemba, que l’abdication du roi Edouard VIII en 1936 pour redevenir le duc de Windsor ait défrayé l’actualité jusqu’au cœur de l’Afrique et… justifie également le surnom de Wendo(1984 : 73).
[69] Nous remercions Me Kinkela Vi Kan’sy d’avoir bien voulu nous donner communication des éléments de son « Anthologie de la chanson zaïroise de protestation » (inédit).
[70] A propos de l’art congolais, citons quelques études récentes remarquables. Il s’agit de celles de Joseph Cornet (Art de l’Afrique noire au pays du fleuue Zaïre, Arcade, Bruxelles, 1972 ; Art royal Kuba, Milan, 1982), de François Neyt (La grande statuaire Hemba, Louvain-la-Neuve, 1977 ; Traditional art and history in Zaïre, thèse Louvain, 1981) et de Jan Vansina (Art history in Africa, Londres, 1984). Signalons quelques travaux congolais importants qui sont des mémoires de licence en histoire à l’Université de Lubumbashi : Mpungu Mpolonto A. (1972) sur les Itumba Leele, Malutshi Mudji-Selenge (1973) sur les Masques mbuya des Pende ; Belepe Bope Mabintch (1974) sur les Masques bwoom des Kuba ; Lubingo K. (1974) sur les Masques des Pende orientaux ; Lutala Amuri M. (1974) sur la problématique des Arts Lega ; Mackunya cha M.S. (1974) sur les Sièges historiés cokwe ; Mambulu K. (1974) sur les Statuettes de maternité chez les Mbala ; Mutimanwa W.M. (1974) sur les Masques blancs Luba ; Tshisanda N.M. (1974) sur la maternité dans l’Art Lulua ; Niangi Batulukisi (1981) sur les Masques yaka. Deux thèses de doctorat, de Lema Gwete (La statuaire dans la société teke, T.C. Morphologie et contexte culturel, Louvain, 1978) et de Belepe Bope M. (La triade des masques bwoon, moshAmboy et ngandy a mwaash des Kuba au Zaïre, Louvain, 1982) complètent cette documentation.
[71] En dehors des catalogues d’exposition, les études sur l’art plastique moderne sont fort limitées, cf. Bamba Ndombasi K., Initiation à l’art plastique zaïrois d’aujourd’hui, Kinshasa, 1973 ; Badibanga ne M., Contribution à l’étude de l’art zaïrois moderne, Kinshasa, 1977 ; Bamba Ndombasi K. et Musangi Ntemo, Anthologie des sculpteurs et peintres zaïrois contemporains, Nathan, 1987 ; J. Cornet, 40 ans de peinture zaïroise, 1990.
[72] Cf. Mudimbe V.Y., «African Art as a Question Mark», African Studies Reuietv, 29, n° 1, 1986, pp. 3-4 ; Jewsiewicki B. (ed.), Art et politiques en Afrique noire, Safi, 1989, spécialement le texte introductif de l’éditeur « Le langage politique et les arts plastiques en Afrique » (pp. 1-10) et l’article de T.K. Biaya, » L’impasse de crise congolaise dans la peinture populaire urbaine. 1970-1985 » (pp. 95-120). De ce dernier auteur, il faut lire aussi » Cinq tableaux historiques populaires du Zaïre * (1970-1985) ; » Essai sur les relations entre la mémoire collective, l’ethnicité et l’histoire immédiate », Analyses sociales, 1987 (à paraître). Sur le thème de l’histoire et des pratiques populaires, on consultera avec intérêt les textes édités par Jewsiewicki B. et Moniot H. sous le titre de Dialoguer avec le léopard ? Pratiques, savoirs et actes du peuple face au politique en Afrique noire contemporaine, Paris-Québec, L’Harmattan-Safi, 1988 ; Jewsiewicki B. (ed.), Art pictural zaïrois, Québec, CELAT, 1992.
[73] Le mythe du mamiwata est répandu sur toute la côte atlantique ; dans la région du Golfe de Guinée, ce personnage mythique est connu sous le nom de « mammy water » d’où « mamiwata » tire vraisemblablement son origine. Le mythe est très ancien car il est déjà signalé par Pigafetta (1591). Son origine est sans doute liée à la vision des femmes européennes (phénomène fort rare à l’époque) sur les bateaux qui abordaient les rivages africains. « La femme blanche avec de longs cheveux » est alors entrée dans la légende… qui subsiste encore de nos jours.
[74] Bogumil Jewsiewicki a fait une interprétation du tableau (cf. « La mort de Bwana François à Elisabethville », Annales Acquatoria, 8, 1987, pp. 405-413) ; pour des informations complémentaires voir Cola Musa (« Récit de la mort de Bwana François », pp. 165-170) et J.L. Vellut (« Une exécution publique à Elisabethville – 20 septembre 1922 – notes sur la pratique de la peine capitale dans l’histoire du Congo », pp. 171-222) dans Jewsiewicki B. (ed.), Art pictural zaïrois, Québec, CELAT, 1992.
[75] Quelques grands talents africains s’illustrèrent dans cette activité, notamment le sergent Bumba (qui deviendrait ensuite général, puis capitaine-général).



