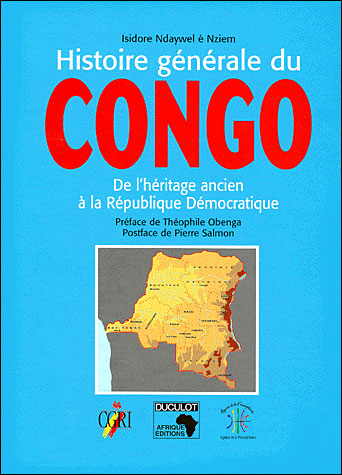
Partie 4 - Chapitre 3 : De la visite à la guerre
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 3
De la visite à la guerre
A la fin du XVIIIe siècle, le tournant amorcé par le règne du commerce d’origine externe atteignit son stade ultime. Les Congolais d’alors passèrent de surprise en surprise. Après la zone côtière, l’arrière-pays découvrait, à son tour l’Européen, cet autre Etranger qui ne se confondait pas avec l’Arabe. Ses apparitions, épisodiques au début du siècle, se firent plus fréquentes et plus nombreuses à mesure que les années passaient. La visite innocente en apparence allait conduire à une opération de conquête qui ne manqua pas de heurter la volonté du peuple et de produire tensions et oppositions. En fin de compte, la colonisation s’installa.
L’ère de la visite des Etrangers a précédé celle de la confiscation des terres, le premier moment préludant au second. Les Congolais ne s’en rendirent compte que tardivement. Au cours des premières décennies du siècle, l’Europe était encore préoccupée, avec une certaine dose de sincérité, des questions scientifiques. Il fallait meubler les blancs des cartes et dissiper des interrogations sans réponses. A l’époque, on est au siècle de l’Angleterre, la Société royale de géographie de Londres faisait notamment le constat de la médiocrité des renseignements qu’on avait sur le fleuve Congo, trois siècles après la reconnaissance de son embouchure par Diogo Câo. Ce fut l’occasion, pour les riverains du fleuve en amont de l’embouchure, de vivre une première expérience de contact avec un homme blanc. Il s’appelait James Kensington Tuckey, un officier de la Royal Navy. Il était chargé de vérifier si le fleuve Congo, dont on ne connaissait que l’embouchure, s’identifiait avec le Niger coulant à Tombouctou. Avec ses hommes, en 1816, il tenta de remonter le fleuve mais ne put le faire que jusqu’à Isangila, sans parvenir à contourner les chutes de Yelela. Même s’il y trouva la mort avec plusieurs de ses hommes, le capitaine Tuckey parvint, grâce à son expédition, à apporter les premières précisions sur cette région du pays (Tuckey, 1818). Ce triste souvenir détourna pendant longtemps l’attention de l’Europe de cette région.
Il a fallu attendre quelques décennies pour qu’une expérience semblable soit renouvelée. En 1884, Ladislas Magyar remonta le fleuve. Parvenu aux chutes de Yelela, il longea le cours du Kwanza jusqu’au Kwango. Avant lui, le lieutenant Grandy, en 1873, s’était aventuré également sur le fleuve mais il s’orienta, à partir des chutes, vers Sâo Salvador en Angola. L’Allemand Pogge qui était entré au Kasaï par l’Angola, s’installa pendant deux ans dans le pays de Kapanga avant de rentrer en Europe en 1877. Les souvenirs de son séjour sont consignés dans un livre fameux : Im Reich des Mwata Yamuo. Le même Pogge effectua, trois ans plus tard, un autre voyage dans la région, en compagnie de son compatriote Herman Von Wissmann, celui-là même qui allait devenir le grand explorateur du Kasaï (Cornevin R., 1966 : 78-80 ; Lederer A., 1988 : 183-212).
Mis à part ces cas de rencontre dans la partie occidentale du pays, les incursions européennes étaient surtout le fait du Congo oriental, spécialement des alentours des Grands Lacs. En février 1858, deux Blancs firent une apparition auprès des riverains du Tanganyika. Un autre Blanc fut signalé en 1864 sur les rives du lac Albert ; un autre encore fut aperçu en 1868 du côté des lacs Bangwelo et Moëro. En 1869, un autre Européen est remarqué dans la région du Tanganyika, un autre encore au nord-ouest du lac Albert, au bord de l’Uélé… Surprise : ces Blancs étaient chaque fois différents. Mais leurs motivations étaient plus ou moins identiques : ils avaient été envoyés là pour arriver à situer avec exactitude la ou les sources du Nil, ce fleuve dont l’embouchure en delta était bien connue depuis des siècles pour avoir abrité la prestigieuse civilisation pharaonique (Cornevin R., 1989 : 115-117).
En 1858, Burton et Speke, deux officiers de l’armée des Indes, furent chargés par la Royal Geographical Society de s’approcher des fameuses chaînes de montagnes signalées par Ptolémée (les monts de la Lune) où devaient se trouver les sources du Nil. Les deux compagnons atteignirent Tanganyika le 13 février (Burton, 1862). Peu après, Speke qui avait continué vers le nord, parvint le 30 juillet au lac Nyanza qu’il baptisa du nom de Victoria. Il eut la confirmation que ce lac était la source du Nil puisqu’il s’échappait par une rivière s’écoulant vers le nord. Fier de cette observation, Speke retourna à Londres le 8 mai 1859. Son compagnon Burton, encore malade, avait dû s’arrêter à Eden. Vexé de voir son ami recueillir seul la gloire de la découverte des sources du Nil, il prétendit que celui-ci n’avait rien prouvé. Cette contestation obligea Speke à organiser une nouvelle expédition avec le capitaine Grant pour confirmer que le lac Victoria constituait bien la source du Nil. Ce fut chose faite le 17 novembre 1861 sur la rive occidentale du lac. Descendant le Nil blanc en pirogue, ils rencontrèrent le 15 février 1863 Sir Samuel Baker qui remontait le cours du Nil ; la jonction était faite. Désormais, on était sûr de l’identité du lac Victoria et de la rivière qui y prenait sa source (Speke J.H., 1865). En effet, Baker était dans la partie du cours du fleuve en provenance du Congo ; poursuivant sa course, il atteignit même, le 14 mars 1864, le lac Nzige qu’il baptisa « lac Albert », en l’honneur du mari de la Reine d’Angleterre, et démontra que ce lac constituait une autre source du Nil (Lederer A., 1988 : 188-189). Plus tard, Mobutu donnera à ce lac son propre nom.
L’Européen aperçu du côté des lacs Bangwelo, Moëro et Tanganyika n’était autre que le fameux missionnaire David Livingstone ; cet ancien ouvrier fileur écossais, devenu pasteur et médecin, n’en était pas à son premier séjour en Afrique, il avait déjà procédé à la reconnaissance du lac Ngani et du Zambèze moyen, foulé le sol congolais dans la région de Dilolo et traversé le continent d’ouest en est. Entre Bangwelo et Moero, il cherchait lui aussi à résoudre l’énigme des sources du Nil, bien décidé à consacrer les dernières années de sa vie à élucider cette question. Partant du lac Bangwelo, il s’engagea vers le nord jusqu’à Udjidji sur le Tanganyika (mars 1869) ; il retraversa le lac en direction du nord-ouest jusqu’au Lualaba (mars 1871) ; épuisé, il rebroussa chemin, traversa à nouveau le Tanganyika ; c’est alors qu’il rencontra le 10 novembre un journaliste, Henri Morton Stanley, venu à sa recherche (Stanley H.M., 1879). Les deux hommes explorèrent le pays au nord du Tanganyika ; après quoi, Stanley rentra au pays, laissant là Livingstone trop passionné par ses recherches pour envisager un retour en Europe. En fait, au soir de sa vie, il était près de prouver que le Lualaba était la source du fleuve Congo (Livingstone D., 1874 :193-194). Il s’éteignit le 30 avril 1873 sur les rives du lac Bangwelo.
Entre-temps, en Europe, on était toujours sans nouvelles, non seulement de Livingstone, mais aussi de Stanley parti à sa recherche. Deux autres expéditions de secours furent organisées, l’une par la côte ouest, l’autre par la côte est. Celui qui eut la charge de la première, le lieutenant Grandy, trouva la mort à Sâo Salvador. Quant à l’expédition par la côte orientale, elle était commandée par Verney Lovett Cameron, lieutenant de la Marine qui disposait d’une certaine connaissance de l’endroit pour y avoir navigué près de trois ans. Bien qu’il eût appris la mort de Livingstone, il décida de poursuivre ses recherches et atteignit le Tanganyika le 18 février 1874 ; il gagna ensuite le Lualaba qu’il ne put descendre, faute d’embarcation. C’est alors qu’il décida de continuer sa route vers le Lomami et le Haut-Kasaï et se retrouva à Bangwelo, sur la côte occidentale, en 1876. Après Livingstone, il venait à son tour d’effectuer la traversée de l’Afrique, de la côte indienne à la côte atlantique (Cameron V.L., 1878). Il aurait constitué une grande référence dans l’histoire du Congo et aurait du coup évincé son concurrent potentiel Henri Morton Stanley s il avait descendu le fleuve.
L’énigme du Nil n’était pas l’objet des préoccupations de la seule Société Géographique de Londres. D’autres aussi cherchaient à percer ce mystère, au départ de l’embouchure de ce fleuve vers les terres méridionales ; dans cette recherche, le souverain d’Egypte les encourageait. Une grande expédition fut mise sur pied, donnant le ton à toutes celles qui suivirent, menée par le botaniste allemand Georges Schweinfurth. A partir de Khartoum, il atteignit Fachoda le 24 janvier 1869 puis pénétra dans le pays des Zandé et des Mangbetu en 1870, nous laissant une foule d’impressions et de descriptions sur cette région, y compris sur les Pygmées de l’Uélé et les méfaits de la traite des esclaves dans les bassins de l’Oubangui et du Bahr el-Ghazal (Schweinfurth G., 1875).
A la suite de Georges Schweinfurth. il y eut d’autres voyages, notamment ceux de Giovanni Miani, du docteur Papagiotis Potagos, de Junker et Bohndorff. A Paris, l’Italien Miani entendit parler des sources du Nil. A son retour, il se passionna pour la question. Il s’installa à Khartoum. En 1872, à la nouvelle du voyage de Schweinfurth dans le pays Mangbetu, il pénétra dans le pays de l’Uélé qu’il ne quitta plus avant sa mort. C’est lui qui fit la reconnaissance du cours inférieur de la Bomokandi, établissant que cette rivière était un affluent de l’Uélé. Quant à Papagiotis Potagos, il parvint, toujours sur la lancée de Schweinfurth, à atteindre le Shinko. Junker était un médecin russe, passionné de voyage bien avant de rencontrer Schweinfurth qui l’intéressa à l’exploration du Soudan. Avec un compagnon, l’Allemand Bohndorff, il parvint au confluent du Mbomu et de l’Uélé. Il nous a laissé de précieux renseignements sur les populations rencontrées (Cornevin R., 1989 : 122-125).
Mais ces différentes incursions se limitaient à la périphérie du territoire congolais. C’est le grand voyage de Stanley qui allait dévoiler les secrets du fleuve Congo aux Européens, offrant enfin à la grande majorité des groupes ethniques congolais l’occasion de faire la découverte de l’homme blanc. Né au Pays de Galles, John Rowlands, journaliste américain avait pris par la suite le nom de son père adoptif ; il était déjà célèbre pour avoir retrouvé Livingstone dans la région des Grands Lacs. De plus, le grand public était friand des récits issus de sa plume lyrique, habile à rendre compte du pittoresque des régions « exotiques » visitées. Il revenait d’un reportage en Gold Coast quand il apprit la mort de Livingstone. Se considérant comme héritier spirituel de celui qu’il avait été le dernier Européen à rencontrer, il participa à ses obsèques solennelles à Londres, décidé à continuer son oeuvre d’explorateur en Afrique. Ce choix correspondait d’ailleurs à l’attente du grand public et justifiait les appuis et le soutien matériel que deux grands journaux américains – le New York Herald et le Daily Telegraph – étaient prêts à lui fournir. L’entreprise était tellement attrayante qu’il reçut plus d’un millier de propositions. Mais il ne choisit finalement que trois collaborateurs, tous anglais, Frédéric Barker et les frères Pocock.
Le 17 novembre 1874, l’expédition de Stanley quitta Bangamoyo escortée de 356 personnes. Elle fit le tour du lac Victoria puis des lacs Mobutu et ldi Amin ; elle descendit vers le Tanganyika puis, par la Lukuga, elle déboucha sur le Lualaba qu’elle descendit jusqu’à Nyangwe chez Tippo-Tip qui, trois ans auparavant, avait accueilli Cameron lors de son passage chez lui. Jusque-là, Stanley était en terrain connu. Fallait-il par la suite continuer la descente du fleuve ou rentrer vers la côte indienne ? Il se décida à poursuivre la descente du fleuve, avec le concours de Tippo-Tip. En janvier 1877, il était au large des Falls qu’il entreprit de contourner le 8 janvier, se rendant compte que le fleuve n’en finissait pas de s’orienter vers l’Ouest, ce que lui confirma un riverain qui naviguait sur le fleuve Congo. Il était donc assuré d’aboutir sur la côte atlantique. Parcourant sans grande difficulté le Haut-Fleuve, il atteignit, le 12 mars, le Pool que Pocock baptisa du nom de son chef, Stanley-Pool. Mais le 25 juillet, l’expédition se trouva à nouveau en face des chutes. Les difficultés rencontrées par l’équipe pour les franchir eurent des conséquences meurtrières ; le 6 août, dans un état d’épuisement total, Stanley rédigea et envoya à Borna un message de détresse demeuré célèbre : « A n’importe quel gentleman parlant anglais » pour demander de l’aide. La réponse ne se fit pas attendre et le 9 août, une délégation de 5 Européens arriva de Borna pour l’emmener ; parmi ceux-ci se trouvait Alexandre Delcommune, le seul Belge qui travaillait dans les factoreries de Borna. L’Europe savait enfin que le Lualaba, loin d’être une source du Nil, constituait le cours supérieur du Congo, dont l’embouchure était fort bien connue depuis la fin du XVe siècle (Stanley H.M., 1879).
La fin du troisième quart du siècle apporta quelque changement : non seulement les visiteurs augmentaient en nombre, mais de plus ils créaient sur place des postes de travail en vue de s’installer. Ils cherchaient même à acquérir des terrains. Cette préoccupation nouvelle était le fait de tous les Etrangers, missionnaires ou commerçants.
Les premières implantations protestantes furent l’œuvre de la Livingstone Inland Mission (LIM), mission créée à cet effet à Londres en 1877. Le nom de Livingstone désignait le fleuve Congo, baptisé ainsi par Stanley. Le premier missionnaire s’installa à Palabala, en amont des chutes. En 1879, le long du fleuve, à une centaine de kilomètres de là, on créa Mbanza Manteka, un nouveau poste. En 1882. deux autres postes furent créés en aval du Pool qui ne fut atteint qu’en 1883 ; un bateau, amené en pièces détachées, fut alors monté pour la conquête du Haut-Fleuve. La tâche devint trop considérable pour la seule LIM. Elle fut rejointe par la Baptist Missionary Society (B.M.S.) déjà implantée au Cameroun depuis 1844. Deux jeunes missionnaires y furent détachés : Thomas J. Cambier et Georges Grenfell. Ils s’installèrent à Sâo Salvador, considéré comme une base de départ idéale en direction du Pool. Grâce à un bateau qui leur avait été offert – le Peace – les Baptistes commencèrent à partir de 1884 à s’aventurer au-delà du Pool. Des actions considérables furent poursuivies dans le même sens. Grenfell apporta une contribution décisive à l’exploration du Kasaï et de ses affluents (Johnston H., 1908) ; William H. Bentley réalisera un travail linguistique considérable sur la langue kikongo (1887, 1895).
Du côté catholique, l’archevêque d’Alger avait déjà réalisé la fondation de deux missions, à proximité du territoire du Congo : celles de Nyanza et du Tanganyika. Il désirait étendre cette action. Les Pères du Saint-Esprit qui se virent confier pour évangélisation la partie occidentale de l’Afrique centrale en 1865 par un décret de la Sacrée Congrégation de la Propagande, s’installèrent à Borna en 1880 où ils ouvrirent une mission religieuse et une école. De là, ils se mirent à rayonner. Le poste de Linzolo sera créé en 1884, celui de Kwamouth en 1886 (Demeus D.F. et Steenberghen D.F., 1947 : 22-25).
Simultanément, Henri Stanley faisait une nouvelle apparition du côté de l’embouchure en 1878. Hier, simple voyageur, il se préoccupait à présent de créer des postes. Il fonda celui de Vivi, à l’endroit le plus éloigné de l’arrière-pays accessible à la navigation à partir de la côte. Puis ce fut Isangila. Plus loin, à l’autre extrémité des cataractes, il créa le poste de Léopoldville en décembre 1881, avec le consentement de Makoko et après des tractations avec Ngaliema, le grand trafiquant Teke qui dominait cette région. Stanley lança ensuite sur les eaux son petit bateau à vapeur, l’En Avant, et poursuivit son chemin à l’intérieur du pays. A chaque nouveau poste créé, il faisait flotter un « drapeau bleu à l’étoile d’or ».
Tout ceci était incompréhensible pour les autochtones. Pour saisir la portée de ces comportements, il aurait fallu savoir ce qui se passait à ce moment-là dans les pays des Blancs, et en particulier dans ce pays d’Europe occidentale qui a pour nom la Belgique. Située entre l’Allemagne, la France et la Hollande, au large de l’Angleterre, cette région sortait d’une longue période de dépendance, ballottée depuis la Renaissance entre les ducs de Bourgogne, les Habsbourgs d’Espagne, les Habsbourgs d’Autriche et les Empereurs de France. La dernière emprise dont elle s’était détachée, en 1830, était celle de Guillaume de Hollande, grâce à l’appui de la France et de l’Angleterre. Optant pour un régime monarchique héréditaire et parlementaire, les Belges choisirent d’abord comme souverain un Français – Louis de Nemours. Mais devant l’opposition de l’Angleterre, la France se désista. On retint le candidat anglais qui avait l’avantage d’avoir un itinéraire personnel fort composite. D’origine allemande, Léopold de Saxe-Cobourg s’était fait naturaliser Anglais et épousa, en premières noces, en 1816, l’héritière du trône britannique, Charlotte. Veuf, il se remaria en 1832 et épousa Louise d’Orléans, la propre fille du roi des Français, situation qui apaisa le ressentiment de ceux qui étaient déçus par le désistement du premier roi élu. Léopold était par ailleurs un ami des célèbres banquiers Rothschild qui devaient non seulement gérer sa fortune personnelle mais contrôler aussi les finances de l’Etat belge avec la collaboration de la Société Générale de Belgique, fondée à l’époque du règne de Guillaume des Pays-Bas.
Le deuxième souverain, Léopold II, s’employa à poursuivre l’œuvre de son père, tirant profit de ses alliances « familiales » avec la France, l’Angleterre, l’Allemagne et le monde des affaires pour consolider l’indépendance et la neutralité du jeune Etat. A trente ans, il succéda à son père, le 17 décembre 1865, bien décidé à trouver des débouchés nouveaux pour l’industrie belge pour compenser ceux que la séparation d’avec la Hollande avait fait perdre au pays. C’est bien avant de devenir roi qu’eut lieu son premier contact avec l’Afrique. En effet, il visita l’Egypte en 1865, avant de voyager en Extrême-Orient. En 1860, il envisagea d’acheter le sultanat de Sarawak. En 1867, deux ans après son couronnement, il tenta en vain d’acquérir le Mozambique. Il se tourna alors vers les Philippines et proposa, en 1868, de les racheter à l’Espagne. Ce fut peine perdue. Il était fasciné à l’idée d’acquérir une colonie. Il vouait une grande admiration à l’œuvre colonisatrice hollandaise, impressionné par le revenu important que les territoires occupés pouvaient rapporter à la mère patrie. Dans cette quête, l’Afrique l’intéressait au plus haut point mais rien de précis ne s’offrait à son attention, qui ne pût être considéré comme un défi aux grandes nations engagées dans la course pour la conquête des territoires d’outre-mer. Le peuple belge était beaucoup trop réaliste pour croire à une utopie, fût-elle d’origine royale. C’est ainsi que l’entreprise de Léopold II était a priori vouée à l’échec ; elle échoua effectivement partout, sauf au Congo. Il ne se découragea pas pour autant, et ne se déclara pas satisfait de posséder uniquement le Congo. En 1898, plus d’une décennie après la fondation de l’E.I.C., il était toujours à la recherche d’autres colonies. Les régions du monde les plus diversifiées excitaient son intérêt : le Haut-Nil où il lança une grande expédition qui devait progresser jusqu’au cœur du Soudan, l’Erythrée qu’il essaya d’obtenir en bail de l’Italie, les Philippines qu’il proposa également de prendre en bail, les îles Carolines et les îles Mariannes dont il demanda le prix au gouvernement espagnol, la Chine enfin où il chercha à se procurer des concessions de mines et de chemins de fer afin d’être en bonne position pour le jour où les puissances en présence en viendraient à se la partager (Stengers J.. 1985 : 25).
Pour en revenir au cas du Congo, ce fut un hasard, heureux pour lui, que son dessein ait pu aboutir à une réalisation concrète. Il semble que l’idée de cette conquête lui serait venue d’une lecture. En 1875, parut la version française du livre de Schweinfurth sous le titre : « Au cœur de l’Afrique ». L’auteur y exposait qu’à son avis, le moyen le plus efficace de supprimer la traite des Noirs serait la formation de grands ensembles politiques africains indépendants et forts qui réuniraient les territoires les plus exposés aux rapts pour les placer sous le protectorat des puissances européennes (Roeykens A., 1956b : 46). Léopold II trouvait enfin un projet à accomplir, à la fois d’ordre humanitaire et international. Il pourrait réaliser un Etat comme celui qui était décrit : centralisé, militarisé, placé sous la protection de l’internationalisme. Son ambition politique pourrait y trouver provisoirement satisfaction, tout en profitant à son pays. L’année même de cette publication eut lieu la visite du sultan de Zanzibar en Angleterre. Ce fut le signe pour Léopold II que le sort politique de l’Afrique centrale allait se décider. Au demeurant, il n’est pas exclu qu’il ait été en rapport avec H. Stanley, avant son départ pour la traversée du continent africain (Roeykens A., 1958 : 14-48) ; en effet, la découverte de l’inconnu était une autre passion de Léopold II. Au début de 1876, Emile Banning, archiviste-bibliothécaire au Ministère des Affaires étrangères, avait attiré l’attention du public belge sur l’Afrique centrale dans trois articles de l’Echo du Parlement. La région congolaise constituait encore un blanc sur la carte de l’Afrique. C’est pour combler ce vide que tant d’expéditions s’étaient succédé depuis les premières recherches de Livingstone, en 1859. Le temps était venu de risquer une action publique et concertée.
Le souverain belge conçut donc l’idée de convoquer une Conférence internationale de géographie pour faire le point sur les connaissances acquises jusque-là, qui regrouperait toutes les personnalités intéressées par l’aventure de l’exploration africaine ou qui y seraient impliquées : hommes de terrain, savants et hommes politiques. Les Etats étaient donc représentés aux côtés des personnalités invitées pour leurs compétences intrinsèques. L’initiative avait une portée vraiment historique. La Conférence géographique de Bruxelles eut lieu du 12 au 14 septembre 1876, rassemblant des délégués de la plupart des pays intéressés par la question : notamment la France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Autriche et la Russie. A l’issue des travaux, on décida de créer une Association internationale pour la civilisation de l’Afrique (A.LA.) qui se dota d’une structure souple : chaque nation pouvait créer en son sein un Comité national. Le roi fut désigné président de l’association épaulé par un secrétaire général nommé par lui en l’occurrence, le baron J. Greindl. L’AIA eut soin de se doter d’un emblème, un drapeau bleu à l’étoile d’or (Roeykens A., 1958 : 23-30), que l’on vit désormais flotter en Afrique.
Avec la Conférence géographique de Bruxelles, commence l’aventure de la Belgique outre-mer, bien qu’elle demeurât encore timide pendant plusieurs années. Deux sociétés de géographie furent créées en ce sens au cours de la même année 1876 : La Société beige de géographie de Bruxelles et la Société de géographie d’Anvers. La section belge de l’AIA s’illustra dès le début par son dynamisme et se mit aussitôt à la besogne, à partir de la côte orientale. Sur l’itinéraire d’est en ouest, deux stations seront créées au bord du Tanganyika, Karema en 1880 sur la rive orientale et Mtowa, en 1881, sur la rive occidentale.
Avec l’arrivée de Stanley à Borna (août 1877), Léopold II tenta une première ouverture publique. La nouvelle de cette traversée retentissante, dévoilant le mystère du fleuve, frappa son attention et son imagination. Il faut dire que l’événement était de taille. Avec l’annonce de l’arrivée de Stanley à Borna, le monde de l’époque se trouvait dans une situation de surprise et de curiosité analogues à celles du monde actuel après le premier voyage sur la lune ou après la découverte de Mars. Désormais la surprise ne porterait plus que sur des détails (Nicolai H., 1988 : 13). Léopold II eut l’avantage de comprendre qu’une partie importante de la course pour l’hégémonie politique et commerciale allait se jouer. Aussi envoya-t-il ses émissaires à la rencontre de Stanley pour l’inviter à Bruxelles. Celui-ci commença par décliner l’invitation du roi, préférant accorder la primeur du capital d’informations qu’il détenait à l’Angleterre. Mais déçu par le peu d’empressement que manifesta son pays d’origine, il revint ensuite vers Léopold II, dans l’espoir de rentabiliser les reconnaissances qu’il venait d’effectuer en Afrique centrale. Un Comité d’Etudes du Haut-Congo (CEHC) fut alors créé le 25 novembre 1878, dans le but de tirer parti de ce vaste bassin qui venait d’être ouvert au monde. On constitua un capital fait de plusieurs souscriptions. Le colonel Strauch, désigné Secrétaire général de l’A.LA. en remplacement de Greindl, allait jouer un rôle déterminant dans la relation entre Stanley et Léopold II (Wauters A.J., 1899 : 20).
La vraie genèse de l’Etat Indépendant du Congo venait de commercer. Il fallait désormais faire de la politique, créer des stations et conclure des traités, obtenir des territoires et les agrandir. A partir de ce moment, silence et discrétion furent de mise. Même Stanley, pourtant journaliste et reporter, observa le silence. Débarqué à Borna, il se mit au travail, créant des postes tout au long du fleuve jusqu’aux Falls. Le « Comité d’Etudes » disposait de quatre bateaux – le Royal, le S/S Belgique, le S/S Espérance et le S/W En Avant – tous engagés dans la conquête du Haut-Fleuve et de ses affluents. Des renforts arrivaient régulièrement de Belgique pour participer à la réalisation du projet. Stanley arriva ainsi au lac Maïndombe, ce qui confirma à ses yeux que la communication entre la mer et le Haut-Congo était possible, à condition d’établir un réseau ferroviaire entre la côte et le Pool. Il le baptisa « lac Léopold II ».
La création des postes n’allait pas sans problèmes, surtout celle du poste situé au Pool. Le chassé-croisé avec Savorgnan de Brazza, qui revendiquait lui aussi la possession du Bas-Fleuve, mais au profit de la France, préoccupait le souverain. Ce Français d’origine italienne refusa de travailler pour le compte de Léopold II, et obligea même celui-ci à dévoiler ses ambitions politiques. En effet, pour contrecarrer les actions de Brazza, le souverain belge ne pouvait pas se contenter de l’AIA ni du CEHC où il n’avait pas les coudées franches, ayant à rendre compte à un éventail de souscripteurs. Aussi décida-t-il de dissoudre le CEHC le 17 novembre 1879 pour le remplacer par l’Association Internationale du Congo (AIC). A partir de cette date, le développement de l’entreprise devint exclusivement l’oeuvre de Léopold II puisqu’elle n’associait en réalité que Léopold II avec lui-même. Pendant ce temps-là, le travail sur le terrain se poursuivait sans relâche. En mai 1883, Stanley quitta le poste de Léopoldville, fondé en 1881 en amont du fleuve, avec trois vapeurs et une baleinière, en compagnie de Van Gele et de Coquilhat. La station d’Equateurville qui allait devenir plus tard Coquilhatville (actuellement Mbandaka) fut fondée le 17 juin 1883 (Lufungula L., 1983 : 301-312). Par la fondation de Stanley-Falls en décembre de la même année, Stanley couronnait l’œuvre, commencée en 1879, et commandée par l’AIA de réaliser la jonction des expéditions provenant de l’est et de l’ouest (Ceulemans P, 1959 : 58-60) et de relier les deux côtes par une chaîne de stations scientifiques et « hospitalières » (Nicolai H., 1988 : 14).
Finalement, depuis la Conférence internationale de Bruxelles, en moins de 10 ans, un travail considérable avait été réalisé ; plus de 100 peuplades avaient été visitées, plus de 500 traités avaient été conclus avec des chefs locaux, près de 40 stations avaient été créées et 5 steamers étaient en circulation sur les eaux du fleuve. L’opération se poursuivait de plus belle ; il en allait de même des découvertes géographiques, ce qui réduisait d’autant les zones jusque-là restées blanches sur la carte de l’Afrique centrale.
En 1881, Wissmann et Pogge atteignirent le lac Mukamba en plein cours du Kasaï. En 1882, comme on l’a dit, Stanley repéra l’existence d’un autre lac aux sources de la rivière Kwa, le lac Léopold II. L’année suivante, ce fut le tour du lac Tumba. Jusqu’au début de 1885, les cours du Kasaï et de l’Uélé n’étaient pas encore bien connus. Le Kasaï, dont on connaissait bien le cours supérieur grâce aux traversées régulières des plateaux angolais, constituait une véritable énigme quant à son embouchure sur le fleuve. On l’assimilait à ce niveau à l’Ikelemba ou à la Ruki : certains estimaient que le Kasaï se jetait dans le fleuve après avoir traversé un grand lac central. Il fallut attendre que Wissmann descende le cours du Kasaï et atteigne le Kwamouth en 1885 pour éclaircir définitivement ce mystère. La découverte de la Lukenye (1885), du Sankuru (1886) puis du Kwilu plusieurs années plus tard finirent par compléter la connaissance du bassin du Kasaï. Le sud-est fut parcouru par Bôhm et Reichard qui entrèrent en contact avec Mushid Ngelengwa. En mai 1884. Reichard visita seul les mines de cuivre près du village du chef Katanga et, quelques mois après, Capello et Ivens, venant de Saint-Paul-de-Loanda, visitèrent cette région lors de leur traversée du continent. A la même époque, on explorait les cours des grandes rivières de la Cuvette : Busira, Ikelemba, Oubangui, Itimbiri (1884-1885) ainsi que la Lomami inférieure.
Le nord-est du pays, comme on l’a dit, fut surtout parcouru par Junker de 1877 à 1881 ; en 1881, il séjourna chez le chef de Ndoruma, au bord de l’Uélé.
L’Autrichien Edouard Schnitzler (Emin Pacha) voyagea à l’ouest du lac Mobutu. La grande énigme restait l’Uélé. Junker, poursuivant les explorations de Schweinfurth, avait parcouru le Bomokandi et le Nepoto dont il croyait encore en 1884 qu’il était un affluent du Chari. Mais Stanley corrigea cette information en 1885 en présentant l’Uélé plutôt comme un affluent direct du Congo. La question avait une implication politique car elle concernait la délimitation du bassin du fleuve. Il a fallu attendre 1887 pour que cette énigme soit définitivement levée lors de l’arrivée de Van Gele au confluent de l’Uélé et du Bomu (Nicolai H., 1988 : 15-17).
On commençait donc à bien connaître les lieux. Sur le terrain, l’oeuvre était impressionnante ; avec la concentration des stations, une véritable occupation de l’espace prenait forme. Il fallait gérer tout cela, donner à cette action une signification politique. Mais laquelle exactement ? Le problème était délicat car il n’était pas évident que l’Europe des Grands puisse se contenter de demeurer simple spectatrice des initiatives multiples de ce souverain, fût-il celui du plus petit Etat du continent.
Au début, Léopold II rêva de créer une vaste fédération des populations du bassin du fleuve Congo ; en cela il s’inspirait du modèle libérien mis au point par les Etats-Unis. Le roi était en quête d’une certaine caution internationale pour soustraire ce vaste territoire de l’AIC aux convoitises d’autres puissances, notamment celles de la France, de l’Angleterre et du Portugal, et pour réaliser enfin, en un second temps, son projet de doter la Belgique d’un territoire d’outre-mer. La France ambitionnait d’occuper entièrement le Pool et de faire flotter son drapeau sur les deux rives ; l’Angleterre, quant à elle, nourrissait une vieille ambition qu’elle tenait absolument à réaliser la jonction du Cap au Caire (C to C) ; tous les territoires orientaux situés entre ces deux points extrêmes devaient lui revenir ; le Portugal faisait prévaloir son « droit historique » sur l’embouchure, en tant que premier pays à avoir pris possession de cette région du continent. Léopold II, quant à lui, devait sauver le statut « d’indépendance » de ses possessions par rapport à ces différents réseaux de colonisation naissants. Mais quel type d’indépendance et surtout indépendance par rapport à quoi ? En quelques années, ses propres conceptions n’avaient fait qu’évoluer. Il avait d’abord demandé (novembre 1882) qu’on reconnaisse ses « villes libres » (les stations fondées au Congo), puis ses « stations et territoires libres » (février 1883) puis les « Etats libres du Congo » (novembre 1883) et enfin (janvier 1884) l’« Etat libre du Congo » (Stengers J., 1989 : 53).
Sur un plan plus général, l’Afrique, devenue l’objet des convoitises de plusieurs pays d’Europe, risquait de devenir une pomme de discorde entre les nations européennes. Une tentative de concertation s’avéra nécessaire, afin de calmer les esprits, dissiper les malentendus et prendre acte des parties de territoire occupées par chacun des pays. Elle eut lieu à Berlin, sous la présidence du chancelier Bismarck, ami personnel de Léopold II. Ce détail constituait l’un des nombreux atouts dont le souverain belge disposait à cette conférence. Il y avait aussi la qualité des membres de la délégation belge au nombre desquels figurait E. Banning, le grand théoricien du roi en matière de colonisation. Au sein de certaines délégations, Léopold II comptait de puissants alliés, notamment parmi la délégation américaine dont H.M. Stanley était membre. La conférence dura trois mois, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. L’objectif poursuivi était d’aboutir à une entente entre nations du Nord au sujet de l’exploitation de l’Afrique.
Les conclusions de la conférence furent présentées en un Acte général de Berlin. Elles consistaient en un vaste traité en sept chapitres et trente-huit articles accompagnés de dix protocoles et de cinq rapports qui en faisaient le commentaire. Cet Acte général prônait la liberté du commerce, la lutte sur terre comme sur mer contre la traite, la neutralité du bassin du Congo même en cas de guerre, la navigation libre sur le Congo et sur le Niger bien que l’administration de ces fleuves fût réservée aux puissances riveraines. Toute prise de possession sur les côtes de l’Afrique devrait être notifiée et ne serait valable qu’à condition d’être effective (Wauters A.J., 1899 : 31-33).
La question du Congo n’était pas à proprement parler à l’ordre du jour de la conférence. Mais Léopold II profita de la circonstance pour obtenir la reconnaissance par les puissances représentées de la souveraineté de l’AIC. En effet, la conjoncture générale était favorable au projet léopoldien de déclarer autonomes et indépendants les territoires prospectés dans le cadre de l’AIA. Chacun des Etats participants y trouvait son compte dans la mesure où, à défaut de pouvoir se les approprier, il ne devait plus craindre de voir ces territoires tomber sous la domination d’une puissance étrangère. Avant la Conférence de Berlin. Léopold II avait commencé déjà à solliciter la reconnaissance de la neutralité de cette région. Il l’avait obtenue non seulement de l’Allemagne de Bismarck (le 3 novembre 1884) mais, bien avant encore, des USA (le 22 avril). Ce pays, qui faisait à l’époque son entrée dans le monde international, s’était volontiers laissé séduire par les idées léopoldiennes de liberté et d’indépendance ; les Américains firent même le déplacement jusqu’à Berlin ; pour la première fois, leur pays siégea dans une conférence internationale aux côtés de treize Etats européens parmi lesquels on trouvait la Russie, le Danemark, la Suède et la Norvège.
Dans les coulisses de la conférence, les démarches se poursuivirent, savamment menées par les collaborateurs de Léopold II, le colonel Strauch et E. Banning. Elles finirent par aboutir. Ce fut d’abord la Grande-Bretagne (le 16 décembre 1884) qui reconnut l’existence de cet Etat, puis l’Italie (le 19 décembre), l’Autriche-Hongrie (le 24 décembre) et les Pays-Bas (le 27 décembre) suivis de l’Espagne (le 7 janvier 1885) ; ensuite la Russie et la France (le 5 février), la Suède (le 10 février), le Portugal (le 14 février) et enfin le Danemark et la Belgique (le 23 février). Le 14e Etat, à savoir la Turquie, n’accordera sa reconnaissance que bien plus tard (le 25 juin). Les négociations furent plus laborieuses avec le Portugal et la France. Pour conserver la rive droite du bas-fleuve avec les deux ports de Banana et de Borna, on accorda la cession du bassin du Kwilu-Niari ; l’essentiel était de parvenir à un accord général, au prix de concessions importantes.
Le 23 février 1885 fut une journée historique. La conférence reçut la notification du Président de l’AIC de sa reconnaissance, comme Etat souverain, par toutes les nations présentes à Berlin, à l’exception de la Turquie. L’Etat indépendant du Congo était né. Il sollicita et obtint son adhésion à l’Acte général de Berlin, le 26 février et fut la seule nation « africaine » à avoir été présente à Berlin du moins en cette dernière journée (Stengers J., 1985 : 14-15).
La Conférence de Berlin avait vécu. Au cours des décennies suivantes, ce rendez-vous acquit un retentissement qu’il n’avait pu susciter à l’époque. On a pu s’en rendre compte notamment grâce à l’importance prise par ce chapitre dans les lectures qui nous ont été proposées de l’histoire africaine, qu’elles soient de la plume de G. Hardy (1922), de Ch.A. Julien (1942), de H. Deschamps (1952), de R. Cornevin (1956, 1964), de Ganiage (1968), de H. Brunschwig (1971) ou de J. Ki Zerbo (1971). En Afrique, on a pu s’en rendre compte par l’audience qui fut accordée à la célébration de son centenaire en 1984-1985 [1]. Ceci démontrait à suffisance le caractère hautement significatif que le monde contemporain attachait à cet événement historique.
Pourtant, si l’on s’accorde sur son importance historique, son contenu précis se prête à des interprétations différentes, voire même divergentes. La première méprise à relever est le fait que, si cet événement est aujourd’hui perçu sous un angle dépréciatif, les contemporains de la conférence et ses participants n’avaient nullement mauvaise conscience. Au contraire, ils étaient fiers d’avoir abouti à une aussi belle réalisation, intéressante à tous points de vue pour l’Europe comme pour l’Afrique. La presse de l’époque n’a pas manqué de souligner ce fait comme en témoigne cet article paru dans le journal Indépendance belge du 2 mars 1885 :
… Les navires pourront désormais aller et venir librement sur tous les cours d’eau qui sillonnent cette zone de trois millions de kilomètres carrés [,..]Les ouvriers que notre vieux sol ne peut plus nourrir et qui n’ont plus d’autre travail que de manifester leur manque de travail, trouveront là-bas une terre hospitalière où ils exploiteront l’ivoire, la gomme, les céréales, toutes les ressources de ces fertiles régions sous l’œil protecteur d’Etats civilisés dont les frontières sont maintenant régularisées, dont les lois libérales sont garanties dans leur fonctionnement.
Les 80 millions d’indigènes, livrés jusqu’ici à toutes les entreprises des trafiquants d’esclaves sont assurés pour l’avenir de leur habeas corpus. Leurs protecteurs européens sont là engagés d’honneur et décidés à tenir à distance les brebis de proie humaine. Plus de servitude à craindre ; au contraire, la liberté morale elle-même garantie à ces malheureux ; la liberté d’exercer leur naïve religion, comme ils l’entendent, et avec cela la faculté, l’occasion de s’instruire, de s’enrichir, de s’élever au niveau des peuples les plus éclairés de l’univers.
On a beau dénoncer les faux rôles que les différentes interprétations ont fait jouer à cette conférence qui n’aurait pas formellement partagé l’Afrique, ni posé le principe des sphères d’influence, ni même reconnu l’EIC qui acquit une sorte de statut de « colonie internationale » (Stengers J., 1985 : 11-19), il n’en reste pas moins vrai que Berlin aura constitué un point de départ, la mise au point d’une méthode d’expansion coloniale qui fait l’économie de conflits entre puissances coloniales ; Berlin apparaît comme l’ébauche d’une première « Société des Nations » où furent conclues les premières conventions internationales qui ne soient pas le résultat d’une guerre (Chambard L., 1985 : 19). Considérée sous l’angle résolument africain, la Conférence de Berlin, en prenant acte des zones d’influence des uns et des autres, a prôné le partage entamé plus tôt et qui allait se poursuivre après elle. L’Europe avait renforcé son unité par ce partage. En ce qui concerne le Congo, la conférence a constitué le premier instant de la célébration collective d’une reconnaissance qui avait été négociée et accordée individuellement. Le premier acte diplomatique du nouvel Etat, confirmant par le fait même son existence, a été posé d’un point de vue juridique. La conférence demeurait incontestablement le point de départ juridique de l’E.I.C. et donc, de l’aventure coloniale au Congo.
Léopold II venait de réaliser brillamment la première partie de son plan. Restait à présent à placer cet Etat dans le giron de la Belgique. Dans l’immédiat, il lui fallait obtenir de cette même Belgique l’autorisation d’être également le souverain du nouvel Etat. L’accord fut donné le 18 avril par un vote du Parlement et il fut confirmé par le Sénat le 30 du même mois : Léopold II, roi des Belges, était le roi-souverain de l’Etat indépendant du Congo.
Pour bien faire les choses, le 1er juillet 1885, Sir Francis de Winton, administrateur général de l’Etat indépendant à Vivi, fit notifier officiellement aux chefs de missions et de maisons de commerce, la fondation de l’Etat indépendant ; le 19 juillet, il proclama la constitution de l’Etat sous la souveraineté de Léopold II de Belgique [2]. Quelque chose d’important venait de se passer, même si les autochtones, qui vaquaient comme d’habitude à leurs activités quotidiennes d’autosubsistance, n’en savaient encore rien. Aux yeux de l’Europe, il était évident qu’un Etat de type moderne venait de se mettre en place. Léopold II l’avait d’abord conçu, on l’a vu, comme une « confédération » des postes créés. Mais c’est la forme centralisée qui finalement l’emporta. On peut affirmer que déjà à ce niveau, la morphologie du nouvel Etat était définitivement établie. Il constituait un tout juridique et politique, et non une multiplicité de petits Etats ; il allait vivre une colonisation composite en dépit des efforts nationalistes de Léopold II, situant son statut à mi-chemin entre l’internationalisme et l’appartenance à la Belgique.
Un Etat de type nouveau était mis en place. Mais l’imposition de cette nouvelle organisation de l’espace, commandée par les Européens, ne s’est pas réalisée sans une longue guerre de conquête. On a essayé longtemps de minimiser cette guerre en évoquant le caractère pacifique de l’entreprise. L’histoire des « résistances » face à l’occupation coloniale qui passait pour être, dans l’historiographie des années 60, une histoire militante, celle qui donnait le ton au nationalisme africain, accréditait, elle aussi hélas, cette vision erronée. Il fallait comprendre que toute la conquête avait été pacifique, à l’exception de quelques « poches de résistances », quelques « révoltes » ici et là dont on rendait compte avec emphase mais qui n’étaient en fait que des combats d’arrière-garde dans une bataille qui était déjà perdue. Les résistances étaient alors « primaires » ou « secondaires » suivant qu’elles s’inscrivaient en faux contre toute présence étrangère ou qu’elles étaient une mise en cause du système ou encore qu’elles constituaient des contestations de certains aspects de l’organisation nouvelle jugés trop contraignants ou trop rigoureux. Hérité de l’histoire européenne de la deuxième guerre mondiale, ce concept de « résistance », dans l’historiographie africaniste, a connu diverses acceptions selon qu’on lui accordait une interprétation élitiste ou populiste. Dans le premier cas, on y a vu la recherche des héros, les premiers porte-parole de l’idée nationaliste. Dans le second, on s’attachait à montrer comment les couches populaires étaient parvenues à constituer des fronts communs pour s’opposer aux conquérants (Ranger T., 1977 ; Vellut J.L., 1987 : 24-25). Nous pensons que les faits africains n’ont pas besoin d’être singularisés par une terminologie excentrique. Les résistances constituent un phénomène qui apparaît en principe dans un état de défaite, réelle ou présumée ; elles sont donc nécessairement postérieures à un état de guerre. Certaines résistances, considérées comme telles dans l’historiographie coloniale, étaient plutôt, comme on va le voir, les différentes « batailles » de la guerre coloniale ; ce n’est qu’après la défaite, bien après, au cours de l’évolution coloniale qu’apparaîtront çà et là des résistances d’une population tombée sous le joug du vainqueur.
Dans le cas du Congo, la conquête coloniale, ou plus précisément l’entrée en colonisation, a fait l’objet d’une longue « guerre de trente ans ». Entamée en 1874, elle s’est poursuivie jusque vers les années 1900, bien que les puissances européennes aient décrété à Berlin en 1885 que leur victoire pouvait être considérée comme déjà acquise (Vellut J.L., 1987 : 24-31). Avant d’en rendre compte, il convient d’élucider l’origine du mythe de la « pacifique croisade » de l’Europe en Afrique, qui aurait abouti à la création d’un Etat indépendant du Congo. On l’a senti, ce mythe procède de la méthode adoptée par Léopold II, du moins sur le plan officiel. Au début, son action a surtout visé à s’insérer dans le circuit des compétitions commerciales qui préexistaient et qui assuraient la distribution des produits européens importés : étoffes, armes, poudre, alcools, etc. C’est ce qui se passe vers les années 1879-81. Les agents du CEHC effectuent des échanges de produits, créant des postes ; ce phénomène n’est pas extraordinaire car il existe d’autres créateurs de postes : les missionnaires, les Portugais et même les autochtones et semi-autochtones, des Teke, des Lunda, des Swahili. Dans ce contexte, l’accueil ne pouvait être qu’empreint de sérénité, de temps en temps troublée par des maladresses ou des malentendus : arrivée non annoncée, provenance d’un territoire considéré comme ennemi, etc. Quand il fut question de cession de terre, l’atmosphère fut la même car dans l’entendement local, toute cession de terre ne pouvait être que partielle, puisqu’une terre ne peut jamais faire l’objet d’une expropriation. Elle demeure toujours liée, sur le plan mythique, à son propriétaire. L’occupant, fût-il européen, ne disposait que de l’usufruit. Il s’avérera qu’en cette matière, l’étranger agissait selon une toute autre logique, dans laquelle la terre convoitée pouvait être arrachée à son propriétaire. Au besoin, celui-ci pouvait être tué pour mettre un terme définivement à ses prétentions. La réalité prouvera que cette vision était plus réaliste que celle de nos ancêtres. Que les agents de l’A.I.A. aient recouru à la signature de traités – l’historiographie coloniale déclare qu’il y en a eu environ 500 -, le fait n’avait pas une grande importance pour les autochtones puisqu’il ne s’agissait pour eux que de cessions provisoires et partielles. D’ailleurs, les agents de Léopold II n’y croyaient pas davantage. S’ils insistaient sur cette formalité, c’était essentiellement pour se mettre à l’abri des contestations de représentants d’autres puissances européennes, sans plus.
C’est là que se situaient les manipulations. Pour les autochtones, la signature des traités, tout comme leur dénonciation, étaient des formalités, fruit des initiatives des étrangers qui les utilisaient comme instruments d’une stratégie d’opposition ou de rapprochement. En effet, face à la pression extérieure, on activait la signature de traités. Dès que le danger extérieur était écarté, le même étranger ne se gênait pas toujours de violer lui-même le traité qu’il avait fait signer aux autochtones. Nombre de traités, signés à l’époque, ont pu être conservés jusqu’à nos jours. La lecture attentive de deux cent cinquante-sept d’entre eux trouvés dans les archives a pu établir une certaine progression dans l’intention de s’approprier les terres. L’ambition, au départ timide dans son expression, ne s’est plus dissimulée dans la suite dans sa formulation. Le premier stade se situe entre 1880 et 1882. Les concessions sollicitées sont petites et concernent uniquement l’installation des stations. Ces cessions ne portaient que sur l’exploitation sans revendication de transfert de droit de souveraineté. L’année 1882 fut l’année intermédiaire où l’on remarque un glissement vers d’autres préoccupations. Les aristocraties locales, signataires des traités, sont placées sous la suzeraineté du CEHC. La transition fut brève. Elle a abouti à des traités franchement politiques. C’est à cette époque que commence le processus de reconnaissance de la souveraineté du CEHC ou de l’AIC (Denuit Somerhausen C., 1988 : 77-146).
Au travers de ces traités, l’odeur de la guerre était perceptible. Ils véhiculaient beaucoup trop d’ambiguïtés pour constituer de véritables symboles de concertation ou de réconciliation. La guerre finit par s’installer. Elle connut trois phases, pas forcément successives mais suffisamment distinctes en fonction des adversaires en présence : Arabes contre autochtones, Européens contre autochtones. Européens contre Arabes. A chaque étape, les autochtones étaient les victimes tout indiquées : non seulement ils vivaient l’état de guerre chez eux, mais de plus ils se trouvaient dans tous les rangs, y compris chez les Arabes et les Européens. Rien que la campagne arabe, dont les autochtones ne constituaient pourtant pas la cible, a fait soixante- dix mille morts dans leurs rangs (De Boeck G., 1987 : 25).
Ces oppositions armées avec les Arabes et leurs auxiliaires étaient le prolongement du climat de guerre et de banditisme qui accompagnait l’essor de l’activité commerciale de l’époque. Mais l’état de guerre véritable vint avec la présence européenne, dès le début des expéditions du CEHC. Les envoyés de Léopold IL mis à part Stanley, étaient tous des militaires de carrière. L’histoire des explorations est en quelque sorte une page d’histoire militaire. Les Européens utilisaient des armes modernes, y compris des canons. Du reste, l’origine de l’usage de l’artillerie sur le sol congolais mérite d’être racontée.
En 1883, le lieutenant d’artillerie Liebrechts, appelé au Palais Royal, fut chargé par Léopold II d’une mission confidentielle. Le roi avait acheté aux usines Krupp douze canons rayés de montagne 7,5 cm. Liebrechts s’en fut en grand secret réceptionner ce matériel en Allemagne et procéder à des tirs d’essai.
Pour ne pas donner l’éveil à des puissances jalouses, canons et munitions furent emballés dans des caisses couvertes de l’étiquette peu compromettante « pièces mécaniques ». A Liverpool, où le jeune officier embarqua son « précieux » chargement, quelle ne fut pas la stupéfaction des devanciers lorsqu’ils virent s’échapper d’une caisse toute une série d’obus… Heureusement, après un échange de télégrammes avec Bruxelles, tout finit par s’arranger.
L’usage qu’on allait en faire ne se fit pas attendre, dès leur transport vers le Haut-Congo.
… Au reçu de l’ordre de Stanley, l’artilleur embarqua une pièce sur l’En Avant et remonta en toute hâte vers Bolobo. Dès son arrivée, on lui fit mettre en batterie la pièce et on convia les indigènes à venir admirer ce formidable fusil… Il fallut le spectacle de l’explosion d’un obus pour amener une réconciliation avec le chef. La station fut rétablie, on y laissa Liebrechts et la flottille continua sa route (FP, 1952 : 24-25).
Les armées autochtones n’étaient pas toujours démunies d’armement moderne comme on pourrait le croire. A cette époque, l’arme à feu s’était largement diffusée par le jeu des échanges commerciaux. Les trafiquants introduisaient couramment des fusils et des munitions qu’ils échangeaient contre des esclaves et de l’ivoire. Un traitant pendu à l’issue de la « campagne arabe » fut trouvé en possession de deux cents fusils Mauser, arme qui, dans la Force publique, était réservée aux officiers (Lejeune-Choquet A., 1906 : 117-118). Mais ce cas était plutôt rare. Les fusils les plus fréquents étaient d’origine locale. En effet, l’artisanat local imitait même cet armement et fabriquait des fusils locaux – pupu – tout aussi efficaces que les armes d’origine étrangère. Parfois, ces fusils explosaient, faisant des ravages dans leurs propres rangs. L’armement des représentants de l’ordre colonial avait l’avantage d’être homogène, alors que les troupes locales utilisaient un armement hétéroclite, fait de flèches, de fusils de marques différentes et de projectiles de toutes sortes.
Une autre caractéristique de cette guerre a été l’utilisation des « mercenaires ». Les Européens utilisaient des personnes qui n’avaient aucune autre motivation dans la guerre que de toucher leur argent à la fin de l’opération. Et quand l’Etat indépendant du Congo s’efforcera plus tard de constituer des troupes locales pour les substituer à « l’armée des mercenaires », l’appât du gain poussera les candidats mercenaires à faire par eux-mêmes le déplacement de Borna pour se faire recruter. Ils avaient pris goût à ce genre de travail. Ces « volontaires » étaient recrutés pour des usages multiples : ils étaient à la fois soldats, porteurs, chasseurs, cultivateurs, maçons et donc bâtisseurs de postes, au gré des circonstances. La première génération de ces mercenaires s’appelaient les Zanzibaristes ; ils étaient trois cents. Stanley les recruta pour réaliser sa grande expédition de 1874. Il fut tellement content d’eux qu’il les ramena à Zanzibar à la fin de l’expédition. Du moins les cent quinze qui survécurent à l’opération. Lorsqu’il travailla à nouveau pour le CEHC, il prit soin de recruter d’abord des mercenaires zanzibaristes avant d’entamer son voyage au départ de Banana. Ceux qu’il recruta étaient pour les trois quarts les vétérans de la première expédition qu’il avait ramenés à Zanzibar. Par la suite, on recruta aussi des gens de Cabinda et des originaires de la côte de Krou (près du cap Palmas) qu’on appelait des Krouboys. Les Sénégalais étaient appréciés mais leur recrutement était difficile à cause des Français qui s’y opposaient. On se mit alors à engager abondamment des Haoussa de la Côte d’Or. Ceux-ci constituèrent pendant longtemps l’élite des troupes car ils étaient souvent d’anciens soldats, possédant un entraînement et un sens de la discipline qui manquaient à la plupart des autres volontaires, à qui on se contentait d’apprendre le maniement du fusil. Plus tard, les zones de recrutement furent popularisées. On eut alors des mercenaires provenant du Liberia, d’Abyssinie, de Somalie et même d’Egypte. Tous étaient invariablement appelés « volontaires de la côte » (FP, 1952 : 11-12).
Tableau 7 — Recrutement des « volontaires de la côte » de 1883 à 1901 (engagements et réengagements)
| 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | Total | |
| Libériens | – | – | – | – | — | 143 | 168 | – | 39 | 59 | 99 | 89 | 12 | 5 | 38 | 20 | 11 | 17 | 8 | 708 |
| Accra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 | 295 | 36 | 5 | 12 | 21 | 20 | 6 | 4 | 491 |
| Abyssins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 412 | – | – | – | — | — | — | — | — | — | 412 |
| Somalis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 215 | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| Egyptiens | – | – | – | – | – | – | – | 217 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 223 |
| Dahoméens | – | – | – | – | – | – | 185 | – | – | 1 | — | – | – | 5 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 198 |
| Zanzibaristes | – | – | – | – | – | 783 | – | 243 | – | – | 593 | – | 32 | 109 | – | 2 | 8 | 2 | 3 | 1775 |
| Haoussas | 50 | 30 | 20 | 5 | 662 | 305 | 15 | 1253 | 548 | 316 | 463 | 774 | 340 | 328 | 76 | 211 | 111 | 37 | 41 | 5585 |
| Sierra-léonais | – | – | – | – | – | – | 204 | – | 9 | 138 | 793 | 715 | 92 | 176 | 98 | 237 | 128 | 85 | 70 | 2745 |
| Totaux | 50 | 30 | 20 | 5 | 662 | 1231 | 572 | 1713 | 597 | 926 | 2355 | 1873 | 512 | 629 | 228 | 492 | 281 | 149 | 127 | 12452 |
(Force Publique, 1952 : 510)
Précisons que l’origine attribuée à ces volontaires faisait référence au lieu de conclusion du contrat de recrutement. Les origines réelles des recrutés étaient bien plus diversifiées. A titre d’exemple, la provenance des trente hommes qui servirent sous les ordres de Coquilhat en 1884 était la suivante : deux de Cabinda (esclaves libérés à la côte), dix-sept de Zanzibar (en fait huit Zanzibaristes, trois Nyamwezi, un Comorien, quatre Swahili, un esclave libéré provenant du Maniema) et onze Houssa (deux véritables Haoussa et neuf Yoruba) (FP, 1952 : 12-13 ; De Boeck G., 1987 : 34-35).
Face à ces professionnels de la guerre, les autochtones ne disposaient que des hommes disponibles qui abandonnaient pour un temps leurs champs et leur commerce pour diriger leurs instruments de chasse (flèche et fusil) contre les envahisseurs. Il était quasiment impossible de garder longtemps les hommes sous les armes ; leur présence était indispensable à la subsistance de leur famille. Voilà pourquoi on avait l’habitude d’amener les femmes et les enfants à la guerre, ce qui augmentait considérablement les pertes en cas de défaite. Cette coutume se note tant du côté des troupes autochtones que de celui des agents de l’EIC. Cette description de 1898 permet de saisir l’ambiance qui régnait au sein d’une expédition en campagne au moment où elle s’installait quelque part pour la nuit, à l’issue d’une longue marche. On y notera la place particulièrement importante des femmes et des enfants.
… Pour camper, la troupe forme un carré de quatre-vingts mètres de côté ; les Blancs dressent leur tente derrière le milieu de leur subdivision ; le commandant occupe le centre du campement. La cuisine des Blancs est établie dans un angle du carré, du côté opposé au vent et à proximité de la tente du sous-officier qui en a la surveillance.
Dès que ces dispositions sont prises, les femmes se portent aux emplacements destinés à leur mari et y déposent leurs ‘biloko’. Elles vont ensuite à la recherche de trois grosses pierres qui doivent servir de chenets en même temps que de support aux vases dans lesquels on prépare les aliments. Pendant que ceux-ci mijotent sur le feu, les femmes courent au ruisseau voisin s’y rafraîchir le corps et s’y livrer à des soins de propreté. Aussitôt qu’elles ont procédé à un lavage minutieux de leur personne, elles se versent une goutte d’huile dans la paume de la main et s’enduisent la peau en la frottant fortement. Elles revêtent ensuite un pagne propre pour retourner, à une allure indolente, vers le ‘foyer conjugal’.
A ce moment, les tentes se dressent déjà au milieu d’un fourmillement de noirs. C’est un va-et-vient continuel des soldats, des femmes et d’enfants entre le camp et le ruisseau ; les uns, s’éloignant, tiennent à la main des récipients vides, les autres, revenant, portent sur leur tête immobile des vases remplis d’eau où apparaissent quelques branchages.
Une heure après l’arrivée des troupes, l’installation est ordinairement terminée ; les faces du camp se dessinent par une rangée de feux autour desquels hommes, femmes et enfants circulent dans un déballage de pots, de boîtes, de couvertures, des nattes, etc.
Les membres de chaque famille mangent au même plat et trempent leurs farineux bouillis dans le même vase contenant la sauce pimentée composée de sel, de piment et d’eau. Les soldats réguliers se servent habituellement de la cuillère, tandis que les autres emploient les quatre premiers doigts de la main droite.
Les Elminas n’admettent pas la femme à leur table, parce que, disent-ils, cette coutume n’est pas en usage dans leur contrée. Quand les estomacs sont satisfaits et que les fatigues de la journée n ‘ont pas été trop éreintantes, ils chantent en choeur les complaintes de leur pays. Le tam-tam se mêle au brouhaha du camp et donne une note vraiment foraine.
Mais l’obscurité met un terme à tout ce tapage car, aussitôt qu’elle arrive, les membres de chaque famille se rassemblent autour de leur foyer, deux ou trois par feu, et préparent leur couche, qui se compose de nattes ou de feuilles de bananier débarrassées de leurs nervures. Pour dormir, ils ne conservent aucun vêtement ; ils se couvrent seulement d’un pagne ou d’une couverture. Pendant les nuits claires, le Noir n’aime pas se coucher sous un arbre ni même sous un abri ; il préfère être ‘sous les étoiles’.
Le silence se fait petit à petit ; la plupart des feux meurent faute de combustible ; ceux qui brûlent encore éclairent de leurs vacillantes lueurs les visages de quelques soldats s’entretenant à voix basse.
Une heure et demie environ après le coucher du soleil, vers sept heures et demie, les derniers fumerons s’éteignent. Les stridations aiguës et monotones des innombrables cricris cachés dans les herbes, les buissons et les arbres cessent bientôt à leur tour. Seuls les ronflements sonores et variés troublent le silence de la nuit. Plus tard, par-ci, par-là, jaillit dans l’obscurité la pâle lumière d’une charbonnée qu’on remue et qu’un souffle de vent active, et l’ombre d’un Blanc se dirige à tâtons dans ce dédale de corps et d’objets éparpillés sur le sol, pour aller s’assurer de la vigilance des sentinelles.
Vers deux heures du matin, quand la température est la plus basse, plusieurs feux flambent de nouveau au milieu de groupes d’hommes transis de froid. Les conversations redeviennent bruyantes et réveillent les Blancs qui maugréent sous leur tente contre ces infatigables bavards. Cependant, le silence se rétablit encore, les feux s’éteignent et les ronflements reprennent jusqu’au petit jour. Alors, tout le monde se lève le matin. Pour rendre la souplesse à leurs membres engourdis, les hommes, les femmes et les enfants s’étirent, se tordent en faisant craquer leurs bras. Les uns circulent pendant quelques instants à l’intérieur et à l’extérieur du camp, d’autres rallument leurs feux, d’autres encore vont au ruisseau. La femme, très frileuse, se lave à l’eau chaude à proximité du feu, derrière un pagne déployé par un enfant. Après le premier repas, composé d’une pâtée quelconque, elle prépare sa hotte et les hommes roulent leurs paquets et ustensiles dans des nattes.
Les Blancs se lèvent également et pendant qu’ils déjeunent, des soldats disposent les tentes et les bagages en charges qu’ils distribuent ensuite aux porteurs. Quelques instants après le lever du soleil, les soldats désignés pour l’avant-garde se rangent en ordre de marche sur le sentier à suivre, et au signal de départ, se portent en avant. Blancs, soldats et femmes entrent en colonne dans l’ordre déterminé à l’avance. Les sentinelles et l’arrière- garde ne quittent leur position qu’au moment où les derniers hommes du gros des troupes se mettent en marche (FP, 1952 : 129-131).
Il fallait donc compter avec cette particularité qui gênait plus qu’elle ne facilitait l’exercice de l’art de la guerre.
En dépit de cette difficulté, l’issue des batailles était variable. Les autochtones ne remportaient pas que des défaites. Le langage colonial voulait que lorsque les autochtones remportait des victoires, l’on parlât des « massacres inhumains perpétrés par des sauvages ». Les récits rapportés avec force détails par l’historiographie coloniale étaient ceux des défaites des forces autochtones. Si on louait la bravoure des ennemis et qu’on évaluait leur nombre impressionnant, c’était pour vanter davantage l’héroïsme des agents de l’EIC qui allaient remporter la bataille.
La grande faiblesse des populations locales était qu’elles n’avaient jamais compris – et ne pouvaient pas comprendre – ce que voulaient exactement les Européens. En réalité, ceux-ci voulaient tout pour eux, chose que les autochtones ignoraient. Ils imaginaient notamment que, si on leur faisait la guerre en les délogeant d’un endroit, c’est qu’ils pouvaient aller s’installer ailleurs et qu’ils seraient tranquilles, à l’abri des Blancs, dans un nouvel habitat. En réalité, la forêt où l’on pouvait aller se cacher, le village natal où il fallait rentrer pour avoir la paix, n’existaient plus. A cause de cette méprise, un certain nombre de révoltés de 1897 pourtant vainqueurs, se firent battre comme des poulets, parce qu’ils avaient tout simplement regagné leur village d’origine pour cultiver à nouveau les champs, se croyant enfin débarrassés de ce fléau. La logique coloniale était toute différente : il était exclu qu’elle tolère quelque résistance ou indépendance que ce soit, si minime fût-elle. Ainsi se mettra-t-on à la recherche des anciens rebelles jusque dans leur village d’origine pour les attraper, les juger et les condamner. Cette méconnaissance de l’enjeu réel de la guerre a empêché que l’on puisse envisager l’éventualité d’un regroupement quelconque pour lutter contre l’envahisseur. Chacun entrait à son tour dans la guerre lorsqu’il se sentait personnellement menacé et minimisait le mouvement tant qu’il se déroulait chez le voisin (De Boeck G., 1987 : 27-31).
Examinons à présent les étapes de cette guerre de conquête, d’abord l’affrontement des autochtones avec les Arabes, puis avec les Européens, et enfin l’affrontement des envahisseurs entre eux.
La guerre avec les Arabes, on l’a vu, était un phénomène ancien. Leurs représentants, les Swahili ou encore les Ngwana, pratiquaient le commerce de l’ivoire et la traite des esclaves dans le pays situé à l’est de Lualaba. En 1874, quand Tippo Tip accepta de faire un bout de route avec Stanley, jamais il ne s’était aventuré aussi loin dans le nord-ouest. C’est dire que leur action était limitée. C’est après Stanley que Tippo Tip étendit ses conquêtes dans cette direction. On sait que sept ans plus tard, lorsque Stanley revint dans la région par la côte occidentale pour créer le poste de Stanley-Falls, les Arabes avaient déjà dépassé ce point dans leur conquête du monde occidental et atteint l’Aruwimi.
A l’est du Congo, le « quartier général » des Arabes était le Maniema, plus précisément à Nyangwe et à Kasongo. A partir de ce point, ils organisèrent leur expansion, à la recherche d’ivoire et d’esclaves, aidés en cela par des ethnies arabisées et des auxiliaires autochtones, faisant fonction de chefs d’expédition (les Tonge). Trois itinéraires – l’un partant de Nyangwe et les deux autres du Kasongo – allaient vers l’est et le nord-est. Jusqu’en 1877 l’expédition arabe, sur la rive gauche comme au nord de Nyangwe, était quelque peu bloquée à la fois par les rapides du fleuve et l’expérience malheureuse de Mohara qui aurait mené une bataille acharnée avec les « nains » avant de rebrousser chemin. On fera le récit de cette bataille à Stanley pour l’empêcher d’aller au-devant d’un désastre certain (Stanley H., 1885 : 114-119). Il s’agit probablement de l’une des poches où s’étaient retranchés les Pygmées après des combats avec les Bantu de l’est du Lualaba. Le voyage de Stanley, comme on l’a dit, sonna le départ de l’expansion vers le nord et le nord-est, avec de nombreuses vicissitudes dues à l’intrusion des Européens. Vers le nord, à partir des Falls, Tippo Tip avait pour objectif d’atteindre le pays de Munza, chef des Moubouttou (Mangbetu) dont Stanley lui avait parlé à Kasongo en octobre 1876. Mais ces appétits guerriers se dissipèrent lorsqu’il apprit les nouvelles internationales sur le partage de l’Afrique et la création de l’EIC. Il s’engagea même en 1885 à ne plus attaquer les autochtones et à respecter les territoires de l’EIC. Il est certain que si les Arabes des Falls étaient arrivés plus tôt au sud de l’Uélé, ils auraient opéré une jonction avec les traitants arabes de Khartoum qui étaient dans cette région depuis 1864. Ils ne purent poursuivre plus au sud, ayant subi une défaite en 1865 devant Tuba, souverain mangbetu. Toutefois, des relations commerciales furent instaurées par la suite avec les Zandé puis avec les Mangbetu, au temps de Munza, le successeur de Tuba. Ces relations dépassèrent le Haut-Uélé et atteignirent même le Bas-Uélé, en aval de Djabir (actuel Bondo).
Pendant ce temps, le mouvement madhiste voyait le jour au Soudan. Son intervention dans la région mit un terme aux relations commerciales entre les traitants khartoumiens et les sultans zandé. La situation ne changea pas jusqu’aux années 1888-89, quand les traitants arabes des Faits atteignirent enfin le pays zandé-mangbetu. Mais en 1890-91, l’intervention de l’EIC se fit sentir dans la région avec l’expédition Van Kerkhoven qui, elle aussi, cherchait de l’ivoire, tout en empêchant les Arabes de faire la jonction avec les traitants khartoumiens et les madhistes.
Au sud-ouest, la conquête arabe eut plus de chance avec l’oeuvre de Tippo Tip. Elle avait pu atteindre la Lubilash et la Mbuji-Mayi et établir des contacts avec le chef Kalamba des Bena Luluwa. Cette réussite était l’œuvre de Ngongo Leteta et de ses vassaux.
Au nord-ouest, les opérations étaient dirigées par les vassaux de Mwini Mohara à partir de Riba-Riba ; ceux-ci ravagèrent la région de la Cuvette centrale jusqu’aux rivières Lopori, Bolombo et la rive de la Maringa. Toutefois, ni les Arabes venus de Zanzibar ni ceux provenant de Khartoum n’atteignirent vraiment l’Equateur. Que voulaient-ils exactement, ces conquérants originaires du Moyen-Orient ? Ces Arabes étaient en fait victimes de leur conception du bonheur, semblable à celle des vizirs et sultans du Moyen Orient. Il fallait qu’ils se fassent servir en tout, et en plus, par une main-d’œuvre gratuite, servile, parce que païenne. Pour accroître leur richesse, ils disposaient d’un corps de lieutenants fidèles (les Tonge). Ceux-ci à leur tour désignaient des représentants chargés dans les villages conquis de veiller sur les dépôts d’ivoire et les camps d’esclaves (Npampara). Toute une hiérarchie à la fois sociale, politique et économique s’était ainsi instaurée. Les Tonge, placés entre autochtones et Arabes, représentaient une classe – celle des Ngwanami – esclaves, mi- libres. C’est cette catégorie d’hommes qui se rendit coupable de toutes sortes d’atrocités vis-à-vis des autochtones. Le système les y contraignait en quelque sorte. En effet, ce sont eux qui opéraient des razzias et venaient mettre le produit de leurs rapines à la disposition du maître qui pouvait, s’il le voulait, leur remettre une partie des biens. Pour le reste, ils devaient se débrouiller. Ce système commercial les prédisposait à pratiquer ce genre d’activités. Le produit recherché était l’ivoire. Celui-ci, à cause de sa rareté, était recherché dans des régions de plus en plus lointaines : il fallait le transporter sur des distances de plus en plus grandes. Il fallait donc des porteurs, c’est-à-dire des esclaves. Il fallait aussi des vivres pour nourrir ces caravanes. La manière la plus directe pour se procurer tout cela était d’incendier les villages, de s’emparer de l’ivoire et des vivres, de « recruter » les femmes et d’ « engager » des porteurs. De grands espaces de conquête, régions razziées, étaient ainsi déjà constitués dans l’est du Congo. Le conquérant arabe s’installait dans la partie « pacifiée », ses Ngwana guerroyaient à la périphérie, poursuivant les conquêtes ; à chaque village conquis, on affectait un Nyampara pour la surveillance des biens. Un système de courrier fonctionnait au sein de la zone. Le pays conquis était soumis à une certaine civilisation qui fut assez florissante au Maniema : des cultures florales, de riz et d’arbres fruitiers ; une architecture extratraditionnelle ; l’usage d’ustensiles de luxe : lits sculptés, matelas de soie et de satin, moustiquaires de soie, gobelets et carafes en cristal et en argent ; l’existence du sucre, des bougies, des allumettes (Kimena K.K., 1984 : 109-112).
On constatera que la guerre entre autochtones et Arabes ne supposait pas une présence massive des Arabes proprement dits. C’était essentiellement une guerre entre Congolais, d’une part ceux qui était armés par les Arabes et d’autre part ceux qui, ne disposant que de l’armement traditionnel, étaient attaqués, puis vaincus. Ils étaient alors « intégrés » dans l’organisation arabe soit comme marchandises soit encore comme main-d’œuvre utile pour le portage ou comme auxiliaires militaires en vue d’autres conquêtes.
4.2 La guerre avec les Européens
La guerre avec les Européens démarra dès les premières conquêtes, au temps de la première traversée du continent par Stanley. En effet, dès 1874, Stanley se rendit compte que pour nourrir son immense caravane de porteurs, il ne disposerait jamais de quantités suffisantes, en procédant par l’échange avec des cotonnades et des perles. Il fallait donc autre chose, c’est-à-dire user de la force, pour arracher les provisions nécessaires. La population, habituée à produire la quantité nécessaire à sa subsistance, ne songeait pas encore à réaliser un surplus qui lui rapporterait un profit certain, destiné à la vente aux caravanes arabes et à celles de l’EIC. Pour avoir de quoi nourrir les siens, Stanley devait donc employer la force. Ce qu’il fit. De ceux qui l’accompagnaient, Tippo Tip, le seul témoin oculaire non européen, qui ait laissé un écrit, atteste la violence de ce premier contact :
… Le bateau assemblé, nous nous embarquâmes[…]. Les petites pirogues indigènes étaient certainement au nombre de trois cents ; nous leur tirâmes dessus. C’étaient des hommes de la tribu de Wagenia, dont la principale occupation est la pêche. En entendant les fusils, ils furent terrorisés et un bon nombre se rendirent et nous abandonnèrent leurs pirogues. Nous capturâmes une trentaine de pirogues ou plus et ainsi nous traversâmes le fleuve (Bontinck E, 1974 : 106).
Ce « glorieux » voyage fut ponctué d’une série ininterrompue de trente-deux batailles, à commencer par les premiers coups de feu sur la Lualaba, dans un combat contre les Kusu, le 24 novembre 1876 (Vellut J.L., 1987 : 26). Lorsque le 14 février 1877, il est aux prises avec les Iboko et les Mabale (les Bangala), Stanley livre là son trente et unième combat, lequel fut, suivant ses propres dires, le plus acharné de tous ceux qu’il avait eu à soutenir au cours de son voyage (Stanley H.M., 1879 : 302). Le ton était donné. Les expéditions suivantes, réalisées sous l’égide du CEHC, de l’AIC ou de l’EIC, firent appel aux armes dans tout le pays. Déjà au Pool, en novembre 1881, Ngaliema fut sur le point d’attaquer Stanley avec ses guerriers ; il y renonça à la vue des mercenaires que ce dernier avait d’abord cachés. Dans toutes les régions du pays, on enregistra plusieurs batailles, mettant aux prises expéditions « conquérantes » et forces autochtones.
Dans la partie méridionale du pays, on a dénombré plusieurs combats : en 1885, la station d’Isangila fut attaquée par les populations voisines. Une caravane fut attaquée par Munyanya ; sur la route du Kasaï, en 1884, Wolff fut assailli par les Songo, Von Wissmann eut maille à partir avec les Kutu. Malgré de lourdes pertes, son escorte réussit à mettre les assaillants en fuite (FP, 1952 : 21, 24, 29).
Mais les batailles les plus décisives se déroulèrent au Kwango et dans le Katanga. Le Kwango était à l’époque sous l’empire de Mwene Putu Kasongo dont la capitale portait le nom, Kasongo-Lunda. Son pouvoir était redoutable. Un témoin de l’époque rapporte ceci :
… Installé à Kasongo-Lunda, entouré constamment d’une garde dévouée forte de 700 à 800 hommes, il dicte ses ordres jusqu’aux extrémités du pays et tous s’empressent d’envoyer au chef redouté les vivres, les gibiers et les esclaves qu’il réclame pour satisfaire aux exigences de son sérail et de sa garde, dont la seule occupation consiste à veiller sur le chef en échange du bien-être qu’il leur fournit (Planquaert M., 1932 : 141).
Face à une telle puissance, deux expéditions furent nécessaires, en 1889 et 1891. Cette dernière fut commandée par Dhanis, escorté de quatre-vingts soldats et de cent cinquante porteurs. Les combats les plus sanglants eurent lieu en mai-août 1892 et firent plusieurs victimes dans les rangs d 5 agents de l’EIC avant d’aboutir à la soumission de ce grand chef autochtone ; soumission purement tactique car l’année suivante, il passa à nouveau à l’attaque. Il ne succomba que suite à la trahison de son rival Lukokisa qui le conduisit à la mort en décembre 1893 (FP, 1952 : 162- 164).
Au Katanga, l’opposition dure s’était organisée autour de Mushid Ngelengwa qui refusait tout arrangement avec les Européens, qu’ils soient représentants de l’E.I.C. ou de la « British South » de Cecil Rhodes. Les Européens lui vouaient une haine sans pareille, le considérant comme le type même du grand chef despote et sanguinaire. Mais Ngelengwa s’était rendu maître d’un immense territoire où il monopolisait le commerce et commandait une importante armée de guerriers dont trois mille étaient armés de fusils (FP, 1952 : 164). Son territoire était fort convoité, du fait des richesses qu’on y entrevoyait. Le Katanga, pensait-on, était le pays des mines de cuivre et d’or. Il fallut plus d’une expédition pour en venir à bout : celle de Paul Le Marinel qui partit de Lusambo en décembre 1890, forte de cent quatre-vingts soldats et de près de cent cinquante porteurs ; celle de Delcommune qui, partie de Ngandu en mai 1891 avec une escorte non moins importante, dut subit les assauts des Luba de Kikondja faisant plusieurs victimes ; celle de Stairs qui partit de Zanzibar en juillet 1891 avec trois cent cinquante personnes et quelques compagnons parmi lesquels, le capitaine Bodson. C’est cette expédition qui décida d’anéantir le grand chef, le 20 décembre 1891 : Bodson tira sur lui à bout portant avant d’être à son tour massacré par ses fidèles (Stairs, 1893 : 199 ; FP, 1952 : 164-174). L’occupation du Katanga devint enfin possible, en dépit de quelques escarmouches comme celle qui opposa l’expédition Bia-Francqui-Cornet aux Sanga, en janvier 1892.
Au Congo septentrional, le spectacle fut semblable, et probablement plus meurtrier. Déjà en 1883, dans la station même de Stanley-Falls, récemment créée, l’écossais Bennie eut à maîtriser l’opposition des Wagenia. Au cours de la même année, le capitaine Vangèle entreprit l’éventail d’expéditions qui le conduisirent à l’exploration du cours de l’Oubangui et de Mbomu. En janvier 1888, sa flottille fut sérieusement attaquée aux environs de Yakoma. Il nous a laissé le témoignage de cette bataille qui traduit la détermination des adversaires Ngbandi qui attaquèrent avec « une soixantaine de pirogues contenant en moyenne chacune vingt guerriers » :
… Malgré les pertes qu’ils éprouvent, les guerriers continuent à s’avancer dans les herbes jusqu’à quinze mètres du steamer et nous sommes obligés de tirer à bout portant.
L’attaque eut lieu plus de quatre fois consécutives. Vangèle, malgré sa victoire, est obligé de reconnaître la force et la bravoure de l’adversaire.
Ce combat est l’un des plus acharnés que j’ai eu à soutenir en Afrique… Un fait digne de remarque : pendant ce combat qui dura près de trois heures, les Yakoma n’ont poussé aucun cri, leur silence et leur froide résolution avaient quelque chose de terrifiant (cf. Tanghe R., 1922 : 161).
C’est grâce aux efforts de Vangèle que l’EIC parvint à prendre possession des rives du Haut-Oubangui et du Mbomu, devançant de beaucoup les Français dans l’occupation effective de ces territoires déjà délimités sur papier.
La conquête du Nil donna également lieu à quelques batailles spectaculaires. Les expéditions organisées dans cette direction prenaient toujours des proportions gigantesques. Déjà celle de Stanley en 1887-1888, à la recherche d’Emin Pacha, gouverneur de la province Equatoria, passait pour être l’expédition la mieux organisée et la mieux équipée jusque-là. Elle donna en quelque sorte le ton à ce qui allait suivre. L’expédition de Van Kerkhoven fut encore plus impressionnante, conforme en cela à l’ambition de Léopold II qui tenait à ce que son empire atteigne le Nil. et à la mesure des objectifs qu’il s’était fixés ; planter le drapeau sur les rives du Nil, occuper immédiatement ces terres. Ceux qu’on craignait n’étaient pas les Anglais, avec lesquels on venait de conclure la convention du 24 mai 1890 pour délimiter les zones d’influence respectives, mais plutôt les Swahili et les Mahdistes. Fallait-il pour cela un tel déploiement de forces ? L’expédition comprenait une compagnie de deux cents Européens et une flottille de trente embarcations démontables. Une partie de cet important matériel fut d’ailleurs envoyée et sept ans après le départ de l’expédition, elle traînait encore à Bumba, tant son transport créa un véritable encombrement vu la précarité des moyens de l’époque (FP. 1952 : 126 : Liebrechts C., 1909 :47).
Entre Bumba et Djabir, l’expédition connut ses premiers déboires ; les populations utilisant la tactique de la « terre brûlée », elle ne rencontra que des villages abandonnés. Nous sommes en avril 1892. Arrivée à Yamikele, une grande partie de l’avant-garde fut massacrée. Des soixante-quinze hommes que le commandant envoya à la recherche d’un point d’eau, soixante-treize furent tués, de même que le Blanc qui les accompagnait. Le reste des troupes fut ensuite attaqué et vaincu. Les survivants durent rebrousser chemin jusqu’à Bumba (Lotar R.P., 1946 : 46). Il fallait changer de direction pour atteindre Djabir puis Bomokandi, Niangara et le Nil. La progression fut pénible, les pertes énormes. Le chef de l’expédition lui-même,
Van Kerkhoven, trouva la mort avant l’arrivée au Nil. On parvint toutefois à créer quelques nouvelles stations sur l’Itimbiri, l’Uélé, le Bomu, la Dungu et le Kibali ; le drapeau bleu flotta aux abords du Nil, mais ce fut une victoire à la Pyrrhus.
Il en fut de même au nord de Mbomu lors de l’expédition Colmant en 1894, commandée par Francqui, commissaire de district de l’Uélé à l’époque. Lorsque la convention franco-belge du 14 août fut signée, fixant la frontière au thalweg du Mbomu, il s’avéra que les agents de l’E.I.C. étaient allés trop loin dans le nord, qu’ils devaient abandonner les postes qu’ils avaient déjà créés au-delà de cette ligne. Les postes de Ndoruma et de Mopai chez les Zandé, ayant perdu leur statut de base de départ pour les expéditions projetées vers le Bahr el-Ghazal, devaient également être évacués. Cette phase de repli allait provoquer le désastre des troupes stationnées à Ndoruma sous les ordres du capitaine Janssens. Les populations, y virent un signe de faiblesse et se mirent à narguer l’autorité des Blancs, refusant d’obtempérer à leur ordre de se faire enrôler comme porteurs. Quand la colonne se mit en marche, elles en profitèrent pour les attaquer. Le massacre fut total. Le chef d’expédition fut tué et le sous-officier, qui lui avait apporté quelques jours auparavant l’ordre de se replier dut se suicider, pour ne pas tomber vivant aux mains de l’ennemi. Lotar a essayé de retracer cette scène :
… Epuisé par de longues heures de combat, sous un soleil de feu, n’ayant trouvé pour rafraîchir sa gorge desséchée que quelques feuilles et des herbes arrachées hâtivement le long du chemin, il s’adossa sur un arbre, entouré de huit hommes qui lui restaient. A cet endroit, tous brûlèrent leurs dernières cartouches, et quand le dernier soldat ne fut plus qu’un cadavre, Van Holsbeck, immobilisé par une lance dans la cuisse, de son revolver abattit à ses pieds deux Zandé qui s’élançaient sur lui. Alors, il appuya le canon de son arme contre sa tempe et se fit sauter la cervelle (Lotar R.P., 1940 : 131).
4.3 La guerre entre Européens et Arabes
Cette autre série de batailles se déroula entre 1892 et 95 lors de ce qu’il est convenu d’appeler la « campagne arabe ». Pour quiconque connaissait les visées précises de l’Europe en Afrique, la guerre avec les Arabes et les Swahili, plus précisément l’attaque de leurs possessions par les Européens, était inévitable. Restait seulement à en déterminer le temps et le lieu. Le premier coup fatal porté à l’expansion commerciale arabe fut la création du poste de Stanley-Falls, en décembre 1877. Cette création faisait la jonction entre les efforts d’implantation réalisés à partir de l’ouest et de l’est. L’événement était plus lourd de conséquences que la création du poste de Karema, en plein territoire arabe, sur la rive droite du Tanganyika ; cette station jouait à l’égard des expéditions de l’est le même rôle que Vivi pour celles de l’ouest : l’une et l’autre constituaient, en quelque sorte, les capitales de deux grandes zones d’implantation de l’AIC. Avec la fondation de Stanley-Falls, les Swahili n’avaient plus de zone d’expansion possible. Ils étaient obligés de se limiter désormais aux territoires déjà conquis, plus précisément entre les Falls et l’océan Indien. Sans le savoir, l’EIC venait de faire sa contre-propagande, en montrant aux Arabes que son action compromettait gravement leurs intérêts commerciaux.
Pourtant le même Etat n’était pas encore sûr d’être suffisamment fort pour se passer de l’aide des Arabes, particulièrement pour le recrutement des porteurs ; de plus, il n’était pas acquis qu’il puisse les vaincre, en cas de conflit armé ; aussi préféra-t-il dans un premier temps faire appel à leur collaboration. La manoeuvre avait même quelques accents de sincérité car les Arabes étaient indispensables pour réaliser l’exploration scientifique de la région. Livingstone, Cameron et Stanley durent faire appel aux services de Tippo-Tip et de ses hommes ; Pogge et Wissmann se firent guider par les gens de Hamadi ben Ali Kibonge pour partir du Kasaï vers Nyangwe après avoir traversé le Sankuru et le Lomami. En 1887, le grand marchand swahili, Tippo Tip, devint haut fonctionnaire de l’EIC. Il fut nommé gouverneur du district (Vali) de Stanley-Falls. Stanley profita de son expédition au secours d’Emin Pacha pour l’installer officiellement comme gouverneur aux Falls. En réalité, la motivation de Stanley était ambiguë. Comme il devait réaliser cette grande expédition pour venir en aide au gouverneur de la province équatoriale qui s’était replié au Sud à Wedalaï sur le Nil, après la révolte des Madhistes et des chefs locaux qui s’étaient déjà emparés de Khartoum et des provinces de Kordofan et de Bahr el- Ghazal, Stanley avait besoin de beaucoup de porteurs. Un tel recrutement ne pouvait se réaliser à Zanzibar, dans le climat de tension qui régnait entre les agents de l’EIC et les Arabes. Retenons que, les premières années, les contacts furent empreints de sincérité, voire même de collaboration.
Les choses changèrent quand les Arabes se rendirent compte que la présence européenne avait notamment pour but d’arrêter leur expansion. La pomme de discorde était la situation de Stanley-Falls avec toutes les escarmouches qui s’y déroulaient. A peine créée, la station avait dû être abandonnée. Il faut dire que le coup était dur à avaler pour les Arabes. La seule création de ce poste mettait un terme à leur expansion partie de Zanzibar et qui s’étendait, de loin en loin, vers 1 ouest. Désormais ils étaient condamnés à l’immobilisme, voire au recul. Mais 1 EIC, officiellement, présenta cette installation comme le point culminant de cette ère de collaboration. L’échange se faisait de manière spontanée entre les deux communautés, le tout orchestré par un haut fonctionnaire de l’EIC, lui-même Arabe car la nomination de Tippo Tip était de toute évidence un acte de réconciliation idéal. En effet, le puissant Tippo Tip était connu pour être « l’ami des Blancs ». Le fait d’être sous la protection britannique signifiait qu’il devait être ménagé par l’EIC, sans quoi il pouvait faire basculer vers les Anglais l’immense territoire sur lequel il avait de l’influence.
L’expérience de Tippo Tip fut catastrophique pour ses intérêts ; mais elle fut positive pour l’EIC qui avait pour objectif de miner l’influence de cet homme qui contrôlait un immense territoire. Intégré dans l’administration de l’EIC, Tippo Tip dut subir automatiquement la contestation des autres chefs. Déjà son autorité était contestée par les Arabes purs, parce qu’il était bâtard et qu’il avait du sang « noir» dans les veines. Pour cette raison, il s’était associé à Buana Nzige qui, lui, était un Arabe « blanc ». Mais en tant que chef, ses instructions étaient suivies par ceux qui lui étaient favorables et rejetées par les autres, surtout dans la mesure où elles remettaient leurs intérêts en question. Jouant le jeu de Léopold II, il interdisait les razzias et exigeait que la production en ivoire de ses pairs soit vendue à l’Etat ou qu’elle soit écoulée par la voie de l’Ouest. Les Arabes l’accusaient de trahison ; ils estimaient qu’il travaillait à leur ruine et pour le succès de l’EIC.
Du côté des Européens, Tippo Tip n’avait guère plus de chance d’être bien considéré car il inspirait malgré tout la méfiance. Sa station n’était ni visitée ni ravitaillée au même rang que les autres. On ne le laissait pas exercer toutes ses prérogatives. Lorsqu’il lui arriva de commander des armes pour sa station, celles-ci furent saisies à leur arrivée à Léopoldville, car on ne souhaitait pas qu’il en dispose (Ceulemans P., 1958 : 150). Un décret fut pris en 1890 pour interdire les armes à feu dans la zone arabe. A cette époque, en effet, les événements qui se passaient ailleurs, dans la région, incitaient à la méfiance. En Ouganda, les Arabes avaient démis le roi de ses fonctions et exerçaient des exactions sur les populations, sur les missionnaires et sur les stations ; au Tanganyika allemand, une grande révolte avait éclaté en 1888-89. A cette époque où la campagne du cardinal Lavigerie battait son plein, les Musulmans cherchaient à se réunir afin de se mettre en position de légitime défense.
Entre-temps, les Européens, devenus de plus en plus forts, estimaient ne plus avoir besoin de stratagèmes pour réaliser leurs objectifs. La collaboration des Swahili n’était plus indispensable, ceux-ci pouvaient être balayés. La guerre avec les Swahili pouvait enfin commencer. L’idéal d’entente ne se réaliserait pas.
Le coup d’envoi fut donné par l’expédition Van Kerkhoven qu’on appelait « Bula Matende » dans la langue du pays ; elle décida de confisquer tout simplement toute cargaison d’ivoire rassemblée par les Arabes et les Swahili. A ses yeux, cet ivoire devait être considéré comme volé parce qu’acheté voire même pris sur le territoire, réel ou potentiel, de l’EIC. La « déclaration de guerre » ne s’embarrassa pas de formules diplomatiques ou de politesse. Elle se fit dans l’Uélé, au nord du Haut-Congo. Kipanga-Panga, un lieutenant de Tippo Tip, fut empêché par les officiers de l’EIC de se venger de Djabir, grand chef zandé, qui s’était permis de rompre l’alliance avec lui. C’était en octobre 1890. Peu après, l’expédition Vangèle attira le chef Mirambo dans une embuscade sur la rivière Borna, affluent de l’Uélé, pour s’emparer de son ivoire. Mais les plus gros dégâts furent causés, comme on l’a dit, par Van Kerkhoven. Une première opposition eut lieu en octobre 1891 sur la rivière Bomokandi. Sous prétexte de délivrer les autochtones des exactions des Togolomanghi (arabes), il arracha à ces derniers un butin de plus de huit cents pointes d’ivoire. Un second combat, fort meurtrier, se livra quelques jours plus tard, au cours duquel les Swahili perdirent environ deux mille pointes d’ivoire (Ceulemans P., 1958 : 327-328 ; FB, 1952 : 134-138). Les confiscations d’ivoire n’eurent pas seulement lieu lors de conflits armés mais aussi en s’emparant de dépôts entiers sans recours à la force.
Suite à ces provocations, les Arabes s’irritèrent et donnèrent aux officiers de l’Etat l’occasion de les écraser. Une autre occasion se présenta, lors de l’expédition Hodister, cet agent de la SAB, connu comme arabophile et accepté comme tel par les Arabes. Il s’engagea dans le pays de l’entre-Lualaba-Lomami, trop sûr de l’amitié que les Arabes lui témoignaient, ignorant que ceux-ci était troublés par les nouvelles concernant la confiscation d’ivoire qui venait de s’opérer en Uélé, lors de l’expédition Van Kerkhoven. Victime de cette tension, il fut massacré par les Arabes avec tous les membres de son expédition, sans avoir pu connaître la raison de cette colère qui s’abattait sur lui.
Le prétexte au grand affrontement se présenta lors de la soumission de Ngongo Leteta à l’autorité de l’Etat. On se rappellera que Ngongo Leteta fut un auxiliaire fidèle de Tippo Tip au moment où celui-ci était un grand trafiquant à Kasongo et qu’il jouait pratiquement le rôle de chef de l’Etat. Ngongo Leteta était par lui-même un agent à la fois fidèle et efficace. Dès que les terres du Haut-Lomami lui furent confiées, il le prouva en faisant parvenir à son maître, en 1886, 32 tonnes d’ivoire. Les rapports furent prometteurs tant que Ngongo eut à traiter directement avec son maître Tippo Tip. Mais tout changea quand ce dernier, pris par ses nouvelles fonctions à Stanley-Falls, céda la direction de ses affaires à son fils Sefu qui prit le parti de reléguer le puissant collaborateur de son père au second plan. Celui-ci ne supporta pas une telle humiliation. Désormais, il n’eut plus qu’un seul but : se soustraire à la tutelle de Sefu et, au besoin même, se venger de lui et des siens. Mais comment ? Lorsque l’Etat créa le poste de Lusambo, en 1890, en plein cœur du Kasaï, il en profita pour progresser dans sa quête d’émancipation et tenta de se tailler un petit fief en soumettant les chefs Lumpungu et Mpanya Mutombo et en leur imposant un impôt pour lui-même et non au compte d’un autre. Cela lui réussit. Il essaya de poursuivre vers l’ouest pour entrer en contact avec les Cokwe afin de se procurer des fusils et des munitions. En cas de réussite, il enlevait à Sefu son unique droit de tutelle sur lui. Ngongo Leteta s’engagea donc en 1891 assez profondément dans le Kasaï, jusqu’au pays Luluwa, où les autochtones lui barrèrent la route (Van Zandijke A., 1952 :130-145). Il rebroussa chemin et prit la direction du sud. Mpiana Mutombo, craignant que cette expédition ne soit dirigée contre lui, avertit le commissaire de district de Lusambo, le baron Dhanis. On aurait pu imaginer que 1 agent de 1 Etat encouragerait Ngongo à se soustraire à la tutelle des Arabes. Comme 1 objectif visé était de soumettre tout le monde, il préféra lui faire la guerre, avant de la faire aux autres Swahili. Ngongo Leteta fut vaincu le 9 mai au confluent du Mbuji-Mayi et de la Lubilanji, sans toutefois se soumettre à l’Etat. Mais que pouvait-il faire encore ? Fallait-il faire amende honorable auprès des Arabes ? Ils ne lui pardonneraient jamais ses velléités d’indépendance. Il prit donc l’initiative d’entrer en contact avec les représentants de l’Etat et, le 19 septembre, il se soumit à l’autorité de l’Etat à la condition d’être protégé par les forces de celui-ci (Ceulemans P., 1958 : 345-347). Il mit un millier d’hommes à la disposition de l’ElC. ce qui n’était pas négligeable, et renonça à toute prétention sur Lumpungu qui dépendrait désormais directement de l’Etat. Victorieux, Dhanis établit aussitôt un poste de l’Etat à Ngandu, sans en référer à Sefu, le maître des lieux. Ce fait était important d’un point de vue politique, tant pour ridiculiser les Arabes que pour établir une jonction entre le Katanga et le Kasaï. C’en était trop pour les Swahili. Non contents de ravir leur ivoire, les agents de l’EIC venaient leur arracher l’un de leurs principaux lieutenants. Cela ne pouvait se passer sans une réaction violente de leur part. L’affaire Ngongo Leteta constituait l’objet de colère des Swahili. Les Européens avaient eux aussi leur motif de colère. Dhanis venait d’apprendre en effet la mésaventure de Hodister, à la tête d’une expédition commerciale, massacrée aux avant-postes de Riba-Riba, victime du climat d’hostilité entre les deux communautés.
Désormais, la guerre était inévitable. De 1892 à 1894, elle allait faire rage. Faisons le compte des forces en présence. Les Swahili occupaient le couloir allant de Stanley-Falls à Bangamoyo, en passant par Nyangwe, le lac Tanganyika et Tabora. On se rappellera que c’était l’ancienne route des esclaves. Les agglomérations situées sur cet axe constituaient, comme on l’a déjà dit, leurs quartiers généraux depuis les Falls, dominés par Rashid jusqu’à Udjidji, le fief de Said Mohamed ibn Khalfan alias Rumaliza, le sultan qui dominait toute la région de Tanganyika. Réunies, les différentes troupes de Swahili représentaient, semble-t-il, une armée d’environ cent mille hommes (FP, 1952 : 207). Mais l’éventualité d’un front commun était impensable, tant à cause de l’esprit d’indépendance de chaque chef que des difficultés d’intendance que supposait la gestion d’une telle concentration humaine. Ces bandes étaient composées de personnes aguerries à l’art militaire, mais ne disposant que d’un armement hétéroclite : les chefs possédaient des armes à répétition, leurs hommes disposaient généralement de simples fusils à piston. De son côté, l’Etat comptait sur les effectifs et sur l’armement des camps de Basoko et de Lusambo. Basoko avait été créé en 1889, en aval de Stanley-Falls, précisément pour servir de barrière contre les Swahili. Le camp disposait de trois cents hommes ainsi que de deux canons Krupp, de quatre canons en bronze et d’une mitrailleuse. Lusambo avait été créé à la même époque, pour les mêmes raisons. On y dénombrait également trois cents soldats (FB, 1952 : 206-209).
Le grand affrontement éclata de manière inattendue, en tout cas plut tôt que prévu par rapport aux prévisions de l’Etat. Cette situation se lisait sur les statistiques de recrutement des mercenaires, les volontaires de la côte ; de quatre mille deux cents recrutés au début de 1892, on passa à six mille hommes en fin d’année et à dix mille en 1894 (De Boeck G., 1987 : 77-78). L’Etat avait prévu à tout le moins d’équilibrer d’abord ses finances, d’achever d’abord le chemin de fer Matadi- Léopoldville avant de déclencher cette guerre qui nécessitait du renfort et du ravitaillement provenant d’Europe ou d’ailleurs. Mais sur le terrain, Dhanis précipitait les choses, malgré les instructions contraires qui lui étaient données. Sa vraie mission était plutôt de se rendre au Katanga. Mais il préféra s’attarder en cours de route pour combattre les Arabes. Déjà l’attaque de Ngongo Leteta et l’installation à Ngandu avaient relevé de son initiative ; même si elles avaient réussi, l’enjeu consistait encore, du point de vue de l’Etat, à éviter un conflit général. Aussi le gouverneur général lui donna-t-il l’ordre d’éviter toute action belliqueuse au-delà du Lomami, la frontière conventionnelle entre les deux pouvoirs. Sefu, de son côté, recevait également de la part de Tippo Tip des consignes de modération. Ce dernier l’engageait, avec Rachid, à maintenir des relations avec des Européens. Au moment où ces instructions arrivèrent, le jeune Sefu avait déjà déclenché les hostilités sur le Lomami, exhorté par Mohara qui lui déconseillait de régler le conflit à l’amiable. En réalité, il ne cherchait qu’à attaquer Ngongo Leteta, son esclave et vassal.
Il fit parvenir un ultimatum à Dhanis. Il lui écrivit que lui, Sefu, entendait se rendre maître du Congo jusqu’à l’embouchure du fleuve, prétendant qu’il laisserait Dhanis rentrer sain et sauf en Europe, à la condition qu’il lui envoie, en guise de cadeau, la tête de Ngongo Leteta (FB, 1952 : 218). Estimant que les hostilités étaient ouvertes, Dhanis attaqua le premier avec ses deux puissants alliés : Lumpungu et Ngongo Leteta. Le 4 mars 1893, il s’empara de Nyangwe qui fut abandonné par les Swahili et fit de même de Kasongo le 22 avril. Dans cette ville, il fit un butin énorme, comme l’atteste le témoignage de l’époque :
Nous trouvâmes un confort européen dont nous avions presque perdu l’usage : sucres, allumettes, gobelets et carafes en argent et en cristal étaient à profusion. Nous prîmes également environ 25 tonnes d’ivoire, 10 à 11 tonnes de poudre, des millions de capsules, des cartouches pour toutes les espèces de fusils, canons et revolvers qui aient été déjà fabriqués, quelques obus… Les greniers de la ville étaient remplis d’énormes quantités de riz, de café, de maïs et d’autres aliments (FP, 1952 : 240).
Après ces batailles, Dhanis resta près de six mois inactif : le renfort ne suivait pas, tant la guerre était improvisée. Cette période de répit permit aux bandes swahili vaincues de se réfugier chez Rumaliza pour renforcer son armée afin de repousser les troupes de l’Etat. Chaltin, de son côté, mit sur pied une expédition et s’empara de Bena Kamba et de Riba-Riba. Il sauva ainsi de justesse la station de Stanley-Falls au moment où elle allait tomber entre les mains des Swahili. Mais les batailles les plus dures furent menées contre les troupes de Rumaliza. Sans renforts de dernière minute, Dhanis et les siens étaient battus, ne disposant pas de munitions suffisantes. Rumaliza finit par être vaincu et prit la fuite. Les campagnes arabes touchaient à leur fin en janvier 1894. Rumaliza et Buana Nzige ne trouvèrent le salut que dans la fuite vers l’est, au Tanganyika, en territoire allemand. Beaucoup d’Arabes et leurs auxiliaires swahili furent tués, notamment Mohara et Sefu. Plus nombreux encore furent ceux qui se réfugièrent dans la brousse et qui firent allégeance au vainqueur. Mais que pouvait-on en attendre ? Déjà avant la guerre, l’Arabe inspirait la méfiance, même quand il était de bonne volonté comme Tippo Tip. Comme l’Etat avait besoin de personnel, surtout pour la Force publique, il recruta ces éléments et en fit des collaborateurs.
A cette époque éclata l’affaire Ngongo Leteta, qui est l’une des pages les plus sombres de cette histoire de conquête. Après la guerre. Ngongo retourna à Ngandu, son fief, où on ne tarda pas à l’accuser de contestation à l’égard de l’Etat. En réalité, après s’être servi de lui, on cherchait à présent à l’éliminer à cause de l’influence qu’il avait dans la région sur certaines catégories de personnes. Peu après, il fut reconnu coupable de rébellion et d’atrocité. Un conseil de guerre siégea avec une rapidité suspecte et se prononça évidemment pour la peine capitale. Condamné à mort, Ngongo Leteta fut exécuté le 15 septembre 1893, après avoir essayé de se pendre dans sa cellule pour éviter un tel déshonneur. L’Etat s’est empressé de se débarrasser de cet homme gênant, vu qu’il ne lui était plus utile. Cet acte allait lui coûter cher car il allait constituer, deux ans plus tard, une des causes principales de la révolte de Luiuabourg (FP, 1952 : 242). En d’autres circonstances, Ngongo Leteta aurait pu être un fondateur de royaumes, à l’instar de Mushid Ngelengwa. Sa condamnation hâtive prouvait que ce temps était révolu et qu’impitoyablement le nouvel ordre politique, pour imposer sa nouvelle organisation de l’espace, s’était donné pour tâche de briser tout projet qui allait à l’encontre de ses intérêts (De Boeck G., 1987 : 82). Voilà pourquoi la guerre était loin d’être finie. Certes, avec la fin de la « campagne arabe », la conquête de l’espace était pleinement réalisée. Plus aucun autre pouvoir organisé ne prétendait soustraire une partie du territoire à la tutelle effective de l’EIC. Il n’empêche que les révoltes ne manqueront pas de gronder, attestant la persistance des rapports de violence.
5 LES PREMIÈRES RÉBELLIONS AU CONGO
L’après-guerre a ses servitudes. La colère des vainqueurs sur les vaincus s’y manifeste, ce qui suscite, çà et là, des réactions de la part des vaincus. Ils offrent ainsi aux vainqueurs de nouveaux prétextes pour briser ces velléités de résistance et mater plus complètement encore ceux qu’ils avaient pourtant été déjà battus. Ce schéma se retrouve chez les Congolais, particulièrement chez les Swahili qui eurent l’occasion d’exprimer leur rage, dans la mesure où ils furent armés par le nouveau pouvoir.
Partout les nouveaux maîtres traitaient les autochtones en esclaves, les réquisitionnant à tout moment, suivant les besoins, pour le portage, des corvées ou des travaux de construction (routes, factoreries, missions, postes). Les autochtones ne se sentaient nullement concernés par ces diverses activités. Même l’évangélisation et l’instruction procédaient par recrutements forcés. On y envoyait de jeunes esclaves ou les enfants de moins nantis. Les aristocraties locales continuaient à se faire évincer, remplacées par ceux qui se faisaient collaborateurs de ces pratiques. On sait que, à cause de ces violences sur les vaincus, Stanley s’était fait surnommer dans le Bas-Congo « Bulamatari » qu’il traduisit lui-même par « briseur de pierre » (the rockbreaker). Mais dans l’entendement local, ce nom n’avait pas la connotation de courage et d’endurance qu’il y mettait pour son autosatisfaction ; cela faisait plutôt allusion à sa méchanceté. S’il méritait le surnom de Bula-Matari, c’est vraisemblablement pour faire référence à un autre personnage historique tout aussi exécrable qui vécut dans la région au XVIe siècle : Dom Francisco Bullamatari. A sa mort, ce notable autochtone fut enterré près de l’église de Sâo Salvador. La tradition populaire dit que même les démons en furent scandalisés et s’employèrent à déterrer le corps de ce lieu béni. Il est donc logique qu’un personnage aussi cruel que Stanley ait été considéré comme une réincarnation, un retour de l’esprit du Dom Francisco Bullamatari. D’où son surnom (Bontinck F., 1963 : 83-87 ; 1989 : 183).
Dans la zone arabe, l’après-guerre fut encore plus meurtrier. Les troupes victorieuses s’employèrent à détruire les anciennes villes arabes à un point tel qu’elles étaient méconnaissables. Kasongo, métropole de plus de soixante mille habitants, fut rayée de la carte, dès 1893. On fit construire la nouvelle ville quinze kilomètres plus loin sur les rives du fleuve. L’ancien emplacement, laissé à quelques villageois, fut appelé « vieux-Kasongo » ou encore « Tongoni » par opposition à « Kasongo ». C’est vers la fin de la période coloniale que l’administration abandonna la nouvelle ville pour réintégrer l’ancien site. Nyangwe, peuplée naguère de près de quarante mille habitants, perdit toute importance pour devenir un simple repère géographique ; Riba-Riba fut incendiée par Chaltin en 1893. Reconstruite, elle prit le nom de Lokandu. Kirundu déclina définitivement et Kabambare ne fut plus qu’un nom. En même temps qu’il détruisait ou abandonnait les anciennes villes arabes, le pouvoir colonial s’organisa pour régler le sort des chefs arabes qui n’avaient pu quitter la région : exécution des « assassins », relégation et expulsion (Kimena K.K., 1984 : 248-250).
Pourtant du côté des anciens de la « guerre arabe », tout ne se passait pas pour le mieux. L’histoire coloniale militaire de la guerre a retenu trois cas fameux de mutinerie de ces anciens ennemis intégrés dans l’armée régulière parce qu’on reconnaissait leur bravoure et qu’ils étaient de bons soldats. La première rébellion, la « mutinerie de Luluabourg » eut lieu en 1895 ; elle fut la plus longue à être réprimée et paralysa toute activité dans la région comprise entre les lacs du Haut-Lualaba et le cours supérieur du Kasaï pendant plus de dix ans. La seconde, la « mutinerie de la colonne Dhanis » dans le Nord-Est, en 1897, fut particulièrement coûteuse en vies humaines ; elle fut à l’origine de l’effondrement des rêves d’extension vers le Nil et ébranla l’autorité de l’Etat dans cette région pendant près de trois ans. Quant à la troisième, la « mutinerie du fort de Shinkakasa », bien que brève, elle fut grave parce qu’elle se déroula à Borna, au siège même du gouvernement local, en 1900 (FB, 1952 : 349-465).
Ces différents épisodes, dans l’historiographie coloniale, sont qualifiés de « révoltes bateteia ». En réalité, il s’agit des différents scénarios possibles d’une seule et même guerre de résistance des vaincus d’hier qui, intégrés dans l’armée du vainqueur, retournaient contre lui l’arme qu’il leur avait mise dans la main. Ces premières « rébellions au Congo » désorganisèrent pendant une décennie 1 action coloniale dans tout l’est du pays. Toutes ces actions de rébellion avaient des caractéristiques communes sinon similaires. Elles partaient non pas des maquis mais des camps et des rangs de la Force publique. Il s’agissait d’une révolte des troupes régulières. Le groupe en présence n’était donc jamais tribal mais plutôt composite et donc interethnique. On le qualifia de « tetela » suivant l’acception coloniale de 1 époque. Le terme désignait toutes les recrues de l’entre-Lualaba-Lomami : il comprenait pratiquement toutes les ethnies du quart centre-est du pays : Kusu, Songye, Luba. Kanyoka, Tetela, etc. Ces recrues étaient à l’époque les soldats préférés des Blancs parce qu’ils avaient déjà servi dans les rangs arabisés. Qualifions ces éléments de Bauni, terme par lequel ils se désignaient eux-mêmes. Précisons aussi, pour éviter toute connotation ethnique du phénomène, que la guerre des Bauni se déroula en dehors du territoire tetela : les régions concernées furent le pays luluwa (Luluabourg), le Maniema (Kasongo, Nyangwe, Kabambare), la partie septentrionale de la Tanzanie actuelle aux frontières du Ruanda et du Burundi. Dans ces régions, le groupe originel des Bauni grossissait grâce à des recrues locales qui venaient ajouter leur mécontentement face au nouvel ordre politique.
La révolte de Luluabourg eut lieu en juillet 1895. Luluabourg n’était qu’un « poste » aux côtés de Lusambo, la capitale du district de Lualaba-Kasaï. La compagnie active du district comprenait environ un millier de soldats répartis entre Lusambo, Kabinda, Mukubua au sud-est de Luluabourg et Kayeye II en amont de Kanda-Kanda. La mission de Luluabourg-Saint Joseph, à côté du poste de l’Etat, était déjà créée ainsi que celle de Mérode. Les soldats de la garnison étaient pour la plupart d’anciens soldats de Ngongo Leteta qui, après l’exécution de leur chef, avaient été transférés à Luluabourg. Il va de soi que c’étaient des gens avertis, puisqu’ils avaient vu de leurs propres yeux le sort réservé par les Blancs à leur chef, malgré les services qu’il leur avait rendus. De plus, dans les rangs, ils étaient soumis à la chicotte, une peine réservée aux esclaves dans l’armée arabisée. Dhanis en donnait tant qu’on l’avait surnommé « Fimbo mingi ». A Luluabourg, la vie était particulièrement dure à cause de la brutalité des responsables du poste. Le ravitaillement était difficile et la solde irrégulière. La rébellion, au point de départ, consista pour les soldats à décider ni plus ni moins de déserter pour « rentrer au village ». Ils en avaient assez. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, on fit des provisions, les viandes furent boucanées et on plia bagage-
Le lendemain, au moment de passer à l’acte, les choses prirent une mauvaise tournure : un Blanc fut assassiné ; un autre, blessé, se réfugia à la mission. L’alerte fut donnée. Les autres garnisons désarmèrent leurs éléments d’origine arabisée pour éviter que le mouvement se propage. Les mutins prirent la direction est vers le Lomami, leur pays natal. Ils occupèrent Ngandu, traversèrent le Lomami sous la direction de leurs chefs : Kandolo, Yamba-Yamba, Kimpuki qui se sont illustrés par leur combativité. Il a fallu une concentration d’un millier de soldats venus à la fois de Kasongo et de Lusambo, encadrés par quinze officiers blancs, pour mettre les rebelles en déroute, en octobre 1895. Ceux-ci se dispersèrent alors en direction du sud vers le Shaba. Ce fut le début d’une espèce de guérilla qui dura jusqu’en 1908 et qui se commua ici et là, en des guerres « tribales » entre les ethnies partisanes de la rébellion et celles qui soutenaient les Européens. Ce qui se passa dans l’ancien empire luba où le trafic d’armes et la vente d’armes avaient consacré la décadence généralisée de la gestion politique, ce qui constitue également un cas typique de rébellion latente de l’époque. On était loin à présent de la période glorieuse de Kalala Ilunga. La crise politique se manifestait surtout en matière de succession, qui était par définition un casus belli. Le Mulopwe Kasongo Kalombo qui régnait en 1860 avait éliminé par la guerre trois de ses frères. Le quatrième, Dai Mande, qui se réfugia au royaume de Kikondja, tenta de lui succéder mais il fut assassiné par Kasongo Niembo. Ce dernier subit à son tour la concurrence de son frère, Kabongo Kumwimba Shimbu. Une guerre civile éclata entre les partisans des deux frères, les clans du nord soutenant Kabongo et ceux du sud Kasongo.
La guerre continuait toujours quand les représentants de l’EIC arrivèrent en 1891 dans la région. Tirant parti de cette situation, Kasongo Niembo demanda la protection de l’EIC, ce qui poussa Kabongo à chercher des alliances du côté des dissidents, et donc des rebelles bauni au moment où ils envahirent la région. De manière générale, dans la région, les chefs locaux et les populations voisines se répartirent en deux groupes : les partisans des rebelles (Kabongo, Dibwe, Kolomoni) et ceux de l’Etat (Lumpungu, Mpanya Mutombo, Kasongo Niembo). C’est seulement en 1896 que la Force publique s’aperçut de cet état de fait et comprit que les résistances armées de certains chefs étaient dues à l’insertion des Bauni (De Boeck G., 1987 : 129-131). On sait que plus tard, Kasongo Niembo, se rendant compte des intentions réelles du colonisateur, changera d’avis et se rebellera à son tour contre l’EIC. En cela, il ne fera que hâter la fin d’un règne déjà éphémère.
5.2 La révolte de la colonne Dhanis
Si la révolte de Luluabourg n’avait que des ambitions limitées, celle de la colonne de Dhanis eut des prétentions nationales et nationalistes réelles. Rappelons d’abord que l’expédition Dhanis fut un projet grandiose auquel Léopold II apporta beaucoup de soins, tant son désir d’occuper le Nil était vif, de même que sa préoccupation d’inclure dans son empire africain le deux grands fleuves du continent : le Congo et le Nil. Dhanis, à qui cette mission fut confiée, pensa faire appel aux Arabisés tetelakusu, fort de son prestige de vainqueur des Arabes. Avait-il d’autres choix ? Les Arabisés étaient les seuls, à l’époque, à être ouverts aux activités des Européens et capables de manier correctement et efficacement différentes sortes d’armes à feu. Le but de cette expédition était d’occuper la partie sud de Bahr el-Ghazal, appelée l’enclave de Lado, et de conquérir à partir de là les régions septentrionales de l’enclave, jusqu’au-delà de Fachoda, à proximité de Khartoum. L’expédition devait partir de deux points différents pour se retrouver à Dirfi à la frontière nord-est. avant d’entrer dans l’enclave de Lado. L’une des colonnes partait de Dungu sous le commandement de Chaltin, l’autre démarrait des Falls, commandée par Dhanis lui- même, chef de l’expédition. En septembre 1896, Dhanis recrutait encore ses troupes alors que Chaltin, déjà prêt depuis un mois, était en route ; il ne put entamer le voyage qu’en octobre, sans avoir pu assurer tous les préparatifs qu’il avait souhaités pour ses troupes. Il fallait agir vite, suivant les ordres du souverain. Il craignait 1 arrivée imminente des troupes britanniques dans la région.
C’est pourquoi Chaltin reçut l’ordre peu après de ne pas attendre l’arrivée de la colonne Dhanis à Dirfi mais d’attaquer directement les derviches de l’enclave. Il s’exécuta, attaqua avec succès les madhistes à Redjaf, capitale de Lado, le 17 février 1897, et le 18 il entra dans la ville abandonnée par les vaincus. Le 26, la colonne Chaltin occupait encore le Lado mais toujours pas de nouvelles de Dhanis ! Pourtant les deux colonnes auraient dû se rejoindre et poursuivre la conquête vers le nord. Dhanis était toujours absent. Il avait des problèmes. L’avant-garde de ses troupes s’était révoltée. Sans cette mutinerie, les troupes de l’EIC seraient vraisemblablement arrivées les premières à Fachoda. Selon les témoignages des officiers de l’expédition Dhanis, les préparatifs écourtés, pour les raisons que l’on sait, étaient insuffisants ; cela se ressentait tant au niveau des troupes qu’au niveau du commandement, où Dhanis n’avait pu disposer de ses compagnons de la campagne arabe.
De plus, la route n’avait été reconnue que superficiellement et les vivres étaient insuffisants. La méchanceté de Dhanis n’était pas pour arranger les choses. Le capitaine H. Bodart, qui commandait une partie des troupes de l’expédition, nous a laissé sa version des faits. Il y avait trop de problèmes ; de plus le commandant en chef (Dhanis) n’écoutait personne « … trop personnel, trop arrêté dans ses vues, ses projets et ses décisions », il pratiquait même une étrange discrimination entre sa garde prétorienne faite de soldats zanzibaristes et le reste de la troupe. Il faisait plus confiance à ses quelques fidèles tetela qu’aux Européens. La situation était véritablement explosive, d’après ce témoignage :
Tous les trois jours, les soldats partaient en razzia ! Ce genre d’expédition avec des troupes inexpérimentées n’arrangeait rien en ce qui concerne le maintien de la discipline. Les hommes étaient éreintés, affamés et indisciplinés ! On devait utiliser des moyens de coercition pour leur imposer silence ! Joignez-y les plaintes, les récriminations des femmes et des enfants, l’excitation, des menées sourdes des Arabisés, quelques ordres maladroits ou exécutés trop intempestivement, le surmenage, la disette, etc. Vous connaîtrez une partie de l’origine et plus certainement les causes primordiales de la révolte des troupes…
Les soldats arrivaient en retard aux rassemblements, s’enfuyaient dans les herbes, discutaient les ordres sans manquer d’exposer leurs griefs : oui, me disaient-ils, les soldats de Fimbo mingi -M. Dhanis – sont mieux habillés que nous ; ils ne portent pas les charges ; on ne les fait pas travailler comme nous (Salmon P., 1977 : 29-30).
Tableau 8 — Effectifs de la Force publique (1889-1914)
| ANNÉE | EFFECTIFS TOTAUX |
| 1889 | 1487 |
| 1891 | 3186 |
| 1893 | 7634 |
| 1895 | 10294 |
| 1897 | 13983 |
| 1898 | 19028 |
| 1899 | 15565 |
| 1901 | 12786 |
| 1903 | 16650 |
| 1905 | 15908 |
| 1907 | 13011 |
| 1909 | 13936 |
| 1911 | 17833 |
| 1913 | 17833 |
| 1914 | 17833 |
Source : Force publique, 1952 : Annexe 6.
La révolte éclata le 14 octobre 1897. Les meneurs étaient le fils de Mwini Mohara et surtout Piani Kandolo qui avait déjà combattu Dhanis au Maniema. En octobre 1898, lors des négociations qui furent engagées avec les rebelles pour faire la paix, c’est Kandolo, qui parla seul au nom des révoltés et dévoila, ou plutôt confirma les véritables raisons de la révolte :
Nous nous sommes révoltés parce que nous étions traités comme des esclaves. Voici les principaux griefs :
1) Défense de manger du bœuf, de la chèvre et même des poules… ;
2) On nous donnait beaucoup de coups de fouet pour rien ;
3) Pour un rien nos camarades étaient attachés et fusillés ;
4) Nous avions tous deux ou trois femmes ; elles nous ont été enlevées pour être données aux soldats qui n’en avaient pas ;
5) Si une femme ou un boy s’attardait pour boire de l’eau en route, son maître, le lendemain, devait porter une lourde charge ;
6) Tandis que nous ne recevions rien, les gens de l’escorte de Fimbo Mingi recevaient des Livres sterling, des étoffes, des fez et du chop.
Nous (les Bakusu) avons commencé la révolte et les autres nous ont suivis (Salmon P., 1977 : 60-61 extrait lettre de Long du gouverneur général).
A peine avait-elle éclaté que la révolte se répandit dans toute l’avant-garde : elle tua tous les Blancs à l’exception de ceux qui parvinrent à s’échapper. Les mutins rebroussèrent chemin. Dhanis n’apprit la nouvelle qu’en mars. Après le désarmement des soldats originaires des anciennes possessions arabes, il battit en retraite. Il fut aux prises avec les rebelles en mars 1897 à Ekwanga ; la déroute commençait. Plusieurs soldats passèrent à l’ennemi et écrasèrent les forces de Dhanis qui dut battre en retraite. Il subit de nouvelles défaites à Irumu puis à Mawambi. Les rebelles, après leur défaite dans la haute Lindi, le 15 juillet, se dispersèrent le long des lacs ldi Amin, Kivu, jusqu’au Tanganyika. Destitué, Dhanis fut remplacé à la tête de l’expédition par A. Vangèle, puis il fut rétabli dans ses fonctions. La mutinerie continua pourtant à faire rage. Le 14 novembre 1889, Kabambare fut prise et quelques officiers furent tués.
Toutefois, les rebelles commencèrent à reculer à partir de janvier 1899 suite à la mort de plusieurs de leurs chefs devant Bwana Dabwa, localité située près de la rivière Lubondoye. Quelques mois plus tard, le 20 juillet, ils abandonnèrent Sungula ; le 16 octobre, les troupes de l’EIC entrèrent à Uvira. Les mutins se divisèrent : une partie passa en territoire allemand (Tanganyika), une autre continua la guérilla jusqu’en 1902 (Kimena K.K., 1984 : 259-261). Ce qui vint à bout des rebelles malgré leur force, ce fut l’absence d’un projet politique dans lequel ils auraient pu investir l’ardeur de leur révolte. Une fois de plus, ils avaient pour seul objectif de rentrer chez eux et de se faire quelque butin au passage. C’était là une conséquence directe des mauvais traitements subis. « Nous étions traités comme des esclaves », avait déclaré Kandolo, le principal chef rebelle.
La rébellion touchait à sa fin. Elle connut toutefois un dernier sursaut, en 1900, à l’autre bout du pays et dans la capitale même. Depuis 1891, dans les environs de Borna, plus précisément à Shinkakasa, on avait fait construire un fort susceptible d’arrêter les vaisseaux de guerre tentés de violer les passes du fleuve. La menace s’adressait en réalité au Portugal qui se prévalait de ses droits historiques en tant que premier découvreur de l’embouchure du Congo. A Shinkakasa, on comptait une bonne quinzaine de canons et d’autres armes pour parer à toute éventualité. La garnison comprenait deux cents soldats réguliers et un nombre au moins aussi important de soldats-travailleurs. La plupart appartenaient à des unités révoltées ou dont on avait craint la révolte lors des rébellions de Luluabourg en 1895, de l’Ituri en 1897 et de Lusambo en 1898. Exilés à Borna, la plupart avaient déjà servi pendant un terme complet, sans être libérés après leurs sept années de service. Une fois de plus, ils en avaient assez et souhaitaient rentrer chez eux. Ils parvinrent à associer d’autres soldats à leur mécontentement.
La rébellion éclata le 17 avril 1900, dans l’après-midi ; les rebelles s’emparèrent du fort, de ses magasins d’armes et de munitions et ouvrirent le feu sur les Blancs. Ils firent ensuite une sortie, s’emparèrent des provisions dans une factorerie et une ferme proches, puis s’enfermèrent dans le fort d’où ils bombardèrent Borna et le port. Deux navires à quai, l’un venant d’Europe, l’autre de Matadi, furent obligés de se mettre hors de portée des projectiles. Un obus tomba près du palais du gouverneur. Le bombardement ne fit cependant guère de dégâts : les rebelles n’avaient pas vissé de fusées aux obus, de sorte que ces engins n’explosaient pas.
A cause de l’effet de surprise, la réaction se fit quelque peu attendre. Le lendemain, le 18, la bataille s’engagea et l’on brûla de part et d’autres une quantité impressionnante de munitions. C’est le matin du 19 que les forces régulières se rendirent compte que les rebelles avaient pris la clé des champs pendant la nuit. Il ne restait au fort qu’une cinquantaine d’hommes avec des morts et des blessés graves. La comptabilité du fort établira que les rebelles avaient tiré pendant les deux jours deux cent vingt-cinq obus de tous calibres, trois cent vingt-huit boîtes à balles et des milliers de cartouches. On organisa la poursuite des rebelles et on les rattrapa dans les régions avoisinantes, y compris au Congo français. Ceux qui se rendirent aux autorités françaises furent relégués à Brazzaville. Une trentaine d’hommes, arrêtés, rejoignirent ceux qui avaient été pris dans le fort. Un conseil de guerre condamna à mort dix-huit d’entre eux qui furent exécutés le 30 avril (FP, 1952 : 460-464 ; De Boeck G., 1987 : 347-349). En soi, il s’agissait d’une révolte banale au regard de celles qui s’étaient passées auparavant. Mais elle est importante, parce qu’elle se déroulait à la capitale, elle montra le courage suicidaire des rebelles qui n’en pouvaient plus de supporter le traitement qui leur était infligé.
A l’époque, ces incidents eurent un grand retentissement car Borna abritait la plus grande concentration d’Européens, qui ne se privèrent pas de parler. Les deux bateaux qui furent témoins de l’incident, tout comme la frontière proche du Congo et de l’Angola, contribuèrent à diffuser les nouvelles.
A côté des rébellions dues aux anciens de la Force publique, on nota une série de réactions violentes qui furent le fait de quelques groupes locaux menés par des aristocraties locales. A chaque fois, ces initiatives occasionnèrent la mise sur pied d’« opérations de maintien », notamment chez les Mbudja qui n’admettaient pas encore la suprématie des nouveaux venus [3]. L’affrontement se poursuivit de 1898 à 1905. Il en fut de même chez les Zandé dans le Bas-Uélé (1895-1904) ainsi que les Boa dans l’entre-Uélé-et-Rubi (1895-1906) et au sein de plusieurs autres ethnies, notamment au Kasaï. Au début du siècle, avec la généralisation du commerce imposée par les Etrangers, on avait supposé que la colonisation allait se faire en douceur. Ce ne fut pas le cas : une lutte âpre se poursuivit de manière quasi ininterrompue, de 1877 à 1907. La guerre fut totale : guerre de conquête coloniale pour s’emparer des terres, guerre entre envahisseurs, où les Européens évincèrent leurs concurrents Arabes, guerres de répression contre les premières rébellions du Congo… A ce tableau, il faut ajouter cette autre forme de violence que constituent les travaux forcés dont il sera question plus loin.
En réalité, les autochtones ne le savaient pas, la guerre généralisée avait plusieurs ramifications ; elle s’était installée non seulement entre envahisseurs – Arabes et Européens – mais se retrouvait également au sein de chaque camp d’envahisseurs, entre Arabes et entre Européens, même si les uns et les autres n’allaient pas jusqu’à s’entre-tuer. Chacun voulait posséder le Congo, sans partage. En effet, si les Européens ont fait la guerre des Arabisés, ce n’est pas tant pour combattre l’esclavagisme, mais parce que ces derniers gênaient par leur présence et qu’ils se posaient en concurrents qui avaient entamé à leur profit une conquête que les autres entendaient réaliser. Les Arabes ont été vaincus facilement parce qu’ils se faisaient la guerre entre eux, par des oppositions commerciales : le camp Tippo Tip se fit accommodant à l’égard du nouveau pouvoir tandis que l’autre camp opta pour la position radicale, écoulant son ivoire envers et contre tout, vers 1 est au lieu de l’ouest. Les Européens eux-mêmes s’opposaient entre eux : il fallait désormais apprendre à distinguer entre les agents de l’EIC et les représentants des autres puissances. Chez les premiers, il fallait maintenir une distinction importante entre les Belges et les non-Belges. C’est à cause de cette guerre interne, sournoise, que Mushid Ngelengwa fut assassiné sans autre forme de procès. Il fût tué par une balle tirée par un Belge membre d’une expédition dirigée par un Anglais au service de Léopold II, qui redoutait d’être devancé par les Anglais au service de Sa Majesté la Reine d’Angleterre. Un véritable puzzle. Même les « Blancs de Dieu », les missionnaires, étaient divisés entre eux : il y avait les protestants et les catholiques, les Belges et les non-Belges ; les distinctions entre congrégations catholiques, encore peu perceptibles à l’époque se devinaient aux détails variables des soutanes. Cependant, tout en se combattant entre elles, les différentes factions de cette immense armée étaient engagées dans une même « offensive » contre les Congolais.
Les Congolais, même armés, furent vaincus. Non seulement ils n’étaient pas préparés à subir une telle guerre, mais ils n’en comprenaient pas les mécanismes, ni l’enjeu fondamental. Ils la minimisèrent, luttant en ordre dispersé, chaque groupe attendant d’être directement concerné pour réagir. Ils ne comprirent pas que la guerre était un phénomène général et que les nouveaux venus étaient à l’affût de tout « faux pas » pour le transformer en casus belli. Pourtant, la guerre profitait à une classe d’autochtones, une bande de fonctionnaires sans scrupules utilisés pour le maniement de la chicotte, l’organisation de razzias ou de rafles. Ces auxiliaires, à l’instar de leurs confrères arabisés, devaient être éliminés à leur tour, dès qu’ils devenaient encombrants, gênants voire inutiles. C’est dire que, comme toute guerre, celle-ci avait ses traîtres ; elle eut aussi ses batailles, telles ces « rébellions » que la tradition a retenues comme étant les temps forts de cette guerre. Le candidat colonisateur n’oublia pas non plus ces épisodes. Non seulement, il prononça alors ses premières condamnations mais il créa aussi ses premiers camps de relégation. Plus important encore, il revit la physionomie globale de la Force publique, et donc de la future armée congolaise. Alors qu’au point de départ elle était constituée essentiellement de ressortissants des régions arabisées, donc de l’est du pays, elle fut par la suite plus sélective dans ses zones de recrutement et s’intéressa aux Bangala. La langue des militaires cessa d’être le swahili et tout militaire swahiliphone dut renoncer à son identité linguistique, pour s’intégrer à la grande famille des lingalophones.
La guerre des Bauni fut le premier combat organisé sur le plan interethnique, donc national ; elle eut pour effet de retarder l’action de la colonisation. Elle aurait pu avoir des conséquences plus importantes encore si les mutins avait moins fait la guerre, et davantage la guérilla. Le fait de se prêter à des batailles rangées plaçait en effet les troupes régulières en position de force. Il n’empêche que ces héros ont le grand mérite d’avoir tenté de résister et d’avoir commencé courageusement. Quelques noms sont restés dans l’histoire : Kapilu, le boy qui incita les gens de Luluabourg à tirer sur son maître, le capitaine Pelzer, qui, la veille, lui avait fait administrer des coups de fouets au-delà des limites autorisées ; les caporaux Yamba-Yamba et Kimpuki qui tirèrent les premiers coups de feu donnant le signal de la rébellion, les premiers de la lutte contre l’oppression coloniale ; le sergent Kandolo, ancien garde du corps de Ngongo Leteta qui dirigea les rébellions de Luluabourg avec Kimpuki et Yamba-Yamba [4] ; Piana Kandolo, qui commanda la révolte de la colonne Dhanis et de ses principaux lieutenants.
Texte : Déclarations de reconnaissance de l’Etat indépendant du Congo par les U. S.A. et la Belgique
Déclarations échangées entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Association internationale du Congo
L’Association internationale du Congo déclare parla présente qu’en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans les bassins du Congo et du Niadi-Kwilu et dans les territoires adjacents sur l’Atlantique, il lui a été cédé un territoire pour l’usage et au profit d’Etats libres déjà établis ou en voie d’établissement sous la protection et la surveillance de ladite Association dans lesdits bassins et territoires adjacents, et que lesdits Etats libres héritent de plein droit de cette cession ;
Que ladite Association internationale a adopté pour drapeau, tant pour elle-même que pour lesdits Etats libres, le drapeau de l’Association internationale africaine, à savoir un drapeau bleu avec une étoile d’or au centre ;
Que ladite Association et lesdits Etats ont résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises ou les produits importés dans leurs territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo ; cette résolution a été prise afin d’aider le commerce à pénétrer dans l’Afrique équatoriale ;
Qu’ils assurent aux étrangers qui se fixent sur leurs territoires le droit d’acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d’établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d’obéir aux lois. Ils s’engagent, en outre, à ne jamais accorder aux citoyens d’une nation un avantage quelconque sans l’étendre immédiatement aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.
En foi de quoi, Henry S. Sanford, dûment autorisé à cet effet par ladite Association, agissant tant pour elle-même qu’au nom desdits Etats, a ci-dessous apposé sa signature et son cachet, le 22 avril 1884, en la ville de Washington.
(Signé) H.S. Sanford. (L.S.).
Frédéric T. Frelinghuysen, Secrétaire d’Etat, dûment autorisé à cet effet par le Président des Etats-Unis d’Amérique, et en conformité de l’avis et consentement donné dans ce but par le Sénat, reconnaît avoir reçu de l’Association du Congo la déclaration ci-dessus et déclare que, se conformant à la politique traditionnelle des Etats- Unis, qui leur enjoint d’avoir égard aux intérêts commerciaux des citoyens américains, tout en évitant en même temps de s’immiscer dans des controverses engagées entre d’autres puissances, ou de conclure des alliances avec des nations étrangères, le gouvernement des Etats-Unis proclame la sympathie et l’approbation que lui inspire le but humain et généreux de l’Association internationale du Congo, gérant les intérêts des Etats libres établis dans cette région, et donne ordre aux fonctionnaires des Etats-Unis, tant sur terre que sur mer, de reconnaître le drapeau de l’Association internationale à l’égal de celui d’un gouvernement ami.
En foi de quoi il a ci-dessous apposé sa signature et son cachet le 22 avril A.D. 1884, en la ville de Washington.
(Signé) Fréd.T. Frelinghuysen. (L.S.).
Déclarations échangées entre le Gouvernement belge et l’Association internationale du Congo
L’Association internationale du Congo déclare par la présente, qu’en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans le bassin du Congo et de ses tributaires, il lui a été cédé en toute souveraineté de vastes territoires en vue de l’érection d’un Etat libre et indépendant ; que des conventions délimitent les frontières des territoires de l’Association de ceux de la France et du Portugal, et que les frontières de l’Association sont indiquées sur la carte ci-jointe ;
Que ladite Association a adopté comme drapeau de l’Etat géré par Elle un drapeau bleu avec une étoile d’or au centre ;
Que ladite Association a résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises ou les produits importés dans ses territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo ; cette résolution a été prise afin d’aider le commerce à pénétrer dans l’Afrique équatoriale ;
Qu’elle assure aux étrangers qui se fixent sur ses territoires le droit d’acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d’établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d’obéir aux lois. Elle s’engage en outre à ne jamais accorder aux citoyens d’une nation un avantage quelconque sans l’étendre immédiatement aux citoyens de toutes nations, et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.
En foi de quoi, le Président de l’Association, agissant pour elle, a ci-dessous apposé sa signature et son cachet.
Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.
(Signé) Strauch.
Le Gouvernement belge prend acte des déclarations de l’Association internationale du Congo, et par la présente reconnaît l’Association dans les limites qu’elle indique et reconnaît son drapeau à l’égal de celui d’un Etat ami.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont apposé ci-dessous leur signature et leur cachet.
Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.
(s.) Cte. Aug. van der Straten-Ponthoz.
Baron Lambermont.
[1] Le Centenaire de la Conférence de Berlin a été célébré par une série de colloques à Lomé (Togo), à Yaoundé (Cameroun) et à Paris. Les rencontres les plus significatives se déroulèrent à Brazzaville (Colloque international sur la Conférence de Berlin) et à Kinshasa (Symposium international sur l’Afrique et son avenir).
[2] Pour plus de renseignements sur ce personnage, consulter Luwel M., Sir Francis de Winton, administrateur général du Congo, 1884-1886, Tervuren, 1964.
[3] Pour plus de détails, consulter l’étude réalisée à partir des témoignages des intéressés eux-mêmes. Moke Moseko M.L., La révolte des Mbuja (1891-1905), mémoire licence. Lubumbashi. 1989.
[4] Il existe dans l’ancienne zone de la guerre (plus précisément au sud-ouest du Katanga) trois villages portant les noms de Yamba-Yamba, Kimpuki et Kapepula (chef coutumier qui s’allia aux Bauni).



