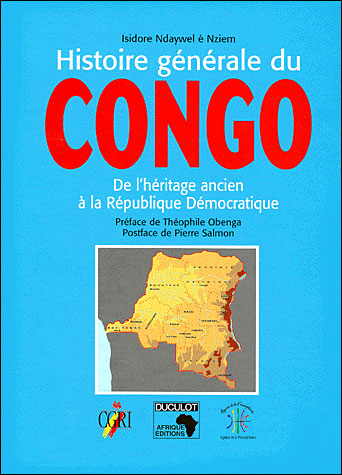
Partie 5 - Chapitre 2 : La gestion belge du Congo
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 2
La gestion belge du Congo
La Belgique prit donc les choses en mains pour un demi-siècle au moins. L’Empire colonial belge, le Congo belge, se caractérisa par une longue stabilité des institutions et des idées. En effet, son évolution fut régulière et se poursuivit même au travers des conjonctures particulières qu’elle rencontra, telles la Première Guerre mondiale, la grande crise économique des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Malgré leur acuité, ces phénomènes n’eurent qu’un impact limité et donnèrent même parfois une impulsion particulière à la progression du développement colonial, au lieu de l’arrêter ou de l’écarter de son objectif. D’ailleurs, après ces trois événements, l’avenir colonial fut à ce point prometteur que la Belgique se préoccupa de le planifier. En effet, le premier « Plan décennal du développement social et économique du Congo belge » fut mis au point au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et concerna la décennie qui suivit cette période de crise, c’est-à-dire les années 1949-59. Cette décennie fut pourtant la plus mouvementée, surtout à partir de 1956, à cause d’un fait tout à fait imprévu : la revendication de l’indépendance. La stabilité fut ébranlée et le cours de l’histoire s’accéléra, transformant ces années en un véritable temps d’éveil. A l’issue de cette période révolutionnaire, le pays connut un véritable envol. La permanence institutionnelle qui avait caractérisé lage de la gestion belge du Congo fut en soi un phénomène remarquable, quand on sait qu’elle dura une cinquantaine d’années, où se succédèrent plusieurs administrations. En effet, au cours de cette période, en Belgique, quatre souverains se succédèrent, de Léopold II à Baudouin Ier, ainsi qu’une trentaine de gouvernements. Les gestionnaires directs dans le pays, les représentants de ce pouvoir colonial, se sont également succédé : une dizaine de gouverneurs généraux et au moins deux fois plus de ministres de colonies (Vanhové J., 1968). Cette stabilité valut au Congo belge la palme de « la colonie modèle » (Mbokolo E., 1990 : 9-40).
De manière conventionnelle, on distingue au sein de ces quatre décennies trois moments distincts : jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, plus précisément de 1908 à 1920, on assista au retour de la liberté commerciale, qui remplaça la cueillette exclusive et monopoliste que le système léopoldien avait inauguré vers 1895. L’avènement du commerce libre s’accompagna d’une implantation du grand capital bancaire d’une importance inconnue en Afrique. Le Congo, après avoir assuré de larges profits à la Belgique de Léopold II, continua ainsi à se particulariser du point de vue économique par rapport à l’ensemble de l’Afrique située au sud du Sahara. La suite confirma cette tendance. Malgré les répercussions de la crise internationale, l’entre-deux-guerres, de 1920 à 1940, fut une période de prospérité. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la colonie pouvait se prévaloir d’un développement économique exceptionnel dans toute l’Afrique noire. Cette croissance fut le fruit d’un contrôle extrêmement strict de la vie quotidienne de l’autochtone qui ne put trouver refuge qu’au sein des sectes à caractère messianique ; celles-ci ne craignaient pas, en effet, de prédire la fin prochaine du règne des Blancs.
La fin de la Seconde Guerre mondiale permit à la colonie, entre 1946 et 1956, de diversifier ses partenaires commerciaux en traitant directement avec les USA et l’Angleterre. La prospérité, qui s’était confirmée par une nette accélération commerciale, provoqua une urbanisation rapide dans des proportions sans comparaison possible, une fois de plus, avec le reste de l’Afrique au sud du Sahara, à l’exception de l’Afrique du Sud.
Les revendications de l’indépendance vinrent enrayer les progrès de cette évolution. La prospérité dont on ne cessait de vanter les mérites était fragile tant qu’elle n’était pas assumée par les Congolais à qui on refusait tout droit à l’initiative (Cornevin R., 1975 : 445-466). L’histoire consciente du Congo reprit donc droit à l’initiative à partir de ces revendications, refermant résolument la parenthèse historique qui s’était ouverte en 1877. Dans le vécu congolais, ces distinctions internes n’étaient guère significatives ; on pense même qu’elles étaient inexistantes. L’âge colonial vécu ne l’a été que dans deux époques extrêmement distinctes : l’âge d’or de la colonisation, caractérisé par le règne des tracasseries, et l’âge révolutionnaire, qui est l’instant de décolonisation, marqué par des troubles anomiques.
Les signes de l’avènement d’un second âge colonial, distinct du premier, ont donc été ressentis pour la première fois vers les années 1910 dans la préoccupation de l’autorité coloniale d’assurer une gestion plus suivie des autochtones. En effet, la vie en chefferie fut une réelle imposition pour ceux qui ignoraient ce mode d’organisation, regroupés chez eux soit en villages indépendants les uns des autres, soit en royaumes ou empires. Pour ceux qui connaissaient déjà la chefferie, ces nouvelles dispositions constituaient malgré tout une innovation car la réalité imposée, la chefferie coloniale, n’avait qu’un vague rapport avec la réalité précédente. Par rapport au premier, le second âge colonial n’apportait qu’un changement dans la continuité avec, à nouveau, des impositions, des recrutements et des travaux forcés. Les raisons de cette continuité étaient évidentes. Léopold II n’avait été qu’un bouc émissaire, à qui l’on reprochait d’avoir réalisé avec ostentation ce qu’on aurait souhaité voir se réaliser avec plus de discrétion. La disparition du bouc émissaire eut l’inconvénient de faire éclater la vérité. Il fallait à tout prix que le Congo se sous-développe pour que la Belgique se développe et avec elle, le reste de l’Europe occidentale. Pour ce faire, cette région du continent, tout comme l’ensemble de l’Afrique, fut contrainte à prendre part à une histoire qui n’était pas la sienne. Son évolution propre fut soumise aux pulsations de cette histoire différente. En réalité ce processus était engagé depuis des décennies. L’innovation, à ce stade, était que ces ingérences se vivaient plus directement par les populations autochtones.
La colonisation belge est donc un épisode commun à deux histoires nationales. Il n’est pas indispensable de la restituer ici de manière exhaustive. Limitons-nous à rendre compte des faits significatifs pour la vie locale et dont l’impact sur son devenir était évident. Pour évaluer la gestion belge du Congo, commençons par examiner les réalisations coloniales avant d’en évaluer les effets sur les autochtones et de faire état de leurs réactions. La production coloniale sera examinée au niveau administratif et donc institutionnel d’abord. On s’interrogera ensuite sur la mise en valeur socio-économique qui a été faite de l’espace colonisé. Le domaine des mentalités, et donc de l’ouverture du monde et de l’accès à la modernité sera appréhendé en une troisième approche.
Au début du XXe siècle, les campagnes congolaises se plaignaient de l’existence, dans les villages, de hiérarchies nouvelles d’essence coloniale. L’activité commerciale, particulièrement la perception d’impôts en nature et le recrutement de porteurs, avait fait naître une hiérarchie particulière connue ici et là sous des noms variés : surveillants, linguisters de négoce, et plus couramment capitas. Les surveillants, on l’a vu, étaient d’anciens agents de la Force publique chargés de percevoir l’impôt à caoutchouc et de punir les paresseux, les récalcitrants et tous ceux qui n’arrivaient pas à respecter les délais. On sait de quel type d’abus ils étaient capables. Les linguisters de négoce étaient des auxiliaires commerçants européens ambulants, généralement des Portugais qui, à partir de la factorerie, faisaient du commerce ambulant aux alentours. Les linguisters étaient parfois appelés capitas mais ce terme avait une acception plus large ; il désignait aussi des collecteurs d’impôts et des recruteurs de porteurs. Ces élites nouvelles assuraient en réalité le contact entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir des Blancs. L’Etat et les sociétés commerciales disposaient des capitas. Dans certaines régions, tel le Kwilu, il existait même plusieurs catégories de capitas : ceux du village et ceux de la région, les uns et les autres étant parfois flanqués d’adjoints appelés alors « sous-capitas ». Le capita du village était en principe un indigène que le Blanc avait investi du pouvoir d’exercer des activités de recrutement ou de collecte de produits. Il acheminait le fruit de son travail chez le capita de la région qui le rassemblait et assurait sa conservation jusqu’au prochain passage du Blanc. Le capita de la région était généralement un indigène, lui aussi, que le Blanc avait recruté parmi les premiers groupes de « détribalisés » (zanzibaristes, Tetela, Kusu, Luba, etc.) et qu’il avait fait venir de loin pour son service. Ces « capitas étrangers » constituaient une véritable « bourgeoisie », crainte et respectée pour son pouvoir d’argent et la puissance de son fouet. L’histoire locale du Kwilu-Kwango ne s’est pas gênée pour conserver les traces de ces premiers « seigneurs autochtones » ; en témoigne l’éventail des noms tuba, de nos jours intégrés dans le registre anthroponymique local : Tshunza, Kandolo, Tshibamba, Kasongo… qui passent pour être des noms authentiques de cette région.
Le même phénomène était perceptible à peu près partout. Il ne constituait que la genèse des grands déplacements des populations qu’on allait connaître pendant la colonisation. Constatons que cette hiérarchie « nouvelle » coexistait avec celle des chefs locaux qui avaient acquis un statut nouveau. C’est à partir de 1891, au temps de l’EIC, que la chefferie traditionnelle fut reconnue par le pouvoir colonial… mais à la condition que son chef obtienne l’investiture de l’Etat. Tout tenait dans cette dernière assertion volontairement ambiguë, laquelle fut renforcée par le Décret du 3 juin 1906. Il fallait donc comprendre par là que le pouvoir traditionnel devenait l’instrument de la colonisation et le chef en place, peu sensible à cette exigence, devait être évincé et remplacé par un autre. Mieux encore, le pouvoir colonial pouvait indiquer lui-même l’individu qu’il jugeait apte à exercer cette fonction. La chefferie, à partir de 1906, fut donc considérée officiellement comme la subdivision administrative du poste et fit son entrée dans la catégorisation administrative imposée du dehors.
La chefferie, en tant qu’institution coloniale à base coutumière, fut généralisée en 1910. En effet, le décret du 2 mai imposa cette organisation partout. Les « indigènes » devaient être répartis en chefferies et éventuellement en sous-chefferies dont les limites étaient déterminées par les commissaires de district en « conformité » avec la coutume. Cette organisation était une manière d’exercer un contrôle strict sur la population car la liberté de circulation fut ainsi limitée. Il était interdit de s’absenter plus de trente jours de la chefferie sans un « passeport de mutation » délivré par l’administration coloniale après avis du chef de la chefferie. Il demeure entendu que non seulement les limites des chefferies étaient déterminées et donc revues par le pouvoir colonial mais que les chefs étaient désignés par l’Etat qui leur allouait un traitement. Le chef exerçait aussi le pouvoir judiciaire mais il lui était interdit d’infliger une autre peine que le fouet ; il avait en outre pour charge de participer à la collecte des impôts et d’assurer l’exécution des travaux communs ; il participait aux travaux de recensement, organisait les marchés, signalait l’apparition de maladies contagieuses, assurait l’hygiène des villages et l’exécution des travaux agricoles. Toutes ces réalités qui dataient de la fin de l’EIC furent donc généralisées.
Les méfaits se généralisèrent dans les mêmes proportions, car ces dispositions entraînèrent des abus. Les chefs qui se faisaient nommer étaient soit des aventuriers et d’ambitieux roturiers qui voulaient par là contourner le vrai pouvoir, soit des esclaves désignés par les chefs, les vrais reconnus par le pouvoir traditionnel, pour échapper à la tutelle de l’Etat. A peu près partout s’instaura une dichotomie entre le vrai chef, inconnu de l’Etat et le « chef coutumier » reconnu par l’Etat. Là où cette dichotomie était inexistante, un véritable conflit s’instaura, où le chef traditionnel était perdant d’avance. En effet, l’ambitieux qui s’était fait introniser par le pouvoir du dehors s’efforçait le plus souvent de se faire admettre par l’ordre traditionnel. S’il n’y arrivait pas par ruse ou en vantant à sa clientèle les bienfaits des produits importés, il usait généralement de la force en convertissant ceux qui pouvaient l’être et en écrasant impitoyablement tous les autres. Sa prétendue légitimité, il la tirait de la force militaire symbolisée, comme on le sait, par le fusil et la puissance d’argent. Comme ils étaient quelque peu affranchis de la tradition, de par la référence aux Blancs, et comme ils devaient absolument faire étalage de leur puissance d’argent, ces chefs d’un type nouveau s’affichaient sans honte avec une multitude d’épouses, dans des proportions plus élevées que celles autorisées par les traditions. En Equateur, on enregistra des cas de chefs mariés à deux cents voire même trois cents épouses. Peu importait si celles-ci entretenaient par ailleurs des amants ; en cela, elles faisaient oeuvre utile car elles contribuaient à l’élargissement de la clientèle du chef « nouveau » qui disposait ainsi de plus d’adeptes que le chef traditionnel. Evincé, ce dernier était réduit à sa plus simple expression sous le titre de « chef de terre », par opposition au « chef coutumier », décoré par le pouvoir colonial.
Ce contrôle strict de la population, limitée jusqu’à ses déplacements, fut pour les Congolais une manière comme une autre de vivre le changement. Ce qui n’était qu’épisodique s’étendait à l’ensemble de l’espace national. L’EIC, avec son cortège de méfaits avait vécu. La population était désormais prise en charge par un Etat et par un gouvernement. Du reste, en cette même année 1910. un autre changement important s’était réalisé : l’abolition de l’impôt en nature. Il devait désormais se payer uniquement en argent, encore qu’il subsistât dans certaines contrées, sous le mode de perception en nature ou en travail.
La colonisation belge disposait au départ de deux atouts. D’abord l’expérience malheureuse de la pratique léopoldienne qui imposait des garde-fous pour éviter des excès. Ensuite, la Charte coloniale, ce texte puissant, fruit d’une maturation de deux ans de travail, de réflexion et de débat. Les garde-fous en question donnaient à l’organisation une forme absurde. Au lieu de concentrer le pouvoir sur le terrain, auprès du Gouverneur général et de ses collaborateurs, on avait préféré situer cette concentration du pouvoir à Bruxelles, à près de 6 000 km de distance. Visiblement cette option avait été adoptée pour éviter les abus. Pour garantir au maximum la légalité, on préféra que tous les actes concernant le Congo suivent au plus près la régularité de la procédure qui avait cours en Belgique. Le pouvoir fut concentré dans un Ministère des Colonies, soumis aux mêmes obligations que les autres ministères. On envisagea d’abord d’en choisir le titulaire en dehors des partis politiques pour rendre les affaires coloniales indépendantes de la politique intérieure de la métropole. Cette option fut aussitôt rejetée. Nommé dans des conditions particulières, ce ministre spécial risquait de ne pas avoir d’alliés au gouvernement et dans les Chambres. Ces particularismes risquaient d’anesthésier son pouvoir. Le ministre des Colonies fut donc aligné sur les conditions de ses pairs. Il constituait à lui seul un mini-gouvernement colonial car il réunissait les activités de tous les secteurs existants : administration, justice, éducation, santé, armée, etc.
Au-delà du ministre, un rôle considérable fut accordé aux Chambres devant lesquelles le ministre était responsable et à un Conseil colonial qui devait examiner tous les projets de décrets c’est-à-dire tous les projets d’actes législatifs. Le Congrès colonial et la Commission pour la Protection des Indigènes au Congo constituaient des assemblées plus larges dont les délibérations étaient publiées. Si dans l’ensemble le régime acquit un caractère autoritaire, ce fut à cause de l’inexistence dans les organes belges d’un grand bloc démocratique réellement intéressé par les affaires congolaises, qui aurait pu agir en faveur d’un type de gouvernement colonial plus représentatif. Le pouvoir était donc centralisé et ce principe fut respecté au cours de l’ensemble du demi-siècle ; son siège demeura à Bruxelles. Ceci n’empêcha pas qu’il y eût sur place un gouverneur général qui disposait d’une délégation du pouvoir exécutif à Borna puis à Léopoldville. Son rôle était également important, non seulement par la coordination administrative qu’il assurait sur place mais aussi par la part qu’il prenait aux décisions de Bruxelles grâce à ses positions, ses avis, l’influence personnelle qu’il pouvait exercer sur le ministre. Ce gouverneur général était épaulé par les gouverneurs de province.
La première structure significative de la vie congolaise demeurait, comme on l’a noté, la chefferie et l’apparition d’une bourgeoisie villageoise d’essence coloniale. La colonisation essaya de soutenir ce groupe de privilégiés en l’isolant du reste de la population et en le forgeant à l’image européenne. On poussa la naïveté jusqu’à envisager la création d’ « écoles pour fils de chefs » afin de préparer les successeurs présomptifs à assurer les fonctions qui les attendaient en tant que fidèles auxiliaires de la colonisation. On devrait plutôt parler d’ « internats pour fils de chefs » puisqu’il ne s’agissait pas d’écoles à proprement parler mais plutôt de structures appropriées où étaient logés à part des fils de chefs qui fréquentaient les mêmes écoles que tout le monde. La première école du genre, créée à Buta en 1913, fut suivie aussitôt de quelques autres et notamment celles de Lusambo et de Stanleyville (Kita K.M., 1982 : 147-148). Mais l’expérience ne s’avéra pas concluante car ces enfants gâtés préféraient l’école buissonnière à toute autre activité et les aristocraties locales préféraient se débarrasser des enfants d’origine esclave, en les envoyant à l’école plutôt que d’y envoyer leurs propres enfants. La référence à la coutume se révélait être un statut mouvant et miné à l’avance, dès lors qu’on n’était pas suffisamment renseigné sur les usages en cours. De plus, on avait beau les prendre en charge, les chefs coutumiers demeuraient limités.
La colonisation créa à partir de 1911 des « secteurs », dont le chef serait nommé par l’Etat sans supprimer pour autant l’existence des chefs locaux. De manière informelle, ces unités avaient fait leur apparition ici et là depuis 1904. Cette création prolongeait l’effort de faire évoluer la coutume et de la « développer ». En effet, tout en procédant toutes deux de la coutume, ces deux structures étaient distinctes. La chefferie était un regroupement traditionnel reconnu par le commissaire de district, tandis que le secteur était un rassemblement de chefferies créé et réalisé par le même commissaire de district. Cette nouvelle unité abritait une série d’institutions : un conseil, un tribunal indigène, une école indigène. Cette nouvelle politique visait à créer au sein du territoire trois, quatre ou cinq secteurs. Une autre catégorie de chefs apparut au Congo. Une hiérarchisation de type colonial s’instaura entre chefs coutumiers selon qu’ils étaient médaillés ou non. Les secteurs se subdivisaient en groupements dirigés eux aussi par des chefs.
Il existait une catégorie de Congolais qui, dès cette époque, n’étaient plus régis par la coutume. C’était le cas de ceux qui travaillaient avec les Blancs ou dans les entreprises nouvellement créées et formaient des agglomérations qui poussaient à côté des factoreries et des postes de l’Etat. On qualifia ces zones d’habitation dès 1913 de « cités indigènes » et de « centres extracoutumiers ». L’opinion coloniale se mit à s’inquiéter du sort de ces communautés hétéroclites qui ne subissaient plus la mainmise du chef coutumier. Son inquiétude était fondée car ces lieux furent le cadre de toutes sortes d’abus. La prostitution y fit son apparition et symptomatiquement, la prostituée s’appelait « femme de l’Etat » (mwasi ya Leta). La politique indigène pensa régenter ce comportement par la mise en place d’une administration spécifique de ces cités, parallèle à celle des secteurs et des chefferies. Le chef de centre était l’équivalent du chef de secteur tandis que le « tribunal du centre extracoutumier » faisait office de « tribunal de secteur ». C’est surtout à partir de 1920 que ces administrations furent renforcées et généralisées, avec une prédilection pour le mode de gestion en chefferie-secteur. La constitution des agglomérations se réalisa progressivement, et s’épanouit après la grande crise mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale pour des raisons qu’on expliquera plus loin. Déjà en 1939, les centres extracoutumiers étaient au nombre de 32. Dans les plus importants, la progression est significative, avant et après la Deuxième Guerre mondiale.
Tableau 11 — Evolution de la population urbaine
| VILLES | 1940 | 1950 | 1958 | 1970 |
| Kinshasa (Léopoldville) | 47000 | 191000 | 389000 | 1323000 |
| Lubumbashi (Elisabethville) | 27000 | 99000 | 183000 | 318000 |
| Likasi (Jadotville) | – | – | 75000 | 146000 |
| Mbandaka (Coquilhatville) | 10000 | 17000 | 58000 | 108000 |
| Kisangani (Stanleyville) | 15000 | 67000 | 103000 | 227000 |
| Bukavu (Constermansville) | 1900 | 18000 | 52000 | 135000 |
| Kananga (Luluabourg) | 4900 | 15000 | 109000 | 429000 |
| Mbuji-Mayi | – | – | 25000 | 256000 |
| Matadi | 9000 | 18000 | 63000 | 110000 |
| Kikwit | – | – | 13000 | 112000 |
Sources : Young C„ 1965 : 207 ; 1972, n° 140 : 9-10 ; Verhaergen B. et alii, 1975 : 35 ; Nicolai H., 1963 : 393 ; Nzongola Ntalaja, 1975 ; Young C.& Turner R., 1985:81.
Seule Léopoldville accéda dès 1923 au statut de « district urbain ». Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les trois premières « villes » du pays furent constituées ; il s’agit de l’ancien district urbain de Léopoldville puis d’Elisabethville et de Jadotville qui fonctionnèrent sous ce statut au côté des CEC réservés aux autochtones.
Un autre échelon d’organisation s’imposa entre le secteur et le district. La zone qui avait cours vers 1895, du moins dans certaines régions, fut remplacée par le territoire. Cette subdivision officielle du district fut consacrée par l’Arrêté royal du 28 mars 1912.
Au-delà du district, l’organisation provinciale naquit en 1910 au Katanga, qui fut institué vice-gouvernorat général. La situation particulière du Katanga, l’intérêt suspect de l’Angleterre pour cette région qu’elle situait volontiers dans la mouvance des Rhodésies, exigèrent l’instauration de ce régime particulier, où le vice-gouverneur général pouvait entrer en contact direct avec le ministère à Bruxelles. Cette idée fit son chemin. En 1913, un statut semblable fut accordé à l’immense pays des Falls. Ce deuxième vice-gouvernorat général reprit à son compte le titre de « province orientale » qui prévalait déjà vers 1900.
La formule fut généralisée l’année suivante. Les 22 districts que comptait le pays furent regroupés en quatre provinces : le Katanga et la province orientale, puis l’Equateur et la province du Congo-Kasaï (carte 17). L’uniformisation fit perdre au Katanga son autonomie : à l’époque, cette situation fit l’objet de controverses (De Hemptinne Mgr, 1920 ; Van Iseghem A.A., 1921). Pourtant les 4 provinces jouissaient d’une assez grande autonomie puisqu’elles étaient gouvernées par des vice- gouverneurs généraux. C’est en 1933 qu’on en vint à un pouvoir plus centralisé. En effet, pendant l’entre-deux-guerres, on estima utile de combattre la tendance décentralisante des provinces et des districts. Les provinces devaient être dirigées par des représentants régionaux du gouverneur général qui prirent le titre de « commissaires de province ». Le nombre de provinces, en 1933, passa de 4 à 6, à cause de la scission de la province orientale (provinces de Stanleyville et de Constermansville) et de celle du Congo-Kasaï (provinces de Léopoldville et de Lusambo). Cette organisation subsista jusqu’à la fin de l’âge colonial (carte 19).
Seule la terminologie se modifia. Les 6 provinces devinrent Katanga (Elisabethville), Kivu (Costermansville puis Bukavu), Equateur (Coquilhatville), Kasaï (Lusambo puis Luluabourg) et Léopoldville (Léopoldville). Mais la structure en districts continua à se préciser, à tel point qu’à la veille de l’indépendance, on en dénombrait 24 regroupant, par-delà les territoires, 941 unités administratives locales, chefferies et secteurs (Vellut J.L., 1974 : 112-117 ; E.C.B., 1957 : 709-737) [1]. Telle fut la structure administrative qui assura la gestion du pays au cours du demi-siècle belge.
Il convient de noter que la mise en place de l’administration coloniale, loin de se réaliser d’un coup, fut le résultat d’un long processus. En effet, l’Etat colonial en était au stade de l’élaboration au moment où il devait être opérationnel. On comprend qu’au lendemain de l’entrée en colonisation et pratiquement jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’Etat colonial n’ait été qu’une administration assez élémentaire affirmant mal son autonomie vis-à-vis de l’Eglise catholique et des milieux d’affaires, deux réseaux solides et bien en place depuis l’EIC (Vellut J.L., 1983 : 49-80). La « trinité coloniale >> était une conséquence de cet état de fait. L’Etat colonial, soutenu par ces deux piliers, suscita par le fait même le sommet qui manquait au triangle.
Tableau 12 — Gouverneurs généraux, ministres des colonies et souverains du Congo belge
| GOUVERNEURS GÉNÉRAUX | MINISTRES DES COLONIES | SOUVERAINS | |||
| Baron Th. Wahis | Jules Renkin | (30.10.1908)* | Léopold II | (1908-1909) | |
| Baron Th. Wahis | Jules Renkin | Albert Ier | (1909-1934) | ||
| F. Fuchs | (20.05.1912) | ||||
| E. Henry | (05.01.1916) | ||||
| L. Franck | (21.11.1918) | ||||
| M. Lippens | (30.01.1921) | ||||
| M. Rutten | (24.01.1923) | H. Carton | (13.05.1925) | ||
| M. Houtart | (20.05.1926) | ||||
| E. Pecher | (15.11.1926) | ||||
| M. Houtart | (29.12.1926) | ||||
| A.Tilkens | (27.12.1927) | H.Jaspar | (18.01.1927) | ||
| P.Tschoffen | (19.10.1929) | ||||
| H.Jaspar | (26.12.1929) | ||||
| P. Charles | (16.05.1931) | ||||
| P. Crokaert | (06.06.1931) | ||||
| P.Tschoffen | (23.05.1932) | ||||
| P. Ryckmans | (14.09.1934) | P. Charles | (20.11.1934) | Léopold III | (1934-1945) |
| E.Rubbens | (25.03.1935) | ||||
| C. du Bus de Warnaffe (a.i.) | (28.04.1937) | ||||
| A. De Vleeschauwer | (15.05.1938) | ||||
| G.Heenen | (22.02.1939) | ||||
| A. De Vleeschauwer | (16.04.1939) | ||||
| P. Ryckmans | E. De Bruyn | (12.02.1945) | Prince Charles | (régent) | |
| R. Godding | (02.08.1945) | ||||
| E. Jungers | (31.12.1046) | L. Craeybeckx | (13.03.1946) | ||
| R. Godding | (31.03.1946) | ||||
| P. Wigny | (20.03.1947) | ||||
| A. Dequae | (16.08.1950) | ||||
| L. Pétillon | (01.01.1952) | A. Dequae | Baudouin Ier | (1952-1960) | |
| A. Buisseret | (23.04.1954) | ||||
| H. Comelis | (05.07.1958) | L. Pétillon | (05.07.1958) | ||
| M. Van Hemerlrijck [2] | (06.11.1958) | ||||
| A. De Schrijver | (03.09.1959) | ||||
| R. Scheyven [3] | (17.11.1959) | ||||
| W. Ganshof Van der Meersch [4] | (16.05.1960) | ||||
(Source : Vanhove J., 1968 :151-154).
* La date entre parenthèses est celle de l’entrée en fonctions.
L’origine des principaux gestionnaires de la colonie est une question essentiellement belge ; elle nous intéresse dans la mesure où elle permet une meilleure compréhension de ce qui a été vécu. Bien qu’exécutants d’un système qu’ils n’avaient pas élaboré eux-mêmes, les ministres des Colonies ont cependant imprimé de leur marque particulière le cours des événements et les commissaires généraux ont disposé, à certains moments, comme on l’a fait remarquer, de pouvoirs considérables. Il convient de noter que pratiquement tous se recrutèrent sur une même base idéologique. Sur l’ensemble des ministres des Colonies que connut le pays, la plupart furent des socio-chrétiens. Il s’en suivit une politique de nomination, essentiellement en faveur des catholiques et des francophones jusque dans les années 1950 (Pétillon L., 1967 : 24). Le camp socialiste, manifestement écarté du partage du gâteau colonial, a constitué le camp opposant aux normes existantes. C’est de ce milieu qu’est partie, en Belgique, la campagne antiléopoldienne ; il suscita une campagne semblable, dans l’entre-deux-guerres, pour dénoncer les recrutements forcés et le régime d’imposition instauré.
Quant à l’articulation de l’Etat et du monde des affaires, elle continua à s’exprimer, comme au temps léopoldien, par le recours aux mêmes hommes. Léopold II, s’il avait pu revivre au milieu de la période coloniale, aurait été content de constater que… « ses anciens officiers, ses anciens agents, chevronnés, enrichis, anoblis, commandaient dans de discrets bureaux ce qui fut un fief personnel et qui était devenu un monopole anonyme » (Vellut J.L., 1983 : 69). Non seulement les fonctionnaires coloniaux provenaient des mêmes milieux familiaux que les agents des entreprises mais souvent ils étaient les mêmes. On commençait sa carrière dans l’administration coloniale et on l’achevait au sein d’une entreprise privée. Ce scénario était devenu classique dans les carrières coloniales. Du coup, les agents coloniaux devaient se montrer complaisants, à l’égard de ces sociétés dont ils étaient les agents potentiels. Les sociétés par ailleurs se faisaient bienveillantes à l’égard de l’administration. Il n’était pas rare qu’elles prennent en charge certains frais relevant de l’administration ou des agents administratifs afin de leur être agréables. On comprend que, dans ce monde « incestueux », l’informel ait joué un plus grand rôle que le formel ; la gestion publique était trop dépendante des relations et des ententes stratégiques. Le caractère monolithique de la gestion coloniale en fut accentué.
Pourtant, malgré son caractère autoritaire, cette gestion ne put se passer totalement de consultations plus larges. A ce niveau aussi, presque tout se passait entre Européens. La principale assemblée consultative, de la capitale, fut d’abord un Comité consultatif (1911-1914) qui devint le Conseil de gouvernement à partir de 1915. Les provinces furent dotées de Conseils régionaux. Le plus ancien fonctionna au Katanga à partir de 1919. La formule fut généralisée dès 1934 et chaque province eut son Conseil de province qui admit ensuite des représentants d’associations d’intérêts coloniaux en son sein [5]. Le Conseil de gouvernement coopta une députation en 1947 ; celle-ci devint en 1959 le Conseil consultatif. D’une manière générale, ce n’est que peu avant l’indépendance que l’on s’efforça de donner aux assemblées un caractère plus représentatif et que les Conseils de province eurent à élire les membres du Conseil de gouvernement.
Dans les centres urbains, on avait prévu depuis 1923 des comités urbains à la fois pour les districts urbains (seul Léopoldville eut ce statut) et pour les villes (à partir de la Deuxième Guerre mondiale). Mais jusqu’à 1957, il ne sera question que des membres européens. En 1957, le décret du 10 mai constitua l’amorce d’un système représentatif dans les nouvelles « circonscriptions indigènes » ; on organisa alors les premières consultations électorales pour la constitution de conseils communaux dans les trois villes. Ce fut une grande innovation. Avant cela, les consultations africaines n’étaient possibles que dans le cadre des Conseils de centres dans les centres extracoutumiers, à partir de 1934 (Vellut J.L., 1974 : 118-199).
2. LA MISE EN VALEUR SOCIO-ÉCONOMIQUE
La mise en valeur du Congo belge fut conçue essentiellement en fonction de la Belgique et des Belges et suivant leur vision des choses [6]. Au beau milieu de la colonisation, il était difficile d’imaginer qu’il pût en être autrement. On sait qu’en matière de colonisation, la Belgique s’était imposé au départ une trop grande ouverture internationale et ce, pour des raisons tactiques ; l’enjeu consistait à s’écarter systématiquement et avec méthode de cette vision par crainte de perdre la colonie ou une partie de celle-ci. Cette crainte, ressentie dès la fin de la période léopoldienne, confirmait la nécessité de jouer à fond la carte nationaliste (c’est-à-dire belge). On poursuivit dans ce domaine la politique de Léopold II. Le personnel colonial était exclusivement belge. Pour l’évangélisation, on s’employa à soutenir « les missions nationales » par rapport aux « missions étrangères », peu importe en principe qu’elles aient été catholiques ou protestantes, encore qu’en réalité elles furent presque exclusivement catholiques. Seules ces dernières, on le sait, furent encouragées à poursuivre leur rayonnement.
Mais l’option nationaliste ne poussa pas la logique au point d’encourager l’immigration au Congo. Elle s’opposait à la présence de « Blancs pauvres » au Congo, ce qui risquait sans doute de compromettre l’image du Blanc qu’elle avait répandue dans la colonie. Tout au plus s’efforça-t-elle, dans la logique de cette politique, de tolérer l’installation dans la colonie d’un colonat blanc, essentiellement d’origine non belge [7]. Déjà la présence du commerçant portugais ambulant dans le paysage congolais l’inquiétait dès la fin du XIXe siècle. Elle ne manqua pas de la combattre. Mais ces inquiétudes s’accentuèrent. Peu après la croissance économique du Haut- Katanga industriel avant la première guerre mondiale, on enregistra une vague d’immigration d’origine anglo-saxonne provenant essentiellement des Rhodésies. La Belgique eut la même attitude d’hostilité, soutenue fort heureusement par la grande crise. Mais le même phénomène se renouvela vers les années 1927-28 à propos du Kivu qui fut envahi par des candidats planteurs d’origine italienne. On para à la menace par la création, en 1928, d’un Comité national du Kivu (CNKi) qui se chargea de favoriser la belgicisation de ce colonat naissant, ce qui signifiait tout simplement son effritement. En pratiquant cette politique à l’égard du colonat blanc, parce qu’elle n’avait pas d’alternative à proposer, la colonisation belge prit le parti de détourner quelque peu le futur Congo de sa vocation agricole et pastorale. En effet, l’agriculture vivrière traditionnelle, qui aurait pu se moderniser grâce à l’apport du colonat étranger, ne put jamais accéder à ce stade de développement.
Au Kivu précisément, la mise en valeur socio-économique prit une forme particulière, allant dans le sens de réduire considérablement les espaces disponibles pour les populations locales et de conforter la poussée de peuplement qui s’exerçait du Rwanda-Urundi au Kivu, de l’est à l’ouest des Grands Lacs. En effet, à partir de la fin des années 20, les populations des hautes terres du Nord-Kivu se trouvèrent progressivement dépossédées de leurs espaces naturels, du fait des appétits de terre croissants de l’ordre colonial. La création des Parcs nationaux, particulièrement celle du Parc Albert (actuellement Virunga) [8], alliée aux octrois anarchiques de terres au colonat blanc par le CNKI, en fut la principale cause, au point d’avoir rendu les autochtones particulièrement sensibles à la question foncière. Les sentiments de haine qu’ils portaient à l’endroit du CNKI n’étaient surpassés que par ceux qu’ils nourrissaient contre les Parcs nationaux (Lemarchand R. 1964 : 119).
Cette politique restrictive était paradoxalement accentuée par celle du surpeuplement de la région, imposée par la colonisation, avec des éléments provenant de l’autre côté du graben. Que le Kivu ait été le prolongement naturel du Rwanda- Urundi, cela allait de soi, par la géographie comme par l’histoire. Les Etats du Kivu [9], on l’a vu, participaient à la même culture politique que ceux du Rwanda-Urundi. La mise en valeur coloniale, à partir des années 20, avait abouti à deux modes de gestion différents [10], de part et d’autre de la frontière, au point de faire de la poussée démographique naturelle, du Rwanda vers le Kivu, un choix politique et un impératif de gestion économique. Entre 1930 et 1950, des colonies rwandaises furent transplantées ; soit pour échapper aux famines et au surpeuplement du « territoire sous mandat », soit pour servir de main-d’œuvre dans les plantations des Européens et dans les mines du Katanga [11].
Dans le Masisi, en 1937, une « Mission d’Immigration des Banyarwanda » (M1B) fut constituée sur initiative du CNKI et des autorités administratives du Kivu. Elle avait pour rôle de gérer l’immigration rwandaise dans ce territoire qui, à l’époque, possédait encore de vastes étendues inhabitées ou faiblement peuplées [12]. A la fin des années 40 et au début des années 50, plusieurs paysans rwandais (plus de 25.000 entre 1937 et 1945, 60.000 entre 1949 et 1955) furent installés sur des collines de Masisi totalement réaménagées pour la circonstance [13]. Une Convention de cession de terres avait été signée, en bonne et due forme, avec le chef hunde, Kalinda, qui reçut un dédommagement financier (Willame, J.C., 1997 : 41). Ces déplacements commandés entraînèrent d’autres mouvements plus spontanés. Aussi l’administration coloniale en 1955 estimait-elle déjà à 170 000 le nombre de Rwandais installés au Congo. Si ce flux migratoire connut un ralentissement au cours des cinq dernières années de la période coloniale, c’est en raison de l’interruption au Rwanda de la propagande en faveur de l’émigration. Ce qui n’empêcha pas de constater, au cours de 1957, que près de 4 000 autres Rwandais étaient venus s’installer au Kivu dans le Masisi comme dans le Rutshuru [14].
En effet, plus au nord, où fut créé le Parc de Virunga et où s’installèrent les planteurs européens, les Banyarwanda furent utilisés pour planter le café arabica (Willame, J.C., 1997 : 41-42). La particularité de l’installation de ces colonies dans le Rutshuru a été de prôner exclusivement l’agriculture et de s’opposer au pastoralisme, de peur de voir encore soustraites à l’agriculture des portions d’espace tant recherchées dans cette région. Des politiques édictées dans ce sens favorisèrent l’installation au Kivu des Banyarwanda hutu, au détriment des Banyarwanda tutsi. Et pour détacher complètement ces immigrants de leurs chefs traditionnels et démarquer les Rwandophones du Congo de ceux du Rwanda, des chefs hutu furent ici nommés à la tête de ces colonies, en lieu et place des Tutsi. C’est ainsi que le mwami (hutu) Ndeze Iriyuz’Umwami fut intronisé en 1923 dans le Bwisha au sud de Rutshuru et que l’immigration hutu fut si importante pendant la période coloniale.
Visiblement, la présence rwandophone ne posait pas encore de problèmes de conflictualité particulière avec les autochtones. La culture du Kivu elle-même offrait une grande latitude en matière de cession de terres aux étrangers et aux immigrants. Raison pour laquelle l’expansionnisme rwandais avait toujours trouvé des ouvertures dans le Kivu, même avant la colonisation. Qu’il soit appelé, Kalinzi (shi), uusoki (nande) ou mutobo (hunde), le contrat foncier, qui fonctionnait finalement comme une institution sociale, rendait aisée l’intégration de l’immigrant et lui facilitait l’accès à la terre, en lui attribuant le statut de client du propriétaire foncier (Willame, J.C., 1997 : 43). Au demeurant, les déplacements sur initiative des autorités coloniales ne constituaient qu’un peuplement supplétif par rapport aux flux migratoires traditionnels en provenance du Rwanda-Urundi et qui se déversaient dans l’agriculture et l’élevage.
La situation du Sud-Kivu, beaucoup moins peuplé en dehors du territoire d’Uvira, était sensiblement différente. L’on n’y enregistra pratiquement pas de perturbations particulières pendant la période coloniale. Mais les flux migratoires provenant des zones précocement denses du Rwanda-Urundi ne cessaient de s’effectuer de la même manière. C’est dès l’arrivée du colonisateur que la présence des Rundi fut constatée aux côtes des Bembe, des Vira et des Fulero. Les hauts plateaux de l’Itombwe se trouvaient également occupés par des populations provenant du Rwanda-Urundi. Ceci est confirmé par des sources orales d’origine rwandaise qui évoquent le départ de lignages qui auraient émigré du Kyniaga (Rwanda), au cours du XIXe siècle, pour aller s’installer à Murenge (Mulenge) [15]. Les raisons de ce déplacement auraient été la recherche de meilleures terres, mais surtout la fuite des attaques répétées de KigerilV Rwabugiri (1853-1895) [16], mwami du Rwanda, déterminé à mettre un terme à l’autonomie du Kyniaga (Newbury C., 1988 : 48-49).
Tant d’apports humains [17] allaient intervenir avantageusement dans le développement de l’élevage et de l’agriculture au Kivu.
2.1 Permanence dans le changement
Mais, en dehors de cette province, l’agriculture dans son ensemble ne joua qu’un rôle accessoire par rapport à ce qu’on pouvait en attendre, orientée qu’elle était vers les produits d’exportation. Psychologiquement elle développa des mécanismes qui ne pouvaient fonctionner efficacement qu’aussi longtemps que la chicotte pouvait siffler et frapper. A partir de 1917, en effet, on fit de l’agriculture traditionnelle une imposition et on parla de « cultures obligatoires ». Cette initiative fut le fait de E. Leplae, directeur général de l’Agriculture au ministère des Colonies, qui entendait instaurer par là un régime permanent de corvées agricoles pour prévenir les ruptures de stocks, de vivres et surtout aligner une production locale de type industriel. En principe, l’imposition concernait donc aussi bien l’agriculture vivrière que l’agriculture d’exportation ; dans la pratique, elle se spécialisa fort rapidement dans l’exploitation de l’huile de palme et surtout du coton pour lequel on créa une importante entreprise, la Cotonnière du Congo belge (Cotonco). L’Histoire se répétait. Ces deux produits, après 1910, avaient pris la place du caoutchouc. Leur exploitation fut soumise à un même régime de contrainte, avec cette différence qu’il fallait y mettre plus de délicatesse et de discrétion pour éviter de voir se lever une nouvelle campagne de dénonciation. C’est pour prévenir ce genre de dénonciation et se réconcilier définitivement avec les milieux d’affaires britanniques que la Belgique avait pris soin d’inviter le puissant trust anglais Lever à investir au Congo, et qu’elle lui consentit des avantages énormes. Cet arrangement fut une manière de faire accréditer, par la puissance la plus antiléopoldienne de l’époque, le fait que le changement intervenu pouvait s’effectuer sans problème dans la continuité de l’ancienne politique.
La Charte coloniale eut beau prôner l’abolition du régime de monopoles et de vastes concessions, en pratique il était difficile d’abandonner cette politique. La Belgique était intéressée par une plus grande mise en valeur des ressources congolaises. Comme il était difficile de trouver sur place de grands capitaux pour financer cette mise en valeur, on chercha encore à intéresser des capitalistes étrangers à ces exploitations par la création de sociétés mixtes pour l’intérêt à la fois des privés et de l’Etat. En matière foncière, l’Etat colonial avait instauré le système de « zone de protection » où la société bénéficiaire disposerait non seulement d’une concession à titre provisoire de toutes les terres « vacantes » mais aussi du monopole de l’achat à bas prix des produits agricoles des paysans, du monopole du traitement de ces produits et du monopole de recrutement de la main-d’œuvre (Merlier M., 1962 : 63).
La société Lever Brothers Limited fut la première à bénéficier de cette nouvelle législation agraire en 1911 et devint l’une des principales puissances foncières du pays. Cette société, qui s’était constituée vers 1894 pour se spécialiser dans la fabrication d’un nouveau type de savon à base d’huile plutôt que du produit traditionnel, était en quête d’une zone d’approvisionnement en huile depuis 1906. Après des tentatives infructueuses dans le Pacifique et dans les colonies britanniques de l’Afrique occidentale, elle fut attirée par le Congo, où l’administration coloniale pratiquait une politique plus généreuse en matière foncière. Ainsi, le 14 avril 1911, fut signée entre le Ministre Jules Renkin et le Président du Conseil d’administration de cette société une convention en vue de la création d’une Société anonyme des Huileries du Congo belge (HCB). La colonie confia à la société des terres domaniales comportant des palmiers elæis situées autour et à moins de 60 km des cinq points suivants : Bumba et Barumbu sur le fleuve, Lusanga sur le Kwilu, Basongo sur le Kasaï et un point situé à 40 km au sud et sur le méridien d’Ingende sur la Ruki. La société, constituée définitivement en mai 1911, ne tarda pas à faire des bénéfices énormes, à cause de nouveaux besoins créés par la guerre et de l’importante hausse que connut le prix de l’huile de palme et de l’huile palmiste dès le début des années 20. Sa production provenait essentiellement du Kwilu où les HCB possédaient trois grandes usines (Leverville, Tango et Kwenge) mais aussi de quatre autres points : Alberta (de nos jours Ebonda) sur le fleuve près de Bumba, Elisabetha (Lokutu) sur le fleuve dans la province orientale, Flandria (Boteka) sur la Ruki. Brabanta (Mapangu) sur le Kasaï.
Les souffrances que devaient endurer les Congolais étaient toujours inversement proportionnelles à l’importance des bénéfices que d’autres en retiraient. En 1917, les HCB créèrent une filiale commerciale, la fameuse Société anonyme d’Entreprise commerciale du Congo belge (SEDEC). Destinée en principe à vendre aux Africains des articles de traite d’origine européenne, la SEDEC traduisit plutôt la préoccupation des HCB de retirer aux travailleurs africains les maigres salaires qui leur étaient versés ; elle réussit de cette façon à ruiner le commerce des petits traitants (Nicolai H., 1963 : 321). L’appât du gain poussa les HCB à s’emparer d’étendues de terres immenses avec la complicité de l’administration, imposant un régime de corvées et indisposant la population à qui elle imposa des déménagements fréquents pour s’emparer de ses palmeraies déclarées « naturelles ». L’exploitation traditionnelle du palmier fut réduite, voire interdite. Les agents de la compagnie ne se gênaient pas pour détruire à coup de carabines les calebasses qui étaient accrochées aux palmiers pour la récolte du vin de palme. On comprend que cette société fut directement en cause dans la révolte pende qui éclata dans le Kwilu en 1932 (Sikitele G., 1986). On n’avait guère progressé par rapport au régime léopoldien (Mabeng N.M., 1973).
Pour tenter de s’en démarquer, la politique agricole instaura, à partir de 1936, le régime de paysannats avec pour objectif de regrouper et de fixer les cultivateurs de manière à accroître leur productivité. On restituait aux paysans, à l’encontre du régime des concessions européennes, une part d’initiative. Toutefois, les prix agricoles étant fixés à l’achat des produits, et la nature de la production étant revendiquée par le commerçant blanc et par l’Etat ; le paysan retrouvait la contrainte de pratiquer tel type d’agriculture au détriment de tel autre. Cette nouvelle politique fut inaugurée par Léopold III dans son discours devant le Sénat quand il procéda à la création d’un Institut national pour l’Etude agronomique du Congo belge (INEAC) le 22 décembre 1933. L’accent fut mis sur le développement d’une agriculture africaine libre sous la forme du paysannat intégral ; on prônait de la sorte des cultures individuelles au détriment de celles du clan et l’accent fut mis aussi sur l’importance de l’enseignement agricole.
L’INEAC commençait ainsi sa mission, qui était d’asseoir les pratiques locales d’ordre agricole, zootechnique et sylvicole sur des bases scientifiques de plus en plus poussées. Il ne partait pas de rien. Ayant repris à son compte l’actif de la « Régie des plantations de la colonie » (REPCO) existant depuis 1926, il avait hérité de ses 12 stations d’expérimentation et de sélection (Henry J.M., 1983 : 315). Mais l’expérience de promotion des cultures industrielles au détriment de celles du clan se révéla coûteuse, et son rendement incertain. On s’orienta vers une certaine forme de collaboration dans l’exploitation agricole entre le paysan et les entreprises ou les colons. Les Africains s’occupaient de la production, tandis que l’activité européenne portait sur l’achat, le transport et l’usinage. Le système s’avéra concluant dans le cas du coton, du café, et dans une moindre mesure, pour le riz (Jewsiewicki B., 1975).
Ces différents systèmes coexistèrent vers la fin de la période coloniale, mais toujours avec une préférence pour les produits revendiqués par l’exportation. La seule agriculture vivrière digne d’intérêt était celle qui produisait la nourriture pour Européens. L’approvisionnement des autochtones fut toujours négligé, malgré l’instauration des cultures obligatoires et le travail remarquable de l’INEAC qui, à la fin de la période coloniale, venait seulement d’atteindre sa vitesse de croisière. Les seuls vrais problèmes de nourriture ne se posèrent que dans le cadre des grandes agglomérations créées par des grandes entreprises commerciales, qui les résolurent dans ce contexte exclusif par la création de grands élevages. Ailleurs, la situation était calme en permanence. Ce manque de prévision devait conduire le pays à une catastrophe alimentaire, après des décennies, lorsque la démographie serait galopante et que l’INEAC ne pourrait être rentabilisé au mieux au profit de l’économie agricole du pays.
Entre-temps, la colonisation belge, nullement inquiétée par la situation agricole existante, eut le loisir d’orienter sa mise en valeur vers d’autres secteurs, notamment ceux des minerais et des voies ferrées pour assurer l’évacuation de cette production vers l’Europe. Vers la fin de la période coloniale, la teneur des exportations mettait en lumière, de manière un peu plus évidente, le choix de cette tendance économique, surtout si on la compare à celle des pays limitrophes. Vers 1955, en Ouganda et au Rwanda-Urundi, plus de trois quarts des exportations en valeur, étaient constitués de coton et de café. Au Kenya, plus de trois quarts des exportations, toujours en valeur, étaient constitués de produits agricoles venant de la zone de colonat européen des Highlands. Au Congo, en revanche, deux tiers environ des exportations étaient représentés par des produits miniers (cuivre, étain, or, diamant, etc.) ; dans le tiers existant, constitué de produits agricoles et industriels, une très grosse part provenait des sociétés capitalistes européennes et concernait une production impropre à la consommation interne (Stengers J., 1989 : 206-207).
LE CONGO-BELGE EN 1940 – Carte 19

2.2 Au service du capitalisme européen
Le premier facteur de rentabilité économique qui prévalut depuis la période léopoldienne et qui ne fut jamais négligé pendant toute la période coloniale en dépit de l’existence d’autres apports plus substantiels, ce fut l’impôt. Il était senti à la fois comme une contribution des natifs aux charges communes de la société et comme un geste répété d’allégeance à l’égard du gouvernement. Du moins, telle était l’opinion des théoriciens de la colonisation (Encyclopédie du Congo belge : 737). La seconde raison était purement théorique car cette allégeance était maintenue par d’autres moyens, et notamment par la manière forte. Ce geste symbolique n’était nullement indispensable. Par contre il était nécessaire pour s’assurer de plus larges revenus et pour manipuler les populations. On prit soin d’en préciser le contour juridique par le Décret du 17 juillet 1917 qui subit par la suite plusieurs modifications [18]. Malgré tout, les modes de taxation ne changèrent pas. On distinguait l’impôt de capitation de l’impôt supplémentaire. Le premier frappait tout le monde adulte tandis que le second ne frappait que les polygames et était variable suivant le nombre d’épouses. La colonie perçut très consciencieusement ces taxes auprès des indigènes, surtout après la Première Guerre mondiale.
Et puisqu’il s’agissait d’argent, le nerf de la guerre, l’imagination coloniale fut suffisamment vive pour mettre au point un système de dépistage des contribuables récalcitrants. On instaura le « jeton métallique », plus aisé qu’une simple quittance, que devait détenir celui qui était en ordre avec le fisc. Ce jeton métallique représentait sur une face un animal, un végétal ou un objet suffisamment connu des contribuables, mais qui changeait d’une année à l’autre [19]. La plaque elle-même était de forme différente, selon qu’il s’agissait de l’impôt principal de capitation ou de 1 impôt supplémentaire. Celle que l’on destinait aux femmes était distincte, elle aussi, car plus petite et sa forme variait également d’une année à l’autre. Toutes ces plaques avaient deux trous. On pouvait y passer une ficelle et la porter comme pendentif, boucle d’oreille ou bracelet. Ainsi, en cas de contrôle, il suffisait de vérifier si le contribuable portait la bonne plaque (Smith R.E., 1976 : 217-218). Les contrevenants encouraient une privation de liberté et une mise au travail obligatoire, de sorte que la colonie obtenait une certaine rentabilité de tous les hommes et femmes disponibles.
Même si le contemporain congolais était plutôt porté à minimiser ce revenu, il était important dans la mesure où il constituait la rentabilité exigée des humains : c’était une part qui s’ajoutait à celles arrachées au sol et au sous-sol. Cette autre exploitation n’était pas moins méthodique, et procédait d’une vision bien déterminée.
Le Congo économique dans sa phase belge, comme au cours de l’épisode léopoldien, aura été essentiellement l’œuvre du capitalisme européen. Quelques particularités devraient être épinglées au cours de ces trois quarts de siècle de pratique impérialiste. Au cours de la phase léopoldienne, les grandes sociétés commerciales furent érigées sur la base d’une association des capitaux belges et étrangers. On devait encore miser sur l’internationalisme, et Léopold II voulait que les Belges puissent bénéficier ainsi de l’expérience européenne. Cette tendance fut combattue vers le début du siècle, et après 1908 on afficha nettement le nationalisme économique. La seule exception importante est celle des concessions octroyées au groupe Lever dans le seul but politique de se faire des alliées outre-Manche. Le nationalisme économique sera plus modéré vers la fin de la période coloniale. En effet, pour contourner l’anticolonialisme naissant, en 1955, la Belgique pensa faire appel à des capitaux étrangers pour la gigantesque entreprise d’Inga qui consistait à ériger un barrage et une centrale hydro-électrique géante (Willame J.C., 1986).
Œuvre du capitalisme, l’économie congolaise ne s’est cependant pas bâtie comme une entreprise libre, échappant à l’intervention de l’Etat et indépendamment de son soutien. Le cas de la colonisation belge est particulier car il a fait référence aux deux recettes. Le capitalisme privé s’y est implanté avec la complicité de l’Etat et parfois même avec son aide. Dans les secteurs où les investissements étaient lourds, l’Etat a été appelé, depuis la période léopoldienne, à fournir les capitaux ou du moins les garanties d’intérêts. Tel fut le cas de la construction des chemins de fer, où cette collaboration s’est exprimée de plusieurs façons. Une société privée entreprenait la construction d’une voie ferrée et l’Etat souscrivait une partie du capital de cette société en devenant actionnaire. Ainsi, la « Compagnie du Chemin de fer du Congo » (CFC) assuma les risques de l’entreprise de construction de la ligne Matadi-Léopoldville, soutenue par l’Etat qui souscrivit 40 % du capital et consentit en outre à la société d’importants prêts obligatoires. Comme on le sait, la ligne, commencée en 1889, fut achevée en 1898. Un autre modèle de collaboration fut le cas de la Compagnie des Chemins de fer du Congo aux Grands Lacs Africains (CFL), qui constitua entièrement son capital pour la construction des lignes à l’est du Congo à partir de 1902. L’intervention de l’Etat consista en une garantie d’intérêts. Un autre exemple encore fut celui où l’Etat apporta pratiquement tous les capitaux mais confia à une société privée le bénéfice de la construction et de l’exploitation de la ligne ; la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK), créée en 1906, bénéficia de ce système. Cette ligne importante reliant le Katanga à Port-Franqui fut achevée en 1928. La Belgique eut recours aux mêmes solutions pour reconstruire la ligne Matadi-Léopoldville car le tracé de 1889 présentait des courbes et des rampes trop accentuées, au point qu’une locomotive ne pouvait pas tirer plus de trois wagons de dix tonnes. La reconstruction s’avéra fort onéreuse, à tel point qu’au moment de la grande crise économique des années 30, l’Etat fut obligé de racheter la ligne à la Compagnie, celle-ci étant dans l’impossibilité de payer.
De manière générale, on peut considérer que le capitalisme européen a réussi son action au Congo belge grâce à la conjonction d’un certain nombre d’éléments favorables. En effet, au Congo, ce capitalisme fut audacieux et entreprenant. La Société internationale forestière et minière (la Forminière), qui fut créée en 1906, avec la BCK et l’Union minière du Haut-Katanga, qui obtint des droits de prospection minière sur une partie considérable de territoire national, dut patienter sept ans avant qu’on atteste, en 1913, que le Kasaï était vraiment une région diamantifère. Cette confirmation était indispensable. L’histoire de la découverte du diamant du Kasaï n’est que le fait du hasard. Le premier diamant fut ramassé en novembre 1907. Ceux qui en firent la découverte placèrent la pierre en tube pour un examen ultérieur en Europe, car la confirmation ne pouvait se faire à l’œil nu. Cette découverte paraissait si incertaine qu’elle fut négligée et l’analyse n’eut pas lieu. Il a fallu qu’un ingénieur, préparant une autre mission et examinant les échantillons déjà recueillis, tombe sur ce minuscule cristal et qu’il soit frappé par son aspect. Le verdict scientifique tomba enfin : il s’agissait d’un diamant. Mais personne ne put se rappeler où il avait été ramassé. On hésita entre le Kasaï et le Maniema, régions prospectées par la mission qui avait ramené ce bout de diamant, avant de réaliser qu’il s’agissait du Kasaï dans la région de Tshikapa. Mais la grande découverte diamantifère eut lieu en 1916, au Kasaï, dans la région de Mbuji-Mayi, région où la prospection avait été confiée à la BCK suivant la formule combinant la concession ferroviaire et les droits de prospection dans la zone traversée par la voie ferrée. La première société productrice du diamant fut donc la « Minière de la BCK », filiale à laquelle la BCK confia l’exploitation de son diamant. Déjà après la Seconde Guerre mondiale, le Congo fournissait en moyenne 60 % de la production mondiale. En 1959, les productions de deux sociétés diamantifères étaient de quatre cent mille carats pour la Forminière et de quatorze millions de carats pour la Minière de la BCK ; il faut préciser qu’il y avait une plus grosse proportion de diamants de joaillerie dans la production de la Forminière.
L’Union minière s’est également faite suite à une initiative audacieuse, et risquée. L’extraction du minerai de cuivre du Haut-Katanga démarra aussitôt puisque en mars 1909 l’UMHK mit sur le marché la première production de Kolwezi. La société construisit à Elisabethville une grande fonderie coiffée d’une cheminée haute de 150 mètres. Le four de l’usine fut allumé en juin 1911 et la première coulée de cuivre date du 30 juin de la même année. C’était le début d’une ère nouvelle pour l’histoire économique du pays ; cependant, la période qui suivit fut jalonnée de crises. Dès le début de l’exploitation, le cuivre de l’UMHK fut vendu à perte. Il fallut une réorganisation complète de l’exploitation, avec l’emploi de coke provenant de Rhodésie et non plus d’Europe, pour prétendre à une certaine rentabilité. La plus grande crise se produisit après la Première Guerre mondiale. Le marché fut saturé avec la mise en vente des stocks de guerre. Alors qu’ailleurs les exploitations de cuivre ralentissaient leur rythme de croissance en attendant les temps meilleurs, l’UMHK décida de doubler la production ; de cette manière, disait-on, on pouvait abaisser le prix de revient et cesser de vendre à perte. De dix-neuf mille tonnes en 1920, la production fut portée à quarante-trois mille tonnes en 1922. C’est Edgar Sengier, le président du Conseil d’administration, qui prit cette décision audacieuse : elle finit par s’avérer payante. Une fois la crise de surproduction mondiale passée, alors que d’autres grands producteurs redémarraient, l’Union minière se trouva en position de force. En 1928, sa production de cuivre atteignit les 7 % de la production mondiale. Le caoutchouc, qui aux temps de l’EIC avait fait son bonheur, avait enfin son alternative. Alors qu’en 1901, il représentait en valeur 87 % des exportations congolaises, et qu’en 1928, il ne constituait plus que 1 % de celles-ci, le cuivre en cette année dépassait déjà en valeur les 50 % du total des exportations congolaises. Ce rôle dominant, il le conserva jusqu’à nos jours.
A côté du cuivre, l’UMHK produisait aussi à partir de 1920 du cobalt qui représentera jusqu’en 1960 les 60 % de la production mondiale ; elle était également productrice de l’uranium et de son sous-produit le radium. L’histoire du radium et de l’uranium a débuté un peu dans les mêmes conditions que celle du diamant. Leur découverte en 1913 puis en 1915 fut un hasard. En 1913 un prospecteur trouva dans la mine de Kiswishi, non loin d’Elisabethville, un minerai qui fut identifié comme étant un oxyde d’uranium à la teneur particulièrement riche. Deux ans plus tard, un autre prospecteur, le major R.R. Sharp repéra au sud-ouest de Likasi un affleurement cuprifère au moment où il s’apprêtait à y planter un poteau. Quelque chose de jaune accrocha son attention, une pierre qui lui parut remarquable. Sur le même site, il découvrit divers échantillons du même genre, lesquels, à l’analyse, furent considérés comme uranifères. On venait de découvrir le gîte de Shinkolobwe, qui allait être pendant longtemps le gisement uranifère le plus riche du monde (Sharp R.R., 1956 : 133). L’exploitation du gisement commença en 1921. Dans les années précédant immédiatement la Seconde Guerre mondiale, on s’intéressa davantage à l’uranium. Les physiciens étudiaient le phénomène de la fission du noyau de l’atome de ce minerai. Les Joliot-Curie vinrent à Bruxelles pour y présenter l’état d’avancement de leurs recherches.
Edgar Sengier, le patron de l’UMHK, préssentant sans doute le rôle que pouvait jouer l’uranium dans la conduite de la guerre, fit expédier aux USA, dès 1940, un millier de tonnes de ce minerai. Lui-même quitta la Belgique peu après l’arrivée des troupes allemandes pour défendre les intérêts de l’UMHK en Angleterre et aux Etats-Unis, faisant régulièrement l’aller et retour entre les deux pays. Au Katanga, Jules Cousin s’était vu confier la direction locale, tandis que Firmin Van Brée, demeuré en Belgique, assurait la liaison extérieure via Lisbonne (Gillon L., 1988 : 58). Qui pouvait prédire la suite ? Le 18 septembre 1942, le général Graves chargé par le Président Roosevelt du Manhattan Projet, le projet ultrasecret de fabrication de la bombe atomique, envoya son adjoint, le colonel Nichols, rencontrer Sengier à New York. « Pourriez-vous, demanda-t-il, aider les Etats-Unis à se procurer du minerai d’uranium du Congo ? Il s’agit d’une question d’une importance capitale pour la cause des Alliés ». « Quand vous le faut-il ? » répondit Sengier. « Si ce n’était pas impossible, je dirais demain ! ». « Ce n’est pas impossible. Vous pourrez avoir mille tonnes de minerai immédiatement. Elles sont ici à New York. Je vous attendais depuis un an… » (cité par Cahen L., 1983 : 110 ; Stengers J., 1989 : 217). L’épisode est célèbre. Ce qui suivit est tout aussi important. La mine de Shinkolobwe qui était fermée fut rouverte, à la demande des Américains. Ceux-ci achetèrent même les terrils amoncelés à la suite des premiers travaux (Cahen L., 1983 : 111) [20].
L’uranium du Congo fut voué à un destin horrible : celui de servir à la construction des premières bombes atomiques qui éclatèrent à Hiroshima et à Nagasaki au Japon (Helmreich J.E., 1983 : 253-284). Dès que le projet prit forme, on entoura l’exploitation de l’uranium au Congo belge du plus grand secret. Shinkolobwe devint l’un des lieux les mieux gardés du monde. Même après la guerre, l’exploitation de l’uranium demeura une opération confidentielle dont les chiffres de production et d’exportation ne transparaissaient même pas dans les statistiques officielles. Ce n’est qu’en 1955-56 que la société en fit état, sans doute pour mettre un terme aux rumeurs qui circulaient à propos des bénéfices fabuleux tirés de ce commerce clandestin. En 1955, elle prétendit que l’uranium n’intervenait dans les bénéfices d’exploitation que pour 1,5 %. Mais qu’avait-il rapporté pendant la guerre ? Et quel fut l’impact de ce renfort belgo-congolais, pour que les USA arrivent enfin à mettre un terme aux prétentions guerrières du Japon ? Le secret demeure, malgré certaines révélations qui ont pu percer et dont on parlera plus loin. En 1960, l’UMHK décida de fermer la mine de Shinkolobwe à cause de son épuisement et de la concurrence de nombreux autres pays, devenus à leur tour producteurs d’uranium.
Caractérisé par son audace, le capitalisme au Congo se distingua également par la structuration de ses entreprises en groupes puissants. Ces quelques trusts contrôlaient l’ensemble de l’activité économique. Ces groupes étaient représentés par plusieurs holdings, qui créaient à leur tour des sous-holdings et de multiples sociétés filiales (Bezy F., 1957 : 114 ; Mutamba Makombo, 1977 : 145-150). Déjà à l’époque iéopoldienne, on avait vu se constituer un holding puissant, la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie (CCCI) avec à sa tête, l’homme de la bataille du rail, Albert Thys. Les sociétés qui émergèrent furent d’abord la Compagnie du Chemin de fer du Congo, puis, à partir de 1891, diverses autres créations notamment la Compagnie du Katanga. En 1928, la CCCI passa sous le contrôle de la Société Générale qui avait déjà pris de gros intérêts dans les affaires congolaises. Elle avait notamment patronné la création des « sociétés de 1906 » (Forminière, UMHK, BCK) ; désormais, avec l’intégration de la CCCI, elle acquérait une prépondérance écrasante, constituant un véritable empire au Congo duquel dépendirent la majorité de grandes sociétés du pays [21]. Une étude récente a tenté d’identifier de manière exhaustive les multiples embranchements de « La Générale de Belgique » au Congo. Elle a abouti à une véritable « toile d’araignée » ! Citons entre autres, la CCCI et ses nombreuses filiales ; les sociétés de 1906 (Forminière, BCK, UMHK) ; l’UMHK qui, absorbant la CSK, fut à la base sinon la cause d’une grande production de sociétés ; la Société Générale métallurgique de Hoboken (SGMH) qui devait assurer à Olen le traitement du cuivre brut ; les charbonnages de la Luena, la Société Générale des Forces hydro-électriques du Katanga (SOGEFOR) et la Société industrielle et chimique du Katanga (SOGECHIM) qui furent créées pour pourvoir au ravitaillement industriel et énergétique. Il y eut d’autres filiales, notamment les Minoteries du Katanga, la Compagnie foncière du Katanga (COFOKA), la Société Générale africaine d’Electricité (SOGELEC), la Société minière du Sud-Katanga (Sud-Kat), la Société métallurgique du Katanga (METALKAT). Elle contrôlait également d’autres ensembles, notamment la Compagnie du Kasaï (Bourgi A., 1990 : 93-106).
A côté de la Générale, existaient d’autres groupes de moindre envergure. Signalons le groupe Brufina dont le fleuron fut la Symetain, le premier producteur d’étain de la colonie ; le groupe Empain dont l’entreprise de base fut la Société de Chemin de Fer des Grands Lacs ; le groupe la Cominière qui se consacra à une pluralité d’activités : électricité (Colectric), transports (ViciCongo), exploitation forestière (Agrifor), etc. Il faut ajouter à cette énumération le groupe dépendant du trust britannique Unilever, avec des sociétés telles que HCB, SEDEC entre autres.
Cette forte structuration a permis aux entreprises de faire peau neuve, en période de crise. Les ressources provenaient alors des groupes. Leur rôle et leur influence furent considérables d’autant que l’Etat leur laissait les mains presque entièrement libres, même lorsqu’il avait les moyens d’intervenir dans leur gestion et de limiter leur influence. L’Etat disposait en effet de puissants moyens d’action grâce à son portefeuille large, constitué et alimenté par des actions dans ces principales sociétés. L’origine de ce portefeuille remontait à Léopold II, qui avait veillé à ce que les avantages réservés à l’Etat, lors de la constitution de ces sociétés, soient transformés en actions au sein de celles-ci. L’Etat colonial continua sur cette lancée et disposa de parts considérables mais n’usa pas des prérogatives qui lui revenaient. Certes, il se faisait représenter au sein des organes dirigeants par des administrateurs, des commissaires et des délégués. Mais jamais il ne chercha, par l’intermédiaire de ses représentants, à orienter l’action du secteur privé. Paradoxalement, la présence des délégués de l’Etat eut plutôt pour effet de renforcer la position du secteur privé. En effet, les représentants de l’Etat au sein des sociétés ont souvent eu tendance, à identifier leurs intérêts à ceux des sociétés. Celles-ci agissaient alors par eux pour atténuer les ardeurs de l’Etat ou pour obtenir telle ou telle facilité. Les délégués de l’Etat agissaient finalement comme délégués des entreprises auprès de l’Etat.
Là où la politique d’effacement de l’Etat a été la plus étonnante, c’est lorsque, se trouvant dans une position majoritaire, celui-ci a préféré s’abstenir d’user du droit que lui conférait cette position, pour abandonner au capital privé les rênes de l’entreprise. Le cas le plus significatif du genre est sans doute celui du Comité spécial du Katanga (CSK), créé en 1900 comme entité autonome chargée de la gestion des biens de la Compagnie du Katanga (un tiers des terres vacantes du Katanga) et de ceux de la colonie (les deux tiers). Autrement dit, le CSK vendait ou louait les terres en faisant louer les mines en lieu et place de l’Etat ; un tiers de ses bénéfices allait à la Compagnie et les deux autres tiers à l’Etat. Le Comité était dirigé par six membres dont quatre étaient désignés par l’Etat et deux par la Compagnie du Katanga. L’Etat détenant cette majorité des deux tiers, le CSK aurait pu fonctionner, logiquement, comme un simple rouage de l’Etat. Il n’en fut rien, surtout quand, après la période de démarrage, il s’affirma comme une véritable puissance financière. Le Ministère des Colonies le laissa fonctionner de plus en plus en organe autonome, selon la mentalité du capitalisme privé. Ses représentants, qui auraient pu demeurer de simples agents d’exécution de sa politique, devinrent les administrateurs d’une affaire qui avait ses intérêts et sa politique propres. Le CSK devint ainsi un Etat dans l’Etat, traitant avec lui pratiquement d’égal à égal. Cette position résultait d’une philosophie politique clairement affirmée selon laquelle il valait mieux laisser les hommes d’affaires gérer les affaires en dehors de toute question d’ordre politique. L’autre raison est que les hommes d’affaires qui étaient des cadres supérieurs de tout premier ordre se recrutaient essentiellement parmi les fonctionnaires coloniaux. Le passage du secteur public au secteur privé, exceptionnel dans la métropole, était courant ici. Comme la carrière au service de l’Etat était beaucoup plus brève en colonie qu’en métropole, l’entreprise coloniale disposait d’un champ de recrutement relativement étendu et d’accès facile parmi les anciens coloniaux. Les fonctionnaires coloniaux avaient donc intérêt à ménager les entreprises, d’autant qu’il y avait des chances qu’ils y passent leurs derniers jours de vie coloniale. Cette complicité justifie le fait que les intérêts de l’Etat n’avaient finalement pas de vrais défenseurs tandis que ceux des privés se trouvaient défendus tant par les privés eux- mêmes que par les agents de l’administration coloniale.
On comprend plus aisément aussi que l’autorité coloniale ait joué un rôle capital dans le recrutement de la main-d’œuvre autochtone, qui fut de plus en plus sollicitée par les diverses entreprises qui s’installaient. Dans bien des cas, on aboutissait à un système de recrutement qui ne différait en rien du travail forcé. Le scénario classique était que l’agent de l’Etat accompagnât le recruteur dans sa tournée ; arrivé chez un chef, il usait de son autorité pour obliger ce dernier à lui fournir un certain nombre d’hommes valides. Le chef s’exécutait avec d’autant plus d’empressement que l’ordre provenait de l’agent de l’Etat et que son compagnon faisait suivre l’exécution de l’ordre par des cadeaux. La grande période de ce recrutement se situa pendant le boom économique de l’entre-deux-guerres. On assista à une sorte de réédition du travail forcé de la période léopoldienne. Des brassages de populations furent nécessaires pour satisfaire à ces besoins. Le travail de construction du chemin de fer d’Ilebo s’accompagna d’une véritable « chasse à l’homme », où les autochtones furent dirigés vers les chantiers » la corde au cou ». Les recruteurs des HCB usèrent également de procédés violents, le fusil à la main, pour mettre les hommes au travail… (Stengers J., 1989 : 212) mais comme d’habitude, ces pratiques ne furent connues en Belgique que fort tardivement, en dépit de la centralisation imposée par la Charte coloniale précisément pour déceler rapidement de tels écarts. Ils suscitèrent quelques débats houleux dans les Chambres, sans plus. Les besoins en main- d’œuvre diminuèrent spontanément sous l’effet de la grande crise, qui fut vécue sur place comme une grande période de chômage non seulement pour les Congolais mais aussi pour les Blancs (Tshibangu Kabet, 1989 : 25-63, 417-441). Les peuples congolais ont été marqués par ces recrutements forcés ; ces souvenirs subsistèrent au-delà de l’indépendance.
C’est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que les entreprises coloniales disposèrent des états-majors les plus remarquables dans le monde des affaires, ce qui compta pour beaucoup dans la réussite du capitalisme au Congo. Curieusement, lors de la marche vers l’indépendance, cette bourgeoisie d’affaires ne joua presque aucun rôle, alors qu’on aurait pu prévoir qu’elle participerait activement à la lutte contre le changement. Sans doute pressentait-elle que le changement entrevu ne le serait que de nom et que la structure économique coloniale demeurerait intacte. Ce point n’a jamais pu être éclairci.
2.3 La participation congolaise ?
Pour revenir à la participation congolaise à la gestion de l’Etat colonial, notons que la question se limita toujours à celle du recrutement des auxiliaires autochtones les plus aptes à favoriser la colonisation. Cela suscita des débats passionnés entre partisans de la politique « indirecte » et « directe ». La première intuition, comme on l’a dit, fut de considérer les chefs traditionnels comme les antennes indispensables de l’administration ; ils furent chargés de mobiliser les populations (impôts, prestations, recrutements de main-d’œuvre, etc.). On devint méfiant à l’égard des Congolais qu’on croyait déracinés parce que soustraits à l’autorité traditionnelle. Il s’agissait de ces premiers acculturés, regroupés d’abord autour des missions, des factoreries, des nouvelles voies de communication et ensuite, en nombre croissant, auprès « du rail » et des premiers centres industriels. Le fond du problème résidait, pour la politique coloniale, dans la recherche d’un équilibre entre, d’un côté, les pôles industriels et miniers, et de l’autre les campagnes qui devaient conserver leur rôle de « greniers à main-d’œuvre », chargés par ailleurs de nourrir les zones industrielles.
Après les premières actions de consolidation du pouvoir traditionnel, grâce aux décrets de 1906 et de 1910, les théories d’origine anglo-saxonne sur l’administration indirecte inspirèrent plus directement la politique coloniale belge. Elles eurent en tout cas deux puissants défenseurs : le ministre L. Franck et l’ancien gouverneur de l’Equateur G. Van der Kerken (1919-1924) qui devint l’un des professeurs les plus influents de l’Université coloniale d’Anvers. Cette politique fut officiellement instaurée par le décret du 15 avril 1926 qui organisa les tribunaux de secteur et de chefferie, dans l’idée de renforcer l’autorité des chefs. Le point vulnérable de cette politique est qu’elle ne résolvait pas vraiment le problème de la coexistence avec les nouveaux pôles économiques et culturels. De plus, elle avait un revers redoutable : elle entretenait la ségrégation entre populations européennes et africaines et partant, elle évitait au maximum la multiplication des Congolais acculturés et limitait donc l’instruction au strict minimum. Ces deux caractéristiques feront précisément l’objet, lors de la décolonisation, des critiques les plus acerbes. Le clivage entre les deux communautés, blanche et noire, était aussi une raison suffisante pour aggraver les mesures de répression et susciter a posteriori les réactions violentes des réprimés. Le gouverneur Lippens, qui se préoccupait de la sauvegarde de l’autorité et du prestige de la race « occupante » en prônant l’amélioration de la conduite des magistrats qu’il considérait « coupables d’une extrême mansuétude pour les indigènes et d’une sévérité excessive pour les Européens » (Lippens M., 1923 : 65-66) en est un exemple éclairant.
L’administration belge réussit à élaborer une quarantaine de textes législatifs pour appuyer cette option, notamment l’ordonnance du 8 janvier 1918 interdisant aux Noirs de circuler dans les circonscriptions urbaines et dans certaines agglomérations européennes entre 21 heures 30 et 4 heures ; le décret du 16 juillet 1918 imposant la séparation des races dans les villes ; les décrets et les ordonnances de 1919-1920 prévoyant la constitution d’un corps de volontaires européens et le renforcement des mesures préventives concernant l’ordre public ; le décret du 6 août 1922 alourdissant les peines destinées à réprimer les infractions aux règlements de police ; l’ordonnance du 11 février 1926 visant les associations indigènes,… Ces textes légaux discriminatoires furent tous abolis en quelques mois à l’approche de l’indépendance (Brausch G., 1961 : 21). Il faut noter qu’au sein même des couches coloniales dirigeantes, il y eut des voix qui s’élevèrent contre le régime « indirect ». Mgr De Hemptinne, archevêque d’Elisabethville, en était (Feltz G., 1983 : 419-438). Il considérait comme inévitable l’érosion de la coutume et souhaitait voir le Congo moderne encadré par des messagers, des catéchistes, des moniteurs, bref des auxiliaires lettrés que les missions avaient formés. Dans les centres urbains, les grands employeurs combattirent presque systématiquement la politique « indirecte » en accentuant le clivage entre populations de camps (administrés par les entreprises) et de cités. A Elisabethville et Jadotville, les premiers chefs de centres nommés furent des Européens… (Vellut J.L., 1974 : 124-125).
Pourtant, c’est le régime « indirect » qui eut jusqu’au bout les faveurs de l’autorité coloniale. En 1933, cette option fut confirmée par le décret sur les « circonscriptions indigènes ». Il est vrai que ce décret tombait à une époque de crise où le gouvernement colonial, contraint de réduire le nombre de ses agents européens, s’en remettait aux chefs pour accélérer, entre autres, le programme des cultures obligatoires. En 1957, l’organisation des « circonscriptions indigènes » fut modifiée par l’instauration au sein de chacune d’elles d’un Conseil (composé de membres de droit et de membres nommés par le CDD) et d’un collège permanent, dont les membres étaient cooptés au sein du Conseil.
La colonisation belge respecta jusqu’au bout le principe de gestion séparée des communautés en place. Ce régime, on l’a fait remarquer, était de nature à susciter méfiances et suspicions. On comprend dès lors qu’une surveillance policière fut nécessaire, confiée très tôt à des administrations spécialisées. Au départ, la surveillance générale relevait de la Force publique conformément au décret du 10 mai 1919 qui lui confiait, outre la mission d’occupation et de défense, celle «de surveiller et d’assurer l’exécution des lois, décrets, ordonnances et règlements, spécialement ceux relatifs à la sécurité générale ». A partir de 1926, des troupes furent constituées dans chaque province en un « service territorial » comprenant une ou plusieurs unités de police ; la police municipale faisait usage de détectives africains. Indépendamment de la F.P., des corps de police furent constitués à partir de 1925 dans certaines agglomérations importantes : Léopoldville, Elisabethville, Matadi, Stanleyville, et Jadotville. Ils comprenaient un détachement de la Sûreté composé de détecteurs et un service de surveillance (permis de séjour, service dactyloscopique, etc.). Lors de certaines circonstances particulières, des mesures spéciales de surveillance furent prises. A partir des années 20, on redouta vivement les mouvements dits « subversifs » qui prenaient parfois leur origine à l’extérieur du Congo. C’est en particulier pour se prémunir contre ces mouvements d’origine étrangère qu’un service de renseignements fut instauré en 1929 au sein de la Force publique. En 1931, l’effervescence due à l’expansion du Kitawala, la révolte du Kwango, suivie de réactions dans le pays cokwe, le malaise social dû à la crise furent autant de facteurs qui accentuèrent le climat de crainte et de suspicion. On mit sur pied un service parallèle, appelé « Comité secret », chargé d’enquêter et de déporter les suspects à l’insu des services judiciaires et même de l’administration. Cette technique du groupe secret fut généralisée et institutionnalisée. C’est en 1932 que la colonie fut dotée d’un service de renseignements avec une antenne dans chaque province. Ce service devait coordonner les renseignements recueillis auprès des chefs de service du Parquet, des chefs des missions catholiques et des particuliers. Les administrateurs de territoire et les commissaires de district furent astreints à établir aussi des rapports pour la Sûreté. La police secrète commença donc à fonctionner à l’époque où le régime « indirect » fut institutionnalisé. Dans les villes, il eut des indicateurs et dans les campagnes, des « hommes de confiance », généralement des éléments de la Force publique opérant sous de fausses identités. En 1947, les opérations de renseignements furent davantage regroupées et une administration de la Sûreté fut mise sur pied. Sa mission fut essentiellement préventive et elle ne fut qu’occasionnellement chargée de la protection (Vellut J.L., 1974 : 121-130).
Il semble que la colonisation belge n’ait jamais eu l’impression de rencontrer dans aucune région du pays une civilisation africaine digne de ce nom, cohérente, coordonnée et caractérisée (Stengers J., 1989 : 188). La table rase, dans ces conditions, s’imposait. En réalité, ce sentiment était affirmé avec d’autant plus d’empressement qu’il fallait se donner bonne conscience. Il se trouvait contredit par la volonté même qui s’est traduite par une série de réalisations, qui demeurent remarquables jusqu’à aujourd’hui. Sans doute voulait-on connaître l’indigène pour mieux le dominer ? Toutefois, cette démarche comportait un risque : celui de mieux comprendre et, à la longue, d’apprécier la vie indigène. Ce fut le cas ici et là. Quelques esprits honnêtes durent se rendre à l’évidence et reconnaître la valeur des institutions autochtones et du comportement local. La colonisation se réclama, elle aussi, de ce sentiment et en tira pleinement profit pour mieux asseoir sa domination. D’ailleurs tout concourait à ce but ultime de domination et d’exploitation, y compris l’action sociale, sanitaire, et l’œuvre d’éducation. Le texte introductif du Rufast (Recueil à l’Usage des Fonctionnaires et Agents du Service territorial) reproduit à la fin du chapitre précédent, ne le proclame-t-il pas de manière explicite ? Le double but poursuivi était « inséparable » : « répandre la civilisation, développer les débouchés et l’action économique de la Belgique ». Le premier objectif était au service du second.
3.1 Etre connus pour être dominés
La connaissance des indigènes relevait d’un double impératif, celui qui s’imposait à l’administration coloniale dans l’optique de l’administration « indirecte », soucieuse de connaître le fonctionnement des institutions locales pour mieux les contrôler. Cette préoccupation revenait de droit également à l’Eglise catholique en vertu des clauses de la Convention de 1906, qui la liait à l’Etat, depuis la période léopoldienne, par laquelle elle s’était engagée à produire des travaux scientifiques, notamment ethnographiques et linguistiques. Ce double impératif fut à l’origine de la production d’une masse d’archives sur les faits sociaux indigènes et de toute une « bibliothèque » ethnographique et linguistique. En effet, les artisans de la « politique indigène » se trouvèrent dans l’obligation de réaliser plusieurs « enquêtes historiques » pour délimiter les chefferies, les regrouper et identifier les notables et chefs qui méritaient d’être reconnus. L’organisation des chefferies à la suite des décrets de 1906 et de 1910 donna lieu à une première série d’enquêtes, généralement superficielles. Celles qui présentent un plus grand intérêt sont consécutives à la publication de la circulaire de 1920. Les travaux qui l’inspirèrent furent menés notamment par Van der Kerken sur l’ethnie mongo. Mais ce cas situe précisément à bon droit les limites de ces recherches commandées (Hulstaert G., 1972 : 27-60). L’ignorance des langues locales, les rapports strictement hiérarchiques existant entre informateur et enquêteur, le caractère ambigu de l’enquête, objet de manipulations pour légitimer la position coloniale, sont autant d’éléments qui incitent à considérer ces informations avec un maximum de sens critique. N’empêche qu’une telle documentation existe et qu’elle est utile pour connaître les populations du Congo.
Quelques revues spécialisées apparurent et diffusèrent les résultats des études sur l’ethnicité congolaise en même temps qu’elles servaient de tribune pour les débats de politique indigène : Revue congolaise et Onze Kongo qui parurent de 1910 à 1914 ; à partir de 1920, elles furent remplacées par Congo qui absorba en 1925 le Bulletin belge d’études coloniales ; à partir de 1947, Congo changea de titre pour devenir Zaïre et continua à paraître jusqu’en 1961. D’autres périodiques furent : Kongo-Overzee (1934-59), Congo-Tervuren à partir de 1955 qui devint en 1961 Africa-Tervuren. Problèmes d’Afrique centrale (1950-59) hérita du Bulletin des Etudiants de l’Ecole coloniale supérieure d’Anvers qui paraissait en 1921- 25, avant de devenir Le Trait d’Union à partir de 1932 et Bulletin de l’Association des anciens Etudiants de l’Université coloniale de Belgique à partir de 1947.
Au Congo même, il existait quelques périodiques de grand intérêt, notamment le Bulletin des Juridictions indigènes et du Droit coutumier congolais qui paraissait à Elisabethville depuis 1933, Aequatoria édité à Coquilhatville de 1938 à 1961 (remplacée de nos jours par Annales Aequatoria) et le Bulletin du CEPSI à Elisabethville depuis 1946 et qui devint Problèmes sociaux congolais en 1957. Le Musée royal du Congo belge (MRCB), devenu depuis Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC), se consacra à la publication systématique des monographies de linguistique et d’anthropologie, à côté d’autres, consacrées aux sciences exactes. L’Institut royal colonial belge (IRCB) qui se transforma d’abord en Académie des Sciences coloniales (ARSC) et plus tard en Académie royale des Sciences d’outremer (ARSOM) se chargea, lui aussi, de diffuser une série d’études coloniales, en même temps qu’il publia un Bulletin dont l’intitulé se modifia avec celui de l’Institut : Bulletin de l’IRCB (1930-57), Bulletin de l’ARSC (1957-59), Bulletin de l’ARSOM depuis I960.
Les matériaux ethnographiques accumulés sont impressionnants, à en juger par les bibliographies annuelles établies de 1909 à 1925 par J. Halkin, poursuivies à partir de 1925 par le MRCB. Peu de personnes se spécialisèrent dans des grandes synthèses du genre de celles de Van der Kerken (1920), de J. Maes et O. Boone (1935), et de N. De Cleene (1944). La plupart se lancèrent dans les monographies régionales, à tel point que chaque région culturelle eut ses grands spécialistes : H. Burssens et B.O. Tanghe pour l’Equateur et l’Ubangi ; A. Hutereau, C. Van Overbergh, H. De Jonghe, A. De Calonne-Beaufaict pour les peuples de l’Uélé ; P. Schebesta et C.M. Turnbull sur les Pygmées ; E. Boelaert, A. De Rop, G. Van der Kerken et G. Hulstaert sur les mongo et la Cuvette ; A. Moeller sur le Nord-Est du pays ; D. Biebuyck pour le Maniema ; K. Laman, J. Van Wing et A. Bitremieux sur les Kongo ; J. Mertens, J.M. De Decker, J. Vansina sur le Bas-Kasaï ; M. Planquaert, J. Denis, G.L. Haveaux, L. de Sousberghe sur les Yaka et les Pende, etc. Le secret ethnographique du Kasaï et du Katanga fut dévoilé par d’autres spécialistes : P. Denolf, E. Verhulpen, F. Grevisse, P. Colle, etc. Les particularités culturelles étaient mises en valeur, d’autant plus que les coloniaux flamands, à qui on avait imposé en Belgique l’apprentissage de la culture et de la langue françaises, étaient sensibles ici au sort des cultures minoritaires qui couraient le risque de se retrouver écrasées par les cultures africaines dominantes. Mettre en valeur les spécificités culturelles de la colonie était pour eux une sorte d’exorcisme, histoire de rejeter indirectement l’impérialisme de la culture francophone dont ils étaient les victimes dans leur pays. Le mot d’ordre flamand « soyez Flamand que Dieu a créé Flamand » connut chez les Mongo, sous l’impulsion du Père Gustaaf Hulstaert, sa traduction locale en « soyez Mongo que Dieu a créé Mongo » [22]. On comprend dès lors l’intérêt et l’attention qui furent accordés aux études des langues locales. Chacun des nombreux parlers congolais ou presque eut droit à son esquisse morphologique, à son glossaire et même à sa grammaire [23]. On ne saurait passer sous silence l’existence de tant de dictionnaires, dont certains sont encore de grande valeur : H. Hulstaert sur le lomongo (1952 et 1957), C. Sacleux sur le kiswahili (1939, 1941, 1949), R. Butaye sur le kikongo (1909, 1927), M.B. Mc Janret sur le cokwe (1949), Van Avermaet sur le kiluba (1954), G. Vermeersch sur le ciluba (1924-25), A. De Clerq sur le kanioka (1901), H. Roland sur le kisanga (1938, 1950), A. Van Acker sur le kitabwa (1907). M. Mamet sur le ntomba (1955), H. Lekens sur le ngbandi, etc.
Dans ce domaine, notons une réalisation inédite, celle du Père Placide Tempels. Quand ce missionnaire de Kamina entreprit en 1944-45 d’écrire sur la vision bantu de la vie, il était loin d’imaginer la grande audience que sa publication allait susciter. D’abord rédigé en flamand, cet essai fut ensuite traduit en français par A. Rubbens et « Présence africaine » en publia deux éditions successives. Dans la préface, Alioune Diop s’exclame : « … Voici un livre essentiel au Noir, à sa prise de conscience, à sa soif de se situer par rapport à l’Europe. Il doit être aussi le livre de chevet de tous ceux qui se préoccupent de comprendre l’Africain et d’engager un dialogue vivant avec lui ». Effectivement, ce livre a connu un grand succès en Afrique, au-delà des frontières congolaises, où il se retrouva au cœur de tous les débats philosophiques, même au cours des décennies qui suivirent les indépendances (Tempels P., 1961). En réalité, replacé dans le contexte colonial, le livre n’avait a priori rien d’extraordinaire. Il décrivait la volonté flamande de décrypter, de dévoiler les réalités africaines. Il était l’une des conséquences du régime « indirect » prôné à l’époque. « Il n’est pas prouvé, faute d’avoir essayé, que la philosophie et la sagesse bantoues ne puissent pas servir de fondation pour élever une civilisation bantoue. Il y a même de sérieux indices permettant de conclure que l’essai vaut d’être tenté » (p. 118).
Le texte de Tempels s’adressait au public non africain et s’efforçait de lui inspirer de la sympathie pour cette réalité culturelle différente. « …La grande revendication des colonisés, explique-t-il, est d’ordre humain… Ce qu’ils désirent avant tout et par-dessus tout… c’est la reconnaissance par le Blanc et son respect pour leur dignité d’hommes, pour leur pleine valeur humaine. Leur grief principal et fondamental est le fait d’être traités continuellement comme des ‘imbéciles’, ‘macaques’ ou ‘nyama’. Par cette exaspération profonde, ils se montrent les dignes fils de leurs pères » (p. 116).
En tant que discours à « contre-courant », l’action de Tempels fut une invitation à la révolution par rapport à la colonisation classique qui prônait l’anéantissement de la conception de la vie préexistante. On comprend qu’il ait suscité de nombreuses controverses. Il est intéressant de noter que ce même document a subi deux types de critiques totalement différentes. Si les tenants de la colonisation classique l’estimaient trop radical et donc négrophile, dans le contexte de la colonisation, il sera décrié parce que trop accommodant et complice de la colonisation. On connaît le passage que le Martiniquais A. Césaire consacra à Tempels dans son Discours sur le colonialisme (1955 : 36-37).
« S’il y a mieux, c’est du R.P. Tempels. Que l’on pille, que l’on torture au Congo, que le colonisateur belge fasse main basse sur toute richesse, qu’il tue toute liberté, qu’il opprime toute fierté, qu’il aille en paix, le Révérend Père Tempels y consent. Mais, attention ! Vous allez au Congo ? Respectez, je ne dis pas la propriété indigène (les grandes campagnes belges pourraient prendre ça pour une pierre dans leur jardin), je ne dis pas la liberté des indigènes (les colons belges pourraient y voir propos subversifs), je ne dis pas la patrie congolaise (le gouvernement belge risquant de prendre fort mal la chose), je dis : vous allez au Congo, respectez la philosophie bantoue !
Il serait vraiment inouï, écrit le R.P. Tempels que l’éducateur blanc s’obstine à tuer dans l’homme noir son esprit humain propre, cette seule réalité qui nous empêche de le considérer comme un être inférieur ! Ce serait un crime de lèse- humanité, de la part du colonisateur, d’émanciper les races primitives de ce qui est valeureux, de ce qui constitue un noyau de vérité dans leur pensée traditionnelle, etc.
Quelle générosité, mon Père ! Et quel zèle ! Or donc, apprenez que la pensée bantoue est essentiellement ontologique ; que l’ontologie bantoue est fondée sur les notions véritablement essentielles de force vitale et de hiérarchie de forces vitales ; que pour le bantou enfin l’ordre ontologique qui définit le monde vient de Dieu et, décret divin, doit être respecté… [24].
Admirable ! Tout le monde y gagne : grandes compagnies, colons, gouvernement, sauf le Bantou, naturellement.
La pensée des Bantous étant ontologique, les Bantous ne demandent de satisfaction que d’ordre ontologique. Salaires décents ! Logements confortables ! Nourriture ! Ces Bantous sont de purs esprits, vous dis-je : ce qu’ils désirent avant tout et par-dessus tout, ce n’est pas l’amélioration de leur situation économique ou matérielle, mais bien la reconnaissance par le Blanc et son respect, pour leur dignité d’homme, pour leur pleine valeur humaine.
En somme, un coup de chapeau à la force vitale bantoue, un clin d’œil à l’âme immortelle bantoue. Et vous êtes quitte ! Avouez que c’est à bon compte !
Quant au gouvernement, de quoi se plaindrait-il ? Puisque, note le R.P. Tempels, avec évidente satisfaction, ‘les Bantous nous ont considérés, nous les Blancs, et ce dès le premier contact, de leur point de vue possible, celui de leur philosophie bantoue’ et ‘nous ont intégrés, dans leur hiérarchie des êtres-forces, à un échelon fort élevé’.
Autrement dit, obtenez qu’en tête de la hiérarchie des forces vitales bantoues, prenne place le Blanc, et le Belge singulièrement, et plus singulièrement encore Albert ou Léopold, et le tour est joué. On obtiendra cette merveille : le Dieu bantou sera garant de l’ordre colonialiste belge et sera sacrilège tout bantou qui osera y porter la main ».
Le missionnaire était-il de bonne foi ? N’était-il pas conscient que sa « philosophie bantoue » se prêtait aussi à une exploitation colonialiste ? Quand bien même il l’aurait été, son œuvre n’en serait pas moins marquante, du moins au niveau de l’intention. En effet, dans l’entendement de Tempels, le colonisateur méritait d’être éclairé sur la vision du monde des Bantu et donc, des autochtones, afin de savoir comment les prendre pour mieux les contrôler et les mettre au travail. La « philosophie bantoue » se prête à cette double lecture, comme du reste, la Jamaa, cette autre création de Tempels [25]. Comme il se rendait compte, avec raison, de la nécessité d’inculturer le message chrétien dans les valeurs bantoues existantes, le Père lança vers les années 44-45, une pastorale fondée essentiellement sur la famille. Le terme Jamaa qui désigna ce mouvement signifie en swahili « famille ». Ses mafundisho (instructions) furent davantage comprises et intériorisées par les Congolais. Lancé à partir de la région de Kamina (mission de Kabondo-Dianda), le mouvement se répandit dans le Sud-Katanga, spécialement dans les paroisses urbaines de Kolwezi, Jadotville et Elisabethville et s’étendit tout le long du chemin de fer jusqu’au Kasaï ; il prit l’allure d’une secte qui susciterait plus tard de nombreuses controverses. Du point de vue colonial, le mouvement fut intéressant car il joua un rôle de tampon, renforçant le sentiment de soumission, d’abandon et de dépendance des autochtones. Mais le message fondamental prônant le syncrétisme et donc l’adaptation des recettes de culture religieuse « du dehors » aux nécessités « du dedans », ne fut pas assumé car incompris [26]. Pourtant il suscita une très grande ferveur dans le peuple.
Incontestablement Tempels avait le charisme fondateur d’Eglise de tendance syncrétique. S’il n’avait été prêtre catholique, s’il avait voulu quitter ce carcan rigide, il aurait eu certainement un rayonnement plus important.
L’essentiel pour nous est de mettre en lumière les atouts dont la colonisation a disposé pour nuancer ses vues, corriger ses méthodes d’action, ajuster ses projets de « civilisation » par rapport à la situation concrète, même si elle n’en a pas fait usage. Ses intérêts étaient ailleurs. Il n’y a qu’une chose qui se soit rapprochée de cette préoccupation : l’administration « indirecte ». Mais cette similitude ne fut qu’apparente, cette politique n’étant en fait qu’une manipulation de la culture locale au service de la colonisation.
Dans le domaine de la civilisation, tout devait donc être importé. Et la civilisation disposait, on le sait, de deux importants réseaux de diffusion : l’évangélisation et l’instruction.
Dès le début de la période coloniale, le catholicisme disposait d’assises sociales, puissamment soutenues en tant que « missions nationales ». Son action se poursuivit de manière fulgurante par l’entremise des missions ; à chacune d’elles était rattachée toute une zone d’évangélisation, où les villages étaient systématiquement visités par les Pères itinérants. La christianisation n’hésitait pas à utiliser la manière forte, en « persécutant » les païens. Les habitations des polygames étaient brûlées, et les statuettes arrachées à leurs propriétaires, sous prétexte que ce n’étaient que des fétiches. L’administration coloniale combattait également la polygamie par un impôt supplémentaire. Au sein de chaque mission, existaient deux groupes. Le groupe des catéchumènes, des adultes qui effectuaient un séjour de plusieurs mois pour apprendre le catéchisme. Ils étaient recrutés dans les villages par les Pères itinérants. Leur séjour à la mission se prolongeait aussi longtemps qu’ils ne réussissaient pas l’examen de passage sur le catéchisme, qui donnait droit au baptême. L’autre groupe était celui des élèves pour qui l’enseignement du catéchisme était intégré à celui de la lecture et du calcul. Leur séjour à la mission était plus long que celui des catéchumènes. Le quartier des garçons était nettement séparé de celui des filles et ce clivage était respecté même aux heures de prière commune, à l’église. La rencontre des deux groupes était permise une fois par jour. C’était l’occasion entre frères et soeurs, ou entre fiancés et amoureux occasionnels de se donner des nouvelles, de s’échanger des provisions et de s’enquérir de la santé des uns et des autres. La rencontre avait lieu à un endroit déterminé, généralement à mi-chemin entre les deux quartiers. Elle commençait et se terminait au signal du responsable, à une heure déterminée. Dans les langues congolaises, ce cérémonial était appelé « angélus » (Wanzio) tant il était défini de manière précise dans le temps, à l’image de l’angelus qu’on récitait à 12 heures précises [27].
Si le séjour à la mission, tant pour les élèves que pour les catéchumènes, garçons et filles, était laborieux, c’était essentiellement à cause des activités manuelles. On peut même affirmer a posteriori que c’était là la principale raison de cette concentration d’hommes et de femmes à la mission, du moins pour les adultes catéchumènes. Ils étaient astreints à des corvées journalières : travaux dans les champs et dans les constructions de la mission, entretien des routes, etc. L’orientation des travaux était la même que celle que la colonisation avait imposée à la région dans laquelle se situait la mission. Ainsi, dans la région d’exploitation des noix de palme, il n’était pas rare de voir une mission, dotée de son usine de fabrication d’huile de palme, vendre son produit aux entreprises commerciales intéressées.
On comprend que le baptême donnait lieu à une grande explosion de joie. On obtenait le brevet d’accès à la classe des acculturés certes, mais surtout on était enfin libéré du régime des corvées de la mission. Le changement de statut, de païen à chrétien, était symbolisé par le nouveau nom, le prénom. Au début, le prénom se donnait en latin – Petrus (Petelo), Paulus (Paulo), Jacobus (Jacobo) – pour des raisons pratiques ; on ne savait pas quelle identité linguistique privilégier. De plus, le même prénom était donné à tous les membres d’un même groupe. Le missionnaire avait ainsi la possibilité par la suite, quand il rencontrait un Pierre ou un Jean, de retrouver l’année précise où le baptême avait eu lieu puisqu’un seul prénom désignait une promotion entière. Par la suite, le régime des prénoms fut quelque peu libéralisé et les néophytes purent même soumettre leur choix parmi les prénoms proposés. Toutefois, chaque congrégation religieuse avait ses prénoms favoris, qui se répandirent dans la région où elle assurait l’évangélisation. Du coup, chaque région du Congo avait son registre de prénoms. Le Kivu. à cause des Pères Blancs, s’est ainsi particularisé par des prénoms excentriques renvoyant non pas à des saints mais plutôt à des concepts évangéliques : Deogratias (Deo gratias). Immaculata (Immaculata conceptio), Assumpta (Maria), etc. Une fraternité particulière due au phénomène d’homonymie était devenue fréquente. Déjà le fait d’avoir fait partie du même groupe de néophytes créait une relation d’amitié, soudée par les longues journées de travaux imposés exécutés ensemble. On se considérait comme des « compagnons » (mwape, mwata, mwama, moninga). Entre générations différentes, 1 homonymie passait pour être une relation de fraternité sur le modèle de la fraternité consanguine (majina, ndoyi). En effet, les épouses de deux homonymes étaient des « mbanda » (rivales), de même que deux belles-sœurs, car chacune était « épouse » par rapport aux deux homonymes et inversement.
Rentré au village, le chrétien continuait à vivre à sa manière la christianisation reçue ; socialement, il constituait avec ses confrères la catégorie de ceux qui étaient proches du Blanc, de la modernité, mais il continuait toutefois à honorer ses ancêtres et à faire usage de la médecine locale pour se prémunir contre les maladies ; il ne pouvait pas cesser de qualifier ses belles-sœurs d’épouses. Il lui arrivait même de renouer avec ses épouses véritables qu’il avait dû abandonner pendant son séjour à la mission et parfois, d’hériter encore de l’une ou l’autre veuve lors du décès d’un frère ou d’un cousin. Il vivait dans une grande sérénité intérieure, toujours convaincu, avec une certaine dose de sincérité, du baptême pour lequel il avait tant souffert ; c’est le missionnaire seul qui trouvait à y redire, en dénonçant un retour au paganisme, expliquant à qui voulait l’entendre que les deux modes de vie étaient incompatibles, que l’intéressé était un « mauvais chrétien » [28]. Par cette filière, l’accès à la civilisation était semé de bien des vicissitudes.
Mais il existait un autre mode de diffusion de la civilisation dans la colonie. Son accès était conditionné car il reposait une fois de plus, et pour une large part, sur la christianisation. Celle-ci s’en servait comme appât, afin de mobiliser le plus de monde possible pour le baptême. On a vu comment l’activité d’enseignement a débuté à partir des efforts conjugués des officiels et des missionnaires. Cette situation prévaudra jusqu’aux années 20. En 1922, on assista à une première élaboration du système d’enseignement colonial grâce aux travaux d’une commission constituée par le ministre Louis Franck. Les principes de base du système scolaire y furent précisés pour la première fois. La primauté devait être donnée à l’éducation plutôt qu’à l’instruction ; les programmes et les méthodes devaient se préoccuper d’être adaptés au milieu « indigène ». Par le fait même, l’enseignement devait se faire dans les langues locales. A l’époque, suivant l’opinion coloniale, la connaissance du français devait être évitée autant que possible, car elle était source d’orgueil et de prétention, disait-on.
Puisqu’il fallait un enseignement élémentaire, suffisamment large pour y impliquer la grande masse des enfants, il fallait miser sur la création massive d’« écoles normales », capables de former les enseignants nécessaires. L’école normale devint la grande référence scolaire postprimaire ; n’y accédait pas n’importe qui. Il fallait, pour y être admis, faire preuve à la fois de qualités intellectuelles et morales. La Commission Franck décida, en matière d’enseignement, de s’en remettre aux missions religieuses. Lui-même avait beau être à la fois libéral, agnostique et franc- maçon, il demeurait convaincu, à propos du Congo, que « pour l’éducation morale, c’est sur l’évangélisation qu’il fallait surtout compter. On ne ferait rien de permanent sans elle ». Cette conviction est basée sur cette observation que la vie indigène est profondément pénétrée de religiosité et de mystère. Seul un autre sentiment religieux, plus élevé mais aussi profond, paraissait capable de remplacer ces influences traditionnelles et d’amener la moralité indigène à un plan supérieur (Franck L., 1924 : 123). En somme, il prônait la continuité. Il la renforça même, en instaurant pour la première fois le système des subsides. Les écoles missionnaires mais aussi toutes les stations des missions furent subsidiées dans la mesure où elles prenaient part, globalement, à l’oeuvre d’éducation. Il faut dire que l’opinion belge partagea cette vision des choses, persuadée qu’il fallait une éducation aussi stricte que celle prônée par la christianisation pour que l’indigène arrive à se soustraire de ses habitudes barbares et sauvages (Kita K.M., 1982 : 166-167).
Avec le renfort des subsides de l’Etat, l’Eglise catholique se trouva en situation de monopole en matière d’enseignement au moins jusqu’en 1946, date de la création des premières écoles laïques réservées aux seuls Blancs. Jusque-là, toutes les écoles étaient des écoles des missions ou des écoles desservies par des missionnaires. Prenant ses responsabilités, l’Eglise pensa à développer l’enseignement primaire, former des cadres subalternes dont on avait besoin et surtout former des prêtres, ces formateurs de formateurs. L’école primaire comportait deux degrés différents. Le premier était conçu pour la masse et comportait surtout un programme d’« éducation » : travail manuel surtout agricole, catéchisme, hygiène, l’instruction elle-même (lecture, arithmétique) n’y occupant qu’une place négligeable. Le second degré était réservé à des élèves sélectionnés, manifestant la volonté de s’instruire. Ils étaient préparés à entrer dans des écoles dites spéciales, à savoir les sections professionnelles, les sections normales et celles de candidats-commis. Le seul programme de haut niveau était réservé aux candidats à la prêtrise. En effet, en 1948, le pays disposait déjà de 24 petits séminaires qui étaient des cycles d’humanités complets. La première ordination d’un prêtre autochtone avait déjà eu lieu en 1917 à Baudouinville. Il s’agissait de l’abbé Stefano Kaoze. L’enseignement demeurait toutefois fort élémentaire, avec une base très large malgré tout. Les statistiques scolaires témoignent de cette situation. Les diplômes les plus élevés délivrés étaient ceux de la fin du cycle postprimaire et ils l’étaient dans une proportion assurément non négligeable : 318 en 1929 pour les deux réseaux confondus, officiel et subsidié, 605 en 1939 et 645 en 1944 (Kita K.M., 1982 : 192) [29].
On fit un pas en avant vers les années 46-47. Deux actions furent à la base de cette impulsion. D’abord les bénéfices des subsides furent étendus aux écoles protestantes. On sortait de la deuxième guerre mondiale. Les alliés anglais et américains avaient joué un rôle prépondérant dans la libération de la Belgique. Il devenait gênant de continuer à négliger l’œuvre missionnaire de leurs ressortissants au Congo.
Par ailleurs, le libéral Godding, ministre des colonies, procéda à la création d’un enseignement officiel laïc, première fissure officielle dans le système en place. Bien que cette nouvelle création fût réservée aux enfants des Blancs, il était entendu que ce nouveau réseau allait réaliser une percée sensible dans ce secteur où l’Eglise avait le monopole. En attendant, le projet colonial de « civiliser l’indigène » continua à se réaliser de cette façon, dans une totale confiance dans l’œuvre missionnaire.
Une autre manière de « civiliser » fut, à coup sûr, d’assurer l’introduction des biens importés et l’accès à des bienfaits d’origine externe, inconnus avant l’arrivée des Blancs. Cet apport social constitue l’un des fleurons de la colonisation belge. On parlait avec fierté de l’écart existant entre Brazzaville et Léopoldville, entre le sort matériel de l’indigène du Congo français et celui de l’indigène du Congo belge. La situation du Congolais était apparemment plus enviable. L’action médicale était d’une réelle efficacité bien qu’elle n’ait vraiment démarré qu’après la Première Guerre mondiale, avec l’implantation des formations médicales et des campagnes de vaccination. Pour combattre la dépopulation, plusieurs autres institutions furent implantées, notamment la FOMULAC (Formation médicale de l’Université de Louvain au Congo), le CEMUBAC (Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles au Congo), la FOREAMI (Fondation Reine Elisabeth pour l’Assistance médicale aux Indigènes du Congo belge), la Croix-Rouge du Congo et le Fonds social du Kivu. Le niveau de vie connut dans l’ensemble un progrès remarquable. Quelques indices en témoignent. De 1950 à 1957, la consommation générale des « indigènes » augmenta de 76 %. Entre 1946 et 1956, le nombre de vélos en circulation passa de 50 000 à 700 000 (Stengers J., 1989 : 189). Mais ce progrès était surtout sensible dans les milieux urbains. Dans l’univers rural, jusqu’en 1960, la modernité coloniale se limita généralement à l’acquisition de la cotonnade, de quelques ustensiles et de l’un ou l’autre vélo ou machine à coudre par village.
Le phénomène scolaire et l’action médicale constituent sans doute les éléments nouveaux les mieux généralisés. Quelle que soit la forme qu’elle ait revêtue, cette action avait une caractéristique commune : les biens sociaux étaient distribués et « consommés », sans préoccupation de susciter un apprentissage quelconque ou un entraînement. C’est le fameux paternalisme, dont l’effet malheureux a été d’atrophier la créativité locale au contact des « facilités » externes. Ce comportement s’est surtout manifesté au sein des entreprises qui entendaient pourvoir à tous les besoins des ouvriers, sans doute pour éviter qu’ils soient distraits par des préoccupations étrangères à la rentabilité de l’entreprise. La BCK et l’UMHK s’illustrèrent dans ce comportement d’opération de charme auprès du travailleur pour mieux l’assujettir. Prenons le cas de l’Union minière, en consultant par exemple le rapport qu’avait établi le commissaire de district d’Elisabethville en décembre 1945 notamment sur le camp de Lubumbashi. Ce camp, le plus ancien que possédait l’UMHK, comportait le plus grand nombre d’habitations vieilles, neuves et en construction. L’inventaire était précis : 1 218 maisons en briques de Kimberley (pour couples sans enfants ou deux célibataires), 168 dites de type Mottoulle de même forme que les précédentes, 256 maisons de paille, 101 en béton, 1 182 maisons nouvelles de plusieurs types différents [30]. Le camp comportait aussi 39 fosses fumantes et 15 bains- douches. Il existait un frigo de 70 tonnes pour la conservation du poisson. La ration était donnée par tranches, les mardis et les vendredis ; un jour était consacré à la ration des femmes, un autre encore à celle de la MOS (main-d’œuvre spécialisée). Le camp comportait aussi une école primaire de 630 élèves, une troupe de scouts, de guides et de louveteaux ; il possédait une fanfare, deux équipes de football et une chapelle au milieu du camp. On aurait pu dire que tout était prévu, programmé en vue d’un comportement linéaire, où tout écart imprévu serait nécessairement malvenu. La générosité paternaliste poursuivait à court et à moyen terme un objectif précis, celui d’assurer la stabilité de la main-d’œuvre et au besoin, de l’attirer [31].
On a parlé du projet colonial et de ses ambitions de mettre en valeur le pays, de moderniser les institutions locales, d’apporter la « civilisation » à ces peuples qui en étaient dépourvus. Il reste à savoir comment ce beau programme a été perçu par les autochtones, et quelles ont été leurs réactions. Quelle était d’abord la structure de cette population pendant la période coloniale ?
Il fallait s’y attendre, l’évolution de la population congolaise, jusqu’en 1935, a été stationnaire ; elle a même connu des régressions nombreuses. Entre 1925 et 1930, cette population est passée de 10 303 932 à 10 252 515 ; en 35, ses effectifs dépassaient à peine ceux de 25. Pendant les cinq années qui suivirent, l’évolution fut stationnaire et c’est seulement à partir des années 40, au moment où le colonisateur fut distrait par la guerre, que la démographie congolaise se remit à progresser. En effet, alors que pendant quinze ans (de 1925 à 1940), elle avait stagné autour des dix millions d’habitants de 1940 à 1945, soit en une demi-décennie seulement, elle compta un million d’habitants de plus ; sur une même période de quinze ans, de 1940 à 1955, elle passa de 10 723 068 à 13 138 214 d’effectifs, soit un accroissement de plus de deux millions dames (tableaux 13 et 14). Cette progression se poursuivra par la suite.
Les réactions autochtones face au projet colonial de modernité furent diverses et contradictoires en apparence, mais pourtant cohérentes car elles se tenaient toutes. La première a toujours été la curiosité et l’admiration à l’égard des bienfaits de la technologie européenne qu’on a continué à chercher à acquérir, avec le même enthousiasme qu’au XIXe siècle. Mais le contact avec le Blanc continua à paraître risqué, source de souffrances nombreuses, même de la mort. Toute la « mise en valeur » du pays se traduisit en effet par des travaux forcés ou du moins ressentis comme tels ; nous y reviendrons, de même qu’aux assassinats perpétrés par les Blancs, et à leurs actes de « cannibalisme ». Pris à ce piège, les Congolais réagirent de multiples façons : soit par des mini-stratégies pour détourner l’attention du Blanc et échapper ainsi à ses prescriptions et ses impositions, soit par des révoltes pour la violence par la violence, soit encore par des réactions messianiques, annonciatrices de temps meilleurs, ce qui permettait de minimiser les situations vécues et de les combattre avec d’autant plus de courage qu’elles étaient, d’après les prédictions, précaires et vouées à la disparition.
Tableau 13 — Evolution de la population congolaise (1925-1980)
|
ANNÉES |
EFFECTIFS |
ANNÉES |
EFFECTIFS |
|
1925 |
10.303.932 |
1955 |
13.139.214 |
|
1925 |
10.252.515 |
1960 |
14.825.903 |
|
1935 |
10.381.314 |
1965 |
16.975.580 |
|
1940 |
10.723.068 |
1970 |
19.531.722 |
|
1945 |
11.206.034 |
1975 |
22.582.230 |
|
1950 |
11.932.785 |
1980 |
26.377.260 |
(De Saint-Moulin L„ 1987 :391)
Tableau 14 — Estimation de la population par régions (1938-1984)
|
|
1938 |
1948 |
1958 |
1970 |
1984 |
|
Kinshasa |
42.036 |
132.532 |
389.969 |
1.142.761 |
2682.260 |
|
Bas-Zaïre |
655.520 |
828.264 |
963.164 |
1.392.025 |
1.992.845 |
|
Bandundu |
1.426.539 |
1.589.109 |
1.922.655 |
2.600.556 |
3.722.680 |
|
Equateur |
1.610.455 |
1.723.777 |
1.914.332 |
2.341.695 |
3.442.348 |
|
Haut-Zaïre |
2.413.074 |
2.427.125 |
2.636.423 |
3.131.985 |
4.251.564 |
|
Kivu |
1.345.084 |
1.587.166 |
22.75.429 |
3.256.117 |
5.243.980 |
|
Shaba |
1.043.573 |
1.258.149 |
1.689.027 |
2.506.241 |
3.915.922 |
|
Kasaï oriental |
903.804 |
909.099 |
994.149 |
1.500.908 |
2.428.591 |
|
Kasaï occidental |
1.113.454 |
1.117.225 |
1.300.232 |
1.659.434 |
2.312.158 |
|
|
10.553.539 |
11.572.446 |
14.085.389 |
19.531.722 |
29.992.348 |
(De Saint-Moulin L, 1987 :394)
Que la technologie importée ait continué à exercer un attrait sur les autochtones, c’est indéniable et c’est grâce à elle que l’engouement pour les créations coloniales continua à se manifester : les habitations des stations européennes, l’automobile, le textile importé, tout était l’objet de curiosité et les bienfaits que la technologie procurait étaient et demeuraient enviables. Mais on finit par oublier cet aspect des choses, à cause des autres réalités de cette colonisation. La pire de ces réalités est sans conteste le « vol des enfants du pays » : ceux-ci, traqués puis capturés comme du gibier, étaient emmenés sans qu’on puisse espérer les revoir [32]. On procédait au recrutement des travailleurs de cette façon, et par la force s’il le fallait. Un ancien travailleur retraité de la Gécamines explique dans quelle atmosphère cela se passait :
… Personne n’acceptait facilement de se faire embaucher pour Lubumbashi. C’est en pleurant qu’une famille acceptait de donner un des siens. D’ailleurs dès qu’on apprenait l’arrivée du recruteur, les villages se vidaient, les gens abandonnaient tous leurs biens, poules, chèvres, moutons, etc. et gagnaient la brousse. Il arrivait qu’on prenne en otage une femme ou un jeune enfant pour obliger sa famille à fournir un travailleur. Si tout le monde persistait à rester en brousse, le chef envoyait ses messagers arrêter les gens de force. Ceux qu’on attrapait étaient mis à la chaîne et conduits devant le recruteur. S’ils essayaient d’opposer de la résistance, on les battait à mort… Les jeunes gens allaient même jusqu’à faire des fétiches qui les rendaient invisibles en cas de recrutement. Dès qu’un jeune homme était contraint de partir à Lubumbashi, sa famille pleurait beaucoup et croyait qu’il allait mourir là-bas. Son père convoquait les membres de la famille pour les cérémonies de « mapiku ». Il appelait tantes, oncles, grands- parents, cousins… il les mettait officiellement au courant du malheur qui les frappait : le départ de son fils. Ensuite il leur demandait de se réconcilier : ‘Que celui qui a le mal dans son cœur avoue ; que celui qui pense du mal de mon fils abandonne cette pensée ; que celui qui a à réclamer quelque chose le dise publiquement afin que mon fils parte et revienne’ (Muteba K.N., 1976 : 148).
Il s’agit du cas le plus humain, où le candidat travailleur, après avoir été « arrêté », avait le temps de faire ses adieux et de partir avec ses effets. Dans beaucoup d’autres cas, ceux qui étaient « arrêtés » l’étaient comme du gibier attrapé au filet. On les emportait sur-le-champ. Ceux qui apportaient la nouvelle étaient soit des témoins de la scène, soit encore des passants qui avaient croisé le groupe des recruteurs sur le chemin de retour et qui avaient reconnu les victimes qu’ils entraînaient avec eux. Voilà pourquoi, pour se prémunir contre certains recrutements, on recourait à des recettes magico-religieuses d’origine traditionnelle. Mais quels en étaient les effets réels ? Certains charmes, raconte-t-on, avaient la faculté de rendre les personnes invisibles aux yeux du Blanc, d’autres permettaient de s’envoler pour se retrouver dans un autre village loin des agents recruteurs, d’autres encore donnaient une apparence de vieillesse même à des jeunes gens. Pour échapper au recrutement de la Force publique, il fallait recourir à une recette traditionnelle qui, une fois consommée, atténuait considérablement le poids physique des individus. Les candidats recrutés de force qui avaient pris la précaution de consommer préalablement ce produit regagnaient le village après quelques jours, parce qu’une fois au poste de l’Etat, ils étaient déclarés inaptes à cause de leur faible poids.
Le recrutement sauvage de la main-d’œuvre a donné lieu à des légendes et même à des certitudes sur le cannibalisme des Européens. Cette opinion a persisté, même des années après l’indépendance. On faisait allusion à des scènes réelles. Régulièrement, la panique s’installait dans les régions du pays. Les Blancs cannibales (mundele ngulu. Mitumbula) étaient là, circulaient dans les bois, surveillaient les sorties des villages, à la recherche des hommes valides. Pendant ces périodes d’insécurité, aucun homme isolé n’osait quitter le village. Seules les femmes pouvaient se permettre de vaquer à leurs occupations car elles n’étaient pas inquiétées.
Ceux qui étaient attrapés étaient entraînés dans des régions lointaines. On racontait que ces malheureux étaient jetés dans de grandes fosses où ils étaient engraissés de sel. Dès qu’ils étaient suffisamment gros, ils étaient tués, dépecés et partagés entre Européens. Quand ils n’avaient plus assez de réserves de viande humaine, les Européens recommençaient l’opération. C’est pourquoi ces périodes de « chasse humaine » étaient saisonnières… Cette légende faisait assurément allusion au recrutement des mineurs, recrutement forcé à l’issue duquel les travailleurs étaient envoyés sous terre pour y travailler. On leur faisait sans doute consommer des vitamines pour être endurants et forts. Comme la mortalité était élevée et les mines nombreuses ; il fallait après un certain délai de nouveaux recrutements. Ces légendes, qui ont pris forme dans les zones méridionales, se sont répandues dans l’ensemble du pays au point que l’Européen a toujours suscité la méfiance, à cause de ses appétits suspects.
Dans le sud, la légende des Mitumbula naquit au Kasaï, puis elle se répandit vers l’est (province du Katanga) et vers l’ouest (province de Léopoldville) [33]. Un rapport de la Sûreté des années 45 fournit des précisions sur le phénomène dans cette région. Son origine se situe vers les années 20 ; ces rumeurs refaisaient régulièrement surface aux mois de janvier, février et mars. Les récits convergent par la récurrence de certains épisodes : les victimes sont hypnotisées par une lampe ou par le lancement d’un morceau de caoutchouc, l’intervention des infirmiers et des injections, l’engraissement, l’existence des trous, la boucherie finale [34] et le cannibalisme qui est la cause de la grosseur de certains coloniaux, considérés généralement comme étant mitumbula [35].
Dans le nord-est du pays, cette légende daterait de 1929 et aurait pris forme dans les milieux des mines d’or de Kilo-Moto. L’administration coloniale en était consciente et en fit même état vers les années 1939-40. A l’époque, le vice-gouverneur Ermens attira l’attention du chef de la province orientale sur la persistance de cette croyance. En 1938, un Congolais fut accusé d’anthropophagie dans le district de Kibali-Ituri ; il se serait permis de se livrer aux mêmes pratiques que les Européens. Les agents de l’administration étaient soupçonnés de délivrer aux Européens des patentes » ya kulia batu » (sic), en d’autres termes, des permis d’anthropophagie (Verhaegen G., 1983 : 486). Pendant la guerre, ces histoires des Togbagba ou Togwawa (Blancs anthropophages) évoluèrent de la région de Watsa-Gombari-Kilo- Mambasa vers Stanleyville. Les Boyomais de l’époque indiquaient même la boucherie où cette viande spéciale était vendue. Le scénario de la capture des victimes était pratiquement identique. Elles étaient hypnotisées à l’aide des puissantes torches électriques, puis transportées en un lieu où elles étaient engraissées jusqu’à ne plus savoir tenir debout. Elles étaient ainsi réduites à l’état d’animaux et n’émettaient plus que des grognements de cochons. On les tuait et vendait leur chair aux Blancs réputés dont le goût pour la chair humaine ou plus précisément la chair des Noirs était connu. Verhaegen note à ce propos qu’aujourd’hui encore, il est rare de trouver, même parmi les universitaires, une personne qui ne croit pas que la légende contenait une part de vérité » (Verhaegen G., 1983 : 486-487).
Pour revenir à la question de la main-d’œuvre, signalons que la période des recrutements intensifs s’est située avant 1929. A l’UMHK, par exemple, de 1921 à 1925, on dût recruter au moins chaque année 10 112 hommes pour maintenir un effectif moyen de 10 565 travailleurs. Ceci équivaut à un rythme de renouvellement annuel de l’ordre de 957 %. Entre 1926 et 1930, le taux de cette annuité se réduisit à 626 %. En dépit de ces recrutements, la pénurie de main-d’œuvre ne fit que croître et provoqua une baisse de production du cuivre de 10 % entre 1926 et 1927. Comme ses fournisseurs étaient incapables de lui apporter les effectifs dont elle avait besoin, l’Union minière entreprit ses propres recrutements au Rwanda- Urundi (1925), au Maniema (1926-28) et au Kasaï (à partir de 1926) et même en Angola (Per rings C., 1977 : 237-259). Mais ce mouvement s’affaiblit avec les manifestations de la grande crise économique. Les grandes zones industrielles procédèrent même au licenciement de nombreux salariés.
A cette époque, l’agriculture prit son essor grâce à l’instauration de cultures obligatoires, pour compenser les effets de la crise. Au Katanga, les zones réservées aux cultures vivrières furent alors ouvertes à la culture du coton. Chaque homme adulte était concerné par ces cultures obligatoires et des pressions énormes s’exerçaient pour qu’elle soient exécutées ; les prix imposés étaient dérisoires. En même temps, les corvées administratives se multiplièrent, de même que les tournées de collecte de l’impôt de capitation, qui touchait tout adulte valide (Muteba K.N., 1976 : 141-143). A partir de 1929, les recrutés ne furent plus systématiquement envoyés au loin ; ils devaient exécuter des travaux agricoles sur place. La main-d’œuvre était sollicitée non seulement par les grandes entreprises telles HCB, mais aussi par les petits exploitants. Un système permettait à ces derniers de monter une affaire, même sans investissement préalable. Les noix de palme ou les noix palmistes s’achetaient avec de la monnaie fictive (timbres) ou contre un reçu. Le commerçant européen avait le temps de vendre sa marchandise, d’empocher le surplus et de remettre enfin son dû au paysan, contre présentation du reçu ou des timbres, après des semaines d’attente.
On peut estimer que les Congolais ont apporté une contribution exceptionnelle à la construction de leur pays pendant la période coloniale, par les travaux gigantesques qu’ils ont réalisés de leurs propres mains. La conscience d’un travail collectif, si elle avait déjà pris corps, leur aurait permis de se rendre compte de la force qu’ils auraient constituée s’ils avaient pu s’unir et travailler de concert.
A cause des travaux forcés, la colonisation fut ressentie comme une réalité abjecte. On exécutait les travaux demandés, mais on se mit à fredonner des chansons injurieuses comme les Blancs. Des stratégies furent élaborées pour échapper à la vigilance du colonisateur et du missionnaire. Déjà, lors des premières manipulations des chefferies en 1906 et 1910, il n’était pas rare, on l’a dit, que des arrangements soient pris pour mettre à l’avant-plan un esclave ou un homme de paille, histoire de mettre le vrai chef à l’abri. Les polygames dissimulaient volontiers leur état pour se soustraire au courroux des missionnaires, en présentant les autres épouses comme des « soeurs » ou des « tantes ». Chez les Leele-Kuba, au Kasaï, on a vu comment l’institution polyandrique a été conservée pendant des décennies entières, à l’insu des agents coloniaux. La polyandre était présentée comme une simple épouse monoandrique qui avait réellement ce statut devant l’administration coloniale, bien qu’il fût entendu, pour tout le monde, y compris pour le prétendu mari, qu’elle était polyandre.
Les réactions autochtones ne purent être réprimées pendant des décennies entières. Ici et là, elles se transformèrent en actions violentes. Ce phénomène a été constaté pratiquement dans tous les milieux, parmi les paysans que la colonisation avait désinstallés de leurs usages comme parmi les nouvelles couches qui s’étaient constituées à la faveur de l’ordre nouveau, les ouvriers dans les zones urbaines et les soldats dans les casernes.
Dans les campagnes, contrairement à ce qu’on pourrait croire, les réactions violentes ont été relativement nombreuses et diversifiées. Certaines, les plus anciennes, poursuivaient le mouvement de contestation de l’ordre politique nouveau [36]. Tel est le cas des révoltes dites de Sankuru qui se succédèrent entre 1904 et 1921. Celle qui est connue sous le nom de Tonga-Tonga (du nom du charme dont se réclamaient les révoltés) éclata en avril-mai 1904 et se prolongea jusqu’en 1905 dans la région de Bena-Dibele, entre le Sankuru et le Lukenye ; elle multiplia les attaques contre les factoreries de la CK. D’autres révoltes étaient en fait des combats menés dans certaines zones isolées qui n’étaient pas encore tombées sous la domination coloniale. C’était le cas du nord-est, dans la région du lac Albert. En 1922, une offensive militaire fut dirigée contre la région des monts Mitumba (zone de Béni) avec, comme naguère, des centaines de soldats et de porteurs. La région des éleveurs lendu connut le même sort. Occupée militairement, elle fut ensuite laissée à l’abandon. En 1921, le territoire de Djungu, centre de la population lendu, n’était toujours pas administré de manière effective. On préconisa son occupation, pour permettre à la société des mines d’or de Kilo-Moto d’y effectuer des recrutements et des achats de vivres. Dans l’ensemble des campagnes congolaises après l’instauration des « circonscriptions indigènes », on nota des réactions violentes, en réaction au despotisme des nouveaux chefs et des capitas. Ce témoignage recueilli à l’Equateur par Mumbanza est suffisamment révélateur de la méchanceté insolente de ces auxiliaires :
… Dès que le chef arrive dans un village, tout le monde est obligé de se réunir chez le capita pour contribuer à l’«esanzo» ou «posa» [vivres à offrir au chef et à sa suite]. Un jour, une brave femme apporta un gros poisson… qui n’était pas encore bien fumé et dont elle n’avait pas encore remarqué les vers récemment déposés par les mouches. Les policiers qui accompagnaient le chef le firent remarquer au capita en le menaçant. On rechercha celui qui avait apporté le poisson et la pauvre femme se présenta. Le chef lui ordonna de brouter ce gros poisson avec écailles et arêtes et la femme le fit, en pleurant, jusqu’au bout. Ailleurs, continua le témoin, il s’agissait d’une grosse calebasse de vin de raphia dont le chef n’apprécia pas la saveur. L’homme qui l’avait apporté fut obligé de la vider d’un seul trait. Il le fit et, comme la calebasse contenait près de cinq litres, il vomit avant de la vider et tomba malade après (Mumbanza mwa Bawele. 1980 : 643).
La réaction populaire fut l’expression d’une rage, non seulement en tuant ces tyrans, mais parfois même en les dépeçant et en mangeant leur chair. Le pouvoir colonial réagissait par des expéditions punitives pour venger ses alliés.
D’autres groupes empruntèrent la voie des sectes et des associations secrètes pour exprimer leur désarroi face à la mutation qui passait pour être irréversible et donc sans issue. Généralement, on préconisait la purification, on prophétisait la fin du règne des Blancs, l’inutilité de l’école et des travaux imposés… puisque la résurrection prochaine des ancêtres allait enrichir tout le monde.
La célébrité de certains de ces mouvements tient sans doute à la richesse de leur symbolique. L’histoire de Maria Nkoi (Marie aux léopards) dans le pays ekonda est particulièrement éloquente, intégrant même les éléments de l’actualité de l’époque (1915), à savoir la guerre contre les Allemands. La voici. Suite à une expérience mystique, Marie reçut le pouvoir de guérir, annonça la libération prochaine du pays par les Germani (les Allemands) ; ses fidèles entrèrent en conflit avec l’administration et les chefs. Arrêtée, elle fut emprisonnée, tandis que la répression s’abattait sur le pays (Vellut J.L., 1975 : 37).
Plus saisissante encore est l’histoire de la société Anioto, des hommes-léopards, dans la région de Bali du Haut-Aruwimi. C’était une sorte d’empire terroriste. Le caractère apparemment incompréhensible des assassinats opérés par des hommes- léopards fut la preuve de l’existence de profondes dissensions internes entre les « durs » et ceux qui étaient accommodants vis-à-vis de la colonisation. On n’est toujours pas arrivé à justifier ce comportement (Bouccin R., 1936 : 185-192, 221- 226, 252-258 ; Joset P.E., 1955 ; Van Geluwe H., 1960 : 83-88). On aurait pu douter de la revendication de ces assassinats. Mais les faits sont clairs. Une enquête entamée en 1910 déboucha en 1920 sur plusieurs arrestations. Plus tard, de nouvelles vagues d’assassinats se suivirent en 1929-30, en 1932 et en 1933-35 ; on enregistra 22 meurtres pour cette dernière période. D’autres régions furent affectées par ce phénomène, notamment les environs de Wamba, le pays de Budu ou la région des Nande occidentaux. Un cas concret : lors du procès du 19 février 1921 qui fit une dizaine de victimes à Bomili, l’un des accusés reconnut avoir perpétré plus de vingt meurtres. Sept autres accusés furent pendus à Stanleyville le 12 avril 1935 (Vellut J.L., 1987 : 38-39). Mais quel était le but de ces assassinats ? L’opinion populaire pense que les hommes-léopards étaient des collaborateurs des Européens anthropophages à qui ils livraient leurs victimes pour être consommées (Verhaegen B., 1983 : 487). Nous pensons que la vérité est l’inverse de cette opinion, étant donné le caractère antieuropéen du mouvement. Le but principal fut probablement de réagir contre l’influence de l’Européen, de contrecarrer la pénétration de la nouvelle civilisation et de l’autorité du Blanc, considérées comme causes principales de la déchéance de l’ordre ancien : féticheurs, chefs arabisés et trafiquants d’esclaves (Vellut J.L., 1987 : 38-40).
Plus tard, le système des cultures obligatoires provoqua deux réactions violentes. L’une en région cotonnière et l’autre dans la région huilière. La première a éclaté en 1931 dans la région de Ndengese, aux confins des provinces de l’Equateur et du Congo-Kasaï. Le mouvement isola les Européens à Dekese, bloqua les routes, tout en détruisant les cultures de coton. L’obligation de cultiver le coton et les brutalités des agents chargés de cette imposition s’ajoutaient à un alourdissement du taux de l’impôt (Turner T.W., 1971 : 60-84).
Même scénario, en plus grave, dans le Kwilu en pays pende, région qui échappait, un peu à l’époque, au contrôle de l’administration et de la justice. Ceux qui y passaient imposaient leurs lois sans autre forme de procès : les commerçants acheteurs de noix de palme, les recruteurs pour les palmeraies des HCB situées plus au nord, les agents administratifs en tournée complaisants. Le taux de l’impôt trop élevé par rapport au revenu réel, suivant les estimations de l’époque, constituait une autre source de mécontentement. Le règlement de l’impôt équivalait environ à 1 500 kg de noix de palme. La révolte qui éclata en 1932 fut l’une des plus violentes qu’ait enregistrées la période coloniale. Elle entraîna une répression « exemplaire » qui fit plus de 400 victimes rien qu’au cours de la campagne militaire, tant la révolte s’était répandue dans tout le territoire de Kandale. Elle s’y organisa autour d’un mouvement religieux où l’on retrouve nombre de recettes déjà familières : distribution de charmes, retour des ancêtres, annonce d’un temps d’abondance (Nicolai H., 1963 : 313-327 ; Mulambu Mvuluya, 1971 ; Sikitele G., 1986 : 3 vol.).
Dans les milieux urbains, le phénomène de grève fut caractéristique de deux régions où s’était formé depuis le début du siècle un prolétariat ouvrier. Il s’agit du Bas-Congo et du Haut-Katanga. Les premières grèves éclatèrent parmi les employés et ouvriers européens. Ce n’est que par la suite que les Congolais suivirent l’exemple pour exprimer leurs propres revendications. L’origine de cette histoire syndicale se situa au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1920, en effet, éclatent la grève des employés européens de la fonction publique et celle des ouvriers blancs de l’Union minière. Ils en retirèrent le privilège de se syndiquer. L’AFAC, Association des Fonctionnaires et Agents de la Colonie, fut ainsi reconnue par le décret du 23 mars 1921, qui précisa toutefois que ce privilège ne concernait pas « les indigènes et les gens de couleur » (Mutumba M., 1977 : 46 : Jewsiewicki B., 1976 : 57-66 ; Daye P., 1943 : 16-18).
Les premières réactions du genre de la part des Congolais eurent lieu dans le Bas-Congo, dans les milieux des marins et des dockers. Les marins constituent une catégorie professionnelle insaisissable en raison même de leur mobilité. C’est en 1908 que la Compagnie Maritime Belge du Congo commença à faire appel à des marins africains parce que, estimait-on, ils étaient les plus adaptés à la température infernale des chaudières et à la chaleur intense du climat tropical. Sierra-léonnais pour la plupart, ils furent remplacés à partir de 1910 par des Congolais, spécialement des Basolongo de Banana et des Bangala. Par la suite, le recrutement fut plus diversifié à tel point qu’en 1935, on dénombrait parmi les marins, 41 % provenant du Bas-Congo actuel, 27 % de l’Equateur, 18 % de la province orientale, 7 % du Kasaï et le reste de l’Angola et des autres coins du pays (Sabakinu K., 1981 : 588). Chez les marins, la conscience du groupe est généralement solide, raffermie par des semaines voire des mois d’isolement commun et par leur marginalisation par rapport à l’ensemble des autres groupes sociaux implantés sur la terre ferme.
Une première grève des marins africains éclata à bord de l’Anversville en mars 1930 ; une deuxième survint à bord du Léopoldville, d’abord à Matadi (en avril) puis à Anvers, dans la nuit du 20 au 21 mai 1930 ; une troisième et une quatrième eurent lieu respectivement à bord de l’Albertville et du Thysville, en septembre 1934 et juin 1935. La sévérité avec laquelle ce mouvement fut réprimé constitue un signe de son importance : les sanctions infligées furent le licenciement, la prison et la relégation. Les causes du mouvement furent le rejet d’un règlement qui les privait de tout contact avec tout milieu extérieur au leur (à Anvers principalement) mais surtout la détérioration de leurs conditions sociales, accentuée par les effets de la grande crise (Sabakinu K., 1981 : 495-508).
Tableau 15 — Troubles sociaux dans le Bas-Congo en 1945
| DATES | LIEUX ET MESURE DES TROUBLES |
| 15 septembre | grève à Cattier et menace de grève à Thysville |
| 9 novembre | grève à Thysville |
| 22 novembre | grève à Léopoldville : 5 à 6 000 participants |
| 22 novembre | grève et émeutes à Matadi : 1 500 participants ; incidents à Lufu et à Songololo |
| 27 novembre | grève et incidents à Cattier |
| 27-30 novembre | menace de grève à Borna |
| 29 novembre | grève à Moerbeke : 3 000 participants |
| 30 novembre | menace de grève à Banana |
| 2-4 décembre | grèves et menaces de grève dans diverses entreprises et exploitations agricoles au nord de Borna |
| – décembre | menaces de grève à Lukula, grève à Kimwenza |
(Sources : Jewsiewicki B., Kilala L. et Vellut J.L., 1973 :156)
Ces revendications ne manquèrent pas de gagner l’ensemble de la région et d’autres milieux ouvriers, surtout à partir des années 40. Pour la seule année 45, on enregistra dans le Bas-Congo pas moins d’une dizaine de grèves ayant pour thème des revendications sociales, particulièrement d’ordre salarial (Jewsiewicki B., Kilala L., Vellut J.L., 1973 : 155-188).
De l’autre côté du pays, dans le Haut-Katanga industriel, la situation n’était guère plus rassurante. Là aussi, les troubles sociaux acquirent une ampleur insoupçonnée à partir des années 40. L’événement le plus marquant et le plus tragique de l’époque, ce furent les grèves de 1941 au Katanga. En novembre, à Manono, un millier de grévistes protestèrent contre le licenciement des travailleurs de la Géomines. Le 4 décembre, les travailleurs de l’Union Minière, peu après une grève des ouvriers européens, réclamèrent à leur tour une augmentation des salaires. Quelle augmentation ? Un « diaya » (demi-franc ou cinquante centimes). L’Union Minière, que les travailleurs appelaient Tshanga-Tshanga, c’est-à-dire l’instance qui pratiquait des brassages ethniques (« kutshanga » en ciluba signifie « brasser »), ne se décida pas à la leur accorder. Des velléités de grève, immédiatement enrayées, furent signalées dans la plupart des camps : Panda et Shituru (2 décembre), Luisha (8 décembre), Kambove et Kipushi (9 décembre). C’est à Lubumbashi (8 décembre) qu’éclata le plus grave incident. Une foule nombreuse se donna rendez-vous à la plaine de football et le gouverneur de la province ne parvint pas à la faire disperser. Cédant à un mouvement de panique, la troupe ouvrit le feu sur les manifestants. On déplora 40 à 60 morts et une centaine de blessés (Bakajika B., 1983 : 91-103 ; Mutamba M., 1977 : 60-61). Ce massacre marqua pour longtemps l’esprit des travailleurs de cette société. Une peur viscérale s’empara d’eux ; il n’y eut plus jamais d’aussi grandes grèves jusqu’à la fin de la période coloniale. Toutefois, d’autres grèves relatives aux augmentations de salaires furent signalées ailleurs, notamment à Matadi, à Léopoldville, le long du chemin de fer reliant les deux villes.
Les mutineries militaires, malgré la répression des Bauni, ne furent pas complètement supprimées. Bien au contraire, la garnison de Luluabourg réédita ses exploits en une seconde mutinerie de la « Force publique ». Le soulèvement eut lieu le 20 juin 1944. A l’origine de ce mouvement, il y avait la tension entre les milieux coloniaux et les combattants noirs revenus des campagnes en Ethiopie, en Egypte et au Moyen-Orient. Ces derniers étaient déçus et mécontents de se voir moins bien traités que pendant les campagnes ; le pouvoir public, de son côté, estimait que ces contingents avaient acquis une certaine indiscipline à l’étranger. Dans les garnisons du Katanga, le bruit courut que les officiers européens se préparaient à éliminer ces troupes, sous le couvert de séances de vaccination organisées. Les anciens combattants se préparaient à réagir mais le mouvement fut écrasé avant même d’éclater, les autorités coloniales ayant été informées des préparatifs insurrectionnels.
A Luluabourg, le mouvement put avoir lieu. Les insurgés furent dirigés par le premier sergent-major Ngoyi Mukalamushi, à qui la légende prête ce mot : « Quand on est déjà mort, peut-on avoir encore peur de mourir ? » (Mutumba M., 1977 : 49- 51). La colonne se mit en marche vers le Kasaï oriental pour joindre le Katanga et le Kivu. Elle coupa le chemin de fer du BCK (Elisabethville-Port-Franqui), se gonflant tout le long du parcours de porteurs et d’aventuriers, puis elle se disloqua en petits groupes qui furent l’un après l’autre capturés par le pouvoir colonial. La répression suivit : pendaison, fusillade, relégation, etc.
Tirant la leçon de ces incidents, la Force publique s’efforça d’améliorer l’adaptation des officiers blancs à la mentalité bantu. Les idées de P. Tempels furent mises à contribution et trouvèrent une implication pratique. On veilla aussi à « soigner » les anciens combattants pour qu’ils ne deviennent pas les agents de la subversion. Ceux qui n’avaient pas terminé leur service de sept ans furent affectés ailleurs que dans leur région d’origine. Dans les centres urbains, des cercles d’études furent organisés pour les soldats. Certains gradés se virent confier la charge honorifique de chef de cité : le premier sergent-major Henri Bongolo à Léopoldville et le premier sergent- major Michel Mbavu-Ndogo à Costermansville. Ceux qui réintégrèrent le monde rural furent regroupés pour être contrôlés. On créa pour eux des villages » artificiels » où ils continuèrent à bénéficier de la distribution des vivres (Mutamba M., 1977 : 52-53).
Il reste à parler des réactions messianiques. Les « créations messianiques » constituent une forme de réaction caractéristique des populations qui connaissent de grands problèmes de survie. Le Congo colonial semble être le reflet de cette vérité toute simple. On a vu comment les velléités de renouveau politique au royaume Kongo avaient déjà emprunté cette forme. Plus récemment, les réactions en milieu rural avaient recours à des recettes « messianiques », faisant usage de charmes, garantissant la défaite de l’envahisseur et le retour à la liberté et à l’abondance. S’agissait-il d’un besoin de libération dans l’imaginaire, à défaut de libération réelle ? Affirmons d’emblée que le cas du kimbanguisme et du kitawala est plus complexe. En effet, ces sectes constituent aussi la variante d’un christianisme voulu « classique » par le missionnaire et le pasteur, mais qui, dans les faits, s’est toujours traduit par un code et un langage ambigus. Le Congolais y a imprimé sa propre vision du monde et inscrit sa propre lecture du message sacré.
On constatera que les religions syncrétiques trouvèrent un asile privilégié dans les milieux protestants, là où l’orthodoxie, déjà peu rigoureuse au départ, était ouverte aux interprétations nombreuses, différentes et divergentes. Elles tirèrent parti également de la coexistence du catholicisme et du protestantisme, érigeant leurs spécificités sur cette zone intermédiaire où le rituel nouveau a tout loisir de puiser dans l’une et l’autre tradition. Ainsi les « prophètes » furent soit des anciens protestants, soit encore des chrétiens qui furent à la fois catholiques et protestants.
Que la première « terre sainte » du Congo ait été le Bas-Congo, cela n’a rien d’étonnant puisque cette région abrite la plus vieille chrétienté du pays véhiculant des « ambiguïtés » religieuses depuis des siècles, au point même d’avoir vécu l’expérience des sectes au XVIIIe siècle [37].
Le kimbanguisme a été le fait d’un homme, d’un prophète : Simon Kimbangu [38]. Né à Nkamba, à quelques kilomètres de la mission de Ngombe-Lutete de la B..M.S., vraisemblablement en septembre 1889, ancien boy du missionnaire, il devint catéchiste dans son village natal après avoir exercé quelques petits métiers à Kinshasa et à Matadi [39]. Son histoire extraordinaire commença le 18 mars 1921, d’après le témoignage qu’il fit lui-même à un ami. Kimbangu vit en songe un étranger qui lui apportait la Bible, lui recommandant de la lire et de prêcher ; il lui demanda de se rendre dans le village voisin où se trouvait un enfant malade afin de prier pour lui et de le guérir. Il s’exécuta le lendemain, trouva effectivement un enfant malade et il pria pour lui. L’enfant fut guéri. Ce fut le début de tout. Kimbangu se mit à sillonner les villages pour apporter la Bonne Nouvelle et guérir des malades. A ce stade de son action, il reçut même les encouragements des missionnaires protestants, fascinés par la vigueur de son enseignement qui réussissait si bien, même sur le terrain où l’évangélisation « classique » protestante et catholique ne récoltait que de maigres fruits. Mais très vite, le succès du prophète prit des proportions inattendues. La nouvelle se répandit et amena une foule de plus en plus nombreuse de pèlerins et de malades à guérir. Dès mai 1921, environ quatre mille pèlerins devaient chaque jour trouver un logement à Nkamba ou aux environs. Kimbangu guérit les malades mais continua à enseigner aussi, condamnant le fétichisme et la polygamie. Les statuettes anciennes furent abandonnées de même que les médailles. Très rapidement, les catéchuménats catholiques et protestants comme les hôpitaux et les dispensaires, furent désertés au profit de Nkamba. Bientôt, les entreprises se retrouvèrent vidées de leur personnel (Chômé J., 1959 : 5-6).
Lorsqu’on nota les premiers indices de désobéissance civile, le pouvoir colonial eut un prétexte pour lancer contre Kimbangu le mandat d’arrêt que les Pères Rédemptoristes réclamaient depuis longtemps. Réfugié dans la clandestinité, il demeura pendant trois mois, au nez et à la barbe de l’administration, à un endroit certainement connu par ses milliers de fidèles. C’est au cours de cet épisode que le mouvement se teinta de xénophobie et d’hostilité à la colonisation. Le prophète annonça la venue imminente du Christ qui renverserait le pouvoir des Blancs. En attendant, il fallait refuser de payer l’impôt et de se soumettre aux cultures obligatoires. Finalement, au cours du mois de septembre, il se livra lui-même. Son arrestation, son procès à Thysville et sa condamnation furent aux yeux de ses adeptes comme la comparution du Christ devant Ponce-Pilate. Il eut en effet à affronter un tribunal militaire tendancieux, sans l’appui d’un avocat. Il est intéressant de prendre connaissance de l’acte même du jugement. Il situe les motifs de la condamnation et la vision résolument négative que le pouvoir colonial avait de Kimbangu.
Héritage ancien et colonisation
|
Femme ngbandi travaillant la poterie |
Le Mwant (yav) Lunda ; Sandoa, Shaba, |
|
Femme tatouée |
Exemples d’industries lithiques du Congo : 1-3 : outils bifaces étroits à bords plus ou moins parallèles, 1. Mulundu et 2. Kamabunda, Kasai occidental, 3. Tumbas, Bas-Congo • 4-5 : hache polies du Nord Congo <p « >• 6 : nucléus, Kamiji, Kasai <p « >• 7 : pointe de flèche pédonculée • 8 : petit tranchet du plateau Bateke © Musée Royal de l’Afrique Centrale Dessin : Yvette Paquay |
Tombe de femme Kisalien classique,
12e siècle, Sanga, Katanga
© Pierre de Maret
Trois itinéraires au service du Congo : Pierre Ryckmans (accroupi) gouverneur général du Congo-Belge pendant la deuxième guerre mondiale, André Ryckmans, son fils (assis) administrateur de territoire aux idées progressistes qui mourra assassiné sur le pont d’Inkisi en 1959, François Ryckmans (bébé), son petit-fils, journaliste RTBFsouvent en reportage au Congo au cours des années 90.
© J. P. Ryckmans
|
Pose de la première pierre du tout premier bâtiment de l’université Lovanium de Kinshasa
|
|
Une vue du mémorial de H. M. Stanley érigé au Mont Stanley (Ngaliema) en 1956. |
Jugement du Conseil de Guerre de Thysville
Audience publique du 3 octobre 1921
En cause : Ministère public contre : Kimbangu et consorts
Vu par le Conseil de Guerre siégeant à Thysville, région soumise au régime militaire mitigé par Ordonnance n° 89 en date du 12 août 192, du vice- gouverneur général de la province du Congo-Kasaï, la procédure à charge des prévenus Kibango Simon, Mandombe, Zolla, Matufueni Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philémon, Matta, M’Baki André, Kelani John, Batoba Samisioni, Batoba David, Maleaka Sesteni.
Prévenu d’avoir porté atteinte à la sûreté de l’Etat et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Vuabela, prévenus de ladite infraction,
Vu l’assignation des prévenus à la requête de l’officier du Ministère public en date du 28 septembre 1921,
Ouï le Ministère public en ses réquisitions,
Ouï les prévenus en leurs dires et moyens de défense présentés par eux- mêmes,
Le Conseil de Guerre
Attendu qu’il est établi que le 11 mai 1921, au village de Nkamba, l’administrateur du territoire des cataractes sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d’indigènes qui y étaient réunis.
Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l’arrestation du prophète en chef Kibango, y fut violemment attaqué par la foule et que deux de ses soldats y furent blessés à coup de pierres et de couteaux.
Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l’Etat.
Attendu que le nommé Kibango, en répandant et en faisant répandre sciemment de faux bruits de guérisons et de résurrections et en se posant en envoyé de Dieu jeta l’alarme dans l’esprit des populations indigènes, que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique.
Attendu que Kibango est parvenu, en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu’il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances de guérisseur d’hommes et d’envoyé de Dieu, dans son village et ailleurs ; que c’est pendant ces séances qu’on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu’on les a excités contre les pouvoirs établis.
Attendu que Kibango a été reconnu par les médecins sain de corps et d’esprit et par conséquent responsable de tous ses actes, que ses crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu’il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d’instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l’autorité de l’Etat.
Attendu qu’il demeure établi par les faits que Kibango, malgré la défense de l’autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu’un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l’Etat même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibango, Mfumu Simon, Mvuluzi, qu’un temple nouveau, Eglise nationale noire, allait être fondée. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée organisée pour porter atteinte à la sûreté de l’Etat, secte cachée sous le voile d’une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n’est qu’un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme, doivent souvent servir d’instrument pour atteindre le but final.
Attendu qu’il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l’objet d’une haine profonde de la part des adeptes de Kibango, que cette haine s’est infiltrée et s’est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu’il est indéniable que la doctrine de Kibango a été cause d’une grève manquée, d’abstention au travail d’un grand nombre de travailleurs.
Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l’impuissance de l’Etat contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge, que s’il est vrai que l’hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu’à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rebellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu’il convient d’apprécier toute la gravité de l’infraction et d’intervenir en appliquant sévèrement la Loi.
Attendu que la nommée Mandombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par ce fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes.
Que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lumbende Johan qui a hébergé à Sanda les prophètes et la suite de Kibango, tout en les sachant activement recherchés par l’autorité, mais que l’exemple lui a été donné par le chef même du village et le chef médaillé.
Le Conseil de Guerre,
Vu les articles 7ôter du Code pénal, livre 2 et 101ter du Code pénal, livre 1,
Vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire.
Condamnons Simon Kibango à la peine de mort. Zolla, Matfweni, Lenge, Sumbu Simon, Mimba, Philmon Matta, M’baki André, Kelani John, Batoba Samisioni, Batoba David, Malaeka Sesteni, à la servitude pénale à perpétuité.
Bemba et Dongo Vuabela à vingt ans de servitude pénale. Lumbuenda Johan à cinq ans et Mandombe à deux ans de servitude pénale et les frais du procès à charge de la colonie.
Et attendu qu’il g a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l’exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du trois octobre où siégeaient MM. de Rossi, Juge ; Dupuis, Ministère public ; Berrewaerts, Greffier.
(Chômé J., 1959 : 66-71).
Dans les rangs des colons, fort heureusement, il n’y avait pas unanimité. Certains réclamèrent par la suite la révision du procès (Vellut J.L., 1987 : 45-52). Toujours est-il que le recours en grâce introduit par l’administration civile et les missionnaires baptistes fut accordé par le ministre Franck. En novembre 1921, le roi Albert commua la sentence de mort en peine d’emprisonnement à vie.
Le prophète fut transféré à Stanleyville et de là à Elisabethville, accueilli tout au long de son voyage par des foules de sympathisants. A la prison d’Elisabethville, le prophète passa une trentaine d’années avant de mourir en 1951.
L’arrestation de Kimbangu ne mit pas fin au mouvement qui s’implanta profondément dans le Bas-Congo, particulièrement dans les régions sous l’influence des missionnaires baptistes. Entre-temps, il s’était donné une allure nettement plus politique. Kimbangu était le prophète des Noirs venu pour les délivrer. Lorsque tous ces Noirs auraient adhéré au mouvement, les Blancs seraient écrasés ; il n’y aurait plus d’impôts et toutes les richesses seraient aux mains des nationaux.
La répression, quant à elle, n’était pas prête non plus à désarmer. Bien au contraire. Après une période de tolérance, elle se fit plus vive à partir de 1925, notamment sous la pression des missions catholiques. Dès 1924, des milliers de personnes manifestèrent à Thysville contre l’emprisonnement de plusieurs disciples de Kimbangu (Young C., 1965 : 147). Plusieurs furent arrêtés ou relégués dans le Kasaï-Lukenye (Munayi M.M., 1977 : 555-573) et de là en Equateur (Kuama M.M., 1974 : 95), et dans le Haut-Congo (MacGaffey W., 1982 : 381-394). Ces dispositions réussirent tout juste à assurer l’expansion du kimbanguisme dans ces régions.
Pendant ce temps, sur son terrain initial, le kimbanguisme se ramifiait. En 1935, des missionnaires de l’Armée du Salut furent accueillis au Congo comme des réincarnations blanches de kimbanguistes morts. On pensait, en effet, que l’initiale « S » sur le revers du col de leur veste blanche signifiait « Simon ». L’Armée du Salut hérita de ce succès ambigu. En 1939, un sergent de village de l’Armée du Salut, Simon Mpadi, se présenta comme successeur de Kimbangu et donna naissance à une nouvelle forme messianique, « Nzambi ya Sika Sika ». C’était l’avènement du kakisme (ainsi appelé à cause de la couleur kaki de l’uniforme des salutistes) connu également sous l’appellation de la Mission des Noirs. Ce mouvement, qui était en réalité une scission au sein de l’Armée du Salut, rassembla rapidement plusieurs milliers de fidèles dans la région du nord de Madimba. Le kimbanguisme, qui s’était réfugié dans la clandestinité, connut une vigueur nouvelle et prit une tournure politique, rompant complètement avec les Eglises coloniales mais aussi avec les pratiques traditionnelles. Mpadi fut arrêté. Relégué à Befale, en Equateur, en 1940, il adressa à ses fidèles cette lettre (qui fut saisie) et dont les termes trahissent l’engagement politique de son action :
Ce que nous voyons n’est que le début de la guerre du Congo […] Ceux qui viendront, ceux-là combattront et vaincront et prendront ce pays du Congo pour le tenir. Ces rois qui sont étrangers […] sont consacrés par Dieu pour la guerre et la victoire ; de même qu’il a vaincu en Europe, ainsi aussi Dieu le fera vaincre ici au Congo […]. Quand ce roi étranger aura pris le Congo, il donnera le moyen aux Noirs qui sont en Amérique de revenir dans le pays qui est le leur, le pays du Congo. Les Américains seront ramenés dans ce pays du Congo par le règne du roi allemand… (cité par Vellut J.L., 1987 :53).
Tout y est : référence à un avenir meilleur, rendu possible entre autres par l’intervention des Noirs américains qu’on connaît à présent grâce à la guerre mondiale. A plus d’une reprise, on a pu remarquer l’espoir d’une victoire allemande sur la Belgique colonialiste ; les adeptes du mouvement ignoraient que l’Allemagne elle-même avait eu des colonies et qu’elle n’avait pas eu une attitude plus conciliante à l’égard des populations colonisées.
Il est à noter que jusqu’à la fin du régime colonial, les mouvements prophétiques kongo ne se constituèrent guère en Eglise. Ce statut juridique fut adopté après la décolonisation, à la faveur de la création de nouvelles structures. Il fut l’œuvre du successeur de Kimbangu, son propre fils, Joseph Diangenda. Déjà lors la dernière décennie coloniale, celui-ci parvint à ramener le kimbanguisme à son objectif premier, celui de la religion. Dans cette optique, en 1956-57 il réunit un grand nombre de sectes kimbanguistes sous l’appellation unique d’Eglise de Jésus Christ sur la terre par le Prophète S. Kimbangu. La « Mission des Noirs en Afrique centrale » continua toutefois à évoluer comme une entité distincte. En 1960, le 6 avril, le kimbanguisme obtint la personnalité civile. Une décennie plus tard, il se fit accréditer comme l’un des membres du Conseil mondial des Eglises à Genève. Simon Kimbangu fut enfin reconnu sur le plan mondial comme fondateur d’Eglise.
Le kitawala connut un cheminement semblable [40]. C’est à l’autre extrémité du pays, au Katanga, qu’il amorça son action politico-religieuse. A la différence du kimbanguisme, il ne s’agissait pas d’une création originale mais plutôt d’un prolongement et même d’une excroissance du mouvement Watch-Tower, mouvement qui, à partir de 1934, adoptera l’appellation de Jéhovah ’s Witness (Témoins de Jéhovah). La filiation entre le Watch Tower et le kitawala s’inscrivit dans la sémantique. En effet, kitawala n’est rien d’autre que la déformation du mot « Tower », finale de « Watch Tower ». Le mot fut prononcé « Tower » puis il devint ki-tower (enrichi du préfixe de la classe des choses) puis kitawala (citawala en ciluba). Le mot trouva en swahili une analogie heureuse avec le verbe « kutawala » qui signifie « dominer », « diriger » mais aussi « s’éveiller », « voir clair » après une longue cécité (Gérard J., 1969 : 9-10) [41] ; les deux acceptions seront exploitées par les tenants du mouvement. Le kitawala fut compris non seulement comme une instance d’éveil (des Noirs) mais aussi comme synonyme de « règne », « avènement » (sous-entendu « de Dieu »). Cette dernière interprétation correspondait à la « promesse » qui aurait été faite à la Watch Tower quelle dirigerait le monde…
C’est aux Etats-Unis, plus précisément dans l’est de la Pennsylvanie, vers les années 1870, que naquit la Watch-Tower ; elle s’introduisit en Rhodésie du Sud en 1897, par l’entremise d’un pasteur sud-africain, le Révérend Mukoni, qui revenait de ce pays où il avait effectué des études religieuses. A partir des Rhodésies et du Tanganyika, le kitawala s’infiltra au Katanga. On ne peut dater avec précision le début de ces infiltrations ; on sait qu’elles furent déjà agissantes vers 1922 et que ce phénomène se poursuivit progressivement jusqu’en 1925, sans éveiller l’attention du pouvoir colonial. Le courant venant de la Zambie actuelle se répandit assez rapidement chez les Lamba, les Lala, les Bemba et les Baushi. Celui d’origine orientale intéressa au premier chef les Luba.
En 1925, le mouvement rompit avec la clandestinité, avec l’arrivée de Tomo Nyrenda, alias Mwana Lésa. Ce personnage venait de Rhodésie où il avait déjà créé une secte au sein du kitawala, porteuse d’idées fort radicales. Il s’agit de la secte des Baptiseurs. Ce « fils de Dieu » (c’était la signification de son nom Mwana Lésa) n’a pu mener une longue carrière. A cause d’une cérémonie de baptême par immersion totale qui provoqua la noyade d’un grand nombre d’adeptes, il fut déporté en Rhodésie du Nord où il fut pendu en 1926. Le mouvement n’en continua pas moins à éveiller l’attention du pouvoir colonial qui devint vigilant à l’égard de toutes les infiltrations qui s’en réclamaient. Il mit sur pied une organisation – le Comité secret – présidée par le gouverneur de province lui-même, ayant pour but de faire face à toute menée subversive. En 1937, le gouverneur du Katanga préféra interdire le kitawala sur toute l’étendue de sa province. Mais quelle était l’efficacité de toutes ces mesures sur cette secte qui ne s’étendait que dans la clandestinité ? Sa doctrine la prédisposait à une plus grande implication politique. En effet, contrairement au kimbanguisme, elle ne procédait pas d’une révélation divine mais plutôt d’un conditionnement moral et psychologique et d’une lecture « orientée » de la Bible. La secte ne s’adressait qu’aux Noirs et faisait intervenir dans ses prédications le règne de la violence divine pour obtenir le retournement de la situation contemporaine, injuste et misérable. A cet égard, les principaux thèmes enseignés étaient les suivants. Le premier prônait l’égalité des races entre Blancs et Noirs. On ne classe pas les vaches d’après la couleur de leur peau, disaient-ils. Le deuxième annonçait le retournement prochain de la situation vécue : l’évincement des pouvoirs établis, la soumission des Blancs aux Noirs, la possession des richesses détenues par les occupants étrangers qui tiennent leur pouvoir de Satan. Cette idée avait son fondement dans l’attente d’un paradis qui suivrait l’ultime bataille entre Dieu et Satan. Le troisième enfin, corollaire du précédent, enjoignait, dans l’attente du règne de Dieu, de ne pas écouter les ordres des Blancs ni leurs enseignements. Les missionnaires étaient considérés comme de grands menteurs qui dissimulaient ou déformaient délibérément les vérités publiques. Et pour cause : Jésus, avant de mourir crucifié, aurait enseigné la nouvelle religion – le kitawala – insistant sur la condition malheureuse des Noirs et l’hypocrisie des Blancs. La rumeur fondée sur l’occupation possible du Congo par les Aluma (Allemands) les encourageait à réagir violemment à l’oppression coloniale en affirmant vigoureusement qu’ils croyaient que plusieurs forces étrangères salvatrices allaient venir. (Bernard G., 1970 : 207). Parmi celles-ci, les Noirs américains venaient en tête. Leur retour en Afrique était attendu fermement par les kitawalistes pour la libération de l’Afrique noire – comme pour le reste de l’Afrique. Le monde noir-américain apparaissait comme un symbole de liberté, notamment dans le sillage des idées de Marcus Garvey, comme on verra plus loin.
Jusqu’en 1950 environ, le kitawala fut une mystique d’action politique et révolutionnaire. Ce n’est pratiquement qu’au cours de la dernière décennie coloniale qu’il développa un aspect strictement religieux, sans renoncer toutefois à son caractère anticolonial. Pendant l’époque militante, la clandestinité était de règle. Les réunions se tenaient la nuit, dans des endroits cachés ou en forêt. Les adeptes étaient tenus de dissimuler leur véritable identité. Le baptême se réalisait par immersion, dans une rivière située à l’écart du village. On baptisait avec des noms purement africains et la cérémonie constituait une sorte d’engagement à lutter contre les Blancs et à garder le secret absolu (Anyenyola W., 1972 : 9-24).
Le pouvoir colonial se rendit tout de suite compte qu’une simple interdiction n’aurait aucun effet. Les arrestations ne changèrent pas les choses. Complètement désemparée, l’administration coloniale, après avoir interdit partiellement le kitawala au Katanga (1937), en Province Orientale (1943), au Kivu (1944), à l’Equateur (1946) et à Léopoldville (1948), fut obligée d’étendre la mesure à tout le territoire du Congo belge ; toute activité de l’association Watch Tower, quelle que fût la dénomination sous laquelle elle se manifestait, fut proscrite. En prenant cette mesure, le pouvoir colonial annulait lui-même son action car c’est lui-même qui assura l’expansion du kitawala dans le Katanga et au-delà. En effet, cette expansion, comme pour le cas du kimbanguisme, tira profit de la relégation qui fut gérée au sein du mouvement comme un envoi de missionnaires au loin, dans les terres inconnues et « incultes » [42].
Précisons que la relégation fut une mesure conçue en application du décret du 5 juillet 1910 sur le droit de résidence. Elle portait sur deux types de délits : celui relatif à des antécédents judiciaires – cas plutôt rare – et celui portant sur les délits politiques. Comme ces faits étaient les plus courants, la relégation fut ressentie comme la « prison politique » coloniale. Son existence était antérieure à l’apparition du kimbanguisme et du kitawala : en effet, les premières victimes furent les chefs traditionnels qui s’opposèrent à la pénétration coloniale et qui lui menèrent une lutte active. Parmi ceux-ci, il faut citer Kasongo Niembo, qui fut relégué le 20 septembre 1917 dans la province orientale, le chef Yugu de Banza, qui le fut à Basankusu le 15 mai 1918, Mukelenge à Opala le 18 avril 1918 et Mayambo à Basongo, en 1917 (Numbi W.K., 1983 : 36). On disait d’eux qu’ils avaient porté atteinte à la sûreté de l’Etat.
En principe, la décision de la relégation revenait au gouvernement général sur demande du gouverneur de province ; mais dans la pratique, nombreux furent les cas où le CDD et le gouverneur de province s’arrogèrent ce pouvoir. La relégation était en tout cas une mesure administrative sans rapport avec les instances judiciaires en place et qui frappait tout indigène dont la conduite compromettait la tranquillité publique. Ces mesures d’éloignement étaient comprises comme une « rééducation » dans un milieu différent. Voilà pourquoi il existait deux types de relégation : en milieu d’origine et au loin. Pour revenir au kitawala, étaient relégués dans leur « milieu d’origine » les adeptes qui avaient joué un certain rôle dans le mouvement et dont la récupération était considérée comme encore possible. Chez eux, ils étaient confinés dans des lieux de résidence bien déterminés appelés « Centres d’amendement ». A l’intérieur de ces centres, ils jouissaient d’une certaine liberté car ils vivaient avec leur famille et s’adonnaient à leurs activités habituelles ; leurs déplacements étant limités, seules leurs conjointes pouvaient aller et venir à leur guise. C’est par elles que les relégués demeuraient en contact avec le mouvement et recevaient des livres ou d’autres documents relatifs à la doctrine. Certains kitawalistes jugés peu dangereux furent envoyés dans des missions catholiques pour leur conversion ou reconversion au christianisme « classique » tout en exécutant des travaux agricoles du type « travaux forcés » (Kikassa-Kabalo, 1973 : 58 ; Tshibangu K.M., 1972). Dans le même ordre d’idées, des camps de relégation furent construits dès 1937 à Baudouinville, à Mwanza et à Ankoro dans le district du Katanga ainsi que des colonies pénitentiaires à Malonga et à Kasaji dans le district de Lualaba. Les sympathisants, peu dangereux, furent acheminés à la mission de Baudouinville, notamment, et dans les régions de Sandoa et Dilolo. Le kitawala se répandit alors dans l’ensemble du Katanga.
La relégation au loin, en dehors de la région du Katanga, fut réservée aux propagandistes éprouvés et aux fondateurs de cellules. Il existait quatre principaux centres de relégations : Belingo, créé en 1937 en territoire d’Oshtue (province de Léopoldville), Kasaji, fondé la même année en territoire de Malonga (province du Katanga), Punia qui date de la même année en territoire de Lubutu (Province Orientale), Ekafela enfin, ouvert en 1944 dans le territoire de Befale en Equateur. Ces quatre centres furent également des colonies agricoles ; voilà pourquoi on les appelait « colonies agricoles pour relégués dangereux » (GARD).
Suivons l’extension de ce mouvement en Equateur et dans le Kivu-Haut-Congo, deux régions apparemment éloignées par rapport au Katanga où ce mouvement connut une progression aisée.
La première expansion hors du Katanga atteignit l’Equateur à Yakoma ; elle date de 1932, l’année où furent également transférés des relégués kimbanguistes provenant du lac Maindombe. De Yakoma, ces idées nouvelles se répandirent dans toute la région et atteignirent même le territoire de l’AEF ; à Banzyville, le kitawala fut connu aussi sous le nom de masakata, du nom des relégués kimbanguistes (d’ethnies sakata sans doute) qui y furent intégrés. Le mouvement prit de l’extension jusque chez les Ngombe et les Mongo. En 1941, on assista à la naissance d’une nouvelle secte kitawaliste, l’okitawala, qui s’implanta surtout à Befale et dans les environs. Mais la grande innovation de l’Equateur fut la création de la secte Kondima na kolinga en 1932-36 en tant que synthèse dynamique du kitawala et du kimbanguisme. Son fondateur fut un fils du pays, Ambrosius Bereti, originaire de Yakoma. Ancien clerc-vendeur à la NAHV, il constituait par lui-même un phénomène de symbiose. Catholique au départ, il devint catéchiste protestant de la mission baptiste norvégienne de Mongo ; de là, il fut endoctriné par les deux relégués kitawalistes venus du Katanga – Levy alias Simba et Shile Kateshi – et les kimbanguistes relégués eux aussi à Yakoma puis à Banzyville. Ensuite, le mouvement pseudo-religieux naissant n’eut aucun mal à recruter ses adhérents parmi les autres catéchistes dissidents et les chrétiens qui connaissaient Bereti et qui l’appréciaient. Sur le plan doctrinal, le mouvement procédait d’un enseignement libre des textes bibliques, sans immixtion ni contrôle des missionnaires européens qui, pensait-on « cachaient certaines vérités aux Noirs ». La doctrine était celle du kitawala avec une insistance plus particulière sur l’amour du prochain, dans un esprit du partage total qui n’excluait pas le « communisme des femmes », pour reprendre les termes de ses détracteurs. Avec de tels excès, le mouvement ne manqua pas d’adversaires et les candidats à la relégation n’en furent que plus nombreux, assurant l’expansion d’une certaine xénophobie politico-religieuse aux quatre coins du pays, spécialement vers le Congo oriental.
En Equateur, le centre de diffusion fut donc Yakoma. De là, il atteignit non seulement l’AEF mais aussi la Province Orientale. Il se diffusa aussi à Bosobolo, Banzyville, Bomboma et plus tard Lisala. Dans la Tshuapa, il se fortifia encore avec la création de plusieurs centres d’action : Boende, Bokungu, Befale, Basankusu, Ikela, Bongandanga. Ce district fut le plus touché par la prédication kitawaliste car plusieurs relégués y furent envoyés. On y trouvait aussi le CARD d’Ekafela dans le territoire de Befale. Ce CARD avait la réputation d’accueillir des relégués provenant de toutes les régions du pays : en 1945 on y comptait 113 relégués et en 1957, 204 : 8 de Léopoldville, 104 de l’Equateur, 6 de la Province Orientale, 22 du Kivu, 5 du Kasaï et 59 du Katanga (Kuama M.M., 1974 : 138-139). La colonisation offrait inconsciemment un cadre à l’éclosion d’idées nouvelles, généralement contestataires, qui se répandaient par l’entremise de ses prisons et camps spéciaux de relégation.
Au Kivu, les enseignements du kitawala provoquèrent des actes de violence. Cette doctrine atteignit la région de Lubutu en 1937 par le canal des kitawalistes du Katanga transférés à Boende et à Befale, et se répandit spécialement parmi les travailleurs des camps miniers du Comité national du Kivu.
Vers 1942, le mouvement prit de l’importance en particulier chez les Kumu et les travailleurs des mines (Biebuyck M., 1957 : 7-40). En 1943, on enregistra une nouvelle poussée du kitawala à Bafwansende, Masisi, Shabunda, Lowa et Kindu. En moins d’un an, 210 personnes furent internées, 103 au camp spécial de Faradje et 107 à la prison de Bafwansende (Mwene-Batende, 1982 : 142 ; Kwama M.M., 1974 : 71). En février-mars 1944 éclata la fameuse révolte de Masisi, menée par Bushiri et ses principaux collaborateurs : Alléluia, Mikaeli, Fwamba et Kichwama. A l’origine du mouvement, on trouvait le mécontentement dû aux impositions en caoutchouc. La suite s’exprima dans le langage du kitawala. Le nouveau « Jésus » arrêta le travail dans les plantations. Trois Européens furent arrêtés et torturés. On réprima la révolte dans le sang, par l’intervention armée (Lovens M., 1974).
Le kitawala comme le kimbanguisme constituent deux défis qui ont ébranlé l’édifice colonial qui n’en vint pas à bout. Les camps de relégation se multiplièrent. Comme on l’a souligné, les pensionnaires les plus nombreux étaient ceux qui étaient internés pour des « raisons politiques ». En comparant les tableaux numériques des relégués que comptait la colonie entre 1932 et 1956, on se rend compte que leur nombre n’a fait que croître, preuve de l’existence d’une véritable tension au cours de cette période.
Tableau 16 — Relégués (1932-1956)
|
ANNÉES |
RELÉGUÉS POLITIQUES |
RELÉGUÉS JUDICIAIRES |
TOTAL |
|
1932 |
500 |
772 |
1272 |
|
1938 |
2030 |
907 |
2937 |
|
1944 |
2993 |
1902 |
4895 |
|
1956 |
3294 |
1844 |
5138 |
Source : Rapports aux Chambres 1932,1938,1944,1950,1956.
Les deux mouvements pourtant étaient différents. Le kitawala était plus expansif de par sa religiosité ambiguë, adaptable à toute circonstance pourvu qu’il serve à des fins anticoloniales. Il n’était pas lié à un groupe dominant. Quant au kimbanguisme, il avait davantage l’accent du terroir, né du génie d’un fils du pays qui, de toute évidence, n’avait pas eu le temps d’être inspiré par un quelconque mouvement extérieur. Sa carrière, on l’a vu, n’a duré qu’un an. Commencée en mars, elle s’acheva en octobre par son procès. Dans ces deux mouvements, c’est tout un mode de résistance, voire même de lutte contre le pouvoir colonial qu’il faut percevoir. En effet, le kimbanguisme et le kitawala ne furent pas des cas isolés. L’inventaire colonial signale l’existence d’une cinquantaine de mouvements « messianiques », dont l’Etat ordonna la dissolution pour les combattre (Gevaerts F., 1953 : 30-33). Sous une apparence d’homogénéité, la colonisation belge se caractérisait finalement par deux situations contradictoires. D’un côté, elle pouvait se vanter du statut de « colonie modèle » (Mbokolo E., 1990 : 9-40) de ses possessions d’outre-mer ; de l’autre, elle assistait à un sabotage de son action par des contradictions propres au système colonial, mais aussi par une contestation locale active dont on avait délibérément caché l’ampleur, pour éviter que des adversaires, réels ou présumés, saisissent ce prétexte pour arracher à la Belgique sa colonie. Ce sentiment de peur aura été permanent dans l’œuvre belge au Congo, depuis Léopold II jusqu’à la proclamation de l’Indépendance en 1960.
Texte : la légende des Mitumbula
On découvre, à la lecture des témoignages des coloniaux de l’époque, que la légende de Mitumbula était complexe et qu’elle mettait les Européens mal à l’aise. L’avait-on répandue de manière délibérée, pour semer la méfiance envers l’Européen, y compris le missionnaire, afin de le déstabiliser ? Il est intéressant de noter que ce “ mythe » faisait des « victimes » dans tous les rangs car les Blancs eux-mêmes étaient ébranlés. Elle aurait pu être exploitée comme une » arme » en vue de la décolonisation. Dans les extraits des lettres ci-dessous, on a respecté autant que possible le langage propre des auteurs.
I. Extrait d’une lettre datée du 25 septembre 1944 (n° 1024/R)
et adressée au chef de service des A.I.M.O.
« En ce qui concerne le Mitumbula, voici ce que j’en connais. Les Noirs croient qu’il y a des Blancs qui engagent des travailleurs secrets qui sont vêtus d’une longue robe – ceux-ci sont toujours munis d’une espèce de caoutchouc pour paralyser quelqu’un qu’ils veulent prendre – et que cela se fait surtout dans des grandes villes comme Elisabethville et qu’il y en a déjà à Luluabourg. Pour me convaincre, on m’a cité les faits suivants : il y avait quelqu’un à Elisabethville du territoire de Kanda- Kanda ; la femme de celui-ci s’était égarée en allant rendre visite à une connaissance ; son mari a attendu en vain son retour. Le lendemain, il n’a trouvé sur la route que les habits de sa femme, ce qui est un signe qu’on l’a déshabillée complètement. Cet indigène a tâché de savoir par des moyens secrets le Blanc qui engage les Batumbula et on lui a montré ce Blanc-là. La nuit il est allé le trouver et lui a dit : je voudrais aussi m’engager. Celui-ci tout étonné, lui demanda d’abord qui lui avait dit cela et il l’a engagé. Il fut alors initié à son tour et fut placé dans une maison souterraine où on garde les personnes qui sont arrêtées. Là, il vit beaucoup d’hommes et de femmes déformés ; ils avaient plutôt la formation de porc, la face devenue très grasse. Parmi eux il a vu sa femme qui ne savait plus parler ; ces personnages avaient perdu le langage. Puis la nuit il a volé sa femme et il est allé dire à son patron ce qui s’était passé et celui-là lui a dit qu’il doit partir d’Elisabethville avec sa femme en allant prendre le train à la gare suivante. A mon avis c’est une secte contre l’Européen ».
II. Extrait d’une lettre datée de Tshimbulu le 12 janvier 1945
et adressée au responsable de la Sûreté à Luluabourg
« … Voici ce qui se passe dans notre région. Il n’est question que de ‘Mitumbula’ c’est-à-dire ‘le mangeur d’homme’. (…), le boucher et moi-même sommes désignés comme ‘Mutumbula’. Les indigènes, quand ils doivent passer le soir en face de chez moi, filent au plus vite qu’ils le peuvent ; ils prétendent que je circule, le soir, entre ma maison et le passage à niveau, pour y attraper des hommes et les tuer. Je donne beaucoup d’argent à mon boy pour qu’il me prépare de la viande de nègre, et la fosse de visite de mon camion doit servir pour mettre le surplus de viande que j’aurais…
Il y a plus de deux ans que le Père Van C... est au courant de cela et, d’après ses déclarations, j’aurais été cité à ce moment-là. Les indigènes racontent qu’à Elisabethville un Monseigneur aurait installé un hôtel pour y débiter (?) la viande qu’il aurait en trop… Je crois que c’est spécialement parmi les évolués que ce bruit prend corps ; ainsi, voici une histoire qui me fut racontée, il y a trois semaines, par le commis de la gare à Tshimbulu. Un indigène est mort dernièrement à Mutombo-Mukulu et ses amis et membres de sa famille sont allés l’enterrer. Le lendemain, un indigène qui passait à côté de la tombe constata que le mort de la veille était assis sur sa tombe, un livre de prières en mains. On est accouru et on l’a questionné. Voici ce qu’il a répondu : ‘je me suis présenté au Paradis, et là on m’a demandé ce que je venais faire et je répondis que j’étais mort. On me demanda alors quelle chambre j’avais et on a constaté que cette chambre était vide et on m’a renvoyé sur la terre avec ce livre de prières. Je me suis moqué du commis de la gare mais celui-ci m’a dit que son histoire était bien vraie… Il paraît qu’il se trouve dans notre territoire… des nègres du Congo français. On en a arrêté un dernièrement et, par le train de mercredi dernier, on l’envoyait à Luluabourg avec chaînes et menottes, mais il paraîtrait que ce type s’est volatilisé à l’arrivée de Luluabourg. Tu comprends que ceci n’est pas fait pour apaiser les esprits des nègres ; en tout cas, on s’aperçoit que le moment n’est plus aux rigolades…
Les « Mitumbula » désignés sont d’accord de porter plainte mais comme cette plainte irait au territoire, et que nous sommes d’accord que le territoire ne ferait rien, nous avons décidé d’écrire plus haut, c’est-à-dire à la Sûreté et, avant cela, j’ai pris l’initiative de t’écrire ; peut-être me donneras-tu un conseil là-dedans.
Mon boy me disait que, même à la cité, le soir, on craint de passer devant la maison de mes charpentiers. Je ne veux pas pousser mon enquête trop loin de crainte de leur donner la puce à l’oreille mais j’estime qu’il y a danger urgent et, si on ne s’occupe pas sérieusement de suite, il y aura du grabuge sous peu. En tout cas, je connais pas mal d’Européens qui nettoient leur fusil et sortent avec armes et munitions…
Que crois-tu que nous puissions faire pour qu’une enquête soit ouverte dans le délai le plus bref ? Fais-en une histoire officielle car s’il se passe quelque chose, nous voulons qu’il y ait des responsables. J’attends de tes nouvelles avant d’écrire aux journaux ».
[1] Une série de travaux locaux (mémoires de licence en histoire à Lubumbashi sous la direction de L. De saint Moulin) ont été consacrés à une évaluation de l’évolution des entités administratives du point de vue démographique et administratif. Ces monographies «d’histoire de la population et de l’organisation administrative» disponibles, concernent notamment les anciens districts du Kwilu (Buko wa Mungaba), des Cataractes (Kabuto C.), de Mai-Ndombe (Musangi Ntemo), du Kwango (Nzimba Mwana-Mosi), du Bas-Congo (Sabakinu Kivilu), de l’Ubangi (Kajybwami A.), du Haut-Lomami (Mfashingabo M.), de l’Equateur (Nseke K.N.), de la Tshuapa (Payenzo D.O.), du Lualaba (Poipo V.M.), du Sankuru (Biaya Y.), de la Mongala (Tshilema T.), du Tanganyika (Yemba P.T.), de Kabinda (Dibwe D.B.), de la Luluwa (Kalamba M.M.), de Stanleyville (Makwanza B.), du Haut-Uélé (Mata- Mokwaka), de l’Ituri (Mucinya M.), du Kasaï (Nkongolo K.), du Bas-Uélé (Salebongo M.) ; d’autres ont été consacrées aux anciens territoires de Kamina (Beya K.) et de Mushie (Bekimi B.), de Kutu (Moshemvula O.), de Kabare (Mugaruka B.M.), de Bukama (Mukendi S.), de Lubudi (Mulowayi K.), de Sandoa (Nsinga T.), de Manono (Toko D.N.) et de Kambove (Uunga M.N.).
[2] Nommé «ministre du Congo belge et du Rwanda-Urundi».
[3] Nommé «ministre sans portefeuille chargé des affaires économiques et financières du Congo belge et du Rwanda-Urundi».
[4] Nommé «ministre sans portefeuille chargé des affaires générales en Afrique».
[5] L’exploitation des collections des comptes rendus de ces Conseils autorise une lecture analytique et systématique de l’évolution de la politique coloniale vécue dans ces Conseils. Quelques travaux locaux existent notamment sur les Conseils de province de Léopoldville (Ibong), du Kivu (Kalengaie N.M.) et de la Province Orientale (Kisonga M.K.) et les Conseils de territoire de Luozi (Longo M.K.), de Madimba (Nkoko M.L.). Les synthèses sont possibles, dans le cadre des territoires, des provinces ou même de l’ensemble du pays. Dans le même ordre d’idées, il existe un début d’inventaire systématique des archives administratives.Les inventaires déjà réalisés portent sur les districts de l’Equateur (Bakua-Lufu), de la Tshuapa (Kavulu W.H.), de l’Ubangi (Mangobe D.), de la Mongala (Mapondi M.), sur la direction des affaires économiques du Katanga (Malambu ma K.), sur la ville de Kisangani (Muhindo M.), etc.
[6] On consultera avec intérêt la collection des travaux locaux sur «la mise en valeur» socio-économique de chaque entité administrative, notamment sur les provinces de l’Equateur (Tshund’Olela et Kanga Egbebe), de Léopoldville (Lombi Bikandu et Kitambala Dwam’Essa), du Kasaï (Kabatanshi Mulamba et Lwinsa Tshiamba) et du Kivu (Bucyalimwe B. et Kashamura K.R.), etc. Commencée par B. Jewsiewicki, cette recherche n’a pu encore aboutir à une synthèse d’ensemble ; mais cette collection de mémoires de licence en histoire est disponible à Lubumbashi.
[7] A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le Congo comptait 479 colons agricoles soit 18 % des colons de tout genre. Les Belges, qui ne représentaient que 30 % des colons, constituaient 70 % des colons agricoles. En 1958, le nombre de colons agricoles a atteint 1 899, soit 20 % des colons (Jewsiewcki B., 1979 : 559-571).
[8] Le Parc national Albert (Virunga) fut créé en 1925 et connut une plus large extension d’abord en 1929, puis en 1935. Cette création fut suivie de celle des Parcs nationaux de la Garamba (1938) et de l’Upemba (1939) (cf. Van Straelen V., « Les Parcs Nationaux du Congo Belge » Encyclopédie du Congo Belge, Bruxelles, Ed. Bieleveld, s.d., vol. 111. pp. 497-512).
[9] J. Vansina; (1991 : 241) les qualifie de sortes d’» Etats de théâtre», parce que » leur taille minuscule était accompagnée de règles élaborées de succession, d’accession au trône et de funérailles royales, d’une théorie complexe de titres entourant la fonction royale, de rituels royaux compliqués et d’une pléthore d’emblèmes, comme si ces royaumes de la taille de districts étaient les égaux de grands royaumes qui se trouvaient par-delà le graben. (C étaient) des souvenirs complexifiés de ce que d’autres, plus loin à l’est, avaient été avant I apparition de grands Etats dans la région des Grands Lacs… »
[10] La Belgique, pouvoir colonial et pouvoir tutélaire devant les Nations unies, n’avait pas la même politique, de part et d’autre des Grands Lacs. Au Rwanda-Urundi, conformément aux principes de l’administration indirecte, les populations, classifiées selon des critères raciaux, étaient stabilisées sur leurs « collines » ; au Congo belge (Kivu), les populations furent plutôt déstabilisées de leurs terres (Willame, J.C., 1997 : 40).
[11] Le cas des immigrés rundi à Kipushi a fait l’objet d’une première étude (Banzika Libéré, Les mineurs barundi à la Gécamines, Centre de Kipushi : Essai de biographies collectives, Lubumbashi, Mémoire de licence d’histoire, 1976).
[12] L’évolution des densités dans les territoires (zones) du Nord-Kivu est la suivante : Goma : 59 hab./ km2 (1957), 159,5 (1970, 286 (1984) ; Lubero : 11,6 (1957), 20,1 (1970), 34 (1984) ; Béni : 20,1 (1957), 46,5 (1970), 81 (1984); Rutshuru: 26,4 (1957), 63,1 (1970), 91 (91 (1984); Masisi : 38,9 (1957), 57,8 (1970), 101 (1984) ; Walikale : (2,1 (1957), 3,2 (1970), 6 (1984). Cette situation contraste avec celle du Sud-Kivu : Mwenga : 9,7 (1957), 11,4 (1976), 19 (1984) ; Uvira (1957) : 38,4 (1957), 42,4 (1976), 102 (1984) ; Fizi : 9,7 (1957), 7,1 (1976), 13 (1984) (cf„ Résultats de l’enquête démographique 1955-57, Districts Nord- et Sud-Kivu, Ministère du Plan et de la Coordination économique, fasc. 12, s.d. ; de Saint Moulin L., Atlas des collectivités du Zaïre, Kinshasa, PUZ, 1976 ; Recensement scientifique de la population – juillet 1984, Kinshasa, Institut national de la statistique, vol. Il, 1992).
[13] La MIB avait codifié, à l’usage de ses agents, ses instructions sur la manière d’installer ces Banyarwanda : formalités à l’arrivée, organisation politique des zones d’immigration, régime foncier, salaires à payer, travaux d’infrastructures à faire effectuer (R. Spitaels, chef de mission, Instructions générales au personnel de la MIB, District du Nord-Kivu, 1952)
[14] Au total, l’apport migratoire d’origine rwandaise au Kivu, à l’âge colonial, est de l’ordre de 200.000 habitants (de Saint Moulin L., « Mouvements récents de population dans la zone de peuplement dense de l’est du Kivu », EHA, 7, 1975, p. 113-124).
[15] Le géographe G. Weis (1959 : 250) établit la présence rwandophone dans l’Itombwe dès 1881. D’après J. Depechin (1974 : 66-70), le nom de » Banyamulenge » aurait été donné par une couche plus ancienne des Banyarwanda vivant dans la région et qui auraient qualifié de la sorte les nouveaux venus parce qu’ils se dirigèrent vers Mulenge. Mais il n’a pas été noté par l’anthropologie coloniale qui reconnaît cependant la présence ancienne des « Rundi « et des « Rwandais » aux côtés des Bembe, des Fulero et des Vira. Au total, dans l’Itombwe, les Banyamulenge totalisaient un maximum de 30 à 40 000 habitants (Willame. J.C., 1997 : 91)
[16] D’autres auteurs, comme Jean Hiernaux, évoquent comme cause de ces migrations, les troubles qui seraient survenus à la cour du mwami Musinga (» Note sur les Tutsi de l’Itombwe : la position anthropologique d’une population émigrée », Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, Série 19, n° 7, 1065, pp. 361-379).
[17] D’après Mgr P. Kanyamachumbi (1993 : 30), la communauté des Banyamulenge se serait enrichie, dans la suite, avec des éléments d’origine tanzanienne (les clans Abaha et Abaphurika), des Shi de Ngweshe et des Batetela de la colonne du baron Dhanis. Par le jeu des alliances matrimoniales, nombre de membres de cette diaspora se retrouveraient apparentés aux Vira, Bembe et Fulero.
[18] Ordonnance-loi du 9 juillet 1917 ; décrets des 16 juillets 1918 et 22 juin 1936 ; ordonnance-loi des 24 novembre 1940, 26 septembre 1945, 19 mai 1948 : décret du 4 janvier 1952.
[19] Voici quelques exemples de représentations figurant sur les plaques au cours de l’entre-deux- guerres : 1924 (buffle), 1925 (éléphant), 1926 (singe). 1927 (palmier). 1928 (tête de lion). 1929 (voiture), 1930 (machette et trois palmiers), 1931 (avion). 1932 (bicyclette). 1933 (crocodile). 1934 (bateau), 1935 (hippopotame), 1936 (pirogue avec trois piroguiers), 1937 (épi de maïs). 1938 (brouette), 1940 (bananier).
[20] L’histoire de « l’uranium congolais » vient d’être établie de manière plus complète (Vanderlinden J. 1990). Elle révèle que ce minerai avait toujours fait l’objet d’envoi aux U.S.A. auprès des milieux industriels depuis les années 20. L’intention militaire a apparu clairement à partir de août 1942 par la création dans le corps du Génie de l’armée américaine d’un nouveau « district » chargé de la recherche atomique (Manhattan en nom de code). Au moment où Nichols rencontre Sengier, il sait parfaitement qu’il frappe à la bonne porte. L’effet de surprise, rapporté par l’intéressé, ne serait donc pas vraisemblable.
[21] L’U.M.H.K. se situait dans l’orbite de la Générale sans être pleinement contrôlée par celle-ci, car elle dépendait aussi d’une Compagnie britannique qui avait pris part à sa création.
[22] Dans le Buku ea Mbaanda (livre de lecture en lomongo composé en 1935). Hulstaert attaque ouvertement la manie de vouloir parler le français ou le lingala. Les enfants y apprennent que leur langue, le lomongo, est une des plus belles du monde (sur Hulstaert G., consulter Bontinck F., « Le 80° anniversaire de Hulstaert G. », Revue Africaine de Théologie. 5. 1981, pp. 92-102 ; Vinck H., « L’influence des missionnaires sur la prise de conscience ethnique et politique des Mongo 1925- 1965 », Revue Africaine des Sciences de la Mission, 4, 1996. pp. 131-147).
[23] Le département de «philologie africaine» à l’Université Lovanium d’abord et à 1 Université nationale du Zaïre ensuite, continua d’enrichir cette «bibliothèque linguistique» par l’établissement systématique des «esquisses phonologiques et morphologiques» et des «grammaires génératives et transformationnelles» appliquées aux langues locales : nyanga (Kadima K.), hunde (Mateene K.), mbala (Mutanda A.), pende (Bunduki), bodo (Bokula M.), ngwii (Bwantsa-Kafungu), taabwa (Rwakazina), nande (Furere), logo (Lida), mbudza (Bemon-Musubao), mbandza (Tingbo). magogo (Asangana), bira (Dz’ba), lingala (Lyandwa), bindi (Kapudi), etc.
[24] Il est clair qu’ici on s’en prend non pas à la philosophie bantoue, mais à l’utilisation que certains, dans un but politique, entreprennent d’en faire.
[25] Tempels a exprimé son enseignement religieux dans deux écrits : Notre rencontre 1 (Léopoldville, 1962) et Notre rencontre II (inédit) qui n’a pu être publié.
[26] Sur la Jamaa, consulter surtout les travaux de Johannes Fabian (1969, 1971, 1972) ; sur l’ensemble de son oeuvre, voir le texte de Fabian (1970) ; le mémoire de Kaumba L. (La révolution tempelsienne – Une redéfinition de la philosophie, mémoire de licence de philosophie, Lubumbashi, 1979) ; la correspondance du Père avec G. Hulstaert (Bontinck F., 1985). Le phénomène a été étudié sous l’angle sociologique (Zabala R.P.X., 1974) mais surtout religieux (Mels Mgr, 1964 ; Mukenge G., 1970 ; Somers, 1971).
[27] L’horaire strict de l’Angelus a donné naissance dans le Bas-Congo à un toponyme particulier : Vemadia (déformation de « Ave Maria »), autrement dit, relais ou lieu de repos où les caravanes s’arrêtaient à midi à l’heure de l’angelus (Bontinck F., 1989 : 182).
[28] La transmission «ambiguë» du christianisme a été fonction, entre autres, d’une traduction des concepts chrétiens qui n’a pas toujours été heureuse. Cela a donné lieu à un long processus, toujours en cours, de traduction privilégiant les versions plus proches de la compréhension populaire. Ces différents états de traduction, comparés entre eux, offrent un champ fertile de recherche socio-linguistique et d’histoire des mentalités (histoire linguistique), entamée fort heureusement à Lubumbashi. Voir le travail de Bangibangi T.G. (1973) sur la traduction lingala de l’Evangile de st. Jean, celui de Bashi Murhi D. (1974) sur la traduction mashi du même évangile, celui de Lonji M. (1974) sur la traduction luba de ce même texte de st. Jean, celui de Mwifi (1974) sur la traduction français- kikongo à partir du même texte de Jean, celui enfin de Nkongo Tshakala (1974) sur les problèmes lexico-sémantiques posés par la traduction en yombe de l’Evangile selon st. Jean. Signalons aussi l’excellente thèse de Ntamunoza M.M. (1980) sur la fonction socio-culturelle du langage missionnaire à partir du cas de la chronique des Pères Blancs.
[29] Les monographies sur le développement scolaire par «vicariats apostoliques» existent et constituent aussi une recherche systématique engagée. Voir Mukama W. (1963) sur le vicariat apostolique du Katanga, Zonzika K.T. (1975) sur le vicariat apostolique du Haut-Kasaï, Byanafashe (1975) sur le vicariat apostolique de la Luluwa et Katanga central, Bashizi B. (1976) sur le vicariat du Kivu, etc. Certaines études locales ont porté sur des cas de missions catholiques ou protestantes : il s’agit notamment des travaux de Bishikwabo B. (1974) sur le complexe missionnaire de Katana ; de Mushagasha G. (1974) sur la mission de Nyangezi ; Munampala (1979) sur Ipamu ; etc.
[30] Kimberley indique l’origine sud-africaine du modèle ; l’appellation mottoulle fait référence à l’inventeur de ce type de maisons (Mayuma A., 1974 : 127).
[31] Plusieurs études locales apportent des éclairages nouveaux sur le problème du recrutement de la main-d’œuvre, son utilisation et les différents appâts mis au point pour assurer sa stabilité. Consulter entre autres le travail de Ilunga Muloway (1975) sur les ouvriers spécialisés de l’U.M.H.K., celui de Banzika (1976) sur les mineurs originaires du Burundi, et celui de Munsala S.K. (1973) sur les interventions de l’administration dans la fixation du niveau de vie.
[32] On dispose d’une bonne moisson de textes locaux retraçant ces conditions de recrutement. Les travaux ci-après en rendent compte : Madiayi J.A. (1971) sur le recrutement au Kasaï. Manop’Atulua M. (1972) sur le même phénomène en Equateur, Mutcha K.N. (1973) sur le cas du district du Lomami ; Yogolelo Tambwe (1973) sur le Kivu-Maniema, Hakiba Buki (1974) sur le Rwanda-Urundi.
[33] Mitumbula (sing. Mutumbula) vient du verbe «dépecer» et désigne les personnes ayant pour profession de dépecer les êtres humains gros. Les Batumbula (sing. Citumbula) désignent les victimes des Mitumbula.
[34] Longtemps la viande en conserve n’a pas été consommée au Congo parce que sa couleur rouge la faisait considérer comme étant de la chair humaine ; il n’est pas rare de trouver encore de nos jours, de vieilles personnes qui s’interdisent de consommer cette viande pour cette raison.
[35] Rapport de la Sûreté à Luluabourg (16 février 1943) ; Ceyssens R., 1975 : 483-550.
[36] L’inventaire des révoltes n’a pu être établi. Signalons quelques cas parmi les moins connus qui ne seront pas développés dans les lignes qui suivent : la résistance shi (Njangu G.C.), la révolte des Luluwa (Lukengu T.), des Yaka (Mvunzi B.B.K.), des Ngwii (Elagna).
[37] Voir chap. 1 (2e partie).
[38] Sur Kimbangu et le kimbanguisme, une littérature abondante permet d’approfondir le sujet. Retenons ici une bibliographie sélective : J. Chômé (1959), C.A. Gilis (1960), Feci (1972), Martial Sinda (1972, 1977), W. Ustorf (1975), P. Raymackers et H. Desroche (1983), W. McGaffey (1983), S. Ach (1983), Diangenda K. (1984).
[39] Marié à Marie Muilu, il eut trois enfants : Charles Kisolekele (né en 1914), Salomon Dialungana- Kiangani (né en 1916) et Joseph Diangenda (né en 1918).
[40] Sur le kitawala au Congo, voir l’article d’Anyenyola W. (1972 : 3-25) ; l’ouvrage de J. Gérard (1969) et celui de Muene-Batende sur les mouvements messianiques (1982).
[41] Voir aussi l’analyse de S. Faïk, « Les Français au Zaïre», Africanismes, Bulletin du Centre international de Sémiologie, UNAZA, mai 1976, p. 38.
[42] Signalons l’existence d’une série d’études locales, sous la direction de B. Jewsiewicki, sur le kitawala au Congo : au Kivu et dans le Haut-Congo (Gambo Ally Saleh), en Equateur (Kuama Mobwa Makutunga) et au Katanga (Kikasa K. et Ngandu Masamba Makiadi). L’inventaire des archives de la sous-région du Tanganyika et de la région du Kivu établi par Ngimbi Lukoki (1975) rend compte de la lutte de l’administration coloniale pour arrêter la propagation de la secte.



