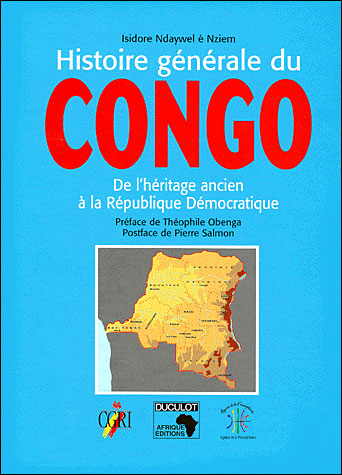
Partie 7 - Chapitre 1 : L’essor
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 1
L’essor
Le jeudi 30 juin, le Congo devient indépendant. Le scénario de cette journée est connu, tant les récits qui la relatent sont nombreux : un Te Deum fut célébré dans la cathédrale Sainte-Anne, avant la séance solennelle dans la grande salle du Palais de la Nation, où trois allocations furent prononcées, alors que l’on n’en avait prévu que deux. Baudouin 1er, arrivé la veille, rendit hommage à l’œuvre coloniale et invita les nouveaux dirigeants à parfaire l’œuvre accomplie. Kasavubu, le président, manifesta sa reconnaissance à l’égard de l’ancienne métropole. Après les deux discours protocolaires, Lumumba, le Premier ministre, prit la parole, mais son propos s’écarta de ce qui avait été apparemment convenu. Il fit le contrebilan de la colonisation, dénonça ses revers, à savoir les injustices, les inégalités, l’exploitation, le mépris [2].
Au cours du déjeuner qui suivit la cérémonie, on tenta de réparer cette maladresse qui resta pourtant dans les mémoires congolaises et belges. II apparut alors que la sérénité de la cérémonie n’était qu’apparente, même si la « déclaration d’indépendance » signée l’après-midi proclamait pompeusement que « le Congo accédait en ce jour, en plein accord avec la Belgique, à l’indépendance et à la souveraineté internationale ».
Le 7 juillet, l’indépendance fraîchement acquise obtenait une caution internationale, grâce à l’admission du nouvel Etat au sein de l’ONU. La Tunisie, le seul Etat africain membre du Conseil de Sécurité à l’époque, présenta sa candidature ; à l’unanimité, le Conseil de Sécurité marqua son accord et recommanda à l’Assemblée Générale d’accueillir la République du Congo en son sein [3].
Cette indépendance constituait pourtant un événement imprévu et quelque peu inexplicable dans le contexte général de l’histoire du continent. Rares étaient les pays africains qui avaient réussi un tel exploit : seules deux générations d’indépendance africaine existaient alors. La première, datée de 1956, soit un an après Bandoeng, ne concernait que des pays déjà fort bien organisés d’Afrique du Nord (Maroc. Tunisie, Soudan) [4] ; la deuxième, qui constituait la tête de pont de l’Afrique noire, englobait le Ghana (6 mars 1957) et la Guinée (10 décembre 1958). Un courant d’indépendance ne naquit vraiment qu’en 1960 dans l’Afrique noire. Personne n’aurait pu prévoir que le Congo belge, le grand absent dans cet effort d’émancipation des populations autochtones, allait participer à cette « ligne du front » des pays indépendants. Ce privilège passait pour être l’apanage des colonies françaises depuis la fin de la guerre mondiale. Elles y étaient préparées, comme nous l’avons déjà noté, par les dispositions constitutionnelles de 1946 et la loi-cadre de 1956. De fait, ces colonies eurent la «primeur» de l’indépendance en 1960, les territoires sous mandat à savoir le Cameroun (1er janvier) et le Togo (27 avril) d’abord. Ensuite, vint le tour de la moribonde fédération du Mali (20 juin) puis de Madagascar (26 juin). Après la Somalie (1er juillet) les francophones repriment le droit avec les cas successifs du Bénin, à l’époque Dahomey (1er août), du Niger (3 août), du Burkina- Faso qui est encore la Haute-Volta (5 août), de la Côte-d’Ivoire (7 août), du Tchad (11 août), de Centrafrique (13 août), du Congo/Brazza (15 août) puis du Gabon (17 août), du Sénégal (20 août) et du Mali (22 septembre). Enfin le Nigéria (1er octobre) puis la Mauritanie (28 novembre) vinrent se joindre à ces jeunes Etats indépendants.
L’indépendance du Congo était de toute évidence un cas à part, un phénomène imprévu, longuement réprimé par le colonisateur avant d’être en définitive précipité par ce dernier apparemment pour des raisons tactiques, pour figurer aux premiers rangs des « nouveaux amis » et ainsi sauver ce qui pouvait l’être. Il est clair que la Belgique avait opté pour cette stratégie en désespoir de cause : elle n’avait pas les moyens de retarder l’échéance, comme c’eût été possible pour la France et l’Angleterre, bien que la concordance des dates ait prouvé que la Belgique s’est maintenue aussi longtemps que la France, malgré les différences existant jusque-là dans leurs gestions respectives des revendications à l’autonomie.
Comment expliquer le mode de gouvernement qui allait être appliqué dès l’indépendance ? L’inexpérience, ou plus précisément une préparation exceptionnellement brève et donc insuffisante à cette situation neuve, alliées à la dimension du pays et à l’ampleur des problèmes, allaient continuer à marquer le Congo.
Nous étudierons ici trois périodes successives : la gestion de l’indépendance qui mena à la ruine de l’État, ensuite les tentatives diverses de remédier à cette situation, dont certaines prolongèrent la crise au lieu de la soulager ; enfin la naissance progressive d’un État nouveau, issu des décombres de cette crise aiguë de croissance politique.
1 L’INDÉPENDANCE ET SA GESTION
La célébration de l’indépendance avait un caractère ambigu : les participants n’en étaient pas conscients, mais les auspices n’étaient guère favorables.
Le peuple congolais est naturellement optimiste et bon vivant, capable d’oublier un moment les préoccupations les plus graves pour profiter pleinement de l’instant présent. Ce fut le cas lors de la fête du 30 juin, où le maître-mot fut l’indépendance : on le traduisit par uhuru en swahili, kimpwanza en kikongo. Le lingala opta pour le terme français d’indépendance qui fut converti en dipanda. Des nuits entières, on dansa sur les rythmes des chansons de l’indépendance, les femmes portaient des pagnes « indépendance », les marchés et les places publiques résonnaient de ce mot magique.
Les interprétations que le peuple donnait à ce mot variaient d’une personne à l’autre et devenaient parfois fantaisistes : certains y voyaient la fin du règne des Blancs et partant, le retour des ancêtres, les héros locaux. La plupart s’attendaient à un retournement de situation, les Noirs remplaçant des Blancs, prenant leurs grosses voitures, leurs grandes maisons et recourant exclusivement à la langue magique, le français [5]. La propagande électorale, en annonçant l’événement, avait contribué à l’élaboration de ce mythe, par l’emploi d’images fortes qui marquèrent le peuple parce qu’elles correspondaient à un idéal souhaité et aussi parce que le peuple était peu habitué au discours démagogique. En laissant entrevoir la possibilité d’une des contraintes, le discours politique avait en effet quelque peu exagéré : il avait ainsi promis qu’avec l’indépendance, le travail ne serait plus nécessaire : des « machines » allaient arriver, qui produiraient directement manioc et maïs, rendant les houes inutiles. Devant la dure réalité qui succéda à l’euphorie, une connotation péjorative fut peu à peu attribuée à « dipanda », qui désigna alors les arrivistes et les parvenus. Avoir une « promotion d’indépendance » se traduisit par « ne pas avoir de mérite » ; les « enfants de l’indépendance » désignaient la génération de l’époque habituée à une existence facile, qui n’avait pas connu le régime strict de l’éducation coloniale. Par la suite, le terme d’indépendance fut réutilisé… en situation de sécession lorsqu’il fut question de se détacher de la tutelle de Léopoldville. Peu après, les rébellions révolutions revendiquèrent la conquête d’une « seconde indépendance », la première désignant celle que les bourgeois s’étaient appropriée.
Pour l’heure, chacun était encore à la fête, confiant dans l’avenir du pays. « L’hymne de l’indépendance » qui se substitua aux chansons « patriotiques » de la période coloniale, était un poème passionné tourné contre le colonialisme mais également et surtout un projet pour l’avenir, traduisant la ferme volonté du peuple congolais de construire une nation unie et prospère.
Debout Congolais unis par le sort
Unis dans l’effort pour l’indépendance
Dressons nos fronts longtemps courbés
Et pour de bon prenons le plus bel élan
Dans la paix
O peuple ardent par le labeur
Nous bâtirons un pays plus beau qu’avant
Dans la paix
Citoyens, entonnez l’hymne sacré de votre solidarité
Fièrement, saluez l’emblème d’or de votre souveraineté
Don béni des aïeux,
O pays bien aimé
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur
Trente juin O doux soleil,
Trente juin du trente juin
Jour sacré sois le témoin, jour sacré de l’immortel
Serment de liberté
Que nous léguons à notre prospérité
Pour toujours.
L’indépendance fut donc un grand moment, évoqué avec une passion d’autant plus grande que l’on était conscient de sa précarité. Ces craintes étaient effectivement justifiées. Le Congo indépendant comptait à l’origine trop de forces centrifuges pour ne pas risquer de perdre sa cohésion interne. De fait, des mouvements de revendication sociale se manifestèrent dès 1959, et se poursuivirent même après l’indépendance, notamment par la grève à l’OTRACO (1er juillet), les troubles à Kinshasa entre Yaka et Kongo (3 juillet), et les revendications salariales à Mbandaka (4 juillet). La formation du gouvernement Lumumba laissa des insatisfaits parmi les représentants de certaines régions, entre autres le Katanga et le Kasaï [6]. On était bien loin d’une véritable cohésion interne : le gouvernement se fondait sur une situation de compromis. L’inimitié entre Kasa-Vubu et Lumumba, déjà perceptible lors des séances du Collège Exécutif Général et encouragée par la structure bicéphale de l’Exécutif, constituait à elle seule un péril pour la politique du pays.
En réalité, la situation n’était guère rassurante. Le 30 juin, certaines régions du pays ne participaient pas à la fête : le Kasaï pleurait ses morts, les Luba ne parvenaient pas à oublier leur échec aux élections provinciales de mai. De plus, leur leader Albert Kalonji n’avait pas été retenu pour faire partie du gouvernement. L’opposition Luba-Luluwa était donc loin de s’atténuer. Bien au contraire, les événements en cette période d’indépendance, contribuaient à attiser les tensions. A l’heure même où à Léopoldville, on dansait pour fêter l’indépendance, les Luba étaient contraints de quitter Luluabourg. La Convention du lac Mukamba, accentua cette migration de la population luba qui atteignit son point culminant quand l’Exécutif décida de faire évacuer le village des Bakwa Mulumba situé dans la zone de Luluabourg. L’indignation fut alors à son comble. Depuis Léopoldville, Ngalula avait encouragé les siens dans leur mouvement d’exode. Les trains de Mwene-Ditu et les camions pour Bakwanga ne suffisaient pas, tant l’affluence était grande, à te! point que certains n’hésitèrent pas à déménager à pied. Comme le note un intellectuel luba, le 30 juin au Kasaï fut « un jour de deuil et de méditation » (Muya bia L. 1980). Cette opposition Luba-Luluwa annonçait une évolution négative de l’ensemble du Congo indépendant.
A Léopoldville et dans la plupart des métropoles, la fête fut intense mais de courte durée. Elle fut vite oubliée quand l’Etat fraîchement constitué éclata en trois temps : au lendemain du départ des derniers invités venus participer aux festivités, éclatèrent les mutineries de la Force Publique (mercredi 5 juillet). Elles furent suivies, six jours plus tard, de la proclamation de l’indépendance du Katanga (lundi 11). Puis de celle du Sud-Kasaï (lundi 8 août). Enfin le Président révoqua le Premier ministre, qui le révoqua à son tour (5 septembre) ; les Chambres votèrent une motion de confiance en faveur de Lumumba révoqué, et Kasa-Vubu répliqua en les renvoyant. L’impasse était totale : l’euphorie de l’indépendance proclamée le 30 juin avait duré un mois, et l’amitié belgo-congolaise qui se voulait le fleuron de ce système colonial ne put résister aux effets de la crise, quelques semaines à peine après la signature en grande pompe du traité liant les deux pays [7].
1.1 Mutinerie de la Force publique ou les Belges attaquent
Comme l’avait prédit Paul Salkin, la mutinerie de la Force publique coïncida avec l’indépendance. L’événement était inattendu, car il survint exactement au lendemain du départ des derniers invités venus participer aux festivités du 30 juin. Cette mutinerie était pourtant relativement logique. En effet, depuis quelques mois, tous les corps de métier avaient successivement fait grève. Les derniers en date étaient les ouvriers de l’OTRACO qui ne renoncèrent pas à leur projet, malgré l’euphorie de l’indépendance. Restait la Force Publique. D’autre part, pour ce corps de métier, « après l’indépendance » signifiait « avant l’indépendance ». Celui qui leur rappela avec empressement à l’issue des festivités cette vérité brutale, en était lui-même le symbole vivant : le général Janssens était en effet commandant en chef de la Force publique, avant comme après. Dans le processus de promotion d’indépendance en cours de réalisation, rien n’était prévu pour les fonctionnaires autochtones en uniforme. Ils ne devenaient ni ministres, ni députés. Ils devaient encore se mettre au garde-à-vous devant des officiers blancs, et qui plus est, et désormais même devant des civils congolais dont certains – parmi ceux-ci le Président et le Premier ministre – étaient hier encore en prison, sous leur garde. Le problème était réel mais les circonstances n’étaient pas propices. Les gardiens de l’ordre allaient à l’encontre de l’ordre au moment où celui-ci était le plus vulnérable. Mais pouvait-il en être autrement ?
Quand celui qui s’estime lésé pourrait-il exprimer sa douleur, si ce n’est à l’instant où il la ressent ? Si la « colonie modèle » n’envisagea la formation des élites autochtones qu’après la Deuxième Guerre mondiale, dans le secteur militaire, celle- ci démarra avec un retard encore plus important. Le dernier commandant en chef de la Force Publique, le général Janssens, se plut à la retarder au maximum, convaincu que le prestige de l’officier était renforcé par celui du Blanc et qu’on ne pouvait nuire au prestige du Blanc sans ternir celui de l’officier (Janssens E. 1961). Il va de soi que l’africanisation de Janssens n’était qu’un simulacre. Son prédécesseur avait adopté cette nouvelle politique en 1945 et instaura cette formation en commençant par le niveau le plus bas qui puisse exister. Il créa des écoles primaires, d’abord cinq, afin de former les futurs officiers dès l’enfance. L’école des pupilles de Luluabourg ne fut créée qu’en 1953, et en 1958 elle ne comptait que 14 élèves. L’école de sous-officiers ouvrit ses portes en septembre 1959 et ne recruta que 9 candidats. Les effectifs restaient étrangement réduits. L’année précédente, on avait annoncé avec fierté que seuls 23 des 1 950 candidats avaient été retenus à l’école des pupilles. Le passage obligé par ces écoles enlevait ainsi aux soldats et sous- officiers en fonction tout espoir de promotion, apparemment réservé à leurs enfants. Ce n’est que le 10 juin qu’on laissa entrevoir la possibilité de recruter des élèves sur base du critère d’ancienneté. Malgré cette disposition de dernière minute – qui n’aurait de toute façon fourni la première promotion d’officiers autochtones qu’en 1962 au plus tôt – l’avenir dans la carrière militaire resterait aléatoire et sans issue tant que les responsables de l’armée ne changeraient pas (Young C. 1968 : 260-261). Les mutineries étaient inévitables.
Parti des troupes d’élite du Camp Hardy de Mbanza-Ngungu (5 juillet), le mouvement gagna bientôt les garnisons de Kinshasa, Comme il était dirigé contre le gouvernement, Lumumba réagit en nommant davantage de Noirs au sein de la hiérarchie militaire. Malgré cela, le mouvement s’amplifia et gagna d’autres garnisons. La panique s’empara des familles européennes, victimes de violences et d’humiliations diverses, au point que les troupes métropolitaines durent intervenir, en principe pour assurer la protection des Européens et leur évacuation. Cependant, un climat de violence se substitua aux intentions pacifiques premières. On crut d’abord qu’il s’agissait de méprises. Mais par la suite, après le 9 juillet, force fut d’admettre que le Congo était victime d’une agression (Vanderstraeten L.F. 1985 : 458). La mutinerie se mua en un conflit militaire avec les troupes belges. Jan Van den Bosch, premier ambassadeur de Belgique au Congo, qui s’efforça de calmer les esprits dans ce conflit, donne cette interprétation des événements. Dans son Pré-Zaïre, écrit 25 ans après les faits, il dénonce cette conduite aberrante de la Belgique qui « après avoir pratiqué pendant de trop long mois une politique de faiblesse dans un Congo qui lui appartenait, entendait se lancer dans une politique de force dans un Congo qui ne lui appartenait plus ». Il poursuit : « N’avais-je pas entendu à l’envie les ministres (belges) répéter, devant les critiques de notre politique congolaise, qu’il fallait à tout prix éviter d’être entraîné dans une nouvelle guerre d’Algérie. Et voici que nous nous y engagions délibérément, avec des titres juridiques infiniment moindres que les Français, avec des forces incomparablement plus faibles, dans un territoire combien plus vaste. Que pouvions-nous espérer ? Réussir au Congo tandis que les Anglais avaient échoué en Inde, les Hollandais en Indonésie, les Français en Indochine et qui n’arrivaient pas à aboutir en Algérie ? » (1985 : 63-64) [8].
La Belgique fut la première à violer le traité d’amitié et de coopération qui la liait à l’ancienne colonie et ce fut en faveur… du Katanga. L’article 6 de ce traité subordonnait toute intervention des forces métropolitaines basées dans le pays à l’accord explicite du ministre congolais de la Défense nationale. Le 10 juillet. les forces métropolitaines basées à Kamina intervinrent à Elisabethville pour protéger les Européens. Arthur Gilson, ministre belge de la Défense qui donna directement cet ordre à la base de Kamina, outrepassa l’accord du gouvernement congolais et ne prit même pas la peine d’en informer l’ambassadeur belge à Kinshasa. Le soir du même jour, un détachement des paracommandos belges fut envoyé à Luluabourg pour sauver un groupe d’Européens qui, se croyant en danger, s’étaient enfermés dans l’immeuble Immokasaï.
On aurait pu prétendre, à la décharge des Belges, que cette violation du traité constituait un acte de défense des droits de l’homme. Mais dans cet autre cas. ce n’était même pas certain ; en effet, le 11, Matadi était attaquée alors que les Européens avaient déjà évacué. A partir du 13, les « attaques » belges se généralisèrent.
Le 13, les troupes métropolitaines s’emparèrent de Léopoldville et du Bas-Congo ; le 14. le Katanga fut entièrement « occupé » ; le même jour, Kikwit tomba entre leurs mains. Puis Borna, le 15 : Coquilhatville le 16 ; Kindu, Goma, Banningville, Boende, Libenge et Gemena le 17 ; Bunia le 18 (Willame J.C. 1990 : 153). Un climat d’hostilité s’était définitivement installé entre les parties qui, quelques jours plus tôt avaient signé un traité d’amitié et de coopération. La Belgique se fit l’auteur de ces actes de violence au moment même où Kasa-Vubu et Lumumba allaient venir à bout de l’insurrection, en allant d’un camp à l’autre, d’une ville à l’autre, pour parlementer avec les insurgés.
Deux incidents surtout renforcèrent la partie congolaise dans sa conviction que la Belgique, avec ses troupes stationnées au Congo, était déterminée à administrer une dernière leçon à son ancienne colonie. Ils sont liés aux circonstances particulières de la proclamation de la sécession du Katanga et aux événements qui se déroulèrent à Matadi. Les troupes qui intervinrent à Elisabethville, le 10 juillet, s’y installèrent, sous le commandement du capitaine-commandant Guy Weber. Cette garnison fut aussitôt rejointe par d’autres compagnies venues de Belgique. Or, le lendemain de cette intervention, on proclamait l’indépendance du Katanga. Kasa-Vubu et Lumumba séjournaient à Luluabourg pour leur mission de pacification et avaient précisément prévu de se rendre à Elisabethville ce jour-là. Ils retardèrent leur voyage d’un jour. Le lendemain ils embarquèrent à Kamina dans un DC 3 piloté par des Belges ; dans la capitale du cuivre, on leur refusa l’atterrissage alors que les troupes belges occupaient la ville. Malgré la nuit tombante, ils durent se replier sur Luluabourg. Le lendemain, le président et le Premier ministre décidèrent de se rendre à Stanleyville, après une escale à Kindu où ils passèrent la nuit. En décollant à Kindu, ils demandèrent à l’équipage belge de se poser à Stanleyville ; celui-ci les conduisit à Léopoldville (15 juillet). Sur la piste d’atterrissage de N’djili, ils furent conspués voire même bousculés par les réfugiés européens… sous le regard impassible ou plutôt narquois des paracommandos belges (Kestergat J. 1986 : 36-37 ; Van den Bosch J. 1986 : 99-100) [9]. Entre la Belgique et le Congo, les ponts furent coupés. Dans un télégramme envoyé depuis leur escale à Kindu au Premier ministre belge, le Président et le Premier ministre rompirent les relations diplomatiques avec la Belgique (14 juillet). Les raisons invoquées étaient la violation du traité d’amitié selon lequel les troupes belges ne pouvaient intervenir sur le territoire congolais sans l’autorisation expresse du gouvernement de la République, et la violation par la Belgique de 1 intégrité du territoire national lors de son intervention dans la sécession du Katanga.
Matadi fut le cadre de l’autre incident majeur qui conforta le Congo dans ses dispositions à l’égard de la Belgique ; une offensive y fut menée tout à fait arbitrairement puisque le calme régnait parmi les unités de la Force publique, et que les installations portuaires n’étaient pas du tout menacées. Le COMETRO (Commandement Métropolitain) crut bon d’y mener à bien une opération, « pacifique » à ses yeux, pour permettre la reprise du trafic maritime, et donc d’occuper préventivement les ports de Matadi et de Borna. Dans son enthousiasme, il avait oublié, semble-t-il, qu’on avait déjà accordé l’indépendance au Congo. Dans la nuit du 11 au 12 juillet, deux algérines de la Force Navale belge embarquèrent à Banana quelques unités de l’armée belge. Entre-temps, le paquebot « Thysville » qui était à quai à Matadi reçut l’ordre d’appareiller et de quitter Matadi avec les réfugiés européens à son bord. Le matin, à la vue de la première algérine débarquant des troupes belges, les Congolais ouvrirent le feu. Il y eut des échanges de tirs d’artillerie. Les Belges s’emparèrent du port, progressèrent jusqu’au camp Redjaf où ils furent bloqués. Les soldats belges passagers de la seconde algérine qui accosta à Ango-Ango ne purent s’emparer du camp de la gendarmerie, l’algérine étant tenue en respect par des canons. Les Belges durent se replier sur Borna et admettre leur échec. On venait d’assister, à peu de chose près, à un épisode d’une guerre « classique ».
En fin de compte, la modeste mutinerie de la Force Publique eut des conséquences incalculables. Elle fut l’étincelle qui mit le feu aux poudres. A posteriori, son rôle de détonateur apparait encore plus clairement. C’était d’abord et avant tout une revendication congolaise adressée aux autorités congolaises. Il en résulta une africanisation de la hiérarchie de l’armée – la Force Publique ne comptait jusque-là que 7 sous-officiers autochtones – ce qui ne se serait jamais produit aussi vite sans une telle pression. Alors qu’on décidait que le général Janssens demeurerait à la tête des troupes et que lors de la mutinerie, on conseilla au Premier ministre de ne pas changer d’« attelage avant la traversée du gué », celui-ci prit une option contraire, sous la pression des événements. Le 8 juillet, l’ancien adjudant Lundula troqua son écharpe majorale à Likasi contre les galons de général, commandant en chef des troupes [10] ; l’ancien sergent Joseph Mobutu, de secrétaire d’Etat, devint chef d’état- major avec le grade de colonel. La Force Publique devint « l’armée nationale ». Dans les garnisons, les soldats furent invités à tirer au sort les noms de ceux qui parmi eux, étaient candidats au grade d’officiers. Le commandement du Camp Léopold fut confié à l’adjudant Kokolo.
Ce mode de promotion est certes pour le moins insolite ; si une telle disposition n’avait pas été prise, le cours de l’histoire aurait sans doute été fort différent. Lors du conflit qui allait opposer un mois plus tard Kasa-Vubu et Lumumba, l’armée nationale commandée par Janssens n’aurait pu les neutraliser l’un et l’autre pour mettre en place un « Collège des commissaires généraux ». En cinq ans, le haut-commandement militaire n’aurait pu atteindre l’envergure qui fut la sienne, en 1965. lorsqu’il mena un coup d’État pour hisser Mobutu à la magistrature suprême du pays.
Il va de soi que des deux premiers responsables militaires autochtones. Lundula et Mobutu, ce dernier partait favori. Mobutu n’avait quitté l’armée qu’en 1956 et y gardait ses entrées, tandis que Lundula avait quitté son poste d’infirmier dans la Force Publique quinze ans auparavant. De plus, il menait sa carrière postmilitaire à Jadotville et n’avait jamais vécu à Léopoldville, tandis que le chef d’état-major était déjà connu dans la capitale, en tant que journaliste et militant du MNC. Dès le départ, l’armée était davantage sous son influence [11].
La mutinerie eut une autre conséquence importante : un vent de panique provoqua en effet le départ massif des coopérants, colonisateurs d’hier, qui avaient choisi de rester au service de la nouvelle république. Spectacle insolite que celui d’une administration se vidant en moins de huit jours de milliers de fonctionnaires. Même lors de révolutions, on n’avait jamais connu un changement aussi brutal. En réalité, il s’agissait d’une réaction excessive qui répondait à une autre situation elle-même exagérée. Un départ si brutal et si massif ne pouvait mener qu’à une véritable sclérose. Toutefois, il était étrange que tant de fonctionnaires coloniaux poursuivent leur carrière en toute quiétude « après comme avant l’indépendance du pays ». L’équation de Janssens était plus significative qu’il n’y paraissait à première vue. De fait, toute indépendance donne lieu à un changement radical. La mutinerie qui suivit les événements du 30 juin fut l’occasion pour la décolonisation de progresser d’un cran. Le processus, encore très éloigné de son achèvement, devait se poursuivre et se poursuivit.
La guerre qui accompagna la mutinerie provoqua surtout la première rupture des relations diplomatiques, quatorze jours après la proclamation de l’indépendance réalisée pourtant « en plein accord » entre les deux parties. Quelques maladresses commises peu après suffirent à compromettre les relations belgo-congolaises… « pour au moins dix ans », d’après les estimations de l’ambassadeur de Belgique, témoin de ces journées chaudes (De Vos P. 1975 : 129). Ces hostilités surgirent malencontreusement à une époque où le pays avait grand besoin du secours de l’ancienne métropole pour la guider dans son entrée dans la vie internationale. La rupture avec l’ancienne métropole eut pour conséquence d’« internationaliser » presque simultanément la crise congolaise. Au moment où la République du Congo est admise comme Etat membre de l’ONU, la mutinerie en est à sa troisième journée (7 juillet) ; le premier appel adressé à cette institution internationale date du 10 juillet, moins de quinze jours après la proclamation de l’indépendance. Il s’agissait d’une demande d’assistance militaire d’urgence adressée à Ralph Bunche, qui se trouvait alors à Kinshasa depuis la veille du 30 juin. A la suite des interventions militaires belges dans le Bas-Congo, le gouvernement central – en l’absence du Président et du Premier ministre -s’adressa le 12 juillet à l’ambassadeur des USA pour demander le renfort d’un contingent de soldats américains en vue d’aider l’armée congolaise à assurer l’ordre. Il faut voir là une première mise en œuvre d’urgence de l’aide sollicitée auprès des Etats-Unis. Simultanément, Kasa-Vubu et Lumumba réclamèrent à l’ONU l’envoi d’une aide militaire directe pour protéger la jeune république contre l’agression extérieure. L’objectif de la demande congolaise se précisa le 13 juillet : elle visait à contrer l’agression des forces métropolitaines. Le Conseil de sécurité qui s’était réuni ce jour-là, constata que la situation au Congo risquait de compromettre le maintien de la paix et la sécurité internationale. Il décida d’envoyer une force des Nations-Unies sur place et demanda le départ des troupes belges. Le 14 juillet, depuis Kindu, Kasa-Vubu et Lumumba prirent soin de prévenir l’Union Soviétique que son aide pourrait être sollicitée si le camp occidental ne mettait pas fin à son intervention. Les circonstances pouvaient mener à un conflit international. Le secrétaire général, le Suédois Dag Hammarskjôld, parvint habilement à éviter une condamnation explicite de la Belgique considérée comme agresseur, et à écarter le risque d’une participation des Grands au conflit du Congo – on était alors en pleine période de « guerre froide ». Les Casques bleus ne proviendraient pas des pays membres permanents du Conseil de sécurité ; ils ne seraient recrutés que dans des pays neutres, pour la plupart afro-asiatiques. C’est ainsi que les quatorze premiers bataillons qui débarquèrent au Congo (14-19 juillet) comptaient des Ghanéens, des Tunisiens et des Suédois (Braeckman C. et alii 1990 : 81-82). La décolonisation congolaise avait cessé d’avoir pour seuls acteurs le Congo et la Belgique. A présent plusieurs protagonistes se retrouvaient dans l’arène : la Belgique, l’ONU, les États- Unis, l’URSS etc. La cible privilégiée de l’internationalisation de cette crise fut le Katanga.
1.2 Deux régions minières, deux sécessions
On considère habituellement que la sécession du Katanga prend ses racines dans la période coloniale, plus précisément dans les années 40-45. Il faut préciser qu’il s’agit là d’un fait européen avant d’être africain. Le « particularisme » katangais désignait bien moins les particularités propres aux autochtones de cette région que les conséquences d’une présence européenne massive et l’existence des puissants intérêts de la Société Générale. Rappelons ici le slogan en vogue au début des années 50, particulièrement auprès des Katangaleux (Belges du Katanga) : » cent mille colons belges avant dix ans ou bien le Congo ne sera plus belge ». Entre Blancs, on se plaisait à cultiver la différence entre la « capitale du cuivre » (Elisabethville) et la « capitale du papier » (Léopoldville) (Yakemtchouc R. 1988). C’est l’association des Blancs du Katanga – l’Union katangaise – qui inaugura les frustrations des « Katangais authentiques » ; ce qui amena ceux-ci, nous l’avons vu, à former un parti politique, la Conakat. A la Table ronde, la Belgique fut sensible au clivage entre « Katangais » et « Congolais ». Déjà auparavant, cette expression était de règle auprès des colons : « Moïse, c’est le seul nègre à qui on dit Monsieur » (De Vos D. 1975 : 176). Ces faits étaient connus et ne justifient pas à eux seuls le déclenchement de la sécession.
C’était une initiative plus spécifique à la période même de l’indépendance. Puisqu’il y avait mutation, pensait-on, autant s’en servir pour la muer en un événement souhaité de longue date. Au lieu d’un État, il y en aurait deux qui accéderaient à l’indépendance. Au cours du mois de juin, les fonctionnaires coloniaux déclarent eux-mêmes avoir étouffé dans l’œuf pas moins de trois tentatives préliminaires de déclaration d’indépendance de la part du Katanga. La première eut lieu, comme nous l’avons déjà noté, le 14 juin. Le Collège exécutif provincial proclama l’état d’urgence et mit en place le plan « troubles », ordonnant l’occupation militaire des points névralgiques de la ville. La deuxième coïncide avec la date fatidique du 28 juin. La police, fouillant les bagages de Frans Scheerlinck – un ancien agent de la Sûreté belge reconverti dans l’immobilier – à son retour d’Elisabethville, découvrit une lettre (sur papier à en-tête de la République du Katanga 1) l’accréditant comme ambassadeur chargé d’annoncer au roi des Belges et aux Etats-Unis la nouvelle de l’indépendance de la province minière à la date du 28 juin. On était le 26 juin [12]. La dernière tentative fut celle du 29 juin, soit la veille de l’indépendance. Les membres du corps consulaire furent conviés à l’Assemblée provinciale en vue d’y « entendre une déclaration importante du gouvernement ». Le projet fut vite contré et la proclamation de l’indépendance ne put avoir lieu.
On revint à ce projet lorsqu’il ne subsista plus aucune instance capable d’empêcher sa réalisation. Que se passa-t-il de particulier, ce 11 juillet, pour que la sécession du Katanga puisse être déclarée cette fois avec succès ? On était au lendemain de la neutralisation de la Force publique par les paracommandos belges. Les autorités katangaises avaient enfin le champ libre pour mener leur projet à bien sans craindre les représailles du pouvoir central. Non seulement celui-ci n’avait plus de défenseur au Katanga, il était même en mauvaise posture à Léopoldville. Tshombe le savait fort bien, puisqu’il en avait été témoin ; du 5 au 8, il y avait séjourné entre autres pour interroger le Premier ministre à propos de la part des ressources « katangaises » qui devraient être accordées à la province du Katanga. Sa mission tourna court et il assista à la dissolution de l’armée et aux hésitations du gouvernement central. Il ne réintégra le Katanga que le 9 juillet – deux jours avant le « coup d’État provincial » (De Vos P. 1975 : 168) [13].
Une seule instance pouvait faire obstacle à la sécession, comme cela s’était passé les 14 et 28 juin… : c’était le commandement métropolitain. Cette fois, il n’en fit rien. De plus, le chef du détachement venu de Kamina, le commandant Guy Weber, s’installa sur place. En moins de quatre jours, cet ancien officier de la Force publique, fils de colons, devint l’homme de confiance du président katangais qui lui confia la haute direction de toutes les forces armées du Katanga. Le Premier ministre belge Gaston Eyskens décida, au lendemain de la proclamation de la sécession, que tous les Belges en poste au Katanga devaient y rester. L’Union Minière déclara quant à elle que ses agents européens qui s’étaient réfugiés en Rhodésie devaient revenir. On avait là un prétexte justifiant la présence des troupes métropolitaines sur place et l’envoi de munitions. Dès le départ, le Katanga était fort militairement, bien plus que le reste du Congo. Non seulement il abritait Kamina, la plus importante base militaire du pays, mais il détenait également toute la flotte aérienne militaire du pays, les 6 «Fouga Magister» que comptait la Force publique (Weber G., 1983 : 110 et 115). En outre, le commandement belge local fut renforcé par l’envoi sur place du général Cumont, qui s’était de suite fixé pour objectif de s’occuper des réfugiés européens et de « soutenir le Katanga ».
Dans le même temps, un grand rassemblement de troupes envoyées directement par Bruxelles se tint à Elisabethville : quatre-vingt-six compagnies au total. Le général Cumont lui-même ne savait que faire d’une telle abondance de soldats (De Vos P., 1975 : 175 ; Boissonnade E., 1990 : 51-53). Peu de temps avant ce déploiement de forces, la Rhodésie britannique se déclara disposée elle aussi à soutenir le Katanga. Sir Roy Welensky, président de la Fédération des Rhodésies et du Nyassaland, était un grand défenseur de la sécession katangaise, sans être vraiment désintéressé. Les Anglais de Salisbury n’avaient pas abandonné le rêve de réunifier à leur avantage l’ensemble de la zone minière comprenant les deux Rhodésies (actuellement Zimbabwe et Zambie) et le Katanga. Les intérêts du capital international étaient en jeu. Apparemment ils n’entendaient faire aucune concession, surtout que le minerai se vendait fort bien à cette époque.
La Belgique se prêta à ce jeu ambigu, déclarant sans cesse s’opposer à la sécession, bien qu’elle ait passé pour en avoir été la cheville ouvrière grâce à l’intervention efficace d’une équipe de ses ressortissants chargés de gérer l’État katangais sur place [14]. La position «sécessionniste» de la Belgique, bien qu’officieuse, obtint l’aval de la famille royale. En juillet, le Katanga organisa une « Foire internationale » ; le prince Albert crut bon d’y prendre part. Plus tard, à l’occasion du mariage du Roi à Bruxelles, Tshombe se déplaça à son tour ; il reçut, pour la circonstance, les insignes de l’Ordre de la Couronne. Au demeurant, Baudouin 1er lui-même. 21 jours après avoir accordé l’indépendance au Congo, déclara lors de la fête nationale belge :
Des ethnies entières, à la tête desquelles se révèlent des hommes honnêtes et de valeur, nous ont conservé leur amitié et nous adjurent de les aider à construire leur indépendance au milieu du chaos qu’est devenu aujourd’hui le Congo belge (Boissonnade E., 1990 : 58-59).
L’allusion à Tshombe était à peine voilée. Cette caution discrète fut bien comprise et conforta dans sa mission l’équipe des militaires et techniciens belges qui entourait le président katangais. Ces « théoriciens » de la sécession du Katanga étaient tous membres de la « Mission d’Assistance technique belge au Katanga » dont la direction fut confiée au comte Harold d’Aspremont Lynden, l’ancien chef de cabinet adjoint du Premier ministre Eyskens, qui fut envoyé sur place [15]. Son équipe comptait donc plusieurs coopérants, parmi lesquels le professeur René Clemens de l’université de Liège, celui-là même qui rédigea la Constitution du Katanga. Les techniciens étrangers élaborèrent une version édifiante de la sécession pour justifier son fondement. Le Katanga y était présenté comme le noyau d’une future confédération des Etats du Congo. L’objectif poursuivi consistait à faire basculer dans le camp katangais les autres régions du pays, de sorte que l’unité du pays ne soit nullement compromise par le projet sécessionniste. Le Katanga lui-même y apparaissait comme une oasis de paix, un pays où Blancs et Noirs avaient les mêmes droits [16]. Mais ce discours ne circula que dans les milieux européens soucieux de se donner bonne conscience.
Chez les Africains, la proclamation de la sécession katangaise ne donna pas lieu à des réjouissances populaires, contrairement à celle qui avait été fêtée en grande pompe le 30 juin à Elisabethville. En fait, la sécession ne concernait que les bureaucrates. Lorsqu’elle fut rendue publique, une partie de la population katangaise n’y resta cependant pas indifférente : le Balubakat et l’ensemble du Cartel Luba contestèrent dès le départ l’initiative du gouvernement katangais et choisirent de s’inscrire en faux contre celle-ci. L’ensemble du fief des Luba Shankadi (Nord-Shaba) entrèrent en rébellion contre Tshombe. A Elisabethville même, il y eut des résistances. Au cours des 30 mois de la sécession, les Luba gardèrent leur position hostile au point que l’ensemble de l’itinéraire du Katanga indépendant ne fut pas de tout repos et connut une zone de guerre permanente dans sa partie septentrionale [17].
Le 8 août, comme on aurait pu s’y attendre, le Sud-Kasaï proclama lui aussi son « autonomie », dans des circonstances similaires, sous la pression discrète des forces extérieures. A la différence près que, au lieu de 1’Union Minière, c’est la Minière BCK qui l’imposa. Albert Kalonji lui-même l’a expliqué du haut de la tribune de la Conférence nationale souveraine (1992). Ecrasé par le poids des réfugiés chassés de Luluabourg comme du Katanga, Kalonji sollicita l’aide de la Minière de la BCK à Bakwanga, l’ancêtre de la M1BA actuelle. Son président, monsieur Cravatte, l’aurait rassuré en promettant de lui verser la part des dividendes dus à l’État sur le bénéfice et les droits de sortie du diamant pour la période de juillet à décembre 1960… « à la seule condition de proclamer l’indépendance et de se comporter en autorité publique pour éviter à la société de payer une seconde fois les impôts au gouvernement central ».
Et Kalonji de poursuivre :
Que pouvais-je faire d’autre avec, sur les bras, des milliers de femmes, des enfants et des hommes affligés, inconsolables d’avoir tout perdu et d’être devenus réfugiés sur leur propre terre ? Mais mon âme de nationaliste invétéré ne pouvait se résoudre à proclamer l’indépendance que nous avions déjà gagnée. Je me décidai à proclamer l’autonomie du Sud-Kasaï, pour sauver le peuple en danger de mort !
Décolonisation et 1ère république
Lucie Eyenga, la première voix féminine au micro, au cours des années 50.
1959, Patrice-Emery Lumumba devant les invités de l’université Libre de Bruxelles. A ses côtés, son proche collaborateur, Joseph-Désiré Mobutu, stagiaire à Inforcongo, le service d’information de la colonie (Photo Jean Guyaux, Bruxelles)
Premier diplôme d’ingénieur agronome remis par Mgr. Luc Gillon recteur de l’université à Pierre Lebughe, Kinshasa, le 28 juillet 1959. (Photo Congopresse.)
Le 30 juin 1960: les premiers animateurs de la démocratie naissante, de gauche à droite, debout et en grande tenue, Joseph Ileo président du sénat, Joseph Kasa-Vubu président de la république, Joseph Kasongo président de la Chambre des Députés et Patrice-Emery Lumumba premier ministre. (Photo RTNC)
<p « >
Ouverure de la Table politique à Bruxelles, le 26 avril 1960 à 11 h. au Palais des Congrès.
Vue d’une partie de la délégation congolaise. (Photo RTNC)
Le futur Premier ministre C. Adoula, «témoin» de I’engagement de collaboration entre le président de la république, Joseph Kasavubu et le Premier ministre Patrice-Emery Lumumba. (Photo RTNC)
Après le Conclave de Lovanium, à la conférence des pays non alignés à Belgrade, le vice-premier ministre A. Gizenga (à gauche) et le premier ministre C. Adoula (à droite, devant Bomboko le ministre des A ffaires Étrangères) entourent le premier ministre du Pakistan (Photo RTNC)
Le second souffle de Lumumba, Pierre Mulele, son ancien ministre de l’éducation nationale.
Le président de l’Etat sécessionniste du Katanga, Moïse Tshombe, reçoit le secrétaire général de l’ONU, Dag Hammarskjôld, à Elisabethville, le 12 août 1960 © Photo
Le président J. Kasa-Vubu accompagné du premier ministre du gouvernement de Salut Public, Moïse Tshombe, reçoit les lettres des créances d’un ambassadeur africain.
(Photo RTNC)
Une autre preuve d’injonction extérieure ? La sécession du Sud-Kasaï, comme celle du Katanga, n’arrêta nullement l’extraction des minerais. Bien au contraire, elle permit même une exploitation anarchique. Des avions venaient chercher, chaque semaine, la totalité de la production pour la transporter en Afrique du Sud (Boissonnade E., 1990, 55-57). Plus encore que dans le cas du Katanga, les circonstances concrètes offraient ici aux tenants de la sécession les prétextes nécessaires. D’abord, Albert Kalonji était le premier adversaire politique de Lumumba, en tant que porte-drapeau de … la dissidence du MNC. Il avait été banni de toute participation au gouvernement central, à la grande consternation des siens. Lumumba l’empêcha par la suite d’accéder à un poste d’importance au Kasaï: en effet, lors des élections provinciales, le MNC/L conclut une alliance avec les Luluwa et les autres tribus pour empêcher le MNC/Kalonji et donc les Luba, d’obtenir la majorité pour former le gouvernement provincial. Les Luba recoururent alors aux menaces en déclarant que, s’ils ne contrôlaient pas le gouvernement provincial, ils se verraient dans l’obligation de solliciter la création d’une province à eux, où ils seraient assurés d’être en sécurité. Rien n’y fit. Expulsés tant d’Elisabethville que de Luluabourg, ils réclamèrent, dès avant le 30 juin, la modification de l’article 7 de la Loi Fondamentale qui autoriserait la constitution d’une septième province. Plus grave encore, dès le 14 juin, ils mirent en place l’assemblée et le gouvernement (présidé par Ngalula) de cette province. Avec l’indépendance, ils n’eurent qu’à se déplacer de Luluabourg à Bakwanga [18].
L’annonce de la seconde sécession, alors que la première restait impunie, déclencha la colère de Lumumba. Le démantèlement de l’ensemble du pays était à craindre, car un autre exclu du premier gouvernement, Bolikango, rêvait lui aussi d’une « république autonome de l’Equateur » et l’Abako, par l’intermédiaire de son vice-président V. Moanda, aspirait à l’instauration d’un Etat de Kongo Central, encouragé en cela par l’abbé Youlou du Congo-Brazzaville. Confronté à tous ces adeptes du séparatisme, Lumumba perdait son sang-froid. Pouvait-il compter sur les forces extérieures ? Les troupes belges affectées dans le pays avaient été à l’origine de cette séparation du fait de leur attitude irrespectueuse envers le chef de l’État et lui-même. On ne pouvait compter sur elles. Qu’avait-il à espérer de l’ONU ? Les Casques bleus, depuis qu’ils étaient sur place, refusaient de se mettre au service du gouvernement central pour reprendre le Katanga par la force. De plus, le secrétaire général avait préféré négocier avec le Katanga, un pseudo-État qui n’était même pas reconnu. A ses yeux, l’ONU ne pouvait être d’aucun secours. Le premier ministre, toujours obnubilé par sa volonté de mettre fin à la sécession, pensa faire appel aux USA. C’est dans cette optique qu’il se rendit en Amérique du Nord, à la fin du mois de juillet, espérant par la même occasion faire taire ses détracteurs qui voyaient en lui un communiste voué à la cause de l’Union Soviétique. Malgré l’accueil courtois qu’il reçut à Washington et à Ottawa, Lumumba n’obtint aucun soutien concret.
Le Président Eisenhower, qui ne daigna même pas le recevoir, lui fit savoir que toute intervention de son pays se ferait par l’entremise de l’ONU. L’opinion que les puissances occidentales s’étaient faite du gouvernement Lumumba ne les encourageait guère à lui octroyer l’aide qu’il réclamait (Willame J.C., 1990 : 293-302).
Dans sa volonté farouche de préserver coûte que coûte le pays de la division, Lumumba se décida à combattre lui-même la sécession : ce serait la mission de l’armée nationale congolaise. L’entreprise était hasardeuse. Pour faire la guerre, il fallait de l’argent et une logistique appropriée : armes, munitions, moyens de transport. Or, à l’époque, tout faisait défaut : sur le plan budgétaire, c’était la banqueroute. Au 30 juin 1960, la trésorerie nationale accusait une impasse de 3 245 millions de FB. L’exécutif congolais ne pouvait survivre financièrement au-delà du 15 août, au dire des spécialistes sans une subvention de 2 milliards de FB qui lui serait allouée par la Belgique. Cette subvention ne fut qu’une promesse (Willame J.C. 1990 : 268). Au demeurant, la Banque nationale de Belgique exerçait encore une tutelle sur la Banque centrale du Congo belge et Ruanda-Urundi. A la table ronde économique, la Belgique s’était déclarée favorable à la création d’une Union monétaire entre elle et les futurs Etats de la CEPGL. Après la débâcle de juillet 60, elle était la première à souhaiter la séparation des patrimoines, pour éviter que la monnaie congolaise, dans sa chute, n’entraîne 1’ nsemble de son ancien empire et compromette ses relations financières avec le Rwanda-Urundi et… le Katanga [19].
La Belgique, qui avait offert au Congo indépendant une Loi Fondamentale, ne lui fournissait même pas les fonds nécessaires à l’application de cette loi [20].
Dépourvu d’argent, Lumumba était également presque sans armement. L’aviation de la Force Publique, on l’a dit, avait pris parti pour les sécessionnistes (Vandewalle, 1974 : 154 ; Weber G., 1983 : 115). Il n’était plus question de compter sur les munitions provenant de l’ancienne métropole, comme à l’époque coloniale, alors que le Katanga continuait à en bénéficier. L’Armée Nationale Congolaise était en piteux état, menée par des officiers à peine nommés, plus proches de leurs leaders régionaux que du haut commandement militaire qui était lui-même en crise. Mobutu, le chef de l’état major, inspirait la méfiance (Kanza T., 1978 : 274). En fait, face à un Katanga bien armé, le gouvernement Lumumba ne faisait pas le poids.
Le Premier ministre, loin de déclarer forfait, décida malgré tout de passer à l’attaque par deux opérations simultanées, via Luluabourg et Bakwanga et via le Kivu au départ de Stanleyville, en se fondant sur un hypothétique soutien de l’URSS. L’offensive fut déclenchée le 22 août. Les troupes de Thysville acheminées à Luluabourg progressèrent vers Bakwanga qu’elles occupèrent le 27. La seconde étape de l’offensive devait, au départ de Stanleyville, passer par deux voies, Luluabourg et le Kivu. Le transfert des troupes à Luluabourg tourna court faute d’avions, malgré les promesses soviétiques d’assurer un pont aérien [21]. Les effectifs censés passer par le Kivu atteignirent quant à eux la frontière katangaise vers le 8 septembre et crou- pirent.sur place, faute d’argent et de support logistique (Willame J.C., 1990 : 187- 192).
L’offensive avait échoué, sauf au Kasaï, où elle réussit quelque peu, sans toutefois dépasser cette région ; le Katanga ne fut donc pas inquiété. Non seulement cette tentative n’avait pas atteint son objectif, mais de plus elle se mua en un massacre généralisé des autochtones à partir du 29 août.Des milliers de Luba succombèrent dans ce génocide. La trop grande assurance de Lumumba allait le perdre. Il n’avait pas prévu que cet acte de violence aurait de sérieuses répercussions sur la politique locale à laquelle il participait en tant que ressortissant de la région. Pour les Luba, il faisait désormais figure d’assassin. Cet incident eut pour effet de renforcer l’opposition qui s’était organisée contre lui et renforça les Luba dans leur solidarité. Réfugiés à Elisabethville, le Président Kalonji et son Premier ministre Ngalula levèrent une armée de « volontaires » recrutés parmi les travailleurs « kasaïens » au Katanga. Cette armée hétéroclite prit le train, le 1er septembre, à destination du Kasaï (Kestergat J. 1986 : 74). Avec le soutien du Katanga et l’encadrement des officiers européens, les Luba commencèrent à reconquérir le pays. Ils reprirent Bakwanga, le 23 septembre, après un repli des troupes de l’ANC ordonné par Mobutu [22]. On récupéra le matériel militaire abandonné par les occupants lumumbistes. ce qui renforça l’armée sud-kasaïenne. L’Etat reprit forme et fut subdivisé en arrondissements, communes et quartiers ; toujours régi par sa Constitution provisoire, déjà promulguée le 5 septembre 1960 [23]. La solidarité luba continua de se construire autour de trois leaders qui s’étaient occupés de l’exode au Sud-Kasaï et de l’installation des réfugiés : Mgr Nkongolo, évêque de Bakwanga, J. Ngalula mais surtout A. Kalonji. Grâce au prestige que son parti et lui-même gagnèrent, il se fit proclamer Mulopwe et donna à l’État sud-kasaïen le titre d’« empire » [24], ce qui déplut profondément à l’élite intellectuelle de la région. Ces « Bena Mukanda » (littéralement, les Lettrés) – anciens conseillers ou ministres – furent contraints de s’exiler à Léopoidville. C’est là que Ngalula lui-même, démis de ses fonctions de Premier ministre, prit la tête de l’opposition et s’enrôla dans le parti démocratique récemment constitué en vue de mettre un terme aux élucubrations de Kalonji. Tout comme au Katanga, la sécession s’était installée sans faire l’unanimité de la population, de sorte qu’elle dut faire face à des mouvements d’opposition actifs.
1.3 L’affaire Lumumba
Entre-temps, le jeune Premier ministre Lumumba défrayait la chronique, parce qu’il avait réussi en moins d’un mois à décourager une bonne partie de ses amis et à réunir contre lui la plupart des forces en présence. L’ancienne métropole n’était pas prête à oublier « l’injure » faite à son roi, lors de la cérémonie du 30 juin 60, et la manière dont les relations diplomatiques furent rompues, même si cette rupture ne fut « consommée » qu’un mois plus tard, par l’expulsion effective de l’Ambassadeur Van den Bosh (9 août). Il est donc certain que la Belgique ne manqua pas d’exercer des pressions pour que Lumumba soit révoqué. Van Bilsen, à l’époque conseiller de Kasa-Vubu, reconnaît que le Premier ministre Eyskens le chargea, le 18 août, de dire à celui-ci que Lumumba devait être révoqué et qu’il en avait le pouvoir (Willame J.C. 1990 : 271). L’ONU, quant à elle, suite à la mésentente survenue le 15 août entre son secrétaire général et le Premier ministre, semblait partager cet avis. En effet, les menaces fréquentes de faire appel à Moscou, du reste peu disposée à lui fournir l’aide attendue, contribuèrent à isoler Lumumba en cette période de « guerre froide », où le monde dit libre et le bloc soviétique s’affrontaient ouvertement dans l’arène de l’ONU. Les pays occidentaux sentaient qu’il gagnait du pouvoir sur Kasa-Vubu et étaient peu enclins à le laisser faire. Pour eux, le chaos du Congo était un moindre mal ; il fallait surtout éviter à tout prix que l’ex-Congo belge, vu son importance stratégique, bascule dans le camp communiste.
Lumumba n’était vraisemblablement pas conscient de l’importance de cet enjeu. Il semble qu’à ce propos, la CIA ait arrêté deux dispositions : le supprimer physiquement et le faire remplacer par quelqu’un de son envergure, issu du camp lumumbiste mais pro-occidental cette fois. L’oiseau rare promis à ce destin aurait été J.D. Mobutu (Boissonnade E. 1990 : 77-78). La décision de l’élimination d’abord politique puis physique fut prise par l’administration Eisenhower à la mi-août, lorsque Lumumba décida de rompre avec l’ONU. Comme il se montrait prêt à tout pour ramener le Katanga dans le giron congolais, on le soupçonna d’être capable de faire basculer le Congo dans le camp communiste ; il sollicita effectivement de l’URSS une implication militaire directe. Il semble que son assassinat avait été prévu pour le 26 août. Une première tentative, tout à fait rocambolesque, il faut le dire, consista à introduire un poison mortel dans ses aliments ou sur sa brosse à dent. On ne fit appel à un spécialiste de ce genre de mission que vers le 19 septembre, mais un imprévu l’empêcha de passer à l’action. La seconde tentative eut lieu en novembre, alors que Lumumba avait projeté de se rendre à Stanley ville. Le « plan » consistait à l’y précéder et à l’abattre à son arrivée (Kalb M. : 129-133 ; 149-159) [25].
Etait-il nécessaire d’aller si loin ? Le pauvre Lumumba était déjà l’objet d’une opposition systématique de la part de certains de ses compatriotes, dont quelques-uns étaient soutenus financièrement par les Belges et les Américains. Ces ennemis comptaient même des complices au sein de son propre gouvernement. Au Parlement, le groupe Abako lui faisait carrément la guerre parce qu’il s’opposait à la réalisation de son projet d’un Bas-Congo fort avec Léopoldville pour capitale.
Lumumba était devenu beaucoup trop gênant. Les anciens routiers du MNC, ceux qui avaient été à la base de la création d’un » mouvement » depuis Conscience Africaine – Iléo, Ngalula, Diomi, Adoula – supportaient mal d’avoir été supplantés par cet outsider venu de Stanleyville. La toute-puissante Eglise catholique était mécontente, elle aussi. Elle lui en voulait d’abord pour son communisme présumé, mais aussi pour sa volonté de « nationaliser » l’université Lovanium, soutenu en cela par le ministre de l’Education nationale, Pierre Mulele [26].
Kasa-Vubu n’avait certainement pas décidé spontanément de révoquer le Premier ministre. De nombreuses pressions tant intérieures qu’extérieures l’y amenèrent. Il est également établi qu’il avait eu vent des complots qui se tramaient en vue d’assassiner Lumumba [27]. Est-ce pour contrer ce projet qu’il précipita la révocation de ce dernier, ou prit-il cette décision en fonction du plan élaboré pour en faciliter l’exécution, ou encore parce que le comportement de Lumumba l’agaçait ?
Toujours est-il que le 5 septembre, à 20hl0, dans une brève allocution qui interrompit les programmes de la radio, le président apprit à la population congolaise que le Premier ministre (qu’il qualifia dans son émotion, de premier bourgmestre) était révoqué. Pourquoi ? «… Il a recouru à des mesures arbitraires qui ont provoqué la discorde au sein du gouvernement et du peuple. Il a gouverné arbitrairement. Et maintenant encore, il est en train de jeter le pays dans une guerre civile atroce ». Une véritable stupeur s’empara de la population, qui ne s’attendait nullement à cette décision. Qu’allait faire Lumumba ? On n’eut guère le loisir de se poser trop de questions car sa voix retentit peu après sur les mêmes ondes et les propos qu’il tint étonnèrent davantage encore les auditeurs : « Le gouvernement populaire reste à son poste. A partir d’aujourd’hui, je proclame que Kasa-Vubu qui a trahi la nation, qui a trahi le peuple pour avoir collaboré avec les Belges et les Flamands, n’est plus chef de l’État » (Heinz G. et Donnay H. 1966 : 22). Au cours de cette même soirée, il intervint encore à trois reprises à la radio.
Lumumba réagissait en toute connaissance de cause [28]. Il était conscient de l’importance que la contribution de son parti majoritaire avait eue dans l’élection de Kasa-Vubu à la présidence de la République : sans cela, il n’aurait certainement pas pu être élu. Pourtant, au regard de la Loi Fondamentale, la réalité était tout autre. D’après celle-ci, le locataire du Mont-Stanley chargé d’inaugurer les chrysanthèmes disposait d’un pouvoir énorme, celui de nommer et de révoquer le Premier ministre (article 22). Préoccupé par mille et une questions, Lumumba ne s’était probablement pas rendu compte que cette subtilité le mettait dans une situation précaire, en dépit de la majorité dont il disposait dans les Chambres. Il s’attendait toutefois à être victime d’un piège. Depuis des semaines, il ne cessait d’évoquer des complots qui seraient dirigés contre lui. La presse catholique (Courrier d’Afrique et Présence Congolaise) ne l’épargnait guère. Les syndicalistes de l’UTC, de la FGTK et de l’APIC l’accusaient de démagogie et d’incompétence face au chômage croissant et à la hausse des prix. Une véritable coalition d’opposition anti-lumumbiste s’était constituée à Brazzaville avec l’aide discrète de la Belgique et le soutien du Katanga. Elle disposait d’un émetteur radio – radio Makala – qui déversait, par-delà le fleuve, un flot de propagande contre Lumumba et ses collaborateurs (Kestergat J. 1986 : 77) [29]. L’originalité du moment résidait dans le fait que l’instrument du complot était Kasa-Vubu, avec qui il avait si bien collaboré au cours des chaudes journées du mois de juillet.
Lumumba mit son offensive au point et misa sur les Chambres dont il sollicita les pleins pouvoirs. Face à cette situation juridique délicate, le Parlement réagit en annulant d’abord les deux destitutions. Ensuite, réunies en « Congrès national », les deux Chambres décidèrent de constituer une commission « compromissoire » de Sages, composée de Okito, Kasongo et Weregemere, chargée de réconcilier les deux dirigeants. La démarche n’avait rien d’illusoire, elle fut même encouragée par plusieurs autres initiatives, entre autres celles de l’ambassadeur du Ghana, du président Nkrumah lui-même, des fonctionnaires de l’ONU et même de Frantz Fanon (Willame J.C. 1990 : 427-429). Un projet d’accord fut même élaboré portant sur la répartition de compétences entre les deux fonctions (Gérard – Libois J. et Verhaegen B. 1961 : 867). En réalité, cette réconciliation était impensable car trop de personnes avaient intérêt à ce qu’elle ne se fasse pas [30].
Lumumba parvint à obtenir auprès des Chambres les pleins pouvoirs qu’il avait sollicités (13 septembre). Fort de cette assurance, il sollicita par l’intermédiaire de T. Kanza l’appui de l’ONU pour faire prévaloir sa légitimité. Etait-il en droit de l’espérer ? Kasa-Vubu, de son côté, ne resta pas inactif. Le 5 septembre, il prit soin de compléter l’exercice des prérogatives qui lui étaient reconnues par l’article 22 de la Loi Fondamentale, en nommant un Premier ministre : J. Ileo. Les Chambres n’eurent même pas l’occasion de discuter de l’éventualité de son investiture, tant elles étaient préoccupées par le conflit Lumumba – Kasa-Vubu. C’eût été peine perdue, puisque le gouvernement n’eut pas le temps de fonctionner : en effet, le 14 septembre, le Président annula les pleins pouvoirs accordés à Lumumba et décréta l’ajournement des Chambres.
Seule la présence de l’ONU empêcha le pays de sombrer dans une violente guerre civile entre les partisans des deux antagonistes. Lumumba opta pour la lutte directe, abordant la foule pour la haranguer au risque de se faire arrêter. Dès le 6 septembre, un mandat d’amener fut lancé contre lui. Sur base de celui-ci, on l’arrêta le 11, mais il fut aussitôt relâché grâce à l’intervention du général Lundula. Le président réagit aussitôt et démit celui-ci de ses fonctions [31].
Le 15 septembre Lumumba, en essayant de rallier les militaires à sa cause au Camp Léopold, se trouva face aux soldats originaires du Sud-Kasaï qui s’en prirent violemment à lui. Il se réfugia au mess des officiers et ne dut son salut qu’à la protection de l’ONU. Son initiative était aussi excessive qu’inutile ; en effet, la veille, le mercredi 14 septembre à 20h30, le Colonel Mobutu avait proclamé la « neutralisation » des institutions politiques, interdisant à Kasa-Vubu, à Lumumba. à Iléo et au Parlement toute initiative et toute activité. Il confia l’exercice du pouvoir à un Collège de commissaires généraux, dirigé par Bomboko et composé d’étudiants universitaires. [32] Mais l’impartialité du Collège dans le conflit opposant Kasa-Vubu et Lumumba était contestable. Non seulement la plupart de ses membres se recrutaient parmi les antilumumbistes, mais il s’était fait nommer, le 27 septembre, par le président Kasa-Vubu pourtant destitué lui aussi. Le colonel Mobutu lui-même se plaignit de cet état de faits.
Cette fois, Lumumba comprit que le temps travaillait contre lui. Aussi ordonna- t-il à ses fidèles et aux cadres lumumbistes menacés de gagner Stanleyville par tous les moyens. Cet ordre émanait à la fois de Lumumba lui-même et des différents leaders des partis prolumumbistes, entre autres le CEREA et le PSA. Il était prévu que, depuis Stanleyville, les lumumbistes exerceraient une pression vigoureuse en faveur de la libération de leur leader. En effet, à Léopoldville où il se retrouvait en résidence surveillée dans sa villa de l’avenue Tilkens, Lumumba devait la vie à l’ONU, dirigée par l’Indien Dayal – le remplaçant de Ralph Bunche, rappelé à New York – et au colonel Mobutu qui avait refusé jusque-là de donner suite aux demandes d’arrestation répétées des commissaires généraux. La résidence du Premier ministre fut cernée par un premier cordon de Casques bleus ghanéens affectés à sa protection, puis d’un second constitué de soldats de l’ANC, prêts à l’arrêter au cas où il viendrait à sortir, comme il le fit le 9 octobre, pour s’adresser à la foule.
La complicité internationale, habilement orchestrée par le colonel Mobutu au détriment de Lumumba, permit à Kasa-Vubu de se faire reconnaître le 23 novembre par l’Assemblée générale de l’ONU comme seul pouvoir légal au Congo. Il ne resta plus à la délégation de Kanza qu’à plier bagages et quitter l’enceinte de l’ONU. Lumumba comprit alors qu’il devait faire vite : non seulement de nombreux lumumbistes arrêtés étaient acheminés à la prison de Luzumu mais ses amis du camp progressiste se trouvaient désormais dans une position diplomatique délicate vu l’option prise par l’ONU. Il décida de se rendre à Stanleyville.
Le 27 novembre, Kasa-Vubu revint triomphalement à Léopoldville après avoir négocié sa légitimité à New York. Le lendemain, Brazzaville était en liesse. Kasa-Vubu devait s’y rendre pour participer au défilé et rencontrer Tshombe, qui serait également l’hôte de l’abbé Youlou. La nuit du 27 au 28 fut le moment choisi par Lumumba pour s’enfuir et rejoindre ses partisans à Stanleyville. En effet, quelques jours plus tôt, Antoine – Roger Bolamba qui assurait ses contacts avec l’extérieur lui avait soumis une étude qui lui démontrait l’intérêt de Stanleyville comme base et comme point de départ pour reconquérir l’ensemble du pays (Heinz G. et Donnay H. 1976 : 17). Comme les autres lumumbistes qui rejoignirent Stanleyville par le Kwilu, les militants du PSA s’organisèrent, afin que le voyage se déroule sans problèmes. Kamitatu lui décrivit l’itinéraire à suivre et informa les responsables locaux [33]. C’est vers 22h que Lumumba quitta sa résidence, dissimulé derrière le siège arrière de sa voiture. Il alla chercher sa femme Pauline et son fils Roland. Avec quelques amis, parmi lesquels B. Diaka (devenu Mungul-Diaka), ils prirent la route de Kenge qu’ils atteignirent le 28 novembre dans l’après-midi, puis Masi-Manimba. A Bulungu, où ils parvinrent le 29 novembre, ils furent retardés : reconnu par la population, Lumumba dut prendre la parole. On considère que l’information fut transmise alors à Kinshasa et que les forces de l’ordre purent localiser le convoi. Passé Bulungu, ils arrivèrent à Mangai (30 novembre à 9h), après avoir traversé la Pio-Pio à Punkulu. Là aussi, l’accueil de la population leur fit perdre un temps précieux.Dans la nuit, ils atteignirent Brabanta (Mapangu) puis Port-Franqui (Ilebo). Là, Lumumba échappa à une première tentative d’arrestation (1er décembre). Il arriva à Mweka où il tint encore un meeting. Il partit précipitamment dans l’après- midi, lorsqu’il eut appris que des militaires de Port-Francqui étaient à sa poursuite. Il se dirigea vers Lodi, situé sur la rive gauche du Sankuru, retardé à plusieurs reprises par des crevaisons de pneu.
Il était environ 23h lorsqu’ils y arrivèrent. Les passeurs avaient déjà gagné l’autre rive avec le bac. Finalement P. Lumumba, P. Mulele et V. Lubuma traversèrent en pirogue et convainquirent non sans mal les passeurs de ramener le bac sur l’autre rive, où étaient restés la famille et les amis de Lumumba. C’est à ce moment, vers 1h du matin, que les soldats lancés à leur poursuite arrivèrent. Ils arrêtèrent les fugitifs et les reconduisirent à Mweka (2 décembre) [34] où une dernière tentative d’évasion fut organisée, mais en vain [35]. Lumumba, surnommé par la sûreté nationale que dirigeait V. Nendaka, « le grand lapin », fut définitivement arrêté. L’officier de liaison chargé de le récupérer, Gilbert Pongo, était un inspecteur de la Sûreté qui s’était spécialisé dans le domaine du contre-espionnage en Europe ; il vint lui-même le chercher pour l’emmener à Léopoldville. A Port-Franqui, un Européen qui avait contribué pour une grande part au repérage du convoi de Lumumba, conseilla à Pongo de conduire Lumumba au Katanga, où il serait jugé pour des délits et crimes de droit commun (Artigue, P. 1961 : 284). Mais Pongo préféra s’en tenir aux ordres de ses chefs, et ramena le prisonnier à Léopoldville (Heinz G. et Donnay H. 1976 : 60,11-18). Conduit à Kinshasa, Lumumba fut finalement transféré à Thysvilie sous la garde des troupes d’élite commandées par Bobozo. Là, il rejoignit neuf autres prisonniers lumumbistes parmi lesquels M. Mpolo, arrêté à Mushie alors qu’il tentait de gagner Stanleyville, et Joseph Okito, le vice-président du Sénat devenu président depuis la nomination de Ileo en tant que Premier ministre.
Que fallait-il faire de Lumumba ? On pensa d’abord préparer un procès pour le juger pour ses crimes. Cependant, à l’époque, le président Kasa-Vubu était plutôt préoccupé par la réconciliation nationale. Une « table ronde » était en préparation où l’on espérait voir siéger aussi bien des représentants du Katanga, du Sud-Kasaï, que ceux du camp lumumbiste. Les Occidentaux voyaient là une nécessité de susciter le « front commun des modérés », soit une réconciliation d’Elisabethville. Bakwanga et Léopoldville qui mettrait un terme au combat contre le camp lumumbiste. Les différents conseillers militaires européens, pour la plupart des anciens de la Force Publique, comme on l’a dit, qui entretenaient des relations confraternelles malgré les oppositions existant entre les chefs congolais, s’arrangèrent pour que l’on exclue à l’unanimité Lumumba du projet de la table de négociation. Kalonji refusa de participer à toute table ronde où Lumumba serait présent ; Tshombe précisa qu’il n’y trouverait sa place qu’en tant qu’accusé siégeant face à ses pairs réunis. Mais que faire ? Le transférer en un lieu sûr et le confier à ses pires ennemis du Sud-Kasaï ou du Katanga ? Il en avait déjà été question, mais aucune décision n’avait été prise. Au début du mois de janvier les incidents qui survinrent précipitèrent le cours des choses [36].
Stanleyville qui, depuis le 13 décembre, s’était proclamée le « seul gouvernement légal du Congo » venait de se révéler comme un véritable danger. Avec l’aide de l’ANC – Lundula, Bukavu fut investi, et le gouverneur en place et ses ministres furent arrêtés (25 décembre). Kashamura s’y installa en tant que « répondant » du pouvoir de Stanleyville. Mobutu, tentant de récupérer le Kivu, envoya un détachement de ses commandos via Usumbura-Cyangungu, avec la complicité de la Belgique qui occupait encore le Rwanda-Urundi (Kestergat J. 1976 : 92). Le 1er janvier, le commando, dirigé par G. Pongo, spécialiste des missions délicates, échoua. Les attaquants, leur chef y compris, furent faits prisonniers et transférés à Stanleyville.
A la même époque, l’ANC – Lundula progressant vers le Nord-Katanga s’empara de Manono où fut instauré un gouvernement de Lualaba anti-tshombiste lié à Stanleyville. La panique gagna Léopoldville, car la rumeur annonçait un projet d’offensive gizengiste sur Coquilhatville. Stanleyville négocia la libération de Lumumba et ses compagnons en échange de celle de G. Pongo et d’autres prisonniers de l’ANC arrêtés au Kivu. Comme Léopoldville refusait, Pongo et les siens furent exécutés.
Une situation nouvelle se dessinait dans la capitale et dans ses environs immédiats où l’on enregistra à nouveau, du 7 au 14 janvier, une succession de mutineries militaires à Thysville et à Léopoldville. Les problèmes de soldes, de grades et d’inégalités furent à nouveau évoqués. Il devenait urgent pour le pouvoir de Léopoldville de régler le problème Lumumba, au risque de le voir resurgir à la faveur de l’effervescence qui gagnait les camps militaires. En effet, une fois arrêté, Lumumba s’attira à nouveau la sympathie de quelques-uns. Manifestement le temps travaillait pour lui. Même à l’ONU, la pression en faveur de sa libération, se faisait plus forte et plus pressante. A Washington, le républicain Eisenhower allait quitter le Maison Blanche. L’investiture du jeune démocrate élu, J.F. Kennedy, était prévue pour le 20 janvier. Il fallait en finir avec l’affaire Lumumba avant cette échéance. Les commissaires généraux pensèrent d’abord le transférer au fort de Shinkakassa, puis ils optèrent pour une destination lointaine du Sud-Kasaï ou du Katanga. Le Sud-Kasaï insistait surtout pour avoir la garde du prisonnier. Les conseillers belges avaient une préférence pour cette destination, du fait que la Belgique était moins engagée dans cette sécession ; et les répercussions internationales de ce qui pourrait arriver là-bas seraient par conséquent moins graves pour elle. Entre-temps, les conditions de détention à Thysville se dégradaient de plus en plus. Lumumba s’en plaignit auprès de M. Dayal, représentant de l’ONU (Van Lierde J. 1963 : 391-393). A son ami Onawelo, il transmit par courrier ses dernières décisions pratiques comme père de famille. Il rédigea également une lettre à sa seconde épouse qui se trouvait au Caire, lettre qui demeura célèbre parce qu’elle tient lieu de testament politique, véritable présage du « triomphe de la cause sacrée à laquelle ses compagnons et lui consacraient toute leur vie » (Heinz G. et Donnay H. 1976 : 195). Cette correspondance constitua son chant du cygne (Willame J.C. 1990 : 456). Qui pouvait deviner alors que sa mort était imminente ? [37]
La journée du mardi 17 janvier, la dernière que connut Lumumba, fut l’une des plus longues. Son déroulement avait été minutieusement mis au point, si l’on en juge par les moyens matériels qui y furent mis en oeuvre. Trois avions furent réquisitionnés ; un Dragon rapide d’Air-Brousse, qui avait quitté Kinshasa la veille, passa la nuit à l’aérodrome de Sonankulu pour être à Lukala de bonne heure ; un DC3 fut envoyé très tôt en éclaireur à Bakwanga pour voir si l’aéroport était gardé par les Casques bleus, susceptibles de réclamer la libération du prisonnier ; un DC4 se rendit à Moanda pour y prendre Lumumba.
Pour celui-ci, la journée commença vers 4h30 du matin, lorsque Nendaka vint le tirer de sa prison, escorté de deux ou trois soldats luba qui étaient sous les ordres du lieutenant Zuzu, officier particulièrement efficace dans les opérations répressives. Le chef de la sûreté était porteur d’une levée d’écrou en bonne et due forme, probablement signée par Kasa-Vubu. Lumumba manifesta une certaine résistance dont on vint rapidement à bout. Un petit convoi se forma, qui prit la direction de Matadi pour se rendre à Lukala où attendait l’avion d’Air-Brousse. Celui-ci décolla à 8hl5 avec les passagers à son bord et atteignit Moanda 75 minutes plus tard, soit à 9h30. Le DC4 attendait depuis deux heures. Cet avion était venu de Kinshasa avec deux passagers : Ferdinand Kazadi, commissaire général à la Défense nationale, qui avait été torturé par les lumumbistes dans les prisons de Luluabourg et Jonas Mukamba, commissaire au Travail et à la Prévoyance sociale qui aurait dû les précéder à Bakwanga à bord du DC3, si la destination initiale du prisonnier, Bakwanga, avait été maintenue. N’ayant pas été prévenu de ce changement, l’équipage du DC3 avait quand même décollé de Ndjili. Mais il rebroussa chemin après deux heures de vol lorsqu’il reçut ce contrordre.
Prirent alors place dans le DC4, outre l’équipage et les trois prisonniers Lumumba, Mpolo et Okito, les deux commissaires, et le lieutenant Zuzu accompagné de ses militaires [38]. Nendaka retourna à Kinshasa à bord de l’avion d’Air-Brousse. Dans le DC4, la composition des accompagnateurs, civils et militaires était homogène du point de vue ethnique : tous étaient luba. Ce choix avait été sans doute fait en fonction de la destination première de l’expédition ou, plus sûrement encore, à cause du sentiment de vengeance ressenti par les Luba à l’égard de l’auteur du génocide de Bakwanga. L’avion décolla de Moanda à 10 heures pour Elisabethville. Il survola l’Angola par la voie la plus rapide. Le voyage devait durer un peu plus de 5 heures (Brassine J. et Kestergat J., 1991 : 126-131).
Mais le voyage ne fut guère de tout repos car l’escorte s’acharna sur les prisonniers, comme en témoigna l’équipage :
La vue des sévices provoqua chez le radio des vomissements ; quant au commandant, il tenta de calmer les soldats dont les brusques allées et venues et les gesticulations incohérentes menaçaient la stabilité de l’appareil. Le commandant chercha à connaître les intentions de Kazadi : avait-il l’intention de laisser tuer les prisonniers à bord de l’appareil ? Kazadi affirma avec flegme qu’ils arriveraient vivants. Finalement, l’équipage s’enferma dans le cockpit (Heinz G. et Donnay H., 1976 : 110).
L’annonce de « trois colis précieux », à l’arrivée de l’avion, créa la surprise parmi les responsables katangais et leurs conseillers belges. Tshombe se trouvait quant à lui dans une salle de cinéma de la ville où on projetait un film sur le réarmement moral. Munongo, le ministre de l’Intérieur, se présenta à l’aéroport au moment où l’on donnait l’autorisation d’atterrir. Il était 16h45 et l’aéroport de Luano grouillait de monde, un avion provenant de Luluabourg était prévu. Les prisonniers sortirent de l’avion contusionnés mais vivants. Ils furent emmenés aussitôt dans une villa isolée où des soldats s’acharnèrent sur eux, puis ils furent conduits 20 km plus loin sur la route de Likasi où on les acheva (Willame J.C., 1990 : 464) [39].
Une nouvelle page de la « crise congolaise » allait être tournée quand Munongo annoncerait près d’un mois plus tard que les prisonniers « s’étaient enfuis » et qu’ils avaient été « massacrés par la population ». Personne ne fut dupe. Cette nouvelle venait confirmer la rumeur qui circulait déjà.
La tension fut vive à l’ONU et dans le monde. On enregistra un peu partout d’importantes démonstrations de protestation contre la Belgique, les USA et l’ONU : au Caire et à Djakarta, des ambassades belges furent saccagées ; il y eut des manifestations à Copenhague, Varsovie, Prague, Tokyo, Dakar, Johannesbourg, Téhéran, Athènes, Montréal, Singapour, La Havane, Lima, Caracas, Los Angeles, Bonn et Tel-Aviv. [40]
Lumumba avait été victime à la fois de son idéalisme, de son radicalisme et de sa formation politique insuffisante, limitée à quelques lectures personnelles et au souci d’imiter Nkrumah et Sekou Touré. En effet, en deux mois de gouvernement, il avait accumulé une série quasi exceptionnelle d’erreurs politiques, depuis le discours inutilement iconoclaste du 30 juin jusqu’à la « fuite » vers Stanleyville, en passant par la rupture maladroite avec Dag Hammarskjôld et les attaques du Sud-Kasaï qui furent indirectement à l’origine du génocide luba.
Cependant, après la mort de Lumumba, la « crise congolaise » se retrouva sans son bouc émissaire. Le mouvement de désintégration nationale n’avait plus sa justification. Les problèmes devaient désormais être examinés sous leur vrai jour. Il fallait reconquérir l’unité. Mais à quel prix ?
Le sang du martyr déchaîna les passions à l’égard du pays, lequel, à l’image du monde en proie à la « guerre froide », se scinda en deux pôles : d’une part Léopoldville, dominée par le « groupe de Binza », et d’autre part Stanleyville, qui devint le bastion des « nationalistes ». Chaque camp se préoccupa de résoudre le problème des sécessions. Dans le même temps deux sensibilités nationalistes, tout à fait différentes et parfois divergentes, avaient vu le jour et allaient marquer le cours de l’histoire future du pays.
L’opposition Lumumba-Kasa-Vubu fut le symbole d’une lutte d’influence plus importante, au lendemain de l’indépendance entre les « modérés » et les « radicaux ». Kasa-Vubu représentait l’aile modérée, accommodante vis-à-vis du pouvoir colonial d’hier, et soutenue par les forces occidentales (Belgique, USA, ONU). Lumumba constituait la figure de proue de la tendance « révolutionnaire », favorable au changement radical et davantage tournée vers les pays socialistes, notamment vers l’URSS évoquée à tout moment comme la seule alternative possible à toute défaillance du camp occidental dans la gestion des affaires du Congo. Le camp Kasa-Vubu, bien qu’opposé aux sécessions katangaise et sud-kasaïenne, était allié à celles-ci puisque il était soutenu par les mêmes puissances occidentales. Au demeurant, tout le monde savait que, si l’on n’avait pas installé en toute hâte Kasa-Vubu sur le fauteuil présidentiel, celui-ci aurait été le premier sécessionniste. L’histoire politique du Congo qui se déroula suite aux initiatives des modérés est assez connue. Elle eut pour cadre essentiellement le Sud, avec Léopoldville pour la tête et Elisabethville pour le cœur.
L’itinéraire politique des « radicaux », les lumumbistes, les partisans de la manière forte à l’égard de l’impérialisme occidental est par contre plus difficile à retracer. En raison de leur foi dans l’intégrité nationale et leur défense pure et dure de l’unité nationale, on les qualifie de nationalistes. Cette histoire « militante» qui s’élabora à partir de Stanleyville, au contact des capitales des pays de l’Europe de l’Est et de l’Asie, demeure quelque peu « secrète » [41]. En réalité, c’est l’histoire des vaincus, de ceux-là mêmes qui allaient subir le martyre pendant des décennies. La révocation de Lumumba et son assassinat constituèrent les premières défaites de cette sensibilité ; elle puisa toutefois dans cet épisode malheureux des énergies nouvelles pour poursuivre son combat.
A ce moment, l’Afrique faisait encore l’apprentissage de son autogestion, au- delà des frontières qui séparaient les différents empires coloniaux. Certes, l’OUA n’existait pas encore. Cependant, deux regroupements s’étaient opérés, soutenant chacun les deux sensibilités congolaises. Le groupe dit « de Monrovia » regroupant le Congo de l’abbé Youlou, le Libéria de Tubmann, l’Ethiopie de l’empereur Hailé Selassié, soutenait le camp pro-occidental, tandis que le groupe dit « de Casablanca », avec le Maroc du roi Muhamed V, l’Egypte de Nasser, le Ghana de Nkrumah, la Guinée de Sékou Touré soutenait Lumumba et ses alliés. Cette dernière tendance était relayée par le groupe des pays non alignés issus de Bandoeng. C’est dire que le conflit qui passait pour être purement « zaïrois » avait des ramifications africaines et internationales, ce qui expliquait sa complexité. Il importe de bien comprendre le déroulement de cette double histoire qui, par rapport au devenir du Congo, constitue à la fois sa grande chance et l’origine de ses malheurs.
2.1 La gestion politique à partir de Léopoldville
Dès février 1961, l’antagonisme se fit plus radical. A Léopoldville, parmi ceux qui se reconnaissaient en rupture de ban avec les positions extrémistes de Lumumba, on reconnaissait aussi bien les anciens adversaires du Premier ministre au sein du MNC (Iléo, Nendaka), et les politiciens issus des partis modérés (Kasa-Vubu, Delvaux. Bomboko) que des personnes isolées qui, au fil des événements, devinrent des adeptes objectifs de cette tendance (Mobutu, Ndele, Kandolo, Adoula). Ils formaient le Groupe de Binza. L’origine de cette dénomination – qui apparut dès 1960 – s’explique par le fait que le noyau originel habitait le camp des paracommandos de Binza, non loin du mont Stanley (mont Ngaliema actuel). Ces locataires du camp militaire (Nendaka, Mobutu, Ndele, Bomboko) se muèrent en véritables éminences grises de la politique du pays (Kamitatu C., 1971 : 97-99 : Chômé J., 1974 : 87).
La lutte contre Lumumba, à partir d’août 1960, les amena curieusement à se rapprocher davantage des meneurs de sécessions avec lesquels ils avaient, il est vrai, des points communs. Ainsi Bakwanga, occupé par l’ANC sur l’ordre de Lumumba le 27 août, retrouva-t-il sa liberté le 23 septembre, après que le repli des troupes de l’ANC eut été ordonné par Mobutu. Avec le Katanga, les rapports furent fréquents. Plusieurs dignitaires de Léopoldville n’hésitèrent pas à s’y rendre. Le président Kasa-Vubu aurait même pu y être accueilli le 12 juillet, au lendemain de la proclamation de l’indépendance, s’il n’avait été accompagné de Lumumba. En août. Adoula et Delvaux y effectuèrent une mission dans le cadre de la réconciliation nationale. Ce dernier y retourna en janvier 1961 pour négocier le transfert du premier prisonnier politique de la République. Toujours en août, lorsque le Katanga créa sa propre banque nationale, Tshombe fit preuve d’une générosité inopinée à l’égard de Léopoldville. Il y fit parvenir plusieurs malles de francs congolais jusque-là conservées par l’État et qui se chiffraient en milliards. Toujours en vue de résoudre des questions d’ordre financier, Mobutu n’hésita pas à se rendre au Katanga, pour lui demander son aide afin de payer la solde des militaires de l’ANC ; de la sorte, il allait pouvoir asseoir son autorité sur l’armée, au détriment de Lumumba qui fut déclaré incapable de répondre aux souhaits des militaires sur ce point (Boissonnade E. 1990 : 64, 70).
Dès la victoire diplomatique du groupe de Binza à l’ONU, Kasa-Vubu évoqua une réconciliation nationale, et la préparation d’une table ronde où siégeraient toutes les tendances. La nouvelle de la défaite de l’ANC à Bukavu et les mutineries de janvier 1961 révélèrent l’importance que le pouvoir de Léopoldville attachait à un rapprochement avec le Ka tanga dans sa lutte contre les lumumbistes. Chacun restant sur ses gardes, la table ronde de Léopoldville (25 janvier – 16 février) ne permit guère de progresser vers la réconciliation car les principaux intéressés manquaient. Stanleyville posa, comme condition à sa participation, la libération préalable de Lumumba qu’il croyait toujours vivant et emprisonné. Le Katanga se fit également prier, exigeant, comme condition à sa participation, que la conférence se tienne à Elisabethville. Le seul résultat concret obtenu à l’issue de ce forum national fut la promulgation, le 9 février, du décret-loi constitutionnel mettant fin à la mission du Collège des commissaires généraux. Le gouvernement provisoire de Ileo lui succéda. L’imbroglio juridique dans lequel on évoluait n’était justifié que par l’importance des enjeux. Kasa-Vubu, neutralisé par le coup d’Etat, avait non seulement reçu le serment constitutionnel des commissaires généraux, mais disposait également du pouvoir de neutraliser les effets du coup d’Etat. Le Collège des commissaires venait de réaliser en six mois un travail remarquable dans le cadre du réaménagement administratif, notamment en instituant un conseil monétaire et en créant une banque nationale (30 octobre 60).
Le gouvernement Ileo n’était que « provisoire » : ses ministres avaient été nommés mais pas investis ; il cumulait les pouvoirs exécutif et législatif mais restait incomplet du fait que certains postes ministériels restaient vacants dans l’attente d’une représentation des provinces alors en rupture de ban avec Léopoldville. Son rôle était essentiellement politique, puisqu’il travailla à la fameuse réconciliation nationale. Etant donné le succès de l’armée gizengiste, il fut amené à négocier des accords militaires avec Bakwanga et Elisabethville. Les armées des modérés acceptèrent de se soumettre à un commandant unique pour arrêter l’avance des lumumbistes. Lors de la table ronde de Tananarive (8 – 12 mars 1961), on tenta de trouver une base politique à ces accords militaires. Les partisans du fédéralisme se rendirent à Madagascar où, sur les conseils du président Tshiranana, ils s’efforcèrent de mettre fin au conflit. Tshombe considéra, non sans raison, sa position inexpugnable car le gouvernement de Léopoldville, privé de l’apport des deux régions minières, devait recourir à des expédients pour boucler son budget. On comprend dès lors pourquoi Kasa-Vubu s’était limité à entériner les seules thèses katangaises. Mais de retour à Léopoldville, il reconsidéra ses positions.
On se mit à préparer la troisième table ronde qui, d’après les décisions prises à Tananarive, aurait dû se tenir à Elisabethville. Suite au changement d’avis de Kasa-Vubu qui tenait à y faire participer les lumumbistes, cette table ronde se déroula à Coquilhatville (du 24 avril au 28 mai 1961). A nouveau, Stanleyville ne fut pas représentée. Tshombe, qui se présenta à la table des négociations, était conscient de l’hostilité dont il était l’objet depuis Tananarive, Kasa-Vubu ayant entre-temps signé un accord avec l’ONU pour le départ des mercenaires et conseillers étrangers qui œuvraient au Congo. Le Katanga qui, de toutes les anciennes provinces du Congo, était celle qui abritait le plus grand contingent d’étrangers, fut offensé par cette décision. Prenant le taureau par les cornes dès l’ouverture de la Conférence, Tshombe exigea que le président dénonce cet accord. Devant son refus, le Katangais voulut s’en aller mais il fut arrêté à l’aéroport. Les autorités de l’armée avaient décidé, en effet, à l’insu des politiciens qu’aucun des responsables politiques ne pourrait quitter Coquihatville sans qu’une décision satisfaisante soit prise qui permette de faire sortir le Congo de l’impasse.
La table ronde aboutit à un compromis selon lequel les six provinces existantes seraient scindées en Etats, dotés chacun d’un gouvernement et d’une assemblée.
Il restait à appliquer ces dispositions, qui nécessitaient l’accord de Stanleyville et d’Elisabethville. La convocation du Conclave de Lovanium (22 juillet – 2 août 1961) fut négociée avec ces deux instances : Stanleyville accepta Lovanium comme lieu de rencontre ; Eiisabethville parvint quant à elle à obtenir la libération de Tshombe [42]. Les Chambres furent à nouveau opérationnelles. Pourtant, malgré ces accords, la délégation du Katanga fut absente lors du conclave. Gizenga s’y fit représenter, en dépit des interventions de l’ONU qui insistaient pour qu’il s’y rende en personne. La conjoncture lui était en effet favorable. Car ce conclave était une opération destinée à séduire les lumumbistes. Gizenga, s’il avait été présent, aurait pu être choisi comme formateur de gouvernement ; l’histoire politique du pays en aurait été changée (Kamitatu C. 1971 : 33). Finalement, on choisit le syndicaliste Adoula comme formateur, en raison de l’audience dont il bénéficiait auprès des lumumbistes. Les négociations préalables à la formation du gouvernement durèrent huit jours (25 juillet – 2 août). Adoula eut l’habileté, en le constituant, de s’inspirer du modèle du gouvernement Lumumba pour qu’il soit accepté à l’unanimité. Il comptait 26 ministres et 15 secrétaires d’Etat. Dix ministres occupaient les mêmes postes que dans le cadre du gouvernement Lumumba, sept avaient participé au gouvernement Ileo. sept autres avaient fait partie du gouvernement Gizenga à Stanleyville. Les lumumbistes passaient pour être réhabilités : Gizenza et Gbenye, bien qu’absents, furent nommés respectivement vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur (Cornevin R. 1989 : 409-420).
Apparemment, les amis des Occidentaux avaient tenu à se faire pardonner pour l’assassinat de Lumumba. En principe, le conflit avec les lumumbistes avait pris fin ; ce n’était en réalité qu’un sursis.
2.2 La légalité réfugiée à Stanleyville ?
D’où était venu le clivage politique entre « groupe de Binza » et « groupe lumumbiste » ? Tout se joua au lendemain de l’indépendance lorsqu’on assista à une nouvelle épartition politique de juin à septembre. Les lumumbistes avaient leur « noyau dur » composé aussi bien de leaders du MNC-L, (Gbenye, Maurice Mpolo), du PSA (Gizenga, Mulele) que du CEREA (Kashamura).
Tableau 22 — Gouvernements du Congo indépendant (1960-1966)
| DATE | GOUVERNEMENTS | CHEF DE GOUVERNEMENT |
| Juin-septembre 1690 | Gouvernement Lumumba | P.E. Lumumba |
| Septembre 1960 | Gouvernement lleo | J. lleo |
| Septembre 1960 – Février 1961 | Collège des commissaires généraux | J. Bomboko |
| 2 Décembre 1960 – Août 1961 | Gouvernement Gizenga à Stanleyville | A. Gizenga |
| Février-Août 1961 | Gouv. provisoire lleo | J. lleo |
| Août 1961-juillet 1964 | Gouvernement Adoula | C. Adoula |
| Juillet 1964 – Octobre 1965 | Gouvernement de Salut public | M.Tshombe |
| Octobre – Novembre 1965 | Gouvernement Kimba | E. Kimba |
| Novembre 1965 – Octobre 1966 | Gouvernement Mulamba | L. Mulamba |
Les premiers universitaires membres du gouvernement (T. Kanza, A. Mandy) se situaient également dans cette mouvance, vraisemblablement influencés par la vision anticolonialiste qui était alors en vigueur. L’espace politique contrôlé par le PSA (Kwilu), le CEREA (Kivu) et le MNC (Sankuru, Luluabourg, Maniema), y compris le Balubakat (Nord-Katanga), convenait idéalement, en tant que soutien « naturel » de Lumumba. La révocation du Premier ministre, confirmée par le coup d’Etat du colonel Mobutu, mit le feu aux poudres. Kasa-Vubu, mais aussi le colonel Mobutu, l’ancien compagnon de Lumumba, fut désavoué [43]. Les deux camps n’eurent plus à s’embarrasser de formules de courtoisie car la lutte devenait publique. On fit la chasse aux lumumbistes et à tous ceux qui les soutenaient. Les chancelleries étrangères qui leur étaient favorables furent fermées. On commença par l’URSS et la Tchécoslovaquie (17 septembre), puis le Ghana (23 novembre) et l’Egypte (28 novembre). [44] Lumumba révoqué continua, tant que cela fut possible, à se considérer comme Premier ministre et à présider ses conseils de ministres. Puis le mot d’ordre fut donné à tous ses partisans de se réfugier à Stanleyville, en passant par la zone favorable : le Kwilu puis le Sankuru.
La plupart réussirent dans leur entreprise, sauf quelques-uns qui furent arrêtés, notamment Mpolo à Mushie, Okito à Kikwit et Lumumba lui-même sur la traversée du Sankuru à Lodi. Gizenga, arrivé à Stanleyville le 14 octobre, proclama dès le 2 décembre Stanleyville « capitale provisoire de l’État ». Le 13 du même mois, il fit savoir que le gouvernement qu’il présidait était « le seul gouvernement légal ». Il ne mentait pas : non seulement il était l’adjoint du Premier ministre Lumumba dans la constitution du premier gouvernement mis en place le 24 juin 1960, mais de plus quelques pièces précieuses extraites des archives de la première administration du Congo indépendant avaient été amenées sur place. [45] Aussi les lumumbistes se crurent-ils en droit de conquérir et de réorganiser l’ensemble du pays à partir de cette capitale provisoire. Le premier impératif était d’ordre militaire. Les troupes, aux ordres du général Lundula, réfugié dans le Haut-Congo après sa révocation par Kasa-Vubu, remportèrent une première victoire militaire (25 décembre) à Bukavu. Le commando de l’ANC qui tenta de reconquérir la ville échoua dans son entreprise. Le Kivu entra ainsi dans le giron de Stanleyville et Kashamura s’y installa (2 janvier).
Peu après, Manono, capitale de l’étain, fut envahie (10 janvier) ; le Nord- Katanga était conquis. Forte de ses succès, l’armée de Lundula eut pour double objectif l’Equateur et le Kasaï-Occidental ; après Luluabourg (25 février) elle se dirigea vers Port-Francqui… Cette inquiétante progression précipita comme on l’a vu la conclusion d’un accord militaire entre Léopoldville, Bakwanga et Elisabethville, grâce auquel l’armée katangaise put, dès le 30 mars, récupérer la ville de Manono où s’était installé un gouvernement antisécessioniste dirigé par Prosper Mwamba – Ilunga (Artigue P. 1961 : 247-248).
Sur le plan diplomatique, le gouvernement Gizenza s’organisa rapidement grâce à P. Mulele, qui s’était installé au Caire depuis le 10 décembre, en tant que ministre- résident. La participation de ce dernier à la conférence de Casablanca, du 3 au 7 janvier 1961, lui permit de plaider la cause de son gouvernement. Les sept Etats présents à la conférence soit, l’Egypte, la Guinée, le Ghana, l’Algérie, la Lybie, le Maroc et le Ceylan confirmèrent leur reconnaissance du gouvernement Lumumba (Congo 1961 : 319). Après l’annonce de la mort de Lumumba, cette reconnaissance se porta sur le gouvernement de Gizenga. D’autres pays, parmi lesquels l’URSS, l’Allemagne de l’Est, la Yougoslavie, la Mongolie, l’Albanie, Cuba, la Pologne, la Bulgarie, l’Irak, la Hongrie et par la suite la Chine Populaire suivirent cet exemple. Il faut préciser qu’au lendemain de la mort de Lumumba, la République Libre du Congo de Gizenga bénéficia pendant de longs mois d’une conjoncture internationale extrêmement favorable, et ce en hommage à la personnalité de Lumumba.
Mais Gizenga s’avéra incapable de tirer parti de ces atouts, même s’il lui arriva parfois de s’imposer. Après la conférence de Tananarive, lorsqu’il apparut que Kasa-Vubu commençait à jouer le jeu de Tshombe, Gizenga et tous les membres de l’ex-gouvernement Lumumba signèrent un document qui déclarait que Kasa-Vubu était mis « dans l’impossibilité politique d’assurer ses fonctions de Chef de l’État » et que ces prérogatives étaient « désormais assurées par le Conseil des ministres », (c’est-à- dire Stanleyville) ; cela se passait le 31 mars. Mais cette initiative était-elle nécessaire, quand on sait par ailleurs qu’à l’époque, le groupe lumumbiste était lui-même en train de se lézarder ? En effet, le gouvernement Gizenga et l’administration provinciale du Haut-Congo se disputaient le leadership de la capitale. De plus, comme le note L. Martens (1985 : 101-102) « ces ministres lumumbistes (à Stanleyville) se préoccupaient surtout de mener le train de vie qu’ils estimaient correspondre à leur dignité. Il était rare que Gizenga réunisse le Conseil des ministres. Il croyait pouvoir gouverner le Congo comme un chef de clan qui veille sur le va-et-vient de ses ouailles. Il ne consultait personne et se complaisait dans une passivité bienheureuse (…) Et rapidement, comme des mauvaises herbes poussant dans un champ abandonné, les ambitions personnelles, les rivalités sordides, les intrigues et les trahisons déchireront les membres de son gouvernement ». Il faut ajouter que les dérapages ne manquèrent pas. Par exemple, la garde de Gizenga ne comptait que des femmes. Plus grave encore, au cours de son mandat, Gizenga saisit une grande quantité d’or de Kilo-Moto – environ une tonne et demi. Il comptait recevoir, grâce à ce chantage, les devises indispensables à ses échanges extérieurs. N’ayant pas obtenu satisfaction, il fit parvenir ce pactole à la Banque du Soudan, qui de là, parvint au Caire [46].
Par ailleurs, des troupes qui descendaient à Kindu s’attaquèrent à un groupe d’aviateurs italiens qu’elles avaient pris pour des mercenaires. Les malheureux furent impitoyablement massacrés, comme le furent également les missionnaires de Kongolo le 1erjanvier 62 (Kestergat J. 1986 : 123).
Minée de l’intérieur, la République Libre du Congo n’était pas viable. A partir d’avril 1961, il ne lui restait guère mieux à faire que de répondre aux avances de Léopoldville en vue d’une réconciliation. Déjà un an plus tôt, Lundula avait envoyé des émissaires à Bunduki, à la frontière entre l’Equateur et la province orientale, pour entamer des négociations avec des émissaires de Mobutu en vue de la réunification de l’armée ; un cessez-le-feu fut conclu entre les deux armées le 17 avril 1960. A la conférence de Coquilhatville, on remarqua la présence des délégués de Lundula et de Manzikala, le chef de l’exécutif provincial de Stanleyville, de même que celle des représentants du PSA. Le Balubakat était représenté par Sendwe en personne. Mais Gizenga préféra ne pas y prendre part, par crainte plutôt que par calcul politique. Enfin les Nationalistes participèrent eux aussi aux travaux du Conclave de Lovanium auquel prirent part les députés lumumbistes. Mulele lui-même, venu du Caire, était là. Seul Gizenga refusa de s’y rendre, renonçant ainsi à un rendez-vous avec l’Histoire.
L’inévitable se produisit. La constitution du gouvernement Adoula alla au- devant des revendications lumumbistes. Non seulement il obtint la confiance des Chambres réunies – ce qui lui accorda la légalité, contrairement aux autres gouvernements postérieurs à Lumumba – mais de plus il était composé essentiellement de membres de l’équipe de Lumumba parmi lesquels Gbenye, ministre de l’Intérieur. Gizenga lui-même, en qualité de vice-premier ministre, occupa les premiers rangs dans cette équipe [47]. Même les pays socialistes reconnurent le gouvernement Adouia. L’URSS le fit le 31 août.
A partir de là, Gizenga n’eut plus aucune marge de manoeuvre à Kisangani. Il regagna Kinshasa le 3 septembre et se rendit à Belgrade, le lendemain, pour participer avec Adouia, à la conférence des non-alignés. Adouia pouvait-il espérer une meilleure issue à la révolution lumumbiste ? Pourtant, une fois obtenue, la réconciliation devait évincer Gizenga. Ce fut chose faite en janvier 1962. Il s’était réfugié à Stanleyville en octobre 1961, d’où il avait reconduit la sécession ; il fut démis de ses fonctions de vice-Premier ministre (le 15 janvier) et au début du mois suivant, il fut arrêté et enfermé dans l’île de Bula-Mbemba, avec l’accord de la Chambre des députés.
La République Libre du Congo avait vécu et le lumumbisme était mal en point : Manzikala (gouverneur du Haut -Congo) accusait son ancien président de « rébellion civile caractérisée et généralisée contre l’autorité établie », et Gbenye (ministre de l’Intérieur) ordonna sa mise en résidence surveillée. Cependant, rien n’était joué tant que Mulele se trouvait au Caire et que plusieurs jeunes nationalistes étaient en formation dans les pays de l’Est.
2.3 Réduire la sécession katangaise
L’ennemi extérieur était écarté ; restait à mettre fin à la sécession katangaise. C’était une entreprise malaisée car le Katanga, sans être officiellement reconnu par un seul Etat au monde, bénéficiait dès le départ de l’appui de l’ensemble de l’Europe Occidentale : la Belgique y avait des militaires et des coopérants, la France était heureuse d’y affecter les anciens de l’Algérie, l’Angleterre ne désespérait pas d’y créer la Fédération des Rhodésies.
Lumumba, à propos de ce même Katanga, s’était heurté à l’incompréhension de l’ONU et avait envisagé de faire appel au bloc soviétique, signant par là son arrêt de mort. L’arrivée des Casques Bleus fut aussitôt mal interprétée. Pour le secrétaire général de l’ONU, les troupes avaient mission de permettre le départ des troupes étrangères postées au Congo, les belges particulièrement, et d’éviter ainsi un conflit international, notamment entre l’Est et l’Ouest. Elles devaient en outre restaurer dans le pays un certain ordre constitutionnel indispensable à son fonctionnement harmonieux, mais aussi reconstituer entièrement l’ANC. Pour les responsables congolais, qu’il s’agisse du gouvernement Lumumba, du collège des commissaires généraux et même, dans une moindre mesure il est vrai, du gouvernement Adouia, l’ONU au Congo avait pour tâche d’aider à rétablir l’unité du pays, et surtout de réduire la sécession katangaise. Ainsi Lumumba demanda à l’ONU qu’elle l’aide à reconquérir militairement le Katanga. Elle n’en fit rien. L’ironie du sort voulut que, quelques mois après l’élimination de Lumumba, l’ONU se rendit compte qu’il n’existait aucune autre solution au problème ; aussi la mit-elle à exécution deux ans plus tard. Curieusement, c’est la mort de Lumumba qui porta un coup fatal à la sécession, en lui enlevant d’un coup sa raison d’être. Non seulement il n’y avait plus de danger contre lequel se prémunir mais de plus la majorité des Etats Occidentaux se mirent à manifester plus d’intérêt pour un Katanga inséré dans le Congo, plutôt que pour un Katanga qui lui était extérieur. Raison occidentale oblige. Le projet de sécession cessa donc d’intéresser les États étrangers. Il n’y eut plus que des particuliers, nostalgiques d’un certain ordre colonial, pour le soutenir. La fin de la sécession katangaise n’était plus une utopie. Nous allons raconter dans le détail le déroulement de cet épisode de l’histoire du Congo.
Dès qu’elle fut instituée, la sécession s’organisa. Sur le plan militaire, la « gendarmerie katangaise », (l’armée de l’État sécessionniste) était constituée et encadrée par des officiers belges d’abord, puis elle fut renforcée par des mercenaires blancs d’origines diverses, en particulier française et sud-africaine [48].
Le nouvel État politique se dota d’un drapeau (rouge, vert et blanc flanqué de trois croisettes de cuivre) et d’un hymne national – la Katangaise – composé par le musicien J. Kiwele, membre du gouvernement. La Constitution, promulguée le 8 août, se distinguait de la Loi Fondamentale par un certain nombre d’innovations. Le régime adopté était semi-présidentiel et un « Conseil de Chefs Coutumiers » fut instauré, à côté de la Chambre des députés. L’État s’organisa aussi sur les plans financier et monétaire. D’emblée, il disposa d’importantes ressources puisqu’il n’avait aucun compte à rendre à Léopoldville. Les entreprises minières, les compagnies à charte et l’Office spécial d’imposition de Bruxelles reconnurent cet état de fait. Le Katanga devint créancier des impôts, taxes et redevances et de toutes obligations dues à l’État, ce qui représenta une somme considérable : 2 096 millions de F.B. en 1961 ; 1 485 millions de F.B. de la part de la seule Union Minière et 431 millions de la part de CSK entre le 30 juin 1960 et le 31 mars 1962 (Gérard-Libois 1963 : 140). Une « banque nationale du Katanga » fut créée et confiée à un ancien fonctionnaire belge de la « Banque du Congo belge et du Rwanda-Urundi ». Sûr de ses ressources, le Katanga se dota également d’une institution d’émission qui lui était propre. Son point faible se situait au plan diplomatique, malgré le fait qu’il bénéficiait de la sympathie de nombreuses nations : il n’avait fait l’objet d’aucune reconnaissance explicite, comme cela avait été le cas de la « République Libre du Congo ». Parmi ses appuis extérieurs, on comptait en effet le Portugal de Salazar, l’Afrique du Sud, la Fédération des Rhodésies et le Congo de l’abbé Youlou. [49] La Belgique, quant à elle, lui prodigua de la sympathie et un certain appui financier et humain. Il en alla de même de la France et des USA qui firent preuve de tolérance face aux manifestations prosécessionnistes organisées dans leur territoire. Il y en eut effectivement à Bruxelles, auprès du Marché Commun, à Paris et à New York (Gérard-Libois J. 1963 : 196-205).
La sécession fut contestée dès son apparition par le cartel luba. On sait l’importance que celui-ci détenait dans la géopolitique katangaise [50]. Elle fut ensuite combattue par l’ONU, soucieuse d’éviter que ce foyer de tension internationale ne se muât en un conflit mondial. La mission de l’ONU était délicate : les pays de la CEE soutenaient la sécession katangaise et l’URSS était décidée à aider Lumumba à la réduire militairement. Voilà pourquoi Hammarskjôld, le secrétaire général, avait demandé que toute aide militaire au Congo, passe uniquement par l’intermédiaire de l’ONU ; il refusa d’être l’instrument du gouvernement de Lumumba et donc, de mettre un terme à la sécession par la force. L’ONU opta d’abord pour la négociation et la pression.
Comme il fallait faire appliquer la résolution du 14 juillet du Conseil de Sécurité réclamant le retrait des troupes belges et leur remplacement par les forces de l’ONU, le secrétaire général se heurta à une première difficulté avec le Katanga, lorsque Tshombe refusa de laisser partir ses soldats belges pour qu’ils soient remplacés par des Casques Bleus, comme dans les autres régions du pays. Ralph Bunche, parti en éclaireur à Elisabethville (2 août 1960), revint avec une description peu engageante de l’accueil qui les attendrait à leur arrivée. Le secrétaire général se rendit lui-même sur place avec un contingent de Casques Bleus suédois (12 août). A son arrivée, on lui tendit un piège en lui présentant le drapeau katangais ; il s’inclina légèrement puis se rendant compte de sa méprise, il poursuivit sa marche. Le Katanga ne manqua toutefois pas de s’en réjouir, proclamant que le secrétaire général avait reconnu « l’indépendance » du Katanga par l’intermédiaire de son emblème. On aboutit à un compromis quant à l’objet principal de sa mission. Les Casques Bleus furent admis, et l’ONU s’engagea à ne pas se mêler des affaires katangaises. L’essentiel, pour l’ONU, était d’être dans la place. Une fois admise au Katanga, elle s’employa à installer méthodiquement sa présence aux endroits critiques.
Ce contact avec Tshombe consomma la rupture avec Lumumba qui ne put admettre que le secrétaire général de l’ONU accepte de « négocier » avec un Etat fictif. Le gouvernement Lumumba en fut vraiment affecté. Cette position « prudente » de l’ONU ne fut d’ailleurs pas payante car à partir de septembre 60, elle réussit à mécontenter tout le monde ; pour les sécessionnistes, l’ONU jouait le jeu des rebelles du Nord et des lumumbistes. Pour ceux-ci, l’organisation internationale était à la solde des forces réactionnaires et protégeait la sécession. Les mobutistes, à Léopoldville, et les commissaires généraux accusaient l’ONU d’avoir pris Lumumba et ses amis sous sa protection ; Kasa-Vubu, quant à lui, n’était pas enclin à s’appuyer sur elle dans son entreprise politique (Braekman C. et Alii 1990 : 84-85). Tout changea après la nouvelle de la mort de Lumumba. Tshombe, d’après les théoriciens blancs, se crut désormais le seul « homme fort » de l’ancien Congo belge, avec lequel il fallait absolument compter. Il préféra minimiser le fait que la disparition du leader congolais avait fait disparaître une des raisons majeures qui poussaient les Occidentaux à le soutenir. Croyant qu’il avait enfin l’initiative, il entama la réalisation de son projet de recréation d’un nouveau Congo à partir du Katanga. Il s’intéressa vivement au projet évoqué lors de la Table ronde de Léopoldville, et ne l’abandonna que parce qu’il ne rallia pas les autres à son point de vue ; pour le Katanga, cette table ronde devait se tenir à Elisabethville. Il domina la Table ronde de Tananarive et fit prévaloir, comme on le sait, sa vision « décentralisante ». Après l’incident de Coquilhatville, il eut le tort de négliger l’importance du « conclave de Lovanium ». Ainsi la constitution du gouvernement d’Union Nationale se réalisa sans lui, anéantissant le dernier crédit diplomatique qui lui restait. Aucun prétexte ne pouvait désormais justifier le soutien du Katanga par les puissances occidentales alors que Léopoldville était dirigée aussi par des « modérés », et que l’ensemble du reste du pays reconnaissait l’autorité de ce gouvernement.
L’ONU, prudente, se fit menaçante, soutenue par la détermination de ses nouveaux dirigeants au Congo, notamment l’Irlandais Conar Cruise O’Brien, anticolonialiste et autoritaire [51]. Ce dernier décida de passer à l’attaque et donc de supprimer la sécession par la force. Une vaste offensive fut déclenchée le 28 août 61, dans le but d’investir Elisabethville et d’en déloger tous les mercenaires. L’opération, baptisée Rumpunch (punch au rhum), réussit partiellement. Plus de trois cents « affreux » (parmi lesquels 180 officiers belges environ) furent expulsés du pays. Mais peu après, on réalisa que le résultat obtenu était plus que sommaire : l’opération s’était limitée à Elisabethville tandis que plusieurs autres contingents, notamment l’ensemble du contingent français, basés dans d’autres villes katangaises, n’avaient pas même été inquiétés. De plus, les soldats expulsés, quand ils ne revenaient pas clandestinement, furent aussitôt remplacés par d’autres « affreux », recrutés dans des pays limitrophes ou plus loin.
L’ONU mena une seconde opération qui devait s’étendre à l’ensemble du pays. Cette seconde offensive – l’opération Morthor (écrasement) – qui se déroula le 13 septembre 1961, était censée aboutir à l’arrestation de Tshombe, Munongo, Kibwe et Mutaka mais elle ne fut guère plus heureuse. Son résultat fut limité. Seul Kibwe fut arrêté et contraint de faire une déclaration exhortant les Katangais à un cessez-le-feu, mais Tshombe intervint également à la radio pour annuler son message. Les Katangais qui avaient l’avantage de connaître le terrain dévastèrent les camps de l’ONU situés à Kamina, à Likasi et à Lubumbashi, notamment grâce à l’unique avion de combat, un Fouga Magister, dont ils disposaient encore.
A la suite de ce second échec, Hammarskjôld se résolut à rencontrer à nouveau Tshombe. Rendez-vous fut pris à Ndola, en Rhodésie du Nord (Zambie actuel) le 17 septembre, pour négocier un cessez-le-feu. Cette mission allait coûter la vie au secrétaire général de l’ONU. Son avion – un Douglas DC6 B – décolla de Léopoldville à 17 heures. Plusieurs personnalités l’attendaient à l’aéroport de Ndola, parmi lesquelles Tshombe. A 0 heure 10, l’avion survola l’aéroport, s’apprêtant à atterrir, puis disparut dans l’obscurité. L’assistance, surprise, pensa que le secrétaire général avait changé d’avis. Le lendemain, on apprit que l’avion s’était écrasé. Tous ses occupants étaient morts, sauf un, un garde du corps, qui mourut quelques heures après avoir été recueilli.
Que s’était-il passé ? Encore une de ces énigmes dont l’histoire du Congo a le secret, et qui ne sera jamais élucidée. On a pensé que le DC6 aurait été abattu par le fameux Fouga Magister du Katanga. Cette hypothèse n’a pas été retenue par la commission d’enquête officielle car l’avion du secrétaire général avait effectué un énorme détour par le Burundi et le lac Tanganyka pour éviter de survoler le Katanga. L’équipage aurait-il confondu, à l’atterrissage, les cartes de Ndolo avec celles de Ndola? Cette hypothèse ne tient pas non plus car dans le Jeppensen (livre contenant les instructions sur la procédure d’atterrissage), aucune confusion n’est possible entre Ndolo (dont la carte est classée à la lettre L de Léopoldville) et Ndola (figurant à la lettre N) (Gillon L. 1988 : 174-175). Deux hypothèses semblent plausibles : le secrétaire général peut avoir mené volontairement le groupe au suicide ou il a été victime d’un attentat. La première supposition se fonde sur le témoignage du seul survivant de la catastrophe. D’après lui, le secrétaire général aurait donné l’ordre au pilote, quelque temps avant l’atterrissage, de reprendre de la hauteur. Une grosse explosion se serait ensuite produite à bord, suivie d’autres moins fortes. Même si l’hypothèse du suicide n’est pas à exclure, il est étrange qu’Hammarskjôld ait attendu de survoler Ndola pour mettre son projet à exécution. Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’un attentat. Plusieurs indices contribuent à vérifier cette hypothèse : on a retrouvé des balles dans le corps de deux passagers suédois et d’autre part, la mission de sauvetage arriva sur les lieux 16 heures après le drame, alors que l’endroit du sinistre ne se situait qu’à 15 km environ de l’aérodrome (Buissonnade E. 1990 : 130-137). Le coupable aurait même été identifié : il s’agirait d’un mystérieux passager, vêtu d’un uniforme de l’ONU, qui aurait pris place à bord de l’avion à Léopoldville. La délégation de l’ONU venue de New York avec le secrétaire général pensait qu’il faisait partie du contingent de Léopoldville tandis que les fonctionnaires de l’ONU à Léopoldville, le croyaient venu de New York en compagnie du secrétaire général. [52] Il est possible que l’on se soit battu dans l’avion, dès lors qu’il fut décidé que l’avion n’atterrirait pas. Une bombe qui devait exploser à l’atterrissage, l’a fait au moment où les manoeuvres d’atterrissage avaient commencé ; ou bien l’explosion de la bombe a été suivie d’une bagarre. Malgré la perte de cette autre grande personnalité après Lumumba, la sécession katangaise resta sur ses positions, et les hostilités se poursuivirent.
Le 5 décembre, trois mois après la disparition de son secrétaire général, l’ONU déclencha une troisième offensive, déterminée plus que jamais à mettre un terme à cette sécession qui minait le Congo. Le Birman U Thant, nouveau secrétaire général, et le président Kennedy, avaient la même opinion de la question. Cette opération conduisit à une négociation, sous les auspices de Washington, à Kitona. Mais les accords signés le 20 décembre entre Adoula et Tshombe pour mettre un terme à la sécession, furent à nouveau dénoncés, dès que le leader katangais retrouva son état-major à Elisabethville,
Il fallait mettre un terme à cette situation. Au cours de l’année 1962, un plan de réconciliation nationale, mis au point par l’ONU et approuvé par Monsieur Spaak, ministre belge des Affaires Etrangères, prôna le retour au bercail du Katanga, selon un plan rigoureux, fondé sur des compromis. Ce plan, dénommé plan U Thant, s’accompagnait de menaces : si la réconciliation n’était pas acquise, des sanctions économiques seraient prises à l’endroit du Katanga. Il serait interdit à l’UMHK de verser ses redevances à l’État sécessionniste. On évoquait encore la possibilité d’un boycottage des exportations du cuivre et du cobalt du Katanga. Tshombe essaya de gagner du temps, multipliant incidents et déclarations contre l’ONU. On assista à une manifestation de femmes katangaises à Elisabethville, le 17 juillet, à un poste- contrôle de l’ONU, qui fit plusieurs blessés. [53]
Les forces de l’ONU se décidèrent à tenter une dernière opération militaire, soutenue matériellement par les USA. Entamées le 24 décembre, les hostilités se poursuivirent jusqu’en janvier 1963. C’est le 14 janvier que les ministres Katangais adressèrent enfin à M. Spaak une déclaration dans laquelle ils se disaient « prêts à proclamer devant le monde que la sécession katangaise était terminée ». Le 15 janvier, l’UMHK signa à Léopoldville un accord sur le versement de la totalité de ses recettes brutes en devises au Conseil monétaire, tandis que les derniers mercenaires, parmi lesquels Schramme, quittèrent Kolwezi, pour se réfugier en Angola. La sécession avait vécu. Tshombe prit le chemin de l’exil, emportant un trésor de guerre de 92 millions de F.B. tandis qu’Ileo, nommé par Adoula « ministre résident au Katanga » vint s’installer à Elisabethville (23 janvier). Cette page douloureuse de l’histoire nationale était enfin tournée.
2.4 Des armées nationales à l’armée nationale congolaise
Qu’en était-il de la situation militaire ? La mutinerie de la Force Publique ayant mené le pays à la ruine, l’unification véritable ne pouvait se faire sans la contribution des forces de l’ordre. Celles-ci avaient connu un itinéraire semblable à celui des événements politiques : à des divisions graves avait succédé un regroupement structurel, dès 1963.
En 1960, le Congo indépendant hérita, nous l’avons dit, d’un service de renseignements remarquable et d’une « Force Publique » que l’on comptait parmi les plus grandes armées d’Afrique, avec celles du Soudan et de l’Algérie (Young C. 1968 : 256). Le service de la Sécurité, étant donné son statut discret, connut peu de changements en 1960. Son titulaire, le colonel Vandewalle, resta à poste et eut ainsi la possibilité de mettre en lieu sûr les documents les plus explosifs «de sa collection » d’archives [54]. Poursuivi par ses préoccupations, Lumumba n’avait guère le loisir de s’attarder à ce genre de détail. Il prit toutefois la peine de veiller à ce que son conseiller en matière de sécurité ne soit plus de nationalité belge ; il nomma donc peu après, à la place de Vandewalle, Chrystophe Muzungu, un homme de confiance. Ce premier chef « autochtone » de la Sécurité connut une carrière brève. Avec la révocation puis l’arrestation du Premier ministre, il fut évincé à son tour [55]. Son remplaçant, V. Nendaka, en tant que dissident du MNC-L, convenait parfaitement pour gérer le dossier Lumumba comme l’entendaient le pouvoir en place et les pays occidentaux. Par la suite, le pouvoir de Nendaka fut encore renforcé par son appartenance au « Groupe de Binza » et grâce à l’appui des services secrets belges et américains.
L’armée connut une évolution plus complexe. Comme nous l’avons dit, à la veille de l’indépendance, elle accusait déjà une certaine vulnérabilité, par le biais de l’appartenance tribale. Les militaires ne pouvaient rester insensibles à faction des politiciens avec lesquels ils partageaient les mêmes références tribales. Certains politiciens favorisèrent donc la mutinerie. Ce n’est donc pas un hasard si les ténors de ce mouvement de juillet 1960 se recrutèrent essentiellement parmi les militaires du Sud-Equateur et du Sud-Kasaï ; ils bénéficiaient en fait des encouragements du leader de la Puna (Bolikango) et du MNC/Kalonji (Kalonji). La même explication justifie l’attachement du général Lundula à Lumumba, tetela comme lui ; le mouvement général de promotion et d’affectation des premiers officiers nationaux tint compte de ce critère politique [56].
Le règne de la division s’instaura avec les sécessions. La gendarmerie katangaise fut organisée par le major Crèvecoeur dès juillet 60 et équipée d’un important armement hérité de la Force Publique. Cette armée se caractérisait par le fait que ses troupes étaient presque exclusivement novices – les anciens de la Force Publique ayant été pour la plupart renvoyés – et qu’elle eut recours à des mercenaires européens, belges, français et autres, venus d’Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud (Zimbabwe actuel). Dès 1961, sous la pression de l’ONU, un Katangais, le général Norbert Muke Masaku, fut nommé commandant en chef. Mais le Katanga se distingua par ses autres armées « particulières », directement rattachées à des autorités coutumières. Ainsi le grand chef Kasongo Nyembo, pour avoir soutenu la Conakat, obtint la possibilité de recruter un bataillon portant l’uniforme des gendarmes katangais, mais soumis à son seul commandement. Le « patron » de Bunkeya, Antoine Mwenda – Munongo avait lui aussi ses propres guerriers, équipés d’armes modernes, indépendants de la « gendarmerie katangaise ».
Le domaine du Mulopwe disposait également d’une armée, la gendarmerie kasaïenne, qui fut en 1961 sous le commandement d’un jeune homme de 22 ans, Floribert Dinanga. Il en alla de même de la République libre du Congo ; elle créa son armée à partir des troupes du 3e groupement stationné dans le Haut-Congo et le Kivu. Mais cette armée, en principe aussi importante que celle de Kinshasa, avait ses faiblesses. D’abord Lundula ne parvint à imposer son autorité qu’aux détachements de la Province Orientale ; il n’en alla pas de même de ceux du Kivu et pour ceux qui furent envoyés au Nord-Katanga et au Kasaï ; de plus, cette armée ne put bénéficier d’une aide extérieure importante comme celle du Katanga. Comble d’ironie, la solde des troupes émanait encore du gouvernement central, donc de Léopoldville.
Ces contradictions au sein des factions autonomes avaient l’avantage de favoriser le regroupement. Au cours de 1961, les « armées nationales » demeurèrent distinctes, défendant les unes et les autres les causes qui leur étaient propres. L’unification ne put se réaliser que par étapes successives.
Une première phase vit s’opérer – paradoxalement – la réconciliation des troupes de Mobutu avec celles de Lundula. Celle-ci fut rendue possible en particulier grâce à l’initiative de Lundula qui brava même les réticences de son Chef Gizenga. La réconciliation se fondait sur l’objectif commun de combattre la sécession katangaise. C’est ainsi que, suite à des négociations secrètes, Lundula réintégra Léopoldville le 11 novembre 1961, et accepta de servir sous les ordres de Mobutu en tant que commandant du 3e Groupement, avec le grade de général major. Depuis Stanleyville, Gizenga eut beau réagir en nommant Pakassa à la place de Lundula, il ne put changer le cours des événements. Les erreurs commises peu après par Pakassa – le massacre des aviateurs italiens à Kindu – et surtout les conclusions du conclave de Lovanium donnèrent plutôt raison à Lundula. Mobutu profita de cette occasion pour renforcer sa position et neutraliser toute velléité de dissidence en affectant Lundula en 1962 à Léopoldville en qualité de conseiller militaire de Anany, ministre de la Défense. Le colonel Léonard Mulamba remplaça Lundula à la tête du 3e groupement et s’employa à effacer tout regret de l’ère gizengiste.
L’intégration de la « gendarmerie kasaïenne » s’effectua plus simplement encore par l’envoi au Kasaï de deux bataillons de l’ANC. Les troupes dissidentes furent absorbées au cours de l’année 1963. La reprise en main des troupes katangaises par l’autorité centrale fut quant à elle plus problématique. Elle donna lieu à une véritable saga qui allait marquer l’histoire militaire du pays pour les décennies suivantes.
Les négociations de Kitona en 1962 ne purent décider si la « gendarmerie katangaise » allait être intégrée dans l’ANC ou si celle-ci demeurerait plus ou moins autonome, opérant au Katanga, avec une simple relation de filiation vis-à-vis de l’ANC. Avec la répression de la sécession par la force, la solution radicale l’emporta. Mais l’ANC n’absorba qu’une partie des gendarmes, soit deux à trois mille personnes ; les autres effectifs, environ dix mille personnes, gagnèrent l’Angola tout en menaçant de compromettre l’environnement militaire du pays. Quelques-uns de ces éléments rejoignirent les rangs de l’ANC lorsque Tshombe devint Premier ministre, tandis qu’une grande majorité d’entre eux restaient en Angola [57]. Après la réduction de la sécession katangaise en 1963, l’unité de l’armée fut donc restaurée officiellement car l’ancien commandant de la gendarmerie katangaise. Muke fut nanti d’un poste d’état-major à de Léopoldville.
L’unification acquise, il restait à résoudre le problème de la modernisation et de l’organisation interne de cette armée. Dès janvier 1963, Mobutu proposa à l’ONU le plan d’une modernisation qui serait subventionnée par la Belgique, Israël, l’Italie, la Norvège et le Canada. Mais ce plan ne fut pas retenu à cause de ses grandes accointances avec l’OTAN. On en retint cependant une version simplifiée et un programme fut mis au point avec l’assistance de la Belgique et d’Israël. Par ailleurs, la formation des jeunes officiers congolais en Belgique entamée dès la fin de la période coloniale était déjà en bonne voie. En juillet 1963, 380 officiers étaient déjà rentrés au Congo et 300 autres suivaient des cours en Belgique. En août de la même année, Mobutu lui-même et 219 autres Congolais reçurent une formation de parachutistes en Israël ; des instructeurs militaires étrangers arrivèrent sur place, ainsi que du matériel et des armes nouvelles provenant des USA. La promotion militaire progressa à un point tel qu’apparurent, au sein de l’armée nationale, des tensions entre « anciens » de la Force Publique et « nouveaux », issus des académies étrangères. La naissance de ce nouveau terrain d’affrontement contribua à enterrer les anciens clivages issus des guerres de sécession. L’héritage toujours vivant de 1 ancienne Force Publique fit le reste, souda cette unité grâce au recours obligatoire à une même langue militaire – le lingala -, à la rotation fréquente des officiers et aux brassages ethniques des camps militaires. Il maintint l’organisation de deux types de troupes distincts : celles qui sont « campées » et celles qui sont mobiles. L’armée campée avait en principe pour rôle d’assurer la sécurité du pays contre les agressions externes. Ces troupes étaient réparties en principe en trois « groupements » (régions militaires) comprenant chacun une demi-douzaine de camps militaires. [58] L’armée mobile, celle des gendarmes, était répartie en « compagnies » au plan des districts et en « pelotons » au plan des territoires. Elle était sous l’autorité civile et s’occupait du maintien de l’ordre. Ce rôle, elle le partageait avec la police qui était une instance territoriale, recrutée et opérant à ce simple niveau local (Young C. 1968 : 257-280).
En définitive, malgré la mutinerie, l’ancienne Force Publique constituait encore, sur le plan national, l’institution la plus valide. Son intervention du 5 septembre 1960 le prouve, lorsqu’elle neutralisa toutes les forces politiques en présence. Pour l’heure elle garantissait, par son regroupement, la réunification de l’ensemble du pays.
2.5 Epilogue
Quelques considérations seront utiles ici, pour éclairer ce qui va suivre. La reconquête de l’unité se réalisa presque aussi rapidement qu’elle fut perdue. En effet, en moins de trois ans, on parvint à retrouver l’unité, du moins sur le plan formel. Cette reconquête, on la doit certes à la conjoncture internationale de l’époque, où la peur d’une guerre mondiale mena à l’étouffement de l’objet de la tension. On la doit aussi finalement au peuple. La séparation était virtuelle ; on ne la rechercha jamais pour elle-même, mais on y recourut toujours en tant que stratégie politique pour exprimer un mécontentement ou revendiquer un positionnement meilleur. Kalonji ne s’en cacha pas, il ne devint Mulopwe que pour protester contre le fait de n’avoir pas été choisi comme membre du gouvernement central. Tshombe, au beau milieu de la sécession, se montra convaincu de la nécessité de l’unité d’un Congo qu’il voulait confédéral. Pour le leader katangais, la sécession n’était ni plus ni moins qu’une stratégie pour faire admettre une autre manière de gérer le Congo indépendant. Les Katangaleux qui l’entouraient sont allés trop loin en trouvant là l’occasion de réaliser leur propre projet de s’octroyer une partie de rêve.
Le temps me semble venu de préciser la ligne politique que je me suis tracée. Comme vous le savez, dès le mois de janvier 1960, à la table ronde politique de Bruxelles, j’ai été un défenseur acharné d’une confédération groupant les territoires formant le Congo belge. Cette formule seule permettrait aux particularismes locaux de trouver leur réelle expression tout en sauvegardant l’unité d’un ensemble qui devait faire du Congo, une des puissances majeures de l’Afrique (…). Dès les événements du mois de juillet, j’ai dû, pour être fidèle à cette politique que je m’étais fixée et au programme sur lequel j’avais été élu, refuser, en accord avec la population katangaise, de collaborer avec un régime qui instaurait une dictature égoïste et néfaste (…). Je me suis désolidarisé de ce régime détestable qui apportait la honte à l’Afrique tout entière, en proclamant l’indépendance du Katanga dans l’espoir d’aboutir un jour à une confédération des contrées de l’ancien Congo (.. J Nous nous inspirerons de ces exemples (USA et Suisse) pour trouver des solutions originales, adaptées aux exigences locales, pour que, comme nous le souhaitons tous, cette confédération puisse avoir la place qui lui revient en Afrique. Il est essentiel que certaines compétences soient exercées, pour le bien de tous par le pouvoir central. Je pense immédiatement à la direction des Affaires Etrangères, de l’Armée confédérale, des Communications, de certaines institutions scientifiques etc. Il faut également que le pouvoir central dispose d’un budget pour mener à bien les tâches qui lui sont dévolues.
Pour alimenter un budget, la solution ne serait-elle pas pour chaque État d’y contribuer par une quote-part proportionnelle à ses ressources ?… Peu importe si les montants sont différents, il suffit que chaque citoyen fasse un effort similaire dans les buts d’intérêt commun (…). Il est indispensable que tous ceux qui partagent ces vues de manière générale se réunissent et acceptent de discuter ensemble les structures futures de la confédération, au cours de franches et légales conversations … (Gérard-Libois L., 1963 : 301-302).
Qui aurait pu reconnaître là les propos de Moïse Tshombe ? Ils ont été tenus le 6 septembre 1960, au moment où la sécession était à son apogée et où Elisabethville n’avait rien à envier à Léopoldville. On comprend alors, malgré des oppositions apparemment irréductibles, pourquoi ces « frères ennemis » qui s’étaient pourtant promis la séparation au niveau du discours, adoptaient aisément des comportements irrationnels par rapport à ces positions officielle. Nous avons fait remarquer les rapports étroits qui existaient en définitive entre Léopoldville et Elisabethville, malgré tout ce qui les opposait ; de même l’empressement déconcertant avec lequel Stanleyville eut des contacts avec Léopoldville et le fait que Lundula se mette à négocier avec Mobutu la réunification de l’armée.
La sécession ne fut pas véritable ; cela se manifesta également par le fait que certains parmi les opposants les plus virulents au séparatisme se recrutèrent dans les rangs même des « séparatistes ». Ainsi la sécession katangaise fut surtout combattue par les Katangais du Nord. Tshombe tenait davantage s la tête de Sendwe qu’à celle de Lumumba. L’opposition entre le Sud- et le Nord-Ksi tanga était devenue telle, au beau milieu de la sécession, qu’en 1961, lorsque le Nord fit mine de vouloir se réconcilier avec le Sud, celui-ci lui opposa un refus catégorique, préférant compromettre les chances de contrôler un plus grand espace sécessiconniste, plutôt que d’intégrer les «rebelles» du Nord [59]. Est-ce la puissance du sentiment fraternel issu de la communauté de colonisation ou plutôt la force de la conscience politique acquise au cours de la lutte anticolonniale qui justifie la prépondérance qu’on accorda à l’unification du pays centralisée ou non ? Il semble que l’une ou l’autre soient intervenues. Ainsi les chansons de l’époque multiplient les exhorta, lions à l’unité. Le thème du fleuve était le favori : on préconisait, en chantant, la réunification des diversités ethniques en un tout cohérent, à la manière des affluents qui, par leurs eaux, alimentent un même fleuve. Aux accents rythmés de la guitare, 1’African Jazz rappela à qui voulait l’entendre que « les eaux du Katanga appartiennent au fleuve Congo » (Ebala ya Katanga, mai ya Congo). Il en allait de même des « eaux » de toutes les régions du pays. Ailleurs, cet orchestre évoqua plus explicitement le fait de l’éclatement du Congo suite à des intérêts «du dehors», invitant les leaders à éviter de se laisser influencer pas ces forces centrifuges.
Cha-cha Negro, Cha-cha Congo, Cha-cha Negro
Bakwanga, Lipopo, venez les amis soyons ensemble
Cha-cha Clary
Partageons le vin de palme, la bière de canne à sucre, Notre boisson traditionnelle Cha-cha Negro
Que le langage du dehors soit banni de vos lèvres
Cha-cha Negro
Notre pays le Congo n’est pas à vendre Cha-cha Negro
Kivu, Bukavu, Maniema, Bakwanga, Ancêtres réveillez-vous !
Cha-cha Congo, Cha-cha Negro
Venez, descendez, nos ancêtres. [60]
Il faut remarquer que les plus grands défenseurs de l’unité du pays furent en somme les Congolais eux-mêmes ; ils ne se différencièrent en fait que par 1 importance qu’ils accordèrent à ce combat commun. Lumumba, qui revendiquait une forte centralisation immédiate, fut, sans s’en rendre compte, à l’origine de toutes les sécessions ; Tshombe croyait aux vertus de la centralisation ; Kalonji et Bolikango briguaient des fauteuils ministériels ; Gizenga revendiquait la légalité de son gouvernement puisqu’il était le vice-Premier ministre du gouvernement légalement institué le 24 juin 1960… Si ces leaders avaient été familiers du débat politique et s’ils avaient été bien informés des mécanismes du fonctionnement démocratique, où une opposition dispose des moyens légaux de luttes en attendant les échéances électorales suivantes, sans doute ne se seraient-ils pas sentis obligés de recourir à la sécession, et auraient-ils ainsi vraisemblablement résisté aux pressions de leurs « conseillers européens », qui les poussaient à devenir les instruments d’une sécession qu’eux- mêmes auraient bien voulu proclamer, pour maintenir leur domination en vue d’écraser davantage le pays.
LE CONGO EN 1964 – Carte 20
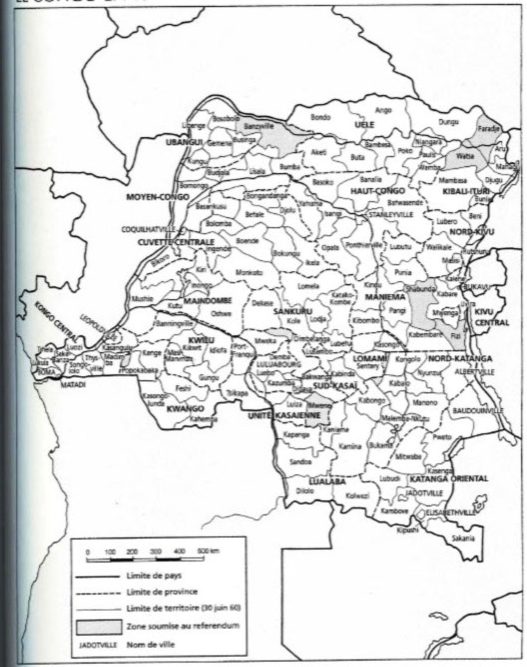
LE ZAÏRE EN 1988 – Carte 21

<p « >
Ces premiers événements ont également provoqué un réajustement des forces en présence au sein du pays. Les regroupements suscités par la lutte pour l’indépendance perdirent rapidement de leur importance. Ni le groupe « Conscience Africaine », ni l’Abako, pas même le MNC, du moins sous sa forme initiale, ne conservèrent le leadership politique. En fait, ce n’étaient plus les partis politiques qui menaient le combat. Trois foyers politiques s’étaient créés sur le tas, préparant l’avenir futur du Congo. D’abord, le « noyau dur » de Léopoldville se transforma en un véritable groupe de pression en vue de capitaliser à la fois le pouvoir et l’argent. Ce groupe de pression – le groupe de Binza – avait ses chefs de file, qui avaient pour noms Bomboko, Adoula, Mobutu, Nendaka. Il y avait ensuite le « groupe des Nationalistes », qui rassemblait les rejetons de Lumumba, du moins ceux d’entre eux qui demeurèrent fidèles à la vision socialisante et unitariste du pays. Vaincus à Stanleyville, ils s’étaient dispersés. Certains étaient à Léopoldville (Gbenye, Gizenga. Sendwe), du moins provisoirement mais la plupart avaient choisi le chemin de l’exil ou celui des études (T. Kanza, P. Mulele, B. Mungul-Diaka, A. Kashamura). Ils ne s’estimaient pas vaincus et entendaient poursuivre la lutte. Le dernier foyer était celui des « Katangais » ; il rassemblait ceux qui avaient pensé conquérir le pouvoir central par le biais de la sécession, aidés en cela par les Katangaleux, leurs amis européens. Parmi eux se trouvaient Tshombe, Munongo, Kimba, Kibwe, Moke, l’ancien commandant des gendarmes katangais… Pendant la sécession, et après l’essoufflement de celui-ci, plusieurs jeunes – notamment le futur Nguz a Karl i Bond – furent envoyés aux études. Ce groupe disposait d’une fortune colossale et des bataillons entiers armés des gendarmes katangais furent affectés comme réserve en Angola. Contrairement aux deux autres groupes, ce dernier disposait d’un puissant réseau de mercenaires d’origines diverses, dispersés à travers le monde et qui n’en demeuraient pas moins fidèles et voués à la cause du groupe. Mais ce noyau avait des affinités avec le « groupe de Binza », ce qui contribuait à tenir en respect le camp nationaliste.
Au terme de cette analyse, il faut ajouter que les événements avaient démontré une fois encore les connexions directes existant entre les forces en présence au Congo et les réseaux internationaux. Ainsi les événements du Katanga et le soin particulier avec lequel Hammarkjôld et Kennedy s’en préoccupèrent paraissent sous un jour nouveau s’ils sont perçus à la lumière des enjeux existant à l’époque sur le marché international du cuivre. La production mondiale du cuivre dépendait pour une large part de trois pays : le Chili, la Suède et le Congo. L’exploitation du cuivre chilien était assurée par la société ANACONDA contrôlée par Joe Kennedy, le père du président défunt ; celle de la Suède relevait d’une société dirigée par le propre frère du secrétaire général de l’ONU ; celle du Congo enfin était soumise à l’UMHK ; Hammarkjôld et Kennedy étaient impliqués dans une guerre de sécession au Katanga, région concurrente, pour sa production, de leurs intérêts familiaux [61]. Une raison de plus pour s’inscrire en faux contre le projet séparatiste ? L’hypothèse n’est pas à exclure à priori. De toute façon, l’implication internationale des événements congolais ne constituait pas en elle-même une nouveauté. Celle-ci résidait plutôt dans l’introduction de ces relais différents et divergents parmi les sujets autochtones. D’où la conquête du pouvoir fut soumise à une compétition sans merci entre les différentes tendances. La conscience historique, que véhiculèrent l’infatigable Kabasele et son African Jazz, dénonça les ingérences extérieures, les vrais démons de la division. Cette chanson fut diffusée dès 1961. Mais ceux à qui elle s’adressait ont-ils pu entendre ce message en lingala ?
Nous vous haïssons, pays étrangers au mauvais cœur
Vous avez dupé nos responsables politiques
Avec des billets de banque, vous avez sali leur conscience
Entre nous, on ne fait que s’entretuer
Malgré tout vous n’aurez pas le Congo
Sur toute question on finira par se mettre d’accord
A la table ronde, on s’est bien entendus
Le Congo possède aussi des esprits lucides
Malgré tout vous n’aurez pas le Congo
Sur toute question, on finira par se mettre d’accord
A la table ronde on s’est bien entendus
Car le Congo possède aussi des esprits lucides [62]
L’unité du pays comptait des défenseurs acharnés. Elle passait de plus en plus pour être acquise, malgré sa fragilité apparente. En réalité, comme on l’a noté, l’unité du Congo avait des racines beaucoup plus solides qu’il n’y paraissait ; les interventions extérieures, intempestives et dispersées, ont dû aiguiser la conscience populaire en ce sens.
Toutefois, la défense de l’unité ne supposait pas nécessairement l’existence d’un consensus interne. L’avenir réservait d’autres heures douloureuses au pays.
3 LA QUÊTE DE LA SECONDE INDÉPENDANCE
Avec la fin de la sécession du Katanga, une page importante de l’histoire du Congo venait d’être tournée ; non seulement le projet katangais avait échoué, mais de plus la sécession cessa d’être utilisée comme une menace pour obtenir une meilleure répartition politique. Certes, les guerres révolutionnaires – les rébellions – furent encore utilisées comme mode de conquête politique. Mais l’objectif poursuivi n’était plus de conquérir une partie du pays pour s’y installer, mais de l’occuper dans sa totalité et d’y instaurer une gestion politique différente.
A l’origine du nouveau conflit, il y avait le clivage politique qui subsistait entre les nationalistes, qui continuaient à proclamer leur fidélité à l’héritage de Lumumba et les autres formations politiques mieux disposées à l’égard des puissances occidentales. L’objectif commun de combattre la sécession avait provisoirement écarté ce clivage et favorisé le succès du conclave de Lovanium. Mais la réconciliation de Lovanium fut de courte durée. Les nationalistes se rendirent compte après coup qu’ils avaient été dupés. Adoula ne put dissimuler longtemps que son action était régie par le « groupe de Binza » et qu’il était donc en faveur des pays occidentaux. La tendance nationaliste qui siégeait dans son gouvernement fut évincée par des remaniements successifs (février puis juillet 1962, avril 1963), visiblement sur le conseil de ses éminences grises. Et ces éminences avaient derrière elles la Belgique et les USA dont l’aide était particulièrement précieuse, en cette période où le pays était encore privé de ses ressources d’origine katangaise [63].
L’opposition au gouvernement Adoula prit forme dans les Chambres, qui s’efforcèrent de le faire tomber. Les syndicats et même des étudiants regroupés au sein de leur Union générale s’en firent l’écho.
Deux faits contribuèrent à rendre le gouvernement plus impopulaire encore et, précipitèrent les choses. Il s’agit d’une part du refus suicidaire de libérer Gizenga, alors détenu à Bula-Mbemba, et d’autre part de l’initiative malheureuse du président Kasa-Vubu, qui provoqua la fermeture du Parlement.
Gizenga, emprisonné depuis janvier 1962 avec l’appui de lumumbistes tels que Gbenye et Lundula, gagna peu à peu les faveurs de l’opinion, à mesure que le gouvernement Adoula sombrait dans l’impopularité. Il fut transformé en héros tant par l’ensemble des lumumbistes que par l’ensemble des syndicats, suite au refus de sa libération. A ce propos, Kamitatu (1971 : 98) rapporte un incident particulièrement révélateur, en tant qu’ancien membre de ce gouvernement. En mai 1962 de la même année, le conseil des ministres décida de relâcher ce prisonnier politique. Mais quelques jours plus tard, Adoula revint sur cette décision. Agacé par les questions qu’on lui posait, il dut avouer : « J’étais d’accord mais mes amis n’ont pas accepté ce point de vue ». L’affaire Gizenga maintint les conflits et soutint 1 opinion selon laquelle le pouvoir était entre les mains des néo-colonialistes, au service de l’impérialisme occidental. [64]
Plus grave encore fut la décision prise par Kasa-Vubu le 29 septembre 1963 de dissoudre les Chambres, en vue de mettre un terme à l’offensive de 1 opposition qui ne cessait d’importuner le gouvernement, paralysant même les travaux relatifs à la rédaction de la nouvelle constitution. Cette intervention présidentielle, loin de calmer les ardeurs de l’opposition, lui fut favorable. Hors de 1 arène du Parlement, elle fut obligée de s’organiser dans la clandestinité. Mais où pouvait-elle se prétendre à l’abri des initiatives policières du pouvoir ? Brazzaville, capitale du Congo/Brazza, était tout indiquée. L’abbé Youlou venait d’être destitué avec son gouvernement, un mois plus tôt, au cours des fameuses « glorieuses » (13, 14 et 15 août 1963). Le nouveau maître du lieu, Alphonse Massamba-Debat, était de tendance progressiste et donc partenaire des lumumbistes. L’opposition trouva ainsi à Brazzaville un abri encore plus sûr que le Parlement de Léopoldville et une rampe de lancement pour la révolution, plus proche de sa cible, Léopoldville, que la lointaine Stanley ville.
3.1 La veillée d’armes
A Brazzaville, les partis unitaristes qui constituaient l’opposition s’organisèrent en un cartel qui fut appelé « Conseil national de libération » (CNL). Fondé le 3 octobre 1963, le conseil se fixa pour objectif de renverser le gouvernement Adoula et réaliser enfin « la décolonisation totale et effective du Congo », encore dominé par la coalition des puissances occidentales (Mbaya E.R. 1987 : 185-210). Dans son manifeste, le CNL proclama la déchéance de toutes les institutions régies par la loi fondamentale, chef de l’État, gouvernement et autres, et réclama la mise en place d’un « gouvernement provisoire de salut public » (Congo 1963 : 232-235) [65].
Malgré ses nouveaux atouts, le camp lumumbiste restait vulnérable à cause de l’existence de forces centrifuges en son sein. Ainsi tous les partisans de cette tendance unitariste ne firent pas le déplacement jusqu’à Brazzaville. D’autres éléments du PSA-G comme du MNC-L choisirent de demeurer à Léopoldville et continuèrent à composer vaille que vaille avec le gouvernement. Tel fut le cas du MNC-L de Kiwewa. Le CNL lui-même ne fut guère épargné par les divisions. Une compétition sournoise opposa dès le départ les membres du PSA-G (plus radicaux) à ceux du MNC-L qui dirigeaient le mouvement, étant donné le prestige de leur parti d’origine. Entre ces deniers il n’existait pas non plus une grande cohésion, à tel point qu’à partir de février 1964, il y eut deux ailes du CNL : le CNL-Gbenye et le CNL- Bocheley. En effet, Egide-Davidson Bocheley (MNC-L) vice-président du CNL contestait l’autorité de son président Gbenye dont il trouvait le comportement ambigu et peu porté à s’engager dans une lutte concrète ; avec ses amis, il révoqua ce dernier (5 février) et se fit élire responsable à sa place. Comme Gbenye ne reconnaissait pas cette révocation, le comité de Bocheley se mit à fonctionner comme faction distincte, opposée à celle de Gbenye. [66] Ces conflits menèrent à un affaiblissement notoire de l’action engagée. Le CNL-Bocheley s’appuya davantage sur le PSA-Gizenga et s’efforça de faire face à Mulele qu’on intégra dans le comité malgré lui, récupérant ainsi son projet révolutionnaire.
Bocheley ne cessa de critiquer l’inefficacité de Gbenye dans la lutte révolutionnaire, ce qui incita ce dernier à envoyer Soumialot et Kabila sur le terrain pour mener une action militaire similaire à celle de Mulele, cette fois au départ d’Uvira via Bujumbura. La multiplication des fronts eut pour effet d’accentuer et de radicaliser la lutte révolutionnaire qui parvint à paralyser une grande partie du pays. C’est le seul domaine où l’émulation des deux CNL fut bénéfique à leur action réciproque. Qu’en était-il sur les plans diplomatique et politique ? Les pays étrangers, sensibles à l’héritage de Lumumba, étaient mal à l’aise, ne sachant quelle faction soutenir. De même, à cause de cette confusion, il ne fut pas possible de mener à bien le projet de collaboration instauré avec Tshombé, alors en exil à Madrid. En février 64, le CNL et Tshombe, engagés dans le même combat anti-Adoula, signèrent un protocole d’accord pour « conjuguer leurs efforts » et former « un gouvernement révolutionnaire » sur base du « socialisme africain » [67]. Le projet ne fit pas long feu, il échoua bien que Tshombé eût à présider le gouvernement qui succédera à Adoula, suite au manque de cohésion de ses partenaires du CNL. Plus grave encore ; Tshombé combattra le CNL et mettra fin aux « rébellions ».
L’absence d’un leader qui eût pu créer l’unanimité fut donc fatale au CNL. Lumumba demeurait irremplaçable, trois ans après sa mort et l’action politique qui se réclamait de son autorité n’avait pas l’efficacité voulue.
Il n’est pas sûr que le CNL se serait orienté dans la voie de la lutte armée si Mulele ne s’y était déjà engagé, indiquant par là la voie à suivre par tout engagement qui se voulait révolutionnaire. Ce personnage avait toujours été partisan de la manière forte, d’abord aux côtés de Lumumba, ensuite auprès de Gizenga. Déjà en 1960, il estimait que Lumumba était trop complaisant à l’égard des Belges lors des événements du mois de juillet, du moins d’après Monguya (1977 : 62) : d’autre part, il réprouva la réconciliation de Gizenga avec Adoula. C’est ainsi qu’il se décida à continuer la lutte depuis le Caire, malgré la défection de son ancien chef qu’il estimait récupéré par le camp pro-occidental. Mais où pouvait-il encore poursuivre la lutte, puisque les amis de la « République Libre du Congo » avaient renoué avec Léopoldville ? Condamné à l’errance, il arriva à Moscou qui ne lui fit pas bon accueil. Parvenu à Beyrouth, il entra en contact avec la mission chinoise qui l’encouragea dans son projet. C’est ainsi qu’à partir de mars 1962. il se retrouva en Chine et put, avec son ami Bengila, s’initier aux techniques de la guérilla, tout en suivant un enseignement politique. Mulele se spécialisa surtout dans la topographie militaire et dans la fabrication des mines, des explosifs, des fusils et des émetteurs.
C’est le 3 juillet 1963 qu’il parvint à Kinshasa, déguisé en Ouest-Africain, bien décidé à mener une révolution paysanne. A Kinshasa, il se montra discret. Les Lumumbistes cherchaient à l’époque à dissoudre le gouvernement Adoula au Parlement. Mais Mulele avait une tout autre notion du changement. Il s’adressa à quelques-uns en ces termes : « Le temps des motions de méfiance est passé ». S’était-il fait comprendre ? Le 27 juillet, il gagna les savanes boisées du Kwilu, préférant finalement ce terrain aux forêts du Mayumbe ou de Stanleyville [68]. La révolution muleliste avait atteint le stade du non-retour, deux mois avant que le CNL ne soit créé (Mertens L. 1985). Vingt jours après, elle subit les premiers assauts de l’armée au moment où elle ne disposait pour tout armement que des deux revolvers de Mulele et d’un fusil calibre 16 obtenu localement.
Les rébellions au Congo constituent la page d’histoire contemporaine la plus saisissante pour l’émotion quelle suscita, et qui reste présente dans la mémoire collective ; c’est aussi un épisode historique très controversé et sujet à des versions diverses, en fonction des pouvoirs successifs en place [69]. Il est entendu que, suite à leur échec, les meneurs des « rébellions » furent abandonnés de tous, y compris de ceux qui avaient soutenu leur initiative au début.
En réalité, comme nous allons le voir, ces guerres ne furent rien d’autre que des révolutions, tant dans le chef de ceux qui les ont menées que par les méthodes utilisées. On pourrait objecter que ce fait est contestable, que ces actions n’ont pas été menées avec une égale compétence révolutionnaire et que les actions sur le terrain ont détourné le fait révolutionnaire de ses buts véritables [70]. Quelle révolution connue n’a jamais produit quelque bavure ? La guerre révolutionnaire congolaise ne fit pas exception à la règle. Il est évident que si elle avait abouti à la victoire des partisans de la révolution, cet épisode historique aurait été considéré comme une des pages les plus glorieuses de l’histoire politique nationale. Comme le dénouement n’avait pas été favorable aux initiateurs de la guerre, ceux-ci devaient payer le lourd tribut de l’échec. Vae victis ! [71]
La révolution lancée connut deux mouvements : l’un à l’ouest et l’autre à l’est. Le premier fut lancé et dirigé par P. Mulele dans le Kwilu à partir du mois d’août 1963. Après ce premier succès, les amis de Mulele à Brazzaville s’efforcèrent de créer une voie d’accès par laquelle ce maquis pourrait être ravitaillé de l’extérieur. C’est ainsi que fut ouvert un second front dans la région de Bolobo-Mushie (juillet 1964). Cette région, baignée par le fleuve, permettait un contact avec le Congo- Brazzaville en même temps qu’elle autorisait une jonction avec le maquis du Kwilu, par navigation sur le Kasai, entre Mushie et Mangai.
Le second mouvement, plus important par son ampleur, partait de la région Uvira-Fizi qui fut conquise en Avril 1964 ; de là, il gagna le Nord-Katanga par la conquête d’Albertville (19 juin 1964), puis le Maniema dont la capitale fut occupée peu après (24 juillet) et enfin le Haut-Congo où Stanleyville conquise (5 août) devint la capitale d’une » République Populaire du Congo ».
Qu’il y ait un lien évident entre les deux mouvements, cela ne faisait aucun doute, et ce rapport était reconnu. Au Kwilu, en avril 1965 encore, les « partisans » attendaient du renfort en provenance de Stanleyville. Inversement, dans la région de l’est, les combattants proclamaient volontiers leur invulnérabilité au cri de « Mai Mulele ». Ce dernier jouissait auprès de ces militants d’un réel prestige qui n’avait d’égal que celui de Lumumba [72]. Dans les chansons révolutionnaires, son nom était cité comme celui du maître de la révolution. Sur un air populaire, les jeunes filles s’exclamaient :
Je ne me marierai pas, ne me marierai pas
Tant que Mulele n’aura pas gagné
Je ne me laverai pas, je ne me laverai pas
Tant que Mulele n’aura pas gagné. [73]
L’unité d’action se remarqua surtout au niveau des objectifs poursuivis et des méthodes utilisées pour y aboutir. A l’ouest comme à l’est, on entendait combattre les « néo-colonialistes », les « valets de l’impérialisme », « ceux-là qui ont vendu le Congo aux Américains » et qu’on appelait les PNP (traduit par « penepene » na mundele). Ce n’étaient plus les Belges et les Américains qui étaient visés, mais plutôt les nationaux à leur solde. On luttait pour instaurer la « révolution » qui était la « deuxième indépendance », le règne de la « prospérité économique », du « partage égal », de « la paix », « de la liberté totale, de la démocratie ».
En effet, en deux ans s’était instauré un véritable dualisme entre deux univers sociaux : d’un côté, la classe politique née de la décolonisation, qui détenait le monopole de la puissance bureaucratique et qui partageait avec les Blancs le pouvoir économique et social ; d’autre part, il y avait la masse, confrontée plus gravement qu’auparavant aux problèmes du chômage, de la misère sociale et de la faim. On réclamait ainsi une plus grande justice politique et dans le même temps, la libération de Gizenga (surtout au Kwilu), le jugement des assassins de Lumumba (surtout à l’est) et la défense de l’unité du pays (le retour à six provinces au lieu de 21), vendu (disséqué) par le « gouvernement fantoche » d’Adoula.
La conquête révolutionnaire procédait de la même manière à quelques nuances près : l’exploitation des conflits locaux (entre tribus et entre partis locaux), l’utilisation des armes traditionnelles et des recettes guerrières locales (immunisation contre les balles ennemies, technique pour se rendre invincible et donc invisible aux yeux de l’ennemi). Ceci souligne la pauvreté de cette révolution qui n’a pratiquement pas bénéficié d’aides extérieures et qui a dû se limiter aux seules forces locales à peu de chose près. Les combattants étaient de deux ordres : les « partisans », véritables combattants appelés à l’est des Simba (lions) et les « jeunesses », sorte de milice recrutée localement et chargée des petites besognes. L’intervention de la Chine maoïste s’est manifestée par une simple initiation technologique. Les mulelistes firent en effet usage des cocktails molotov fabriqués localement. Toutefois l’apport le plus important de la Chine semble avoir été d’ordre idéologique, à tel point que les capitaines de la révolution, à l’est comme à l’ouest, insistèrent beaucoup sur la formation, sur le respect des « principes de base » ou du « catéchisme des partisans ». Mulele commença son action par la création de camps de formation ; au Congo- Brazza, le CNL créa plusieurs camps similaires dans les villages de Mukutimpoko, de Boanga, de Boemba, de Mpuya mais surtout de Gamboma, là où étaient envoyés des jeunes gens recrutés par le CNL de Léopoldville [74]. Plusieurs des principes évoqués étaient une reprise fidèle des enseignements du maoïsme ; c’est le cas des « quatre principes fondamentaux de la tactique de guérilla » de Mulele, qui sont extraits du manuel du Viet-Minh élaboré dès Mai 1928 par le Comité central du Parti communiste chinois, à l’initiative de Mao-Tse-Toung (Verhaegen B. 1966 : 200) :
Quand l’ennemi avance, nous reculons ;
Quand l’ennemi s’arrête, nous harcelons ;
Quand l’ennemi est fatigué, nous l’attaquons, Quand l’ennemi recule, nous le poursuivons.
« L’Ordre de mission des partisans » et les « Trois travaux que les partisans doivent suivre » qui définissaient le code de conduite du partisan étaient eux aussi des adaptations de principes maoïstes connus. Le contenu de ces instructions, tout comme les « Catéchismes du partisan » (Verhaegen 1966 : 237-238) ou du « révolutionnaire » (1969 : 66-67) témoignaient du sérieux de l’action engagée. En effet, les « Huit ordres » auxquels tout partisan devait se soumettre, pour ne citer que ce seul cas, étaient les suivants :
1. faites preuve de respect vis-à-vis de tous les hommes, même des hommes vilains ;
2. achetez les biens des villageois en toute honnêteté et sans les voler ;
3. remettez les objets empruntés à temps et spontanément ;
4. payez les objets que vous avez détruits de bon cœur ;
5. ne frappez pas et n’injuriez pas autrui ;
6. ne détruisez pas et ne piétinez pas les champs des villageois ;
7. respectez les femmes et ne vous amusez pas avec elles comme bon vous semble ;
8. ne faites pas souffrir ceux que vous arrêterez pendant les combats, ne confisquez pas leurs biens. Les « Trois travaux » à ne jamais négliger portaient sur trois recommandations : obéissance stricte aux ordres, interdiction de confisquer le bien d’autrui et obligation de remettre tout butin à l’autorité (1966 : 122-123).
Examinons les différentes phases de l’offensive révolutionnaire avant d’évoquer les conséquences qu’elle eut sur l’avenir du pays, malgré son dénouement malheureux.
3.2 L’offensive muleliste
Cette offensive se déploya dans le Kwilu, en proie à l’époque à une opposition vive entre le PSA-Kamitatu et le PSA-Gizenga. Le premier, soutenu par l’administration et le gouvernement provincial, faisait subir toutes sortes de vexations aux populations des régions à prédominance gizengiste. C’est précisément en pays Mbuun-Pende, principal fief du PSA-Gizenga, que P. Mulele installa son quartier général. Son action se déroula en quatre phases : la première fut celle de l’organisation des camps d’entraînement [75] et la constitution de groupes de « jeunesses » (juillet-octobre 1963) ; la deuxième se caractérisa par des actions sporadiques qui se firent par la suite plus fréquentes et plus violentes (octobre-décembre 1963) : la troisième fut celle de la lutte ouverte, inaugurée par l’attaque de Kilembe, le 22 janvier 1964, au cours de laquelle trois missionnaires belges furent tués (janvier-septembre 1964) : la quatrième phase se caractérisa par la guerre de résistance (fin 1964-1968). Le mouvement fut stoppé par des bombardements et une offensive de grande envergure de la part de l’ANC (Verhaegen B. 1966 : 67-186).
Le « temps fort » se situa au cours de l’année 1964, quand la révolution enregistra une succession de victoires avec l’attentat de la station agricole de l’INEAC à Kiyaka, – en vue de s’emparer des produits de laboratoire nécessaires à la fabrication des cocktails molotov (1er janvier) -, l’attaque des huileries et des missions de la région, l’embuscade à quelques kilomètres de Gungu qui provoqua la mort du colonel Ebeya, etc. En quelques mois, les forces mulelistes occupèrent le triangle compris entre Kikwit, Gungu et Idiofa. Ces deux dernières furent alors la cible d’assauts répétés et Kikwit elle-même fut attaquée, du moins la rive droite du Kwilu. Il y eut de nombreuses incursions dans la province Unité kasaïenne, ainsi qu’au Kwango et au lac Léopold II.
L’action de Mulele fut remarquable par la rigueur de son organisation, due surtout à l’entraînement intensif et à la discipline draconienne qu’il imposait à ses troupes. L’ensemble du maquis fut lui-même organisé à trois niveaux. A la base, il y avait l’équipe de partisans localisée dans chaque village. Le chef d’équipe était un chef militaire, censé avoir suivi une période d’entraînement d’une durée minimale de huit mois. Il était assisté d’un caporal de guerre, d’un chef de peloton et d’un chef de section. Les autres membres du personnel de l’équipe étaient les « commissaires politiques » et leurs assistants, un secrétaire chargé de la rédaction des rapports, un guérisseur (ou un infirmier), un chef de camp puis un homme ou une femme (appelés « un de semaine ») chargés des travaux domestiques du camp et enfin, un chef de poste. Tous les villageois et les membres de l’équipe se réunissaient chaque matin pour répondre à l’appel du chef d’équipe et recevoir ses instructions. Au-dessus des équipes, il y avait les « sous-directions » et les « directions », coordonnées par des « chefs sous-direction » et des « chefs direction ». Ils contrôlaient les équipes et assuraient la liaison entre celles-ci et le « Central », c’est-à-dire Mulele lui-même et son quartier général, établis à Lukamba ou à Mulembe, mais le plus souvent mobiles, de manière à échapper aux poursuites de l’ANC.
Une des caractéristiques propres à l’entreprise de Mulele fut son option résolument rurale. Tout se fit dans les villages, avec une élite constituée de lettrés ruraux, essentiellement des moniteurs. On évita soigneusement dans un premier temps d’affronter les centres urbains – Idiofa, Kikwit. Quand les campagnes des alentours furent conquises, l’offensive s’orienta vers ces centres. Mais elle ne parvint à s’emparer ni de l’un ni de l’autre, ce qui continua à «isoler» Mulele et sa révolution, complètement coupés des points d’accès (port ou aérodrome) par lesquels il aurait pu recevoir du renfort. Est-ce pour cela que Mulele ne fit jamais référence au CNL, ou préféra-t-il éviter de mêler sa révolution aux ambiguités du CNL, ou bien encore, estima-t-il que le moment d’en parler n’était pas venu ? Le fait est que le CNL resta inconnu au Kwilu.
L’action de Mulele se distingua encore par son caractère silencieux et finalement mystérieux. Son leader préféra l’action sur le terrain au discours. Jamais il ne recourut au communiqué ou à la conférence de presse. Les partisans avaient pour consigne de ne jamais citer le nom de Mulele. Le leader devait entretenir un certain mystère autour de sa personne pour assurer sa protection mais aussi pour consolider son identité charismatique. En cela, Mulele s’inspira de recettes traditionnelles d’après lesquelles l’immunité magique faisait la force du partisan. L’origine de cette force supranaturelle qui rendait le partisan invincible et invulnérable n’était autre que Mulele lui-même lequel, ayant été la cible de balles blanches, aurait ainsi donné une preuve de sa force. Invulnérable, Mulele était aussi considéré comme omniprésent, doté d’ubiquité et capable de se transformer en animal. Il semblerait que, lorsque les partisans rencontraient un serpent en forêt, ils le saluaient par un « bonjour, camarade ! », en pensant que Mulele venait les surveiller (Verhaegen B. 1966 : 126). Victime d’une telle supercherie, le partisan ne pouvait que faire preuve de beaucoup de courage, car il était en principe lui-même invulnérable ; et si quelqu’un tombait sous les balles, c’est qu’il s’agissait d’un traître ; ou bien c’est parce qu’il n’avait pas respecté les prescriptions (ne pas manger certains morceaux de viande, ne pas toucher un objet appartenant à un Européen, ne pas se retourner ni s’arrêter au combat, ne pas citer le nom de Mulele) [76]. Grâce à ces quelques principes tactiques, auréolés d’une certaine dimension magique, la révolution put progresser et récolter des victoires, aussi longtemps que les Etrangers ne se mêlèrent pas à cette lutte.
A Brazzaville, les amis de Mulele (Mukulubundu, Mukwidi, Balonji, etc.) ne restèrent pas inactifs et veillèrent à propager la cause de Mulele. A partir de leurs camps d’entraînement, surtout de Gamboma, sept missions furent organisées pour amener la révolution au cœur des autres régions du pays. Il y eut ainsi des noyaux révolutionnaires à Coquilhatville, Stanleyville, Bukavu, Luluabourg, Léopoldville et au lac Léopold IL Seules les deux dernières missions firent quelque peu parler d’elles. En effet, à Léopoldville, les révolutionnaires réussirent leur premier acte de sabotage au plastic, le 10 mai 1964. Une grande panique s’empara des Kinois et le couvre-feu fut décrété (Martens L. 1985 : 306-307). Mais l’opération tourna court car les « clandestins » furent arrêtés. La mission au lac Léopold II connut un succès relativement plus important, elle est connue sous le nom d’opération sur Bolobo-Mushie. Bien qu’elle ait été lancée trois mois après l’ouverture du Front de l’est à Uvira-Fizi, elle doit être évoquée ici car elle s’intègre dans la stratégie de la conquête de l’ouest (Verhaegen B. 1966 : 89-256). Du point de vue tactique, l’opération fut très importante parce qu’elle permettait en cas de réussite, nous l’avons vu, l’établissement d’une jonction entre Brazaville et le maquis du Kwilu par Mushie, située à 325 km par voie fluviale de la pointe extrême de l’avance rebelle. Elle aurait permis également d’envisager l’attaque de Léopoldville, qui était déjà minée par l’infiltration de quelques partisans.
A partir du camp d’entraînement Boanga au Congo, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Gamboma, Bolobo fut envahie par les révolutionnaires dans la nuit du 25 au 26 juillet, sans résistance véritable. Peu après, c’est l’ensemble du territoire situé dans le triangle Bolobo-Kwamouth-Mushie qui fut conquis, et Mushie fut occupée le 28 juillet. Mais cette victoire fut de courte durée, car la région fut reprise par l’ANC au début du mois d’août. Léopoldville n’ayant pas pris le risque de laisser plus longtemps l’ennemi à ses portes. C’est à l’occasion de cette reconquête que plusieurs documents émanant des camps de formation de Gamboma tombèrent entre les mains des militaires. On put ainsi prendre connaissance des principes qui régissaient l’offensive muleliste.
3.3 La conquête de l’Est
Le deuxième front révolutionnaire s’est ouvert le 15 avril 1964, dans la région de Uvira-Fizi, huit mois après le déclenchement de l’opération du Kwilu. Depuis janvier, Gaston Sumaili (connu sous le pseudonyme de « Soumialot ») ainsi que Laurent Kabila venant de Brazzaville s’étaient installés à l’hôtel Paguidas à Bujumbura, et se livraient à des activités « subversives » faisant parvenir des tracts dans les régions de l’est. Il va sans dire que l’ensemble de cette région, composée du Kivu, du Nord- Katanga et du Haut-Congo avait ses propres problèmes internes. La création de nouvelles provinces, décrétée par le gouvernement Adoula, avait créé une vive animosité tant à propos de ces entités que des administrations politiques à mettre en place, à partir de l’enchevêtrement des réseaux de solidarité tribale et de partis.
L’attaque, le 15 avril 1964, des différents postes dans la plaine de Ruzizi en vue d’obtenir le contrôle de la route asphaltée Uvira-Bukavu donna le coup d’envoi de l’offensive révolutionnaire. Elle fut précédée, le même jour, par l’attaque de Bukavu. Les assaillants étaient armés de gourdins, de machettes, de lances, de flèches et de quelques fusils mais ils échouèrent. Le 7e bataillon, commandé par le major Yassa parvint à repousser les assaillants. Repliés, les révolutionnaires s’assurèrent d’abord le contrôle total des montagnes ; puis ils s’emparèrent d’Uvira, dans la nuit du 16 au 17 mai et ensuite de Fizi (27 mai). Cette région servit de point de départ pour les conquêtes suivantes (Verhaegen B. 1966 : 277-336). Albertville, la capitale du Nord- Katanga, fut conquise le 18 juin, pratiquement sans résistance (1966 : 410-529). De là, l’ensemble de la région tomba sous le contrôle des Simba, tant la panique était grande parmi les soldats de l’ANC qui désertèrent Baudouinville sans combattre, puis Kabalo, Manono, Kabongo, utilisant le rail, la route et l’eau pour fuir. Le pays fut abandonné si rapidement que les forces révolutionnaires manquèrent de véhicules pour occuper et administrer le territoire conquis. Les Simba atteignirent les régions abandonnées avec plusieurs jours de retard et ramassèrent les armes et les véhicules que les troupes régulières avaient abandonnés (1966 : 439). Au mois de juillet, Kindu, la capitale du Maniema, connut le même sort, ainsi que d’autres villes de la région : Kabambare, Kasongo, etc (1969 : 279-358).
L’offensive révolutionnaire avait atteint son apogée et une division de travail s’instaura entre les dirigeants du mouvement se trouvant sur le terrain. G. Soumialot devint président du gouvernement provisoire du CNL-Section de l’Est, chargé de la Défense nationale et L. Kabila, vice-président, d’abord chargé des Affaires intérieures puis après, des Relations et du Commerce extérieurs. N. Olenga fut désigné chef militaire. Il réorganisa le commandement de l’Armée Populaire de Libération (APL) en recrutant ses officiers supérieurs parmi les politiciens nationalistes du Maniema ; lui-même s’octroya le grade de « général-major » puis de « lieutenant-général » (Congo 1965 : 374). La révolution continua à évoluer de victoire en victoire car Stanleyville fut occupée le 5 août et la « République Populaire du Congo » y fut proclamée le 5 septembre. Le gouvernement provisoire de l’est fut dissous pour être remplacé par celui de la nouvelle république. Au sein de cette équipe, Kabila fut retenu comme secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et ministre plénipotentiaire auprès de la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya. Cette expérience politique subsista jusqu’au 24 novembre 1964, date à laquelle elle s’effondra, devant l’invasion des parachutistes belges (Notomb, P., 1993).
Stanleyville marqua le point culminant dans les conquêtes. Par la suite, les forces de l’APL se mirent à décliner sensiblement ; elles ne purent s’emparer de Bukavu. L’échec des deux assauts menés contre cette ville entama le moral des troupes et la crédibilité du général Olenga. La première offensive eut lieu le 18 août, organisée selon un double mouvement de révolte intérieure et d’attaque extérieure ; le plan ne fut pas appliqué rigoureusement, et les opérations ne furent pas synchronisées, (15 et 18 août). Le colonel Mulamba, soutenu par les colons européens et les sujets du Mwami Kabare, put se ressaisir et infliger une défaite, la première du genre, aux troupes de l’APL (Masson P. 1965 : 111-112). Olenga se retira à Kindu pour préparer méticuleusement la seconde attaque, soucieux de rétablir la confiance de ses troupes en leur force immunisante. L’enjeu était de taille car la prise de Bukavu, d’un point de vue stratégique, eût permis de s’emparer de l’aéroport de Kabembe, par lequel arrivait du renfort grâce aux avions C130. Mais cette seconde attaque (29 septembre) fut encore plus catastrophique que la première : Mulamba avait entre-temps intégré des mercenaires sud-africains à l’ANC (1969 : 542-543). Un rescapé de ce combat raconte : « … l’avion nous a attaqués une seconde fois ; oh ! maman ! c’était un carnage ! Beaucoup de morts !… En revenant comme ça, nous avons croisé le général Olenga au village. Il nous a sommés de faire demi-tour. Quand nous sommes arrivés à la bifurcation près de Bukavu, le général nous divisa en deux groupes qui s’engagèrent chacun dans sa direction. On nous donna un fusil FM. Mais hélas ! nous étions déjà pris dans une embuscade des ennemis. Peu après, ce fut notre colonel qui tomba mort. Notre féticheur qui nous donnait le bain fut blessé ainsi que ses assistants. C’est alors que l’avion nous attaqua en l’air. Notre jeep fut brûlée. J’avançai encore, en me cachant, pour me battre contre l’ennemi qui voulait saisir le général par les mains. Nous fîmes tout pour le sauver » (1969 : 543). Olenga put effectivement regagner Kindu le 2 octobre. La révolution touchait à sa fin. Le reste ne fut plus qu’une question de quelques semaines.
Le front de l’Est fut incontestablement la plus belle conquête de la révolution : il occupa un peu plus d’un quart du territoire national. Il convient d’en saisir les particularités et de noter ce qui le différenciait de la révolution muleliste.
Le programme de lutte se réclamait ici explicitement du CNL. Soumialot, avant l’instauration du « gouvernement central de la République populaire du Congo », avait toujours signé ses déclarations en tant que « président du CNL-Section de l’Est ». De plus, l’action menée s’identifiait à celle du MNC-L. Le « catéchisme du révolutionnaire » qui fut diffusé sur place était celui du MNC-L. Il convient de prendre connaissance de ce texte pour comprendre la pertinence du combat engagé et la profondeur d’analyse de ces révolutionnaires (voir texte à la fin du chapitre).
On notera que le Front de l’Est s’est encore caractérisé par son souci d’implantation immédiate d’une gestion politique des «territoires libérés». Le CNL-Section est obtint son gouvernement présidé par G. Soumialot. Chaque province fut dotée d’un gouvernement provincial mis en place par le nouveau pouvoir. Il en fut ainsi à Uvira, à Albertville et à Kindu. Les forces combattantes furent organisées en « armée populaire de libération » mais sur le modèle de l’ANC, avec un commandant en chef et un état-major. Dès la conquête de la capitale, on procéda à une réorganisation générale. Par décret-loi du 5 septembre 1964, la République populaire du Congo fut créée avec six provinces, dans les limites ayant existé au 30 juin 1960 ; Gbenye, président et chef de gouvernement, décida de la mise en place d’un gouvernement comprenant 17 ministres (Ordonnance n° 2/64). S’il ne nomma que quatre ministres, c’est parce que les autres portefeuilles étaient en principe réservés aux ressortissants de provinces qui restaient à conquérir [77]. Mulele préféra, on le sait, ne pas s’encombrer de toute une bureaucratie. On peut toutefois estimer qu’elle n’a pas été inutile, dans un espace aussi vaste. Il va de soi que cette administration a produit un minimum d’archives et les dirigeants ont accumulé les déclarations, allocutions, conférences de presse qui ont permis de ne pas limiter cette expérience au seul niveau paysan. Au demeurant, les villes furent ici conquises en premier lieu, avant que ne s’y soient intégrés les espaces qu’elles polarisaient [78].
Une autre caractéristique essentielle de ce front de l’Est réside dans le rôle capital qu’y joua l’aspect magique, à tel point que la définition même du combattant en fut modifiée. Le combattant, le simba (le lion), n’était pas tant un diplômé du camp d’entraînement, que celui qui avait reçu le « baptême » d’immunisation (dawa). Cette initiation consistait en trois rituels distincts qui n’étaient pas nécessairement combinés, chacun d’eux aboutissant à un degré d’invulnérabilité. Le premier rituel était celui du bain (kukoka mayi). Le combattant se faisait asperger d’« eau bénite » par le « docteur-féticheur » qui détenait la force magique. Le deuxième consistait en scarifications, sur lesquelles on apposait un onguent magique ; le troisième enfin était le port d’amulettes. Ces multiples dawa provenaient de traditions « médicales » des populations de la région conquise, réputées pour être spécialisées en ce domaine, notamment les Lega, les Kusu, les Bembe et les Luba (Nord-Katanga). Après ce baptême, devenant un Simba, on était autorisé à porter un morceau de peau de léopard sur la tête (chui).
L’APL, avait intégré dans ses unités des docteurs-féticheurs et avait incorporé la réalité magique à sa gestion quotidienne. Chaque peloton avait son docteur-féticheur ; celui-ci avait un grade militaire et pouvait être promu, révoqué ou permuté suivant les nécessités du combat. Des télégrammes officiels mentionnaient certains ingrédients dont on avait besoin en vue de mener, telle ou telle attaque. Précisons en outre que bon nombre de ces docteurs-féticheurs étaient des femmes. L’histoire de la révolution de l’Est a gardé le souvenir de la plus célèbre d’entre elles, Henriette Onema, qu’OIenga fit venir spécialement de Sankuru pour qu’elle veille sur sa santé militaire ; à cette effet, on installa celle-ci à Kindu (Verhaegen G. 1969 : 565).
La puissance de l’invulnérabilité était soumise à un code de conduite précis et, presque, draconien. Ces tabous, Verhaegen a tenté de les classer en catégories distinctes, reprenant successivement des interdits relatifs à la pureté, au contact avec l’eau, à l’alimentation et à la vie militaire. Dans le domaine de la pureté, le Simba était tenu de s’abstenir d’avoir des relations sexuelles, de ne pas toucher un non-Simba, de ne manger que la nourriture préparée par un homme ou une fille non pubère [79], de ne jamais voler, de ne pas toucher un cadavre ou le sang d’un blessé, de ne pas tuer des innocents ou des femmes. Pour ne pas perdre l’invulnérabilité, tout contact avec l’eau était proscrit. Aussi le Simba était-il tenu de ne pas se laver et donc de ne pas circuler sous la pluie, ni traverser une rivière ; il devait s’abstenir de se couper les cheveux, la barbe et les ongles. Sur le plan alimentaire, outre les prescriptions émises quant à l’identité du cuisinier, il fallait éviter de consommer des légumes (sombe, feuille de manioc) et ne se nourrir que de poisson et de viande. Dans la nourriture carnée, certaines parties (tête ou tripes) devaient être évitées. Au combat, le Simba ne pouvait ni reculer ni fuir ; il ne pouvait se placer à la gauche d’un civil, ni quitter le milieu de la route lorsqu’il marchait. Il ne pouvait faire du butin ni dormir dans la maison d’un civil (1969 : 573-577). [80]
Il va de soi que se conformer à ces tabous posait des problèmes. Certains trichaient. Ainsi un Simba qui s’emparait d’un butin intéressant pouvait justifier sa conduite en prétendant faire un emprunt temporaire qu’il restituerait ultérieurement. Les consignes relatives à l’eau étaient difficiles à observer. Ainsi, à partir de septembre, soit à la fin de la saison sèche, les Simba réclamèrent auprès de leurs chefs un autre dawa, qui pourrait résister à la désimmunisation de la pluie, devenue fréquente (1969 : 592). L’efficacité des bombardements des T-28 par les Cubains anti-castristes de la CIA, était entre autres justifiée par la fréquence des pluies. De même, il était difficile pour le Simba de rester à tout moment insensible à la beauté féminine. Voilà pourquoi les docteurs-féticheurs étaient souvent sollicités : on allait chez eux « prendre le bain », et se purifier, les fétiches ayant perdu leur efficacité. Les militaires de l’ANC croyaient en la force invincible du dawa ; on comprend dès lors qu ils aient fui devant les Simba. Ils ne s’estimaient pas suffisamment armés pour lutter contre la force magique. Les révolutionnaires, dans ce contexte précis, n’étaient guère plus courageux que les forces régulières. En effet, il arrivait que, face à un petit obstacle, ils se dérobent tous ; c’est que pendant des jours, ils n’avaient pas pu « se laver », et étaient conscients de leur vulnérabilité. Si les forces régulières avaient pu les attaquer quand ils s’estimaient impurs, ou élaborer une stratégie en se fondant sur les cours d’eau à traverser, il est évident qu’elles auraient pu aussi accumuler les victoires. C’est dire que la technique magique avait également ses faiblesses. Si elle donnait un surcroît de courage, elle donnait lieu à un sentiment de défaitisme généralisé à certaines occasions. L’issue malheureuse des attaques de Bukavu a pu ainsi être justifiée : d’abord les combattants avaient vécu les délices de Kindu, ensuite le général Olenga poussa le sacrilège jusqu’à amener sa maîtresse au front (1969 : 577). On allait vers une débâcle totale.
L’usage du chanvre était également courant, mais en tant que renforcement de l’immunisation. La drogue permet en effet de perdre momentanément son bon sens et le Simba pouvait ainsi avancer malgré le danger. La drogue rendait ses blessures insensibles et multipliait en quelque sorte l’efficacité du dawa. Cette drogue était utilisée soit en onction sur les scarifications, soit encore en tisane, mélangée au vin de palme ou à la nourriture.
Une dernière particularité de l’action menée réside dans le fait que la révolution du CNL ne se privait pas de faire ostensiblement référence à la prière et à Dieu. En cela, elle se démarquait de l’enseignement « classique » de Mulele qui ne faisait aucun cas des recettes religieuses. Son mouvement était purement laïc (Martens L. 1985 : 238-240). Il n’en allait pas de même de Soumialot, qui n’hésitait pas à aller à la messe dominicale à Kindu ; il avait sa vision propre des questions religieuses, estimant que les Spiritains n’étaient pas aussi colonialistes que les Pères Blancs (Congo 1969 : 236). Malgré le fait que près de 200 missionnaires périrent sur ce front, victimes de la guerre « révolutionnaire », nombre de militants ne cessaient de faire référence au Très-Haut. « Dieu veut la victoire de la révolution car celle-ci est juste », disaient-ils. « Le Grand Dieu qui voyait nos justes demandes nous envoie le second prophète Mulele de la même lignée que le libérateur et martyr Lumumba. Notre armée est l’armée de Dieu. La chance de Soumialot, c’est qu’il peut réunir des soldats qui ont beaucoup de force, une force venant de Dieu pour libérer le Congo ». A Kindu, un chant de bienvenue à l’adresse des leaders révolutionnaires disait explicitement ceci : « Nous prions pour vous. Que Dieu vous prête force pour vaincre les ennemis, ces Noirs du Congo qui ont renié les Noirs et qui sont devenus des Blancs » (1969 -. 738, 361).
3.4 Au soir de la révolution
Ces différentes actions débouchèrent en définitive sur des échecs, y compris le combat pourtant savamment organisé de Mulele. Le fait demeure malgré tout étonnant ; que n’a-t-il fait pour réussir ? Les spécialistes reconnaissent « qu’il a organisé et dirigé la première grande insurrection paysanne de l’Afrique indépendante. Il a appliqué de manière originale les principes du marxisme-léninisme et les leçons du maoïsme… il a mené ce combat avec une détermination exceptionnelle ; il a eu le souci de l’éducation politique des masses ; il n’a cessé de manifester un désintéressement et une générosité qui ont fait de lui un héros légendaire ;… et il a évité totalement les pièges de l’embourgeoisement propre au milieu urbain ainsi Que toutes ingérences étrangères… il avait toutes les raisons pour vaincre » (Verhaegen B. 1987 : 163-164).
En réalité, l’action révolutionnaire connut des faiblesses dès départ. D’abord, les dissensions internes au sein du CNL n’étaient pas de nature à favoriser un dénouement heureux, de sorte que, pour être à l’abri de ces tiraillements, les leaders qui menèrent les opérations sur le terrain prirent leurs distances Par rapport à Brazzaville. Mulele, on l’a vu, n’en fit même pas mention ; Soumialot, qui lui demeura fidèle, reconnaissait l’autorité aussi bien de Gbenye que de Bocheley, se refusant à jouer le jeu exclusif de l’un ou de l’autre. Pour lui, l’un était président du CNL, l’autre son vice-président, le reste n’était qu’une simple rivalité entre les deux hommes. Au demeurant, suite à cette dissension, le CNL, après avoir réussi à faire tomber Adoula, ne put mettre à exécution le protocole d’accord signé avec Tshombé, pour former un gouvernement ensemble. N’ayant pu saisir cette occasion, pour passer de l’opposition à l’action gouvernementale, la révolution se dégrada et s’enlisa dans des difficultés de plus en plus nombreuses. Incapable de profiter de sa victoire, elle allait être vaincue.
Parmi les difficultés internes auxquelles elle fut confrontée et dont l’ampleur croissait à mesure que les combats se prolongeaient, il faut à coup sûr invoquer le développement des violences et du tribalisme. En effet, la révolution n’avait pu éviter les règlements de compte et la violence gratuite. Le règlement de comptes était généralement le fait des «jeunesses », recrutées en zone conquise et qui dressaient la liste des P.N.P. à exécuter. Dans le même temps, les « gêneurs » et ceux qui passaient pour être des privilégiés de la région étaient éliminés. Le chef révolutionnaire cherchait par ailleurs à s’entourer de gens sûrs, ce qui revenait à dire qu’ils devaient être recrutés parmi les siens. C’est ainsi que pour beaucoup, la guerre révolutionnaire avait des motivations tribales tant auprès des partisans que des non- partisans. Mulele, en tant que Mbuun, commença son action, pour des raisons de facilité, à partir de son territoire ethnique, et l’élargit ensuite aux autres contrées. Les ethnies voisines qui subirent l’offensive révolutionnaire comprirent qu’elles étaient attaquées par les Mbuun et quelles devaient repousser ce voisin envahissant. A l’est, on nota que tous les grands dirigeants étaient kusu (Soumialot. Olenga). Les Shi du Mwami Kabare combattirent les Simba d’Olenga avec d’autant plus d’énergie qu’il s’agissait, pour eux, d’une attaque des gens du Maniema.
La dernière faiblesse interne de la révolution se situait tout simplement dans la modestie de la logistique et l’absence de renfort d’origine interne ou externe. Les partisans de Mulele comme ceux du général Olenga ne disposaient, outre leurs gris-gris, que de gourdins, de machettes, de lances et de flèches auxquels s’ajoutaient quelques fusils de chasse. L’armement le plus valable de ces troupes avait été soustrait à l’ennemi apeuré. Et les combattants n’avaient aucun espoir d’amélioration de leur sort. Au sein du pays, les anciens « compagnons » de Lumumba abandonnèrent les révolutionnaires. Mulele fut désavoué non seulement par le PSA-Kamitatu mais aussi par le PSA-Gizenga que dirigeait B. Mungul-Diaka. A sa sortie de prison, Gizenga lui-même omit d’appuyer Mulele dans son entreprise et se démarqua du CNL ; il préféra se donner bonne conscience en créant un nouveau parti politique, le PALU (Parti lumumbiste unifié). Olenga et Soumialot gardèrent, il est vrai, des contacts avec le CNL, tant que Gbenye n’eut pas déménagé pour Stanleyville. La plupart des lumumbistes déclarèrent forfait, jugeant l’entreprise trop dangereuse. Les pays afro-asiatiques et ceux du camp socialiste dissimulèrent à peine leur malaise à la suite de l’expérience malheureuse de la « République Libre du Congo » ; ils préférèrent ne pas trop s’avancer pour éviter de favoriser de nouveaux développements de la « guerre froide » toujours en cours.
La République de Gbenye finit par fondre comme neige au soleil, incapable de contrer des bombardements aériens par des flèches ou des gris-gris. Le dernier télégramme officiel qu’il envoya le 28 octobre 1964 en tant que « président de la République » (adressé à Nkwamé Nkrumah, président du Ghana ; Ben Bella, président de la République d’Algérie ; Nasser, président de la RAU ; Sekou Touré, président de la Guinée ; Modibo Keita, président du Mali) dissimule mal le malheur de cet homme, à la limite entre la révolte et la folie, confronté à une situation sans issue : « J’informe votre Excellence que la responsabilité de la perte de l’Afrique est partagée entre vous et moi stop Ai fait ce que je pouvais faire pour sauver honneur Afrique et vous m’avez laissé tomber seul sous les bombardements américains et belges stop Vous lance un dernier cri au nom de Lumumba, si vous n’intervenez pas dans quelques heures, j’adopterai politique terre brûlée ainsi Américains et Belges trouveront que désert fullstop». Par la suite, ses homologues révolutionnaires restant inactifs, le malheureux président crut avoir trouvé une arme efficace en prenant en otages les Européens qui continuaient leurs activités dans cette région. Il fournissait par là aux USA et à l’OTAN le prétexte qui jusque-là faisait défaut pour autoriser une intervention directe, qui accompagnerait les raids des T-28 organisés sous le couvert de l’ANC. Parmi les otages que Gbenye garda à Stanleyville, il y avait notamment le pasteur Paul Carlson, médecin et missionnaire évangélique de l’Ubangi qui, après avoir éloigné sa famille, était revenu dans la zone trouble [81].
Le frêle gouvernement de Stanleyville n’aurait jamais pu deviner à quel point ses menaces de prise en otage seraient prises au sérieux par le monde occidental. En novembre 1964, deux opérations combinées furent envisagées, à la fois sur le plan terrestre et aérien. Sur le plan terrestre, il y eut l’opération » Ommegang » qu’organisa le colonel Vandewalle, devenu entre-temps conseiller du Premier ministre Tshombe. Pour ce faire, il mit en place la 5e Brigade mécanisée dont les troupes réparties en 5 colonnes allaient opérer « en tenailles » pour reconquérir le pays. La première colonne (Lima 1), dirigée par le colonel belge Liégeois, partant de Kongolo, remonterait vers Kindu pour arriver à Stanleyville. La deuxième colonne (Lima 2), venant de Kamina sous le commandement du colonel belge Lamouline, passerait par Lubutu où elle rejoindrait Lima 1 ; de là, elles rallieraient Stanleyville ensemble. La troisième colonne, appelée Decoster – du nom de son chef – partirait de Bukavu pour reprendre Uvira et Bunia. La quatrième, la colonne Papa, dirigée par le capitaine Protin, partirait de Manono et se dirigerait vers Fizi sur le lac Tanganika, où elle serait rejointe par le 10e commando du major Schramme entre Kongolo et Watsa [82]. Sur le plan aérien, l’opération Dragon rouge avait été mise sur pied, qui prévoyait le largage de 383 parachutistes sur Stanleyville.
Blindés et avions américains parvinrent à la base de Kamina, où se concentraient également les mercenaires recrutés. Durant les mois de septembre et octobre 1964, plusieurs villes et localités furent reconquises. Les villes du Shaba le furent dès le mois d’août, notamment Baudouinville et Albertville (le 30). En octobre, ce fut le tour de Béni (le 2), de Walikale (le 8), de Lodja (le 6) et de Wembo-Nyama (le 7) ; Kindu fut reprise le 1er novembre. C’est au cours de cette phase que l’on s’en prit aux Européens et que le gouvernement multiplia les déclarations alarmantes à propos des otages. Le mardi 24 novembre fut une journée décisive. Stanleyville s’éveilla au son du vrombissement des avions. A 6 heures du matin, les parachutistes s’emparèrent de la ville et libérèrent environ 2 000 Européens dont une centaine furent massacrés. Jamais la défense zaïroise n’avait fait l’objet d’un tel déploiement de forces. Quatorze C130 transportant à leur bord des parachutistes, après une escale à l’île de l’Ascension puis à Kamina, avaient rallié Stanleyville. Le même jour arrivèrent dans la ville les colonnes de la 5e Brigade mécanisée. Le colonel Vandewalle avait eu le souci de synchroniser les deux opérations. L’armée belge découvrirait dans les dépôts quantité d’armes qui n’avaient même pas été distribuées à la population (Martens L. 1985 : 317). La stratégie militaire n’était apparemment pas le point fort de Gbenye. Stanleyville fut ainsi récupérée par les forces gouvernementales. Dans la journée du 26, on répéta la même opération à Paulis et le 30, le corps expéditionnaire était revenu à Bruxelles (Notomb, P., 1993).
Une fois de plus, le gouvernement belge eut à s’expliquer devant le Conseil de sécurité, l’opération « Dragon rouge » ayant suscité une grande émotion dans le monde. Le réquisitoire africain fut des plus sévères. « Au nom de quelle humanité nous parle-t-on, s’interrogera le ministre Ganao du Congo-Brazza, alors que, pour prétendre sauver la vie d’un nombre insignifiant de Blancs, on massacre des dizaines de milliers de Noirs ? Lorsque nous étions jeunes, nous avons appris qu en musique, une blanche vaut deux noires. La fameuse opération humanitaire de Stanleyville vient de nous prouver qu’un Blanc, surtout lorsqu’il s’appelle Carlson, ou s’il est de nationalité américaine, belge ou britannique, vaut des milliers et des milliers de Noirs » (Congo 1964: 499).
La révolution de Mulele connut une durée plus longue mais, enclavée de toutes parts et cernée par les forces de l’ANC qui comptait à présent dans ses rangs les redoutables ex-gendarmes katangais, elle avait peu d’espoir de réussite. L’arme la plus redoutable utilisée par l’ANC fut d’ordre psychologique. Alors qu elle recourait à la politique de la terre brûlée, privant les partisans de tout approvisionnement, elle distribuait volontiers des vivres, des médicaments, des vêtements à ceux qui « sortaient de la forêt » et qui, par conséquent, changeaient de camp. Leurs champs étant brûlés ; privées de sel, de savon, de médicaments et de vêtements, les populations ne tenaient plus. Un minimum de confort est en effet indispensable pour mener une révolution, fût-elle paysanne.
Malgré cela, le leader de la révolution tint bon dans le maquis. En juillet 1965, il décida de se diriger vers le nord, dans la région de Kamtsha-Loange. Son objectif était d’atteindre Mangai, de traverser le Kasai et de s’engager dans la région de Dekese. Il avait appris que Che Guevara, le grand révolutionnaire bolivien, était venu du front de l’Est et cherchait à le rencontrer. Che séjourna effectivement dans l’est du Zaïre dans le maquis de L.D. Kabila. Arrivé personnellement à Kibamba (sur le lac Tanganyika en face de Kigoma) le 24 avril 1965 avec 14 « compagnons » cubains, il a vu assez rapidement son équipe s’agrandir de 18 autres cubains (8 mai) puis, de 34 (22 mai) et 39 (24 juin). Au total 105 latino-américains qui s’efforcèrent d’apporter leur concours à la réussite du maquis de l’Est qui passait pour accessible à cause de la proximité avec la Tanzanie. « Le moment était venu d’agir en Afrique », estimait Che. Mais l’expérience tourna court à la fois à cause de la désorganisation du mouvement, l’incompétence de ses dirigeants et le recours à des pratiques guerrières peu compatibles avec la guérilla classique (Taibo II P.I. et al., 1995) [83]. Mulele, qui, de son côté, essayait d’aller à l’encontre du célèbre révolutionnaire, connut des déboires lors de ce déplacement car il s’aventura dans une région qui ne lui était guère favorable, et où la révolution était perçue comme une simple attaque des Mbuun. Il dut faire face à plusieurs attaques de l’ANC, soutenue par les autochtones ngwii, Iwer et même ding. A partir du 5 novembre, il fut la cible d’une série d’attaques décisives au cours desquelles le noyau dirigeant de la révolution fut détruit. Malgré tout, il parvint à s’échapper, après avoir perdu Bengila de vue ; celui- ci s’intégra dans un autre groupe [84].
On aurait pu croire le mouvement anéanti ; il n’en était rien. Revenu au Central, dans le sud, après avoir perdu beaucoup de ses militants, Mulele resta seul dans la forêt avec sa femme Léonie, recevant de temps à autre la visite de partisans retournés vivre au village. Ceux-ci vinrent l’interroger sur l’attitude à adopter face à l’avènement de Mobutu qui se réclamait lui aussi de Lumumba et de la « révolution ». Certains allèrent jusqu’à créer délibérément la confusion, en traduisant M.P.R. du nom du parti fraîchement constitué par « Mulele Pierre Révolutionnaire ». [85]
Une dernière lueur d’espoir brilla en mai 1968, quand Mulele reçut dans son maquis une délégation venue de Brazzaville, envoyée par le « Parti communiste congolais » créé entre autres par ses amis Mukulubundu et Mukwidi. Il saisit cette occasion pour réclamer de l’aide, en hommes et en matériel. La délégation repartit et promit d’envoyer du renfort dans les meilleurs délais. Dans les semaines qui suivirent, rien n’arriva. Impatient, Mulele décida au mois d’août de se rendre lui-même à Brazzaville pour aller chercher le soutien dont il avait besoin de toute urgence pour continuer son combat. A partir de Kiyaka en plein Kwilu, il prit la pirogue pour Brazzaville qui descendait la rivière uniquement de nuit. Le 13 septembre, il était à Kwamouth, il accosta sur la rive congolaise à Ngabe et atteignit Brazzaville le même jour, dans la soirée. Il se croyait sauvé, en compagnie de Léonie ; en fait il courait à sa perte. [86]
Accueilli par Marien Ngouabi, il fut gardé dans un premier temps par une escorte militaire, sans contact avec ses amis lumumbistes pourtant nombreux dans la ville. Lorsque, le 27 septembre, il rencontra pour la première fois Mukulubundu et les autres, les Congolais lui avaient déjà arraché la décision de rentrer à Kinshasa, dans le cadre de la réconciliation nationale décrétée par Mobutu. Les lumumbistes engagèrent une négociation avec le gouvernement congolais pour le dissuader de ne pas le laisser partir, il s’avéra que les Congolais tenaient beaucoup à voir Mulele partir pour Kinshasa. C’est le dimanche 29 septembre que Bomboko vint le chercher sur l’autre rive, à bord du yacht présidentiel. A son arrivée, une grande réception eut lieu chez Bomboko et Mulele eut droit à des honneurs pendant quelques jours. Le 2 octobre, lorsque le président Mobutu revint du Maroc, le ton changea. Mulele devait être jugé pour ses crimes. Au camp Kokolo où il fut conduit, il retrouva Bengila qu’il n’avait plus revu depuis novembre 1967. Cette nuit-là, ils furent tués de manière atroce, même si le communiqué de la radio diffusa seulement le 8 octobre la nouvelle de sa condamnation à mort par le tribunal militaire… pour assassinat, vol, viol, incendie, vol à main armée (Martens L. 1985 : 298-335) [87].
Comment faut-il évaluer cette guerre révolutionnaire ? Un premier constat s’impose : elle aura eu l’effet de valoriser les campagnes. En effet, un effort aussi colossal n’avait encore jamais été entrepris pour traduire dans la modernité les faits de la tradition. Une armée de type moderne a pu tenir essentiellement par l’adaptation de recettes traditionnelles. Cela valait surtout pour l’Est. Dans le maquis de l’ouest, cet effort fut exigé d’autres aspects de la vie. En effet, coupées de la vie moderne et confinées dans les bois, les populations vinrent à manquer de sel, de médicaments, de textile, de quincaillerie et d’autres produits importés. Elles furent contraintes de réapprendre des techniques de production anciennes, d’en adapter quelques-unes pour subvenir à leurs besoins. Ce faisant, une mentalité nouvelle naquit, et 1 esprit attentiste fut battu en brèche car peu à peu, le peuple apprit à subvenir à ses besoins et à ne plus trop compter sur une aide extérieure. Quelques années plus tard, le terrain muleliste s’avéra l’un des plus propices à l’éclosion de projets de développement communautaire [88].
Partout, la révolution apporta une conscience politique plus aiguë et introduisit au Zaïre un nouveau langage. Le mot « révolution » supplanta celui de l’indépendance et devait constituer l’objet des revendications futures, y compris lors de la création du Mouvement Populaire de la Révolution [89]. La gestion du pays depuis 1964 fut tributaire de ces événements qui précipitèrent la chute du gouvernement Adoula et justifièrent le retour de Tshombe. C’est à cause du déploiement de mercenaires venus mettre fin à la guerre et de l’intervention des forces occidentales à Stanleyville que Tshombe suscita en Afrique un tollé qui facilita son éviction. Le haut commandement militaire justifiera son coup d’Etat du 24 novembre 1965 en évitant une réédition des « rébellions » qui avaient provoqué la mort de milliers de personnes.
La « seconde indépendance » ne fut pas acquise. Elle ne l’est toujours pas. Cependant, au-delà de l’utopie, elle aura marqué l’avenir de la nation zaïroise de façon beaucoup plus concrète qu’il n’y paraît. Les Congolais, pour avoir opté finalement pour une évolution radicalement différente du schéma proposé par Mulele et pour avoir abouti à une impasse, restituent au projet de Mulele un certain crédit, du moins dans une version dépouillée de radicalisme, pour éviter de limiter les libertés individuelles. En tant que seul leader du combat révolutionnaire à avoir été exécuté, Mulele laisse derrière lui l’image d’un martyr, mais aussi le souvenir de répressions sanglantes, qui ressurgit chaque fois que son nom est cité [90].
On sait qu’il mourut dans une sérénité relative, convaincu que ses compagnons continueraient la lutte et qu’ils disposeraient d’atouts nouveaux pour y arriver. A ses compagnons qui, à Brazzaville, tentaient de le dissuader de se rendre à Léopoldville, il rétorquait « Vous dites que Mobutu me tuera. Peut-être. Dans ce cas, l’opinion africaine et mondiale vous donnera raison quand vous continuerez le combat contre ce régime ». Plus tard, il dira encore : « J’ai vécu, j’ai semé des graines partout ; elles ne sont pas tombées sur les pierres mais sur la bonne terre ; elles vont pousser. Si je meurs, vous continuerez » (Martens L. 1991 : 234,240). La suite du combat emprunta un itinéraire complexe dont nous tenterons de retracer les méandres.
4 VERS LA RÉHABILITATION DE L’ÉTAT
Le conclave de Lovanium et la constitution du gouvernement Adoula représentèrent simultanément la première expression de l’État congolais après la crise constitutionnelle de 1960, et la première grande réalisation nationale après celle de la conquête de l’indépendance. L’importance de cet acte national fut consacrée par la durée du gouvernement Adoula, qui connut trois ans d’existence, soit une période deux fois plus longue que celle qui avait mené à l’effondrement de l’État.
L’État, une fois rétabli dans ses frontières, avait besoin d’être consolidé puis organisé par étapes successives. Le premier impératif fut de doter le pays d’une nouvelle physionomie, du point de vue administratif et constitutionnel, qui tienne compte de l’échec des structures de la décolonisation. Le second consistait à trouver une alternative à la situation créée par la contestation révolutionnaire. A défaut d’un compromis, il fallait soit évincer la révolution, soit se laisser vaincre par cette dernière, afin de créer le nivellement indispensable à l’existence harmonieuse d’une nation. Cette lutte contre les « rébellions », conjuguée à l’intervention de l’armée dans la gestion politique, força le destin à emprunter un raccourci pour aboutir à la formation de l’État congolais, tel qu’il existe aujourd’hui.
Consacrons le dernier développement de ce chapitre à décrire cet itinéraire.
4.1 De la réforme administrative à la Constitution de Luluabourg
Le problème de la division administrative fut l’une des premières grosses difficultés de la crise qui accompagna la décolonisation. Pourtant à la Table ronde de Bruxelles, le conflit entre délégués avait porté davantage sur le degré d’autonomie par rapport au pouvoir central que sur la révision du nombre de provinces.
On se rappellera que les contestations allant dans ce sens surgirent déjà à l’aube du 30 juin, quand le Sud-Kasaï revendiqua la révision du fameux article 7 de la Loi Fondamentale fixant le nombre de provinces à 6, pour qu’il soit porté à 7. La sécession du Katanga amena les Balubakat à vivre une situation d’autonomie de fait par rapport à Elisabethville.
A partir de là, les pressions allèrent se multipliant. Les conférences de Tanana-rive et de Coquilhatville en 1961, qui consacrèrent le triomphe des thèses confédérales, abondèrent dans ce sens. Il ne restait plus qu’à passer à l’acte. De plus, étant donné le climat de désorganisation générale ambiant, il eût été déplacé de la part des gouvernants, malgré l’opposition des nationalistes, de négliger cette solution qui permettait d’éviter des tensions. La justification était apparemment fondée : le découpage d’origine coloniale était arbitraire et ne tenait pas compte de la situation de tous les peuples. Mais le moment était-il bien choisi pour réviser cette structuration ? A vouloir conjurer un mal, ne risquait-on pas d’en instaurer un autre plus grave, issu du morcellement qui allait s’effectuer ? A l’époque, on minimisa ces risques. [91]
C’est à partir d’août 61 que le gouvernement Adoula s’engagea à mettre en place les mécanismes juridiques nécessaires pour procéder à ce découpage. On agit de manière précise et méticuleuse : la première préoccupation fut de modifier l’article 7 de la Loi Fondamentale (9 mars 1962), en autorisant une ouverture possible à d’autres créations du genre. C’est ainsi qu’il fut libellé comme suit : « L’Etat du Congo est constitué dans ses limites au 30 juin 60, de six provinces. Une loi peut en créer d’autres. » Une autre disposition fixa les « critères devant servir de base à la création des provinces » (Loi du 27 avril 1962). Trois conditions furent retenues : une population de 700 000 habitants, une viabilité économique et une demande expresse introduite par les deux tiers des députés provinciaux et nationaux de ladite région.
La première province créée fut celle du Nord-Katanga (11 juillet 1962), pour des raisons évidentes de soutien à cette partie de la région cuprifère dans la lutte contre la sécession. Elle fut suivie, pour des motifs tout aussi évidents, par le Sud- Kasaï et le Kongo Central (juillet – août 1962). Ce fut ensuite, au cours de l’année 1963, le tour du Moyen-Congo (Lisala), du Haut-Congo (Stanleyville), du Kivu Central (Bukavu) etc. A l’issue de la sécession, on créa les dernières provinces, celles du Lualaba (Kolwezi) et du Katanga Oriental (Elisabethville). [92] Au total, il y eut donc 21 provinces (Tableau 23).
D’emblée, il faut noter que la volonté de mettre en cause les frontières administratives d’origine coloniale ne fut guère poussée à l’extrême. En effet, les divisions nouvelles tenaient compte de l’existence des districts. Ainsi, les groupes ethniques séparés pour les besoins de l’administration coloniale le restèrent. Seule la province de Lomami se situa à cheval entre deux anciennes provinces coloniales, le Kasaï et le Katanga (carte 20). Il reste que cette révision administrative provoqua, dès le départ, des problèmes à propos des « régions contestées » revendiquées par deux ou plusieurs provinces à la fois. En dehors des anciennes provinces du Katanga et de Léopoldville [93] qui en furent dépourvues au départ, les quatre autres connurent, dès 1962, l’existence de sept régions contestées dont le statut devait être soumis à un référendum. Le premier référendum du genre ne put être organisé qu’en 1964 [94].
La grande faiblesse de cette organisation nouvelle était qu’elle résultait des manipulations politiques nées des solidarités et des oppositions apparues à la décolonisation. Ainsi légitimées, elles ne purent donc éviter de raviver et d’éveiller les sentiments tribaux. Les critères de viabilité démographiques et économiques ne furent qu’une simple couverture dans le but de donner bonne conscience. Ainsi en fut-il de ce phénomène dès le départ. Le Sud-Kasaï revendiqua son autonomie non pour des raisons économiques mais pour offrir une patrie aux réfugiés luba. L’émiettement général fut déclenché à partir de l’initiative de groupes particulièrement conscients de leur identité ethnique et qui revendiquèrent une identité provinciale sur cette base : Kongo (Kongo Central), Mongo (Cuvette Centrale), Luba (Sud-Kasaï) etc. Les autres formations ethniques se regroupèrent sous ce modèle, encouragées parfois par la crainte d’être dominées par ces grandes tribus. Tel fut le cas de la province des Kete, Kuba, Leele, Pende (Unité kasaïenne) dont l’autonomie fut revendiquée par méfiance à l’égard de deux grands groupes voisins, Luluwa (Lulua- bourg) et Luba (Sud-Kasaï).
Mais ces nouvelles administrations, quelle que fût leur morphologie, firent l’expérience de l’incapacité qu’il y a à gérer rationnellement, dans un État moderne, la conscience tribale. Ce sont précisément les provinces, théoriquement homogènes sur le plan tribal qui vécurent les premières expériences malheureuses : Kongo Central (Kongo), Kwango (Yaka), Cuvette Centrale (Mongo), Moyen-Congo (Ngombe). Lomami (Songye), Luluabourg (Luluwa), Sankuru (Tetela et apparentés), Sud-Kasaï (Luba). Dans ces provinces, les divisions internes furent poussées à un degré de conscience aussi aigu que s’il s’agissait de tribus différentes. La stabilité politique n’y était donc pas plus garantie qu’ailleurs. Au Kongo Central, avant l’avènement de Kasa-Vubu, l’Abako était accusé d’être sous la coupe des Ntandu. Avec ce dernier et avec la présidence provinciale de Moanda, le leadership fut donc assuré par les Yombe ; plus tard, le conflit avec D. Kanza se traduisit par un profond désaccord entre les Manianga et les Yombe. Au Kwango, la contestation Pelende face à l’envahissement des Yaka connut un nouveau rebondissement à tel point que le chef Pelende voulut à un moment être rattaché au Kwilu plutôt que de demeurer au Kwango. Au Sankuru, une opposition latente et meurtrière se développa entre les Tetela de la savane, arabisés, et ceux de la forêt. Lors de la constitution du gouvernement provincial, les « arabisés » s’opposèrent à l’investiture présidentielle du candidat non arabisé et se désolidarisèrent des autres Tetela. Le chef de cette dissidence, l’abbé Ndjadi, quitta Lodja, capitale du Sankuru située dans la région forestière, pour aller constituer un gouvernement rival à Lusambo dans la savane.
Que dire alors des provinces constituées d’une pluralité de tribus ? Les tiraillements n’y furent que plus importants, et leur gestion fut le fait d’un savant dosage non seulement de tribus mais aussi de partis. En effet, l’existence des partis est également intervenue comme une autre modalité de regroupement provincial. On a pu ainsi noter l’existence de provinces à parti unique ou à parti dominant, entre autres : Kongo Central (ABAKO), Kwango (LUKA), Cuvette Centrale (Unimo), Moyen-Congo (Puna), Ubangi (MESA), Haut-Congo (MNC/L), Kibali-Ituri (MNC/ L), Nord-Kivu (CEREA), Katanga Oriental (CONAKAT), Lomami (MUB), Luluabourg (UNC), Sankuru (MNC/L), Sud-Kasaï (MNC/K). Soit le parti était tribal, soit il acquit une forte connotation tribale. Des 13 espaces politiques énumérés, 8 se réclamaient de l’homogénéité ethnique. Le cas du MNC/L qui s’est retrouvé en position dominante dans plusieurs provinces (Haut-Congo, Sankuru, Kibali-Ituri et dans une moindre mesure au Maniema) a subi une désintégration de type tribal suite à ce morcellement, tandis que les partis tribaux en sortirent renforcés. Apparemment la solidarité tribale était plus solide que la solidarité idéologique, et le réseau idéologique qui a pu intégrer le réseau tribal a ainsi bénéficié d’une solidité plus grande.
Tableau 23 — Morphologie des provinces de 1960 à 1997
| ANCIENNES PROVINCES (1960) |
NOUVELLES PROVINCES (1962-63) |
NOUVELLES PROVINCES (1966) |
NOUVELLES PROVINCES (1987) |
| 1. Léopoldville | 1. Kongo Central | 1. Kinshasa | 1. Kinshasa |
| 2. Kwango | 2. Kongo Central (Bas-Zaïre) | 2. Bas-Zaïre | |
| 3. Kwilu | 3. Bandundu | 3. Bandundu | |
| 4. Lac Léopold II | |||
| 2. Equateur | 5. Cuvette Centrale | 4. Equateur | 4. Equateur |
| 6. Ubangi | |||
| 7. Moyen-Congo | |||
| 3. Orientale | 8. Haut-Congo | 5. Haut-Congo (Haut-Zaïre) | 5. Haut-Congo |
| 9. Uélé | |||
| 10. Kibali-Ituri | |||
| 4. Kivu | 11. Nord-Kivu | 6. Kivu | 6. Nord-Kivu |
| 12. Kivu Central | 7. Sud-Kivu | ||
| 13. Maniema | 8. Maniema | ||
| 5. Katanga | 14. Katanga Oriental | 7. Katanga (Shaba) | 9. Shaba |
| 15. Lualaba | |||
| 16. Nord-Katanga | |||
| 17. Unité Kasaïenne | |||
| 6. Kasaï | 18. Luluabourg | 8. Kasaï Oriental | 10. Kasaï Oriental |
| 19. Sankuru | 9. Kasaï Occidental | 11. Kasaï Occidental | |
| 20. Sud-Kasaï | |||
| 21. Lomami |
L’inverse était vrai également. Le cas des Lega le prouve ; eux qui, pendant la période coloniale, étaient répartis dans les districts du Kivu Central et du Maniema ; les premiers optèrent pour le CEREA et les seconds pour le MNC/L, bien qu’il existât aussi un parti tribal, l’UNERGA (Union des Warega). Ces derniers s’opposèrent à la création des provinces distinctes du Kivu Central et du Maniema, le maintien du Kivu dans sa forme première leur étant plus bénéfique. Cette création de provinces distinctes éveilla aussi la conscience tribale et le sens de solidarité autour de l’UNERGA, soucieux d’éviter d’être en situation d’infériorité face au Maniema et au Kivu Central, occupés respectivement par les Kusu et les Shi.
La localisation des villes a pu jouer un certain rôle dans les conflits des répartitions provinciales. En 1962, surgirent de graves dissensions tribales dans la plupart des chefs-lieux de province, entre les populations périphériques des milieux urbains généralement minoritaires par rapport aux immigrants qui monopolisaient les structures hiérarchiques. Les autochtones contestèrent, en vertu du droit de la situation géographique, pour conquérir le pouvoir dans les capitales. C’est de cette manière que les Luluwa chassèrent les Luba, que la Conakat se réclama du leadership à Elisabethville, l’Unimongo à Coquihatville, l’Abako à Léopoldville. A Stanleyville, les Lokele – Topoke, représentés par Bernard Salumu, revendiquèrent le droit à l’exercice du pouvoir. Dans ce cas, comme dans d’autres semblables, on assista à l’exode des immigrants – ce qui appauvrit la ville – qui retournèrent d’où ils étaient venus, et ces endroits furent promis à un plus grand développement. Citons le cas des Zande à Stanleyville et des Kusu à Bukavu, qui, chassés de ces villes, provoquèrent respectivement l’essor économique d’Isiro (Paulis) et de Kindu dans le Maniema.
La préoccupation de créer des provinces tenant compte des réalités tribales existantes suscita finalement une confusion plus grande, précisément à cause de cette volonté. Les difficultés d’ordre logistique firent le reste, si bien qu’il n’était pas rare que ceux qui avaient choisi la voie de l’exode reviennent sur leurs pas et cherchent à reconquérir les territoires abandonnés. Le cas le plus typique est celui de la province de l’Unité kasaïenne qui eut du mal à suivre en se passant de la métropole de Luluabourg, capitale d’une autre province. Le regroupement des deux provinces s’avérait nécessaire pour améliorer les conditions de vie. Ce regroupement allait donner naissance à la province du Kasaï Occidental, qui devint effective en 1966.
La subdivision des provinces en entités plus restreintes était bénéfique dans la mesure où elle régionalisait davantage les administrations. Mais elle fut mal perçue, car elle fut le fait d’un pouvoir central affaibli, qui ne put rester maître du mouvement amorcé, et qui se fit complice de tous les compromis. En ce sens, on comprend la réaction des lumumbistes qui s’y opposèrent catégoriquement, estimant dès 1962 qu’une seule chose était prioritaire : la réduction de la sécession. A partir de 1964, alors que le combat dans l’arène parlementaire était interrompu unilatéralement, les lumumbistes en firent leur cheval de bataille, préférant le retour à la situation première, plutôt que d’admettre l’existence de » provincettes ». (sic)
A la différence de la création des provinces, la rédaction d’une nouvelle constitution fut un impératif revendiqué dès le début de l’indépendance. Il était entendu que la Loi Fondamentale était une disposition provisoire et que la première mission confiée aux Chambres, dès la promulgation de cette loi le 15 mai 60, serait de doter le pays d’une véritable constitution qui lui soit propre. La crise constitutionnelle de 60 ne permit pas la réalisation de ce projet, bien que son apparition fût en elle- même une illustration de l’urgence de la situation et de l’inadaptation de l’outil juridique laissé par l’autorité coloniale. Cet impératif était reconnu à l’unanimité. Lumumba, au milieu du conflit, ne put s’empêcher d’aspirer à un régime présidentiel qui aurait pu être soutenu par un véritable « mouvement populaire », son propre parti, du moins tel qu’il se le représentait (Willame J.C. 1990 : 91-92). Les « Conférences nationales », qui se succédèrent à Léopoldville, Tananarive et Coquilhatville, ne furent rien d’autre que les différents épisodes de ce débat constitutionnel, dont les conclusions balançaient entre l’optique fédéraliste et une vision confédéraliste. Déjà à l’époque, Iléo, Premier ministre du gouvernement provisoire, chargea l’ancien commissaire général à la Justice, M. Lihau, de suivre ce débat et de s’atteler au projet de rédaction d’un texte. Adoula, dès le conclave de Lovanium, confirma cette disposition. L’élaboration d’une nouvelle constitution était véritablement en cours.
A partir de 1963, des faits nouveaux survinrent, qui précipitèrent les choses : la sécession fut réduite et le nouvel idéal de gestion du pays, au lieu de rester un débat, dut être concrétisé et mis en pratique. Puisque ces événements furent vécus sous la contrainte, on ne vit plus la nécessité d’être complaisants avec les Katangais, comme à Kitona, pour s’orienter vers une formule largement décentralisante. Le plan Thant, qui faisait prévaloir l’intérêt d’une réconciliation nationale et d’une réduction de la sécession à l’amiable, cessa d’être la pierre d’angle à partir de laquelle la constitution devait être élaborée.
On prit également conscience, cette année-là, que la première législature touchait à sa fin, du moins si l’on se référait à la Loi Fondamentale. Une période politique « chaude » s’annonçait, avec des élections pour les Chambres et la présidence de la République. Il devenait délicat d’envisager à nouveau de tels événements politiques, sans disposer d’un outil constitutionnel adéquat. Une nouvelle crise politique grave aurait en ce cas été inévitable, et il n’était pas sûr que la nation puisse cette fois encore renaître de ses cendres comme en 60, … « par un de ces miracles de l’histoire qui ne se répète pas souvent ». [95]
Il fallait donc s’occuper activement de la mise en place de la nouvelle constitution. Le président Kasa-Vubu l’avait très bien compris, c’est pourquoi il s’efforça d’activer les débats du Parlement. Celui-ci ralentit son activité de mars à juin 1963. La session extraordinaire du mois d’août tourna court, les parlementaires s’étant fixé un autre objectif : faire tomber le gouvernement Adoula. Kasa-Vubu se décida à prendre des mesures draconiennes. Ayant renvoyé les Chambres, il procéda à la mise sur pied d’une commission constitutionnelle, bien décidé à en finir à tout prix avec cette question. [96] Il ne fit pas les choses à moitié, faisant appel aux services d’une commission extrêmement large, avec une représentation des instances les plus diverses, mais aussi les plus inattendues : le gouvernement central les assemblées et les gouvernements provinciaux, les syndicats des travailleurs et du patronat, les confessions religieuses, la jeunesse et la presse. Il faut noter que les délégués étaient des représentants de la société civile et non des partis. L’arrière-pays se tailla la part du lion, avec 84 délégués pour un total de 127 participants. Il y eut certes des absences remarquées, à commencer par celles des Chambres renvoyées, auxquelles s’était substituée ladite commission. Les Lumumbistes du CNL dénoncèrent depuis Brazza la manoeuvre qui, selon eux, permettait à Kasa-Vubu de se façonner une constitution sur mesure ; ils ne participèrent pas aux travaux. L’Union Générale des Etudiants Congolais (UGEC), bien qu’expressément invitée, fut absente.
Malgré cela, la commission réalisa sa mission. Le 11 avril 1964, elle adopta un texte de 204 articles, qui devint le projet de constitution à soumettre au référendum populaire avant sa promulgation par le chef de l’État. Le travail réalisé fut diversement accueilli. Si Kasa-Vubu estima que la commission n’avait pas démérité, le gouvernement eut, quant à lui, une réaction plutôt équivoque, souhaitant examiner à son niveau l’ensemble du texte avant de le soumettre à la consultation populaire Fort heureusement le projet passa. Le référendum, organisé du 25 juin au 10 juillet dans les quelques régions non troublées, aboutit à un résultat positif. La constitution put ainsi être promulguée le 1er août 1964. Bien que largement contestée à l’époque, la démarche de Kasa-Vubu connut un succès estimable. Quatre-vingts ans après sa création à Berlin sous le signe de l’État léopoldien, le Congo avait enfin une première constitution, qui soit le fait de ses propres ressortissants. Le pays se choisit un nouveau nom – République Démocratique du Congo -, une devise nationale — Justice, Paix, Travail -, et un nouveau drapeau, qui était une nouvelle adaptation du « bleu à l’étoile d’or » de l’AIA, déjà modifié en 1960 par adjonction de 5 étoiles à celle qui y figurait déjà. Le nouveau drapeau était bleu, flanqué en diagonale d une bande rouge (symbolisant le sang des martyrs) et d’une étoile jaune (symbole des richesses minières).
La constitution consacra le régime parlementaire avec un Premier ministre et des ministres nommés par le Président dans la majorité parlementaire. Une large décentralisation de la base fut admise. Les provinces, au nombre de 21, furent reconnues comme entités autonomes, dotées de leurs personnalités juridiques. La délicate question des finances fut tranchée de manière à la fois complexe et savante. Le produit des droits d’importation revenait au gouvernement central et celui des impôts personnels, y compris les impôts sur le revenu, appartenait aux provinces intéressées. Seuls le produit des droits d’exportation, des droits d’accises et de consommation ainsi que les impôts sur les sociétés firent l’objet d’une répartition entre la République et les provinces. La quote-part provinciale allait de 45 à 75 %, suivant I’ importance des revenus.
De nouvelles dispositions constitutionnelles, il était prévu que le gouvernement Adoula démissionnerait le 30 juin 1964, date à laquelle s’achevait la première législature. Le nouveau gouvernement formé ne devait pas être investi par les Chambres élues en 60 puisque leur dissolution interviendrait de jure le jour même de l’adoption de la nouvelle constitution. Les nouvelles élections se tiendraient entre le 1er et le 31 mars 65. Les Chambres à nouveau constituées seraient convoquées entre le 1er avril et le 1er mai 1965 et le nouveau président de la République serait élu en novembre 1965. Tout allait se dérouler différemment de ce qui avait été prévu, mais pour aboutir à un résultat similaire, dans les mêmes délais.
4.2 De la première à la seconde République
Le passage de la première à la seconde s’effectua en trois temps qui respectèrent à peu près le délai imparti à cette transition, soit au cours des 17 mois qui séparèrent le 30 juin 64 du mois de novembre 1965. Il y eut d’abord le retour inattendu de Tshombé, cette fois aux commandes du gouvernement central ; ensuite, le tour imprévu que prit sa mission qui le conduisit à son malentendu avec Kasa-Vubu ; il y eut l’intervention du général Mobutu qui s’imposa comme Seigneur de la seconde République, à la grande consternation des deux prétendants, Kasa-Vubu et Tshombe.
A Kitona, lorsqu’Adoula dut négocier avec Tshombe sous l’oeil vigilant de l’ambassadeur des USA, qui aurait pu imaginer que son interlocuteur, le sécessionniste, pourrait un jour lui succéder directement ? Personne, ni l’ambassadeur Gullion, ni Tshombe lui-même. L’avènement des rébellions mulélistes créa les conditions nécessaires à la réalisation d’une telle éventualité. L’ANC, même après sa modernisation et son renforcement par des pilotes cubains, s’était avéré incapable de freiner les mulelistes qui envahissaient le pays avec une facilité déconcertante. La nouvelle du contact de CNL avec Tshombe produisit un choc : si une telle jonction se réalisait, Léopoldville serait une proie facile. Mais cette perspective de désastre avait également un avantage. Si Tshombe était ramené au sein du « groupe de Binza », il disposerait des atouts nécessaires pour ramener le CNL à la logique de la réconciliation et au pire, on éviterait que les forces révolutionnaires puissent bénéficier de l’apport redoutable en argent, en hommes et en matériel que supposait la simple alliance avec Tshombe.
L’appel à Tshombe constitua l’aveu de l’échec militaire ; il était dicté, non par une volonté réelle de réconciliation mais il s’imposait comme le résultat d’un calcul. Les répondants zaïrois de cette stratégie mise au point par les USA et la Belgique furent les ténors du groupe de Binza. Mais les prévisions de Kasa-Vubu n’allaient pas si loin. Il pensait encore qu’Adoula pouvait présider le gouvernement de transition, et qu’on ne ferait appel que pour le premier gouvernement de la seconde législature. Etait-il possible d’attendre encore ? Mobutu était particulièrement bien placé pour savoir que les guerres révolutionnaires pourraient en peu de temps embraser l’ensemble du pays. Aussi prit-il les devants et chargea-t-il son ami P. Davister de faire venir Tshombe à Léopoldville. Pour combattre la sécession, une réconciliation avec le groupe des nationalistes s’était avérée nécessaire. A présent, pour combattre les nationalistes, une alliance avec le groupe katangais était tout aussi indispensable.
Seul Tshombe avait le choix, ayant été contacté par les deux groupes, en vue d’une alliance destinée à en écraser un troisième. L’un et l’autre choix exigeaient son retour à Kinshasa. Mais en choisissant de s’y rendre en compagnie de l’émissaire du général Mobutu, sans transiter par Brazzaville comme le CNL le lui avait demandé en vue d’une ultime concertation, il signifiait qu’il avait opté pour le groupe de Binza, contre le groupe des nationalistes. La mission de réconciliation avait échoué.
Dès son arrivée à Kinshasa le 26 juin à 5 heures du matin, Tshombe fut reçu par Adoula et Mobutu. Ce n’est que plus tard, lorsqu’il fut reçu par le Président Kasa- Vubu, qu’il se rendit compte de l’existence d’un malentendu à propos de son arrivée. Contrairement à ce qui lui avait été dit, Kasa-Vubu n’était pas averti de son retour ; il ne dissimula pas sa surprise en faisant remarquer à Tshombe qu’il ne l’attendait pas si tôt. Dès lors, il devenait clair que ce retour n’avait pas fait l’objet d’une concertation. Apparemment le groupe de Binza s’était servi de Tshombe pour se préserver des révolutionnaires, et pour écraser leurs prétentions. Nommé peu après informateur puis formateur, Tshombe multiplia les démarches pour constituer le gouvernement de salut public, et parvint à la constitution d’une équipe ministérielle qui ne manifesta non plus aucune volonté de réconciliation entre les tendances les plus opposées du moment. En effet, sur 11 ministres, il n’y eut aucun représentant de ceux qui combattaient au Kwilu, au Kivu et au Nord-Katanga, à une exception près : André Luboya, ancien membre dirigeant du CNL-Bocheley qui se présenta sous l’emblème de son ancien parti, l’Union Démocratique Africaine (UDA).
Plus grave encore, l’ancien maître de la sécession du Sud-Kasaï, A. Kalonji, faisait partie de l’équipe, de même celui qui passait pour être l’assassin de Lumumba. G. Munongo. La rupture avec l’aide lumumbiste combattante était donc consommée, malgré la tentative compromissoire du nouveau Premier ministre, qui recruta un des ministres dans les rangs du MNC/Kiwewa en la personne de Kidicho, frère de Bernard Salumu qui joua un rôle important à Stanleyville en 1960-61.
Malgré tout, la partie du pays contrôlée par Kinshasa réserva un accueil sympathique à Tshombe, en ce qu’il choisit de marquer la différence. Non seulement il était lui-même un homme nouveau, mais son équipe n’était composée que de nouveaux visages qui n’avaient jamais occupé de fauteuils ministériels au gouvernement central. Son charisme, sa verve et son habileté lui gagnèrent rapidement les faveurs de la population. Au stade de Léopoldville, en juillet 1964. il promit à la foule en liesse, évaluée à 30 ou 40 000 personnes, «un nouveau Congo en trois mois». A Stanleyville, il conquit la foule sceptique en allant déposer une gerbe de fleurs au monument de Lumumba. Parvenu au stade, il y reçut un accueil enthousiaste. On eût cru que le CNL n’avait plus aucune audience dans cette région du pays. Pourtant, quelques jours après, soit le 5 août. Stanleyville tombait aux mains des prétendus rebelles.
Le problème le plus grave qu’il rencontra fut l’opposition révolutionnaire. Ni l’opération de charme menée sous forme de visites dans les villes importantes des zones rebelles – Bukavu, Bunia, Stanleyville, Kikwit – ni la libération de Gizenga, le 15 juillet [97] ne purent y remédier. L’opposition se marqua d’autant plus qu’elle voyait en lui un assassin de Lumumba. Au demeurant, elle acquit par là une plus grande audience auprès de l’Afrique progressiste, qui ne put admettre le triomphe des assassins de Lumumba et – comble de l’ironie – le règne de l’esprit katangais, cette fois au départ de Léopoldville. Tshombe, aussitôt Premier ministre, fut en effet rejoint par de nombreux conseillers européens. [98] Il ne pouvait sans doute s’empêcher d’agir de la sorte.
A grands pas, la perspective de réconciliation nationale s’éloignait, tandis que l’APL allait de victoire en victoire dans les régions de l’est, et que l’Afrique progressiste ne se gênait pas de manifester son hostilité à l’égard du nouvel « homme fort » de Kinshasa. A Bujumbura, où Tshombe dut se rendre le 22 juillet pour rencontrer personnellement les chefs effectifs de la guerre révolutionnaire, il ne fut pas reçu officiellement ; le Mwami Mwambutsa ne dissimula pas sa sympathie pour les courants nationalistes. De même à Brazzaville qui abritait le quartier général du CNL, on ne put accueillir Tshombe, qui avait souhaité y rencontrer le CNL pendant sa mission de formateur. Les tensions se multipliaient, si bien que le Premier ministre ordonna l’expulsion du pays de tous les ressortissants du Burundi, du Congo-Brazzaville et du Mali au cours du mois d’août, en même temps qu’il rompait les relations diplomatiques avec ces pays. [99]
A la conférence des chefs d’Etat et de gouvernements de l’OUA qui se tint au Caire du 17 juillet au 21 juillet 1964, le Congo était absent. En effet, les chefs d’État des pays dits progressistes refusèrent que le Congo-Kinshasa y participe si sa délégation comprenait notamment Tshombe. Les plus radicaux étaient les pays du Maghreb. Aussi, le Congo ne participa-t-il pas au fameux Sommet où fut statuée l’intangibilité des frontières héritées de la période coloniale.
Par la suite, l’OUA fut bien obligée de traiter avec Tshombe, pour tenter de trouver une issue définitive à la « crise congolaise » et de combattre ses incidences immédiates ou éloignées sur le reste de l’Afrique. A cette fin, on convoqua une session extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’OUA à Nairobi du 5 au 10 septembre, pour tenter une réconciliation entre les deux factions rivales, soit les prétendus rebelles et le gouvernement. Malgré le fait qu’on parvint à un accord en vue d’une réconciliation, il n’y eut pas de cessez-le-feu et la force d’interposition africaine réclamée par Tshombe ne put compenser en puissance celle des mercenaires qui auraient dû être renvoyés. Le résultat le plus probant fut la mise en place d’une commission de réconciliation « ad hoc ». Celle-ci tint ses premières assises à Nairobi dans le courant du mois de septembre mais le CNL n’était pas prêt à faire des concessions et exigea, en guise de préalable, le départ de Kasa-Vubu et de Tshombe. La commission fut embarrassée par cette attitude, alors que les initiatives de ne plus considérer les révolutionnaires comme des rebelles suscitaient déjà la colère de Léopoldville. Jomo Kenyatta avait beaucoup à faire et la solution à la crise congolaise, perçue comme un test de l’efficacité de l’OUA, relevait de l’utopie face à des oppositions aussi irréductibles que celle qui voyait s’affronter Léopoldville et le CNL.
Un fait nouveau vint s’ajouter au dossier ; il compromit toutes les chances entrevues jusque-là d’intégrer Tshombe dans l’aréopage des chefs d’Etat et de gouvernement africains. En octobre 64 se tint une fois de plus au Caire la Conférence des Pays non alignés. Tshombe exprima le désir d’y prendre part mais on lui fit comprendre qu’il ne serait pas admis. Malgré tout, il s’y rendit le 6 octobre. Nasser le mit en résidence surveillée dans une luxueuse habitation d’Héliopolis et les chefs d’Etat et de gouvernements, s’étant concertés à propos de l’éventualité de sa participation, la jugèrent inopportune « tant que la Commission ad hoc de l’OUA n’avait pas encore rempli complètement et de façon satisfaisante le mandat qui lui avait été confié » (Congo 1964 : 486). Le Premier ministre eut beau protester, il dut quitter Le Caire le 9, sans avoir pu prendre part à aucune des séances de la Conférence. Tshombe, cruellement déçu par la coopération africaine, ne se fit plus d’illusions quant à l’efficacité de l’ANC dans la lutte contre les révolutionnaires, et fit enfin appel à ses propres troupes, constituées de mercenaires et d’anciens de la Gendarmerie katangaise qu’on intégrera pour la circonstance dans l’ANC. Le largage des parachutistes belges marqua le point culminant de cette offensive, qui se poursuivit dans le Maniema, le Nord-Katanga et le Kwilu. Finalement les bombardements parvinrent à réduire le mouvement révolutionnaire à quelques points de résistance isolés. Le mouvement insurrectionnel s’achevait enfin.
Les tensions politiques qui s’étaient dissipées un temps réapparurent. Il faut revenir à la fin du mandat d’Adoula pour en saisir les derniers développements. L’éventualité d’une vacance officielle du pouvoir le 30 juin 64, le référendum constitutionnel, puis la perspective des élections générales, permirent la réapparition de partis. A la différence des années 59-60, on assista ici à des tentatives de regroupements politiques. Trois grandes formations firent leur apparition : le Rassemblement des Démocrates Congolais (RADECO) qui naquit en août 63 et devint à partir de mars 64 le parti gouvernemental, du moins tant qu’Adoula fut au pouvoir : le Comité Démocratique Africain (CDA) qui rassembla à partir de juin 64 quelques partis autour de l’ABAKO – aile progressiste [100] ; le Front Commun National quant à lui (FCN), constitué également en juin 1964, regroupa autour de MNC/L une douzaine d’autres partis. L’avènement de Tshombe et l’intensification de la lutte contre les insurgés mirent momentanément la campagne préélectorale au second plan. Le président Kasa-Vubu lui-même donna le ton en restant solidaire de Tshombe dans son combat contre les prétendues rébellions. Même dans les moments les plus difficiles des relations avec l’OUA et les pays non alignés, il soutint son premier ministre et refusa de se substituer à lui lorsqu’on réclama sa présence aux différentes conférences qui se tinrent au Caire, pour qu’il y représente le pays.
Après la libération de Stanleyville, les choses changèrent : des conflits naquirent, du fait que le président supportait de plus en plus difficilement le succès grandissant et envahissant de son Premier ministre. Le secrétaire du général Mobutu témoigna lui-même de la popularité de Tshombe jusque dans le Mayumbe, fief de Kasa-Vubu. Les faits eurent lieu à Kitona, le 9 janvier 1965, lors d’une cérémonie de prise d’armes à l’occasion de la clôture de la formation de la première promotion de candidats officiers d’infanterie. Kasa-Vubu, Tshombe et Mobutu y participaient. Une foule immense s’était rassemblée sur toute la longueur du parcours du cortège présidentiel. A son passage, la foule ignora totalement la présence du président Kasa-Vubu… « pour n’ovationner à tue-tête que le Premier ministre vers qui elle se rua, brisant le cordon de sécurité, pour immobiliser la jeep durant plusieurs minutes » (Ilosono B. 1985 : 77). Tout le monde annonçait une défaite certaine de Kasa- Vubu aux prochaines élections présidentielles, ce qui n’était pas pour améliorer ses rapports avec Tshombe.
Les premières divergences entre les deux hommes apparurent lors d’une discussion relative au moment où devait s’effectuer, d’après certaines clauses de la Constitution, la démission du gouvernement de transition qui était en place. Interviendrait-elle dès la proclamation des résultats des élections ? Tel était le souhait du président. Mais le Premier ministre estimait devoir rester en place jusqu’aux élections présidentielles et ne manquait pas d’arguments pour défendre son opinion. Il était inutile de mettre en place un second gouvernement de transition dont la durée ne dépasserait pas un trimestre. Visiblement, la compétition pour les élections présidentielles avait commencé et Kasa-Vubu ne s’estimait pas vaincu d’avance par son rival. Une occasion se présenta alors à lui, lui permettant d’attaquer : il profita de l’élection de Munongo comme gouverneur du Katanga Oriental, pour nommer V. Nendaka Ministre de l’Intérieur, touchant là un point névralgique de la défense katangaise. Kasa-Vubu fit également savoir qu’il serait candidat à sa propre succession, afin de faire taire les rumeurs selon lesquelles il devrait se contenter du titre de sénateur à vie que lui conférait sa qualité d’ancien président de la République, comme le stipulait la Constitution. Il devint donc évident que les présidentielles allaient se jouer entre le président et son Premier ministre.
Avec le départ d’Adoula et l’avènement de Tshombe, la répartition des partis politiques allait nécessairement être modifiée compte tenu des forces en présence. Tshombe, le nouvel « homme fort », avait ressenti le besoin de s’offrir des assises politiques solides à Kinshasa car la seule Conakat, même dotée d’une section à Kinshasa, n’était pas à la hauteur. Voilà pourquoi, à partir de cette même section de Kinshasa, on procéda à la création d’un regroupement plus important, la Convention Nationale Congolaise (CONACO), dont la dénomination dissimulait à peine ses rapports avec la CONAKAT. Au Congrès de Luluabourg qui se tint en février 1965, une cinquantaine de partis et d’associations tribales décidèrent de s’affilier, pour affronter les élections sous cette bannière et profiter de la popularité du Premier ministre, le chef du parti. Mais la solidité interne du groupe était précaire car chaque entité conservait une certaine marge d’autonomie, et la plus grande opposition à laquelle Tshombe allait être confronté émanerait du sein même de la CONACO.
Nendaka mit en effet un plan habile à exécution qui allait conduire à la défenestration de Tshombe. Tout commença par le succès éclatant et provoquant remporté par la CONACO à l’issue des élections en mai-juin 1965. Une majorité absolue de députés (122 sur 167 élus) lui fut garantie au Parlement, malgré l’intervention de la cour d’appel de Léopoldville qui se prononça en faveur de quelques cas qui firent l’objet de contestations [101]. Nommé au sein du gouvernement. Nendaka, que l’opportunisme avait conduit au sein de la CONACO, n’en demeurait pas moins membre du « groupe de Binza ». Il mena son propre combat à partir du groupe des élus de la CONACO originaires des provinces martyres ; et cela se passait en septembre. En effet, le président convoqua les Chambres pour une session extraordinaire le 20 septembre pour valider le pouvoir des élus et procéder à la mise en place des bureaux des Assemblées. En vue de cet événement, la CONACO tint un congrès du 16 au 18 septembre, dans le but de consolider la solidarité du groupe autour de Tshombe. L’absence remarquée de Nendaka, entraînant dans son sillage quelques membres des « provinces martyres » était significative d’un durcissement de l’opposition interne à Tshombe. On finit par l’afficher ouvertement sous l’appellation de Front Démocratique Congolais (FDC). Ce nouveau parti regroupait des ensembles divers, dissidents de la CONACO, et dont la sensibilité se rapprochait de celle des barons du groupe de Binza – notamment de Bomboko et de Kamitatu – ; le facteur de cohésion interne commun à cet ensemble hétéroclite résidait dans une opposition unanime à Tshombe et à son parti. Il va de soi que ce groupe revendiquait la démission du gouvernement de transition de Tshombe, pour qu’il soit remplacé par un gouvernement d’union nationale. La thèse de la CONACO, était tout autre. Comme on l’a déjà dit, le conflit était faussement juridique. En réalité Kasa-Vubu s’efforçait d’affaiblir son adversaire pour ne pas être écrasé au scrutin ; il lui restait beaucoup à faire. Les résultats des élections aux chambres pour la mise en place des bureaux le démontrèrent. Au Parlement, le président (Y. Kimpiobi) et le vice-président (F. Mopipi-Bitingo) se ralliaient à la CONACO. Au Sénat, c’est de justesse et au prix de mille difficultés que l’opposition à la CONACO 1 emporta pour la seule présidence (S. Mudingayi) sans être capable de rééditer cet exploit au niveau de la vice-présidence (J. Molebe).
Cette législature, conforme à la Constitution de Luluabourg et mise en place avec minutie et sans difficulté majeure, allait connaître exactement trois mois d’existence effective, bien qu’elle ait subsisté sur le plan formel pendant près de trois ans.
L’ouverture de la première session ordinaire, le 13 octobre, fit l’effet d’une bombe : le président profita de la séance solennelle d’ouverture pour révoquer son Premier ministre dont le parti était pourtant majoritaire. D’après Kamitatu (1971 : 127). 48 heures avant le message, il était encore question que Tshombe se succède à lui-même en tant que nouveau formateur, et qu’il lui serait seulement imposé de constituer un gouvernement de large union nationale. C’est en apprenant que Tshombe entendait former un gouvernement de la seule majorité CONACO que le président aurait changé d’avis. C’est Kamitatu lui-même qui aurait suggéré à Kasa-Vubu la candidature de Kimba au cours d’une brève séance du « groupe de Binza » à laquelle Mobutu participait. On peut douter de cette version des faits, quand on sait que Tshombe devait être révoqué à tout prix pour le 13 octobre au plus tard, afin qu’il ne puisse pas prendre part à la conférence de l’OUA où sa présence aurait été dangereuse étant donné que la question congolaise y était officiellement à l’ordre du jour.
E. Kimba, le nouveau Premier Ministre, venait du Nord-Katanga et donc de la Balubakat. Ancien ministre des Affaires étrangères de l’État sécessionniste du Ka- tanga, il venait de s’affilier en octobre au FDC. Son gouvernement ne comptait aucune personnalité importante issue du groupe pro-Tshombe, et les porte-parole les plus marquants de l’opposition, Nendaka et Kamitatu, y occupèrent respectivement les postes clés de ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Poursuivant sur cette lancée, on expulsa les conseillers étrangers et Kasa-Vubu profita de la tribune de l’OUA à Accra, après avoir obtenu que la question congolaise n’y soit pas évoquée, pour se rapprocher de la gauche en se réconciliant avec l’Afrique progressiste à laquelle il promit de chasser tous les mercenaires [102]. Le changement était trop brutal, trop inattendu. Sa réalisation aurait suscité bien des problèmes. Mobutu allait réagir contre cette déclaration. Au lieu d’un compromis, on allait plutôt au devant d’un affrontement. Un quotidien belge (La Libre Belgique) titrait déjà le 8 novembre que « la crise congolaise pourrait mener à un coup d’État » (Congo 1965 : 366) et, comme on aurait pu s’y attendre, les Chambres n’accordèrent pas d’investiture au gouvernement Kimba (14 novembre). Mais Kasa-Vubu décida à nouveau de nommer Kimba formateur (15 novembre). Est-ce volontairement qu’il rechercha le coup d’État, qui était sans doute à ses yeux un’moindre mal, au regard de l’expérience de septembre 60, plutôt que de risquer de voir Tshombe occuper le fauteuil présidentiel ? Il est en effet curieux que Kasa-Vubu n’ait pas jugé utile de nommer un ministre de la Défense nationale dans le gouvernement Kimba. Etait-ce pour laisser le champ libre à Mobutu ? Kamitatu affirme (1971 : 135) que ce dernier suggéra au président, en sa présence, de nommer Kimba formateur. Et d’ajouter « si pour cette deuxième fois, le parlement ne lui accorde pas le suffrage, alors nous agirons en conséquence et vous prendrez vos responsabilités ». Cette prise de position avait valu à Mobutu le titre de « Lieutenant – Général ».
De toute évidence, le coup d’Etat était en préparation. Mais qui aurait pu prévoir qu il était imminent ? Le message qui convoquait le Haut-Commandement de l’ANC à une réunion fut diffusé le 20 novembre. Le prétexte à cette réunion était l’organisation de cérémonies commémoratives du premier anniversaire de la reprise de Stanleyville. La cérémonie, prévue initialement pour le jeudi 25, fut ramenée au mercredi 24 à 17 heures, à la demande du général, sans que Kasa-Vubu ait soupçonné quoi que ce soit.
Pour le secrétaire de Mobutu, cette journée du 24 commença bien tôt, comme il en témoigne lui-même. Il fut réveillé à 5 heures du matin par un appel téléphonique du général, qui lui demandait de le rejoindre dans son bureau. Il s’y rendit en hâte. Là, il lui fut demandé de se rendre au bureau du chef d’état-major, le colonel Malila. Celui-ci lui intima l’ordre de préparer un rapport, à l’intention du haut-commandement, sur la situation politique, économique, sociale et militaire du pays pour la période allant du 30 juin 60 jusqu’à ce jour-là. On l’enferma à double tour dans le bureau. Le colonel Powis de Tenbossche, qui passait devant le bureau qu’il trouva fermé, ne put savoir ce qu’il faisait là. Le travail fut terminé vers 11 heures. Malila lui arracha le rapport et ses copies des mains, avant de l’enfermer à nouveau dans le bureau. C’est à 21 heures qu’il fut libéré, pour être conduit à la résidence du commandant en chef. Il fut surpris d’y trouver tout ce que l’ANC comptait comme commandants de grandes unités. On le fit asseoir et Mobutu lui dicta les lignes maîtresses du communiqué sanctionnant la décision du coup d’État. L’auditeur général de l’ANC, le colonel belge Van Halewijn, fut chargé d’établir le texte sous une forme juridique adéquate (Ilosono B. 1985 : 67-70).
Pendant ce temps, certains membres du gouvernement se montrèrent préoccupés. Kimba lui-même, intrigué par le fait que Kasa-Vubu ne s’était pas fait représenter à la réunion du haut-commandement en sa qualité de commandant suprême de l’ANC, fut victime d’un incident curieux vers 20 h 30. Il logeait au camp de Binza depuis qu’il était nommé Premier ministre ; ce soir-là il se vit interdire la sortie du camp. Les soldats de garde lui déclarèrent en avoir reçu l’ordre formel. Il força ce barrage et se rendit à son cabinet. Avec Kamitatu, il tenta de contacter le chef de l’État par téléphone vers 21 h 30, mais en vain. De plus en plus inquiet, Kimba décida de se rendre chez le président. L’accès du Mont Stanley lui fut interdit. Comme il insistait, les militaires menacèrent de l’abattre. II rentra donc au camp, et assista le lendemain matin à la proclamation militaire (Kamitatu C. 1971 : 147).
La résidence de Mobutu continuait d’être le cadre d’une agitation nocturne. Une fois la rédaction et la dactylographie du texte terminées. Mobutu le prit et se retira dans un coin pour l’étudier à son aise. Entre-temps, le major Wabali et le sous- lieutenant Lonoh furent convoqués pour des missions précises… Le premier fut chargé de couper la ligne téléphonique de la résidence de Kasa-Vubu, ce qui explique que celui-ci ne put être atteint par Kimba, et le second se vit confier la lecture du communiqué du haut-commandement à la radio, dès le début des programmes soit à 5 heures du matin. Le colonel Malila, quant à lui, devait aller remettre à Kasa-Vubu dès 7 heures du matin la lettre de sa destitution. Après la lecture de cette missive, celui-ci dit calmement : « Je verrai le général après ! » [103] Une nouvelle page de l’histoire venait d’être tournée, et le peuple salua l’événement avec enthousiasme.
Les instances politiques accueillirent la nouvelle avec une certaine euphorie. Les Chambres, réunies en congrès le 25, approuvèrent le coup d’Etat. Le FDC exprima son soutien ; la CONACO félicita l’armée pour les mesures qui avaient été prises, sans savoir que Mobutu prenait le pouvoir pour cinq ans. Le bruit avait couru dans un premier temps que le coup d’État serait organisé en faveur de Tshombe. Kasa- Vubu, parti pour le Mayumbe le 4 décembre accompagné d’une petite escorte, exprima lui aussi sa reconnaissance à l’ANC [104]. En définitive, il quittait son poste le tête haute.
Quant aux soldats, ils avaient toutes les raisons d’être fiers du succès de l’initiative de leurs officiers supérieurs, surtout que cette action était en tous points réussie. Mobutu lui-même leur déclara : « Je compte sur vous pour être les ambassadeurs de mon administration… je suis président de la République pour cinq ans mais pendant ce temps, je resterai militaire comme vous. Je porterai mon uniforme et recevrai mon traitement du Quartier général ». De plus, c’est un militaire prestigieux qui présidait aux destinées du gouvernement : il s’agissait du colonel L. Mulamba. Le général Bobozo prit, quant à lui, le commandement de l’armée.
4.3 Les derniers combats
Le coup d’État était une nouvelle preuve de l’incompétence du jeune État qui, malgré ses cinq ans d’âge, n’était pas encore capable de se gérer suivant les règles classiques de la démocratie. Pourtant toutes les conditions semblaient être réunies pour que cela puisse être possible. En effet la Constitution était enfin d’origine zaïroise ; les partis étaient à présent réduits au nombre de deux ; les projets sécessionnistes avaient été abandonnés, et l’opposition nationaliste était pratiquement évincée. Il subsistait une rivalité entre les politiciens du même bord : Kasa-Vubu, Adoula, Tshombe, Nendaka, Bomboko, Kamitatu, Mobutu.
Dans un autre registre, le coup d’État eut pour conséquence l’accélération du processus de réhabilitation de l’État notamment sur les plans politique, économique et militaire. Ces domaines étaient, en effet, le cadre des derniers combats pour la décolonisation du Congo.
4.3.1 Combats politiques
Dans le domaine politique, le président prit la précaution, dès le départ, d’instaurer un « pouvoir fort ». Ainsi, la première ordonnance qu’il signa lui octroyait des « pouvoirs spéciaux » (30 novembre 1965). Aux pouvoirs spéciaux succédèrent par la suite les « pleins pouvoirs » (22 mai 1966), ce qui impliqua le transfert du pouvoir législatif à l’exécutif. La suppression du bicéphalisme politique, décrétée lors de l’éviction du général Mulamba, fut le dernier acte qui instaura par voie de fait le régime présidentiel (26 octobre 1966). Au demeurant, le présumé « complot de la Pentecôte » qui aboutit à la pendaison publique (2 juin 1966), moins de sept mois après le coup d’Etat, de quatre hommes politiques, était une illustration de la puissance de ce pouvoir fort en même temps qu’il donnait un aperçu de ses débordements possibles. [105]
A l’époque, ce pouvoir fut mis à profit pour interdire, dès décembre 65, l’activité des partis pour cinq ans, réduire les rémunérations des députés, décréter la lutte contre la corruption et le trafic de pierres précieuses, voire suspendre le droit de grève.
Au niveau territorial, l’interpellation des révolutionnaires demeurait posée, en ce qui concerne l’émiettement des « provincettes. » Leur fonctionnement était problématique, à la fois faute de ressources suffisantes et du fait de la prolifération de territoires dits contestés. Une solution rapide et ferme s’imposait. Regroupées d’abord en 12 provinces, (7 avril 66), les 21 « provincettes » furent finalement ramenées à 8 provinces, et un statut d’autonomie fut conféré à la capitale (24 décembre 1966). Par la suite, pour en finir définitivement avec les discussions internes nuisibles au bon fonctionnement des provinces, il s’avéra nécessaire de modifier leur statut, pour en faire de simples entités administratives sous la tutelle directe du Président (31 octobre 1966). Les permutations administratives au-delà des frontières provinciales devenaient possibles. Du reste, en juin 67, on poursuivit le travail de réorganisation administrative et les entités furent réparties en 24 districts (appelés plus tard sous-régions), 132 territoires (zones) et 8 villes (Congo 966 : 213-338) (carte 21). La décentralisation administrative ne sera amorcée qu’au cours des années 80. A titre expérimental, le Kivu, la région la plus peuplée éclatera alors en trois régions autonomes, le Nord-Kivu, le Maniema et le Sud-Kivu, les trois anciennes sous- régions (carte 21).
Les actions les plus décisives dans le domaine politique furent certes la proclamation de Lumumba héros national mais aussi la création d’un parti unique et la promulgation d’une nouvelle Constitution dont il sera question ci-après. La proclamation de Lumumba comme « héros national » n’était pas seulement une opération promotionnelle destinée à reprendre à son compte l’héritage lumumbiste et rallier à la cause du nouveau régime les lumumbistes de Kinshasa (tendance Kiwewa), ceux- là mêmes qui n’avaient été tentés ni par la diaspora ni par la lutte armée. En réalité, cette proclamation était une arme véritable qui jetait la confusion dans les rangs des révolutionnaires du Kwilu et de l’Est, dont la lutte devenait quelque peu caduque. C’était également une manière de se rallier davantage l’élite universitaire, dont la vision nationaliste était bien connue à l’époque.
Le Nouveau Régime allait s’appuyer davantage sur les élites universitaires ; il convient donc de faire le point sur la formation de cette élite, et de situer les étapes de son itinéraire dans les méandres de la crise de croissance du pays. La première intervention politique des universitaires locaux remonte, comme on le sait, à l’expérience des Commissaires généraux en septembre 60. Même si elle fut éphémère, cette première manifestation eut pour effet d’intégrer dans la vie publique une première génération de diplômés, dont certains allaient par la suite avoir une renommée plus importante : J. Bomboko (président), M. Cardoso (l’Education Nationale), J. Mbeka (Economie), M. Lihau et E. Tshisekedi (Commissaire Général à la Justice et son Adjoint), P. Lebughe (Agriculture), C. Bokonga (Travail), E. Kashemwa et H. Takizala (Commissaire général au Transport et son adjoint) etc.
Cette expérience fit ressentir davantage la nécessité d’accélérer le processus de formation des universitaires autochtones et à leur niveau, de se doter d’une organisation interne pour apporter une contribution décisive à l’édification de la nation. Dans un premier temps, on procéda à la création d’instituts supérieurs pour compenser les insuffisances de l’apport des universités. L’Ecole Nationale de Droit et d’Administration (ENDA) fut créée le 28 décembre 60, tandis qu’un Institut Pédagogique National (IPN) ouvrait ses portes à Léopoldville en juillet 1961, dans le sillage de l’expérience de l’Ecole normale moyenne de Lumumbashi (1959). Le mouvement allait se poursuivre avec la création d’autres instituts : l’Ecole normale moyenne, le futur ISP de Bukavu et de la Gombe (1961), l’Institut du Bâtiment des Travaux publics (1962) … et bien d’autres.
L’organisation estudiantine s’oriente dans deux voies : celle de promouvoir une structuration interne au sein de chaque établissement et celle de prôner le regroupement de l’ensemble des effectifs du pays. Dans l’optique de la première orientation, une prolifération de sigles firent leur apparition : AGEL (Association Générale des Etudiants de Lovanium), AGEOC (Association Générale des Etudiants de l’UOC), AGENDA (Association Générale des Etudiants de l’ENDA), AEIPN (Association des Etudiants de l’IPN) etc. Le projet d’une tribune commune de l’ensemble des étudiants congolais prit forme très tôt. En effet, dès le mois de mai 61, une assemblée d’étudiants venus d’Elisabethville, de Belgique (Bruxelles, Louvain, Liège), de France, des USA se tint à Lovanium et aboutit à la création d’une « Union Générale des Etudiants Congolais » (UGEC). Cette structure remplaçait l’UNECRU (Union des Etudiants du Congo et du Rwanda-Urundi), qui existait avant l’indépendance. La nouvelle organisation fit appel, pour présider à son destin, à un jeune diplômé universitaire qui était au demeurant l’ancien président de l’Unecru ; il s’agissait de l’ancien commissaire général adjoint au Transport et à la Communication, H. Takizala ; il devait être épaulé par un comité qui comptait parmi ses membres ; N. Watum, K. J. Kalala, A. Dede, J. Nsinga.
C’est au cours de son deuxième congrès, en août 1963, que l’UGEC put parachever son organisation interne en prévoyant l’existence d’organes internes distincts : le Congrès National, le Comité Exécutif National, le Commissariat aux Comptes, la Commission d’arbitrage, les Comités et Assemblées sectionnaires. Le Congrès imposa sa vision de la nation en optant pour l’intégrité territoriale, préconisant l’instauration d’une structure unitaire décentralisée et déconcentrée, « cette option étant la seule garante de la cohésion nationale ». L’UGEC prit ainsi position contre la vision fédéraliste et s’allia aux forces politiques (partis nationalistes, syndicats) qui combattaient l’action gouvernementale et partant, le président Kasa-Vubu. [106] Le Nouveau Comité exécutif, présidé par F. Kayukwa et composé de A. Nkanza- Dolumingu, G. Kamanda, A. Malu et F. Mononi choisit de ne pas participer aux travaux de la commission constitutionnelle de Luluabourg. Puis, les étudiants critiquèrent vivement la politique du gouvernement Tshombe, en particulier le largage des parachutistes belges en novembre 64 à Stanleyville ; à cause de cette prise de position violente, les responsables de l’UGEC-Belgique, O. Ndeshyo et P. Tshilenge furent expulsés de l’ancienne métropole (Lumumba – Sando K. 1980 : 130) [107]. A Léopoldville, Nkanza-Dolumingu et Kamanda furent arrêtés puis relâchés après deux jours d’incarcération.
Dès novembre 65, de bons rapports s’instaurèrent entre les étudiants et Mobutu. Le 14 décembre 65, il fut reçu à Lovanium et les étudiants de FAGEL lui firent bon accueil. « Nous vous félicitons, déclara le président des étudiants, T. Mwamba, pour votre courage d’avoir dit la vérité. Et vous êtes le premier… » l’orateur conclut par ces mots : « Faites appel à l’élite congolaise et vous verrez ce dont l’élite congolaise est capable ». (Congo 1965 : 448) Mobutu le prit au mot. En effet, comme en septembre 60, son régime fit largement appel aux universitaires, sollicitant leurs conseils en vue de construire le pays. Dès le départ, la politique nationaliste du régime s’inspira en effet pour ses premières décisions, des recommandations du 2e congrès de l’UGEC qui avait préconisé notamment la proclamation de Lumumba héros national, l’érection d’un monument en son souvenir, la décentralisation des administrations provinciales, l’instauration du régime présidentiel, l’élection présidentielle au suffrage universel, l’instauration d’une Chambre unique, la reconnaissance du droit de vote aux femmes, la reconnaissance du droit de vote à partir de 18 ans. Ces différents éléments constituèrent la toile de fond de l’innovation constitutionnelle de 1967.
Le 3e congrès de l’UGEC qui se tint en octobre 66 vint compléter cette réflexion qui présiderait à la réorganisation du pays. En effet, ce congrès réaffirma la vision unitariste de la nation et préconisa l’édification d’un « Etat socialiste pour une révolution nationale, démocratique et populaire ». Il se prononçait pour le parti unique conçu comme « organe suprême » concrétisant la volonté du peuple. Les parlementaires, dont le mandat serait gratuit, et le président de la République, devraient être élus au suffrage universel sur présentation du parti. Le congrès préconisa également la création d’une « milice populaire » et la suppression de toutes les associations estudiantines (Mulumba Lukoji, 1967 : 5-13 ; Lumuna-Sando K., 1980 : 128-137). Ces résolutions faisaient office de prélude à la création du MPR, de la JMPR et du mode d’élection tel qu’il serait appliqué en 1977, au point qu’on se demande si elles n’étaient pas le fait de celui-là même qui finança les travaux de ce troisième congrès de l’UGEC.
Quoi qu’il en soit, on comprend que Mobutu ait conclu que les meilleurs réalisateurs de ce corpus de projets nationalistes étaient finalement ceux qui les avaient produits. De conseillers occultes, les universitaires furent projetés à l’avant de la scène politique, avec la création du « Secrétariat général à la présidence » (8 novembre 1966). Dirigé par un ancien leader de l’UGEC, G. Kamanda, ce secrétariat fut doté de trois directions (Affaires économiques, commerciales et financières ; Affaires juridiques et administratives ; Affaires techniques, Mines, Energie et Communications) confiées respectivement à J. Bongoma, J. Umba-di-Lutete et B. Bisengimana. Restructuré en octobre 67, il devint le « Bureau du président de la République » dirigé par E. Loliki et plus tard par B. Bisengimana. Ces premiers conseillers à la présidence, qui furent des techniciens au service de la politique nationaliste du chef de l’Etat, et qui constituaient la deuxième vague des politiciens de formation universitaire (G. Kamanda, Umba-di-Lutete, L. Lobitch qui deviendra Kengo wa Dondo, Bisengimana, B. Dieferding actuellement Kabisi, J. Sambwa, S. Kashama-Nkoy etc.) vinrent cohabiter avec la première, celle que formaient les anciens Commissaires généraux.
4.3.2 Combats économiques
Le domaine socio-économique était également le cadre de combats d’arrière-garde pour l’indépendance. A posteriori, ces combats se révélèrent n’être que le début d’une offensive qui devrait être autrement plus importante et plus élaborée pour restituer au Congo les biens qui sont les siens et promouvoir la production locale de manière à assouvir les besoins des populations.
Une première action relança précisément l’agriculture. Elle démarra dès 1965 par une campagne appelée « retroussons les manches » (12 décembre) dans le cadre de laquelle chacun était invité à cultiver la terre. L’année 1966 fut déclarée « année de l’intérieur » et la suivante « année de l’agriculture ». L’insistance de cette vérité première était mal accueillie, non seulement pour des raisons d’ordre psychologique liées au rejet de la politique agricole coloniale mais aussi parce qu’un tel effort était immédiatement contré par les difficultés de transport et la structure des prix du produit agricole. Le combat mené en vue de « l’indépendance économique pour se débarrasser des séquelles du passé colonial » fut l’une des caractéristiques essentielles de l’année 1966. Il fut rendu possible à la fois par les résultats des mesures de restriction instaurées dans le train de vie de l’État et grâce aux accords et aux prêts financiers consentis par la Belgique et les USA (Février-avril 1966). Cette démarche fut soutenue sinon inspirée par l’équipe des universitaires qui évoluaient autour du chef de l’État. On s’efforça de contrôler la commercialisation de la production zaïroise et de mettre fin au contentieux avec l’ancienne métropole sur le portefeuille de l’État et sur la charge de la dette politique de l’État.
Dans la perspective du contrôle de la commercialisation de la production locale, la première disposition arrêtée le 6 mai donnait l’ordre à toutes les sociétés de droit congolais de transférer leurs sièges sociaux et administratifs à Kinshasa avant le 31 décembre à minuit. L’initiative malheureuse de l’UMHK de rehausser unilatéralement le prix du cuivre pour tenir compte des prix chiliens et zambiens était à l’origine de cette décision. L’État intervint en obligeant les entreprises minières à fournir à l’État congolais 10 % des « matières stratégiques extraites du sous-sol » (Congo 1966 : 188). Dans le même contexte, la Chambre aborda la question plus globale d’une révision fondamentale du régime des concessions foncières qui, depuis Léopold II, accordaient des privilèges exorbitants à des privés étrangers. Votée le 28 mai, cette ordonnance-loi (n° 66-343) – mieux connue sous le terme de Loi Bakajika – fut promulguée le 7 juin : elle précisait en son article 1er que « la République Démocratique du Congo reprenait la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers et miniers concédés ou cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en participation à des tiers, personnes morales ou physiques ».
Le combat pour l’indépendance économique passa à une nouvelle phase lorsque, le 24 décembre, l’UMHK fut nationalisée, ce qui permit la création (le 31 décembre) d’une société minière de droit congolais, la « Générale Congolaise des minerais » (Gecomin) dont le sigle fut revu en 1971 pour devenir la Gecamines (Générale de Carrières et des Mines).
L’autre aspect de ce combat concernait le problème de liquidation du contentieux sur le portefeuille et sur la charge de la dette publique de 1 État. La question n’était pas nouvelle, et la table ronde économique organisée en 1960 n’avait pas donné lieu à un véritable débat, la partie congolaise, retenue par des préoccupations politiques, n’ayant pu affronter la délégation belge, qui, comme on l a vu, était composée des personnes les plus compétentes et les mieux renseignées sur ces dossiers. Les premières négociations qui eurent lieu à Bruxelles en février puis en juillet 1963 aboutirent à un protocole d’accord lors de la rencontre Spaak-Adoula à Kinshasa en mars 1964. Mais ces accords ne purent être conclus à cause de troubles qui éclatèrent au Congo et de la chute du gouvernement Adoula.
Avec Tshombe, le débat reprit ; les négociations se firent à Bruxelles du 28 janvier au 6 février 1965. Elles aboutirent à un certain nombre de conventions que l’on signa le 8 février 1965, ce qui permit à Tshombe de rentrer triomphalement à Kinshasa, brandissant dès l’aéroport une mallette contenant… le portefeuille.
Mais l’année suivante, le gouvernement Mulamba constata que plusieurs questions financières restaient en suspens et que certains des compromis consentis par Tshombe en février 1965 dans le règlement du contentieux renfermaient des clauses qui risquaient, suivant les propres termes du président, de « … lier le Congo éternellement ». « Voilà à quoi auraient abouti… six ans d’intrigues, six ans de manoeuvres et de complots ». Il fallait donc en finir une fois pour toutes. Dans ce même discours du 30 juin 66, Mobutu fit l’inventaire des problèmes en suspens :
- le transfert de propriété au Congo des biens mobiliers et immobiliers ;
- la révision sur une base équitable des modalités de remboursement de la dette publique contractée par la Belgique au compte de sa colonie ;
- le transfert de la propriété des immeubles congolais situés en Belgique ;
- la liquidation des parastataux congolais jusqu’alors gérés par des Belges aux fins de les doter d’un statut compatible avec notre souveraineté nationale ;
- la liquidation des sociétés percevant des impôts et des droits de douane revenant au Congo mais qui sont établies en Belgique et gérées par des Belges, notamment la Banque centrale du Congo Belge et du Rwanda-Urundi, l’Office douanier congolais ;
- le règlement des pouvoirs concédants en matière minière.
Tant de questions pertinentes qui l’étaient d’autant plus que la comptabilité de la colonie, d’après le discours colonial, était distincte de celle de la métropole et que, comme on l’a vu, le Congo avait payé lui-même très largement le prix de sa colonisation.
On mena de nouvelles négociations, d’abord à Bruxelles (11-27 mai 1966) puis à Kinshasa (22-26 juin 1966). A Kinshasa, on planifia des rencontres entre experts. Pour mettre un terme à ce qui tournait de plus en plus au marchandage, le chef de l’État prit la décision unilatérale de considérer le Contentieux belgo-congolais comme clos le 30 juin 1966 à minuit. La suite prit le tour d’arrangements par voie de fait. Le Congo renonça à ses droits de propriété sur des immeubles situés en Belgique, pour confisquer ceux d’immeubles implantés dans le pays. S’il se retira de la Sabena où il avait des actions importantes, c’était pour considérer que la Belgique ne disposait plus d’aucun droit sur Air-Congo. Certaines sociétés minières (Kilo-Moto, Forminière) disparurent, pour être remplacées par des sociétés de droit zaïrois (Kikassa F., 1966 : 327-351).
Le règlement du « Contentieux » ne pourrait de toute évidence être établi du jour au lendemain ; cette étape fut la plus féconde. Cependant, en l’absence d’un accord global sur la répartition d’un patrimoine naguère commun et sur les obligations dérivées de la colonisation, le problème restait en suspens. Le conflit belgo-zaïrois d’octobre 1990 constitue le dernier rebondissement de l’affaire, le Congo bénéficiant de compétences suffisantes dans tous les domaines pour défendre valablement ses droits. Nombre de parlementaires émirent le souhait qu’au-delà du cas du conflit, l’ensemble des accords conclus avec les pays occidentaux soit soumis à un examen critique. Le président, l’initiateur de cette contestation risqua sérieusement d’être débordé par sa gauche. Il fallut toute l’habileté du roi Hassan II du Maroc pour mettre un terme à ce conflit et mettre les deux parties d’accord autour d’une nouvelle convention de développement [108].
Le problème du « Contentieux belgo-congolais » reste cependant irrésolu. Une démystification du fait colonial serait nécessaire pour en finir ; de même, il conviendrait d’établir une évaluation exhaustive des bienfaits apportés et des profits soustraits par les colonisateurs ; il faudrait surtout qu’il existe une volonté internationale d’établir cette compatibilité générale et d’indemniser ceux qui ont été lésés et exploités.
Dans le cas concret du Congo et de la Belgique, un historien congolais, Pilipili Kagabo, a évoqué un projet audacieux, élaboré à partir du modèle précis des revendications alliées après l’occupation allemande de 1914-18, de 1940-45. La première démarche, estime-t-il, consisterait à signer un traité de paix entre le Congo et la Belgique pour mettre un terme à l’état de guerre qui est latent entre les pays depuis 110 ans (1880-1991). Le Congo pourrait alors réclamer à la Belgique, en guise de réparation des méfaits et des séquelles d’une occupation abusive, la somme de 500 000 milliards de dollars américains ventilés comme suit : 100 000 milliards pour «l’occupation abusive du territoire », 100 000 milliards pour «la destruction sociale, économique, politique et culturelle des anciens États, peuples et nations autochtones, 75 000 milliards pour « les impositions illégales et arbitraires », 75 000 milliards pour « les massacres, mutilations et tortures », 75 000 milliards pour « les recrutements forcés, déportations et relégations » ; 50 000 milliards pour « les efforts de guerre » (1914-18, 1940-45), 25 000 milliards pour « les déstabilisations : fausse succession d’États, invasions, sécessions, assistance à des groupes et pouvoirs non-démocratiques (1960-1990) » [109]. La Belgique, de son côté, devrait évaluer le coût des services apportés au Congo et ce montant serait à défalquer de ce qu’elle doit à celui-ci. Comment une telle comptabilité pourrait-elle s’établir ? Qui en garantira l’objectivité ? Quelle est l’instance qui peut présider à l’établissement d’une telle paix ? Pilipili répond que cela pourrait se réaliser dans le cadre de l’Alliance Atlantique à laquelle participent le Congo et la Belgique. L’appartenance des deux pays au camp américain devrait faciliter les choses, les USA pouvant jouer le rôle d’arbitre, de garant de l’objectivité de cette négociation ultime.
Au-delà du gonflement exagéré des chiffres, le projet est en soi pertinent et théoriquement valable pour tout pays du Tiers-Monde face à l’ancienne métropole. Il l’est particulièrement pour le Congo, qui non seulement n’a rien coûté à la métropole, mais a même eu un impact par ses richesses minières, notamment l’uranium, sur le cours des événements mondiaux. Mais le monde est-il prêt à envisager une telle révision de l’histoire ?
4.3.3 Combats militaires
L’aspect militaire constituait un troisième terrain d’affrontement. Une première guerre fut engagée avec les prétendus rebelles qui multipliaient les escarmouches ; la seconde suivit la défenestration de Tshombe, ce dernier disposant alors d’une « force » militaire, composée d’anciens gendarmes katangais et de mercenaires intégrés à l’armée nationale. La perspective d’un même ennemi permit d’effectuer ici et là quelques jonctions entre nationalistes et tshombistes.
A propos des guerres révolutionnaires, l’enchaînement des faits est connu. L’attaque de l’ANC poursuivit Mulele dans sa progression vers le nord, pour aller à l’encontre de Che Guevara que vers le Sud. Complètement démuni, il fut peu à peu délaissé par les militants qui, poussés par la misère et la faim, quittèrent leur maquis. Mais Mulele n’était pas encore vaincu.
A l’est, les leaders de la révolution – Gbenye, Soumialot, Olenga et autres – prirent le chemin de l’exil après les opérations menées contre Stanleyville, Paulis, Fizi – Baraka et celles dites de « bouclage des frontières ». Toutefois certains eurent encore le droit de séjourner dans le pays. Même exilés, les Révolutionnaires étaient poursuivis par le démon de la division – leur action se mua en un véritable imbroglio, dans lequel il fut presque impossible de s’y retrouver. Au Caire, où il s’était réfugié, Soumialot, à l’issue de la conférence au sommet des Forces Révolutionnaires, du 7 au 21 avril 1965, prit la tête d’un « Conseil Suprême de la Révolution ». Ce conseil révoqua Gbenye, alors en séjour d’inspection à Buta. Gbenye, quant à lui, ne put cacher aux combattants les griefs qu’il nourrissait à l’égard de Soumialot et d’Olenga. Mais E. Bocheley – Davidson et le Colonel Pakassa se rapprochèrent de Gbenye. Tandis que Pakassa était assassiné le 2 septembre 65 au Caire, Bocheley renoua avec Gbenye, non sans avoir rompu préalablement avec l’aile dure du PSA ; il accusait celui-ci d’avoir voulu mener une révolution régionaliste et tribaliste et de se laisser manipuler par l’étranger. Avec Laurent Kabila et Ildephone Massengho, les « durs » du Front du Nord-Katanga, ils participèrent aux tentatives de réunification du MNC autour de Gbenye. Géographiquement ces leaders étaient dispersés : Soumialot élut domicile au Caire, Olenga en Ouganda, Th. Kanza, ayant quitté discrètement l’équipe Gbenye, se réfugia à Londres. D’autres s’installèrent au Soudan. Gizenga, libéré par Mobutu, créa au Caire en septembre 66 un nouvel organisme, le « Front Congolais de la Révolution » qu’il conçut comme le pendant externe de son PALU (Congo 1966 : 371-429). Tant de conflits internes continuèrent ainsi à affaiblir l’Armée Populaire de Libération. A cela s’ajoutaient la lassitude de la population civile des zones révolutionnaires, la politique de pacification de l’ANC, la fin de l’assistance militaire cubaine à partir de mai 66 et l’interruption du ravitaillement en armes et en munitions par la Tanzanie, après la reconquête par l’ANC de la région de Baraka.
Pourtant, Laurent-Désiré Kabila se détacha du lot en établissant des bases solides d’appui à Kibamba et à Kasindi, dans le territoire de Fizi, en face de Kigoma, protégé par le relief et par la forêt épaisse. Il allait réussir à conserver cette position jusqu’à la fin du régime de Mobutu. Ce foyer de résistance en veilleuse était situé dans l’espace bembe, en plein milieu de la chaîne des Monts Mitumba, entre Fizi et Baraka, dans la zone frontalière entre le Nord-Katanga, le Sud-Kivu et l’est du Maniema. Le massif stratégique qu’il occupait, il le baptisa d’Hewa Bora (sans doute parce que, dans les hauteurs, on respirait effectivement « l’air pur »). A partir de 1977, ce petit territoire sera transformé en un mini-Etat socialiste, doté de toutes les conditions nécessaires d’existence pour les habitants, ses combattants et leurs familles : écoles, dispensaires, structures administratives et de production. Pour ne pas se laisser trahir par les besoins existentiels et pour être capable de résister à l’appel des sirènes rapaces du mobutisme avec leurs cortèges d’amnisties, Kabila misa, pour financer la guérilla, sur la vente de l’or, exploité dans le territoire sous son contrôle ou confisqué auprès des creuseurs qui s’aventuraient trop près de son « Etat » (Mukendi G. et Kasonga B., 1997, 55). De même, tout autre revenu disponible pouvait servir également d’appoint [110], Nairobi, Kampala et Dar-es-Salaam lui servant d’arrières et de villes refuges [111].
En 1967, Kabila concrétisa à son niveau le projet commun, sans doute inspiré par Mulele, de création d’un grand parti révolutionnaire, sur base de la théorie du marxisme-léninisme. L’inspiration qui l’habitait, avait quelque chose en commun avec celle qui animait Mobutu, exactement en cette même année 1967, mais avec des sensibilités et des intentions fort différentes. A Nsele, on optera pour l’appellation de « Mouvement Populaire de la Révolution » (20 mai), alors que, dans l’exil de Nairobi, on retiendra plutôt celle de «Parti de la Révolution Populaire» (24 décembre), un parti qui allait se doter d’une branche militaire, les Forces Armées Populaires (FAP). Le document que Gérard Althabe publia dans les Fleurs du Congo (1972) avait sans doute quelque lien avec ce maquis où, de manière effective, le dernier révolutionnaire, malgré l’incertitude du lendemain, avait entrepris une reprise en main idéologique de ses fidèles.
Dans cette région du Kivu méridional où, au peuplement ancien des ancêtres des Banyamulenge, étaient venus s’ajouter d’autres flux de réfugiés tutsi, la rébellion avait fait particulièrement usage des guérilleros tutsi rwandais, ceux-là mêmes qui avaient fui le progrom de 1959-63. Une collaboration qui restera fidèle jusqu’au bout. C’est à partir de la prise d’Uvira, le 5 mai 1965, par Antoine Marandura, que les Rwandophones prirent une part active au sein de l’APL. « Peu après, précisa- t-on dans le maquis, les patriotes révolutionnaires rwandais envoyèrent leur délégation auprès du Comité du Front de l’Est afin de lui affirmer leur soutien et de lui exprimer leur intention de contribuer concrètement à la guerre révolutionnaire du peuple congolais frère. La délégation était composée de 30 combattants éprouvés, conduits par le Président Rukeba de l’UNAR (Union Nationale Rwandaise). La voie révolutionnaire se dessinait avec beaucoup d’optimisme. Des Africains s’unirent pour jeter les bases de l’unification africaine par la lutte révolutionnaire. De nombreux combattants rwandais vinrent renforcer le Front de l’Est » [112]. Che en avait dénombré « plus de sept cents » et « ils étaient les plus courageux ». S’ils s’étaient associés aux Simba, c’était avec l’idée de disposer, après leur victoire, d’une base logistique pour mener la lutte au Rwanda et disposer de l’appui de l’APL victorieuse. Le révolutionnaire argentin avait noté qu’ils constituaient « les bras armés d’une organisation politique rwandaise » (Taibo II P. et al., 1995 :108-109). Il ne se trompait pas car leur parti, l’UNAR, qui avait combattu le colonialisme dès la fin des années 50, était, lui aussi, en exil [113]. Il avait, dès avant l’indépendance, les soutiens de pays et d’organisations « progressistes », comme l’URSS, la Chine populaire et le secrétariat afro-asiatique, qui le considéraient comme le seul parti nationaliste et anticolonial du Rwanda. Dans sa « traversée du désert », ce parti royaliste avait conservé intacte l’idée d’un retour au Rwanda, par la force s’il le fallait, comme l’avaient été son éloignement et son exil. Aussi ses éléments avaient- ils lancé, entre 1961 et 1966, une dizaine d’attaques contre le Rwanda mais sans succès. Avec les Simba de Soumialot et de Kabila, des accords avaient été conclus pour combattre ensemble « les gouvernements fantoches et impopulaires » de J. Kasa-Vubu et G. Kayibanda ».
Malgré cet appui, les « rébellions » de l’Est avaient toujours été en perte de vitesse. Les Simba, délogés des centres urbains, s’étaient réfugiés dans les montagnes où ils se livrèrent au pillage du bétail des Banyamulenge. Cherchant à se défendre et à se protéger [114], ces derniers se retrouvèrent dans la position des « loyalistes », soutenant les thèses gouvernementales et luttant contre des frères tutsi [115]. C’est parmi ces derniers que le PRP allait faire une abondante moisson d’autres combattants tutsi et s’appuyer sur les Bembe pour combattre les troupes de Mobutu. L’ironie du sort veut que, trois décennies plus tard, ce sont les Rwandais qui seront « libérés » plus tôt et l’accord conclu allait être finalisé, mais en sens inverse ; en prenant pour prétexte, le devoir de solidarité à l’égard des Banya mulenge martyrisés. Mais on en est pas encore là.
En 1966, c’est l’ancien Premier ministre Tshombe qui causa bien des préoccupations. Lorsque Mobutu neutralisa les institutions, interdisant la pratique politique, son parti, la CONACO détenait la majorité au Parlement. De toute évidence, Tshombe était le grand perdant de ce nouveau régime qui imposait la table rase. Comble d’injustice, le gouvernement Mulamba composé d’un représentant par province, recruta ses ministres non pas essentiellement dans les rangs majoritaires mais dans ceux de son opposition. Le gouvernement censé garder le pouvoir pour 5 ans était donc composé des plus grands leaders du FDC : V. Nendaka, J. Bomboko et en principe C. Kamitatu (remplacé en définitive par B. Mungul-Diaka suite à la pression des chancelleries occidentales). La CONACO, le parti majoritaire, dut se contenter de peu. On choisit ses représentants parmi les moins « inconditionnels » du parti : E. Tshisekedi, V. Kande, J. Nsinga, M. Tshishimbi etc. Il devint évident que l’homme à abattre – parce qu’il possédait lui aussi l’envergure d’un chef d’Etat – était Tshombe. On eût dit qu’il y avait, de manière manifeste, un conflit dans le camp occidental, à propos de Tshombe et de Mobutu. Ceux qui soutenaient le général s’efforçaient d’éliminer l’ancien leader katangais. [116]
Ce dernier, fort de l’appui de ses amis et de ses « gendarmes » – les Diabos comme on les appelait – ne pouvait s’empêcher de poursuivre le combat. Réfugié à nouveau à Madrid, il élabora des plans en vue d’une reconquête militaire du pouvoir, au départ du Katanga. La sécession était à ses yeux une solution payante car il était sûr que l’ONU ne s’en mêlerait plus. Pour ce faire, il lui fallait des mercenaires en nombre suffisant pour créer des unités armées susceptibles d’opérer au Congo ou de faire pression sur le « nouveau régime », comme en 1964, au temps de Kasa- Vubu – Adoula. On se mit à recruter des mercenaires un peu partout, en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Dans ce dernier pays, une indiscrétion aboutit à une maladresse ; les services de sécurité française (DST) intervinrent en Ardèche, dans un domaine où une trentaine de mercenaires suivaient un entraînement pour intervenir au Congo, pour le compte de M. Tshombe. A ses anciens mercenaires intégrés à l’ANC par la 5e Brigade mécanisée Tshombe envoya un mot d’ordre : ils devaient se rebeller et se regrouper au Katanga. Finalement, un plan général plus ou moins cohérent fut mis au point, comprenant deux parties : des révoltes dans l’ancienne province orientale (presque entièrement contrôlée par des mercenaires et par la 5e Brigade mécanisée) et le parachutage des troupes tshombistes (mercenaires et gendarmes) à Elisabethville au départ d’Angola. De l’aéroport, ils s’empareraient aussitôt des points stratégiques de la ville, Tshombe arriverait dans la ville le jour même et ferait une déclaration à la radio en tant que « Premier ministre légal ».
C’était négliger le caractère versatile des mercenaires qui se mettent au service du plus offrant. Tshombe n’avait pas prévu que certains de ses mercenaires intégrés dans l’ANC étaient devenus de grands amis du général Mobutu au point de lui préférer ce dernier. [117] Son plan était voué à l’échec car il fut dévoilé à Mobutu. De plus, les avions ne purent larguer les renforts prévus sur Elisabethville, malgré le soutien de Salazar. Malgré tout, quelques mercenaires et les anciens gendarmes se rebellèrent à Stanleyville. Mais était-ce spontanément ou sur l’ordre de Tshombe ? De toute façon, la cause était perdue d’avance et cette action fut l’occasion rêvée pour éliminer enfin ce danger permanent que représentaient au sein de l’ANC les ex-gendarmes et les mercenaires.
Déjà le 16 juillet 1966, une tentative de mutinerie s’était produite à Bukavu, les Diabos se plaignant d’être « toujours envoyés dans les mauvais coins » pour se faire tuer. Tout rentra rapidement dans l’ordre. Mais le 23 juillet commença la révolte du fameux régiment Baka du colonel Tshipola. Ce colonel et ses hommes étaient au nombre des Katangais qu’on alla chercher en Angola en 1964 pour combattre la rébellion. Visiblement, il s’agissait de fidèles de Tshombe, qui n’avaient nullement apprécié sa défenestration. Intégrés dans l’ANC, ces Diabos demeuraient groupés en unités homogènes (4 commandos, le 11e Codo, le 12e, le 13e et 14e), commandées par leurs propres officiers et encadrées par des conseillers européens. La mutinerie avait pour cause officielle le fait qu’une certaine discrimination était favorable aux éléments de l’ANC de Kitona et défavorable aux Katangais. On évoqua même des retards ou une certaine irrégularité dans le paiement des salaires. Mais pourquoi auraient-t-ils attendu juillet 1966 pour se rebeller ? Une motivation politique s’imposait de toute évidence. Pour preuve, cette mutinerie avait été préparée. Tshipola avait pris soin de concentrer en juin à Stanleyville les forces katangaises disséminées dans le Haut-Congo. Dans cette vaste région qui n’était pas encore dégagée complètement de l’emprise des forces révolutionnaires, se trouvaient stationnées, outre le régiment Baka, deux autres unités militaires : la 6e Brigade de commandos étrangers commandée par le lieutenant-colonel Bob Denard et le 3e Groupement de l’ANC avec ses deux bataillons de factions sur l’une et l’autre rive, que dirigeait le colonel Tshatshi qui avait remplacé le général Mulamba, devenu Premier ministre. Mais contrairement à ce dernier, Tshatshi n’était guère apprécié par les Diabos, ce qui ne facilita pas les choses.
L’arrivée à Stanleyville d’un 3e bataillon de l’ANC, peu avant les hostilités, montre que l’armée régulière s’attendait à un coup d’éclat. La mutinerie débuta le 23 juillet et, le lendemain, lorsque Tshatshi, pour juguler la rébellion, tenta de s’emparer du quartier général de Tshipola sur la rive gauche, il succomba sous des balles katangaises. Très rapidement, les rebelles investirent la ville et occupèrent ses points stratégiques. La bataille gagna les autres centres : Bafwasende, Buta où les Katangais subirent leur premier revers. A Stanleyville, où ils furent vainqueurs, ils n’échappèrent pas aux pièges de l’indiscipline. C’est à ce moment que l’ANC décida de lancer une nouvelle attaque par les « Volontaires » de Bob Denard. Le 25 septembre, les Katangais durent abandonner la ville et prirent le chemin du Maniema où Jean Schramme, après avoir « pacifié » la région, s’était taillé tout un empire, en créant selon sa propre expression « un État dans l’État » (Schramme J. 1969 : 219-232). Il accueillit Tshipola et les siens, puis plaida leur cause auprès du général Bobozo pour que, désarmés, ils puissent rentrer chez eux. Le 10 octobre, Bobozo alla sur place et les rassura. Cependant, récupérés par l’ANC pour être reconduits chez eux, les Diabos rebelles furent tués. Tshipola lui-même fut exécuté. Plusieurs mercenaires soupçonnés d’être de mèche avec les Katangais périrent également.
Il ne restait plus qu a se débarrasser du major Jean Schramme, le maître du Maniema, avec son bataillon Léopold qui avait été si efficace pour combattre les révolutionnaires mais qui était devenu gênant parce que trop conscient de ses forces. [118] De plus, il passait pour avoir été, sinon complice des rebelles katangais, du moins trop complaisant avec eux. Du reste, il ne dissimulait pas toujours ses options politiques, comme il le racontera lui-même (1969 : 261) : « Tous les matins, je montais les couleurs : le pavillon rouge et blanc barré du vert et orné des croisettes d’or, emblème du Katanga, flottait dans le ciel bleu… J’ignorais le drapeau du Congo « démocratique » et son étoile jaune à la mode soviétique ». Les messagers de Tshombe lui rendirent visite dans sa capitale à Yumbi et lui promirent du renfort en « volontaires » rhodésiens et sud-africains [119]. Toujours d’après Schramme, c’est la peur d’être attaqué et de finir comme les hommes du régiment Baka qui le décida, l’année suivante, à attaquer le premier et à s’emparer de Bukavu, Stanleyville et Kindu, les trois villes d’où partaient les trois axes routiers qui conduisaient au Maniema. Cette révolte des « affreux » eut donc à peu de choses près le même mobile que l’action de Tshipola. La décision de Kinshasa de dissoudre l’unité spéciale de J. Schramme et la Brigade des commandos étrangers de Bob Denard pour les fusionner avec les autres éléments de l’ANC a fait naître la peur d’une vengeance de l’ANC qui s’était déjà abattue sans distinction sur les Katangais comme sur les « Volontaires ». Mieux encore : cette initiative était un volet d’un coup d’État que les anciens gendarmes katangais et les mercenaires organisèrent en faveur de Tshombe. A cet égard, Bob Denard, jusque-là ami de Mobutu, avait repris contact avec son ancien maître sans doute pour mieux l’abattre. Il se chargea du recrutement des mercenaires en Rhodésie du Sud et en Afrique du Sud pour mener à bien cette action. Sur le terrain, le grand stratège fut Jean Schramme. Il fit diffuser un plan indiquant les axes de progression que ces forces antimobutistes allaient emprunter. En réalité, ce plan Kerilis était un faux, diffusé expressément pour que les troupes de l’ANC s’écartent des itinéraires réellement prévus pour l’attaque. Suivant l’arrangement intervenu entre Denard et Schramme, les troupes du bataillon Léopard allaient attaquer les trois villes le même jour ; après l’assaut, les hommes de Denard allaient assurer le relais à Stanleyville et Bukavu. ce qui permettrait à Schramme de renforcer Kindu.
La mutinerie démarra partout le 5 juillet. Schramme, à la tête de ses hommes, investit Stanleyville. Il le fit avec d’autant plus d’acharnement qu’on venait d’apprendre la nouvelle de l’enlèvement aérien de Tshombe et sa détention dans une cellule à Alger. Mais Bob Denard, en parfait agent double, sabota lui-même l’action, n’ayant nullement mobilisé, comme il le prétendait, ses mercenaires. Schramme ne put tenir que quelques jours et fut obligé de se replier sur Kindu avec ses hommes. Mais là encore, la traîtrise s’était manifestée. La colonne de mercenaires et de Diabos, partie de Bunia pour s’emparer de Kindu, tomba dans une embuscade parfaitement préparée et subit d’énormes pertes. A Kindu, les mercenaires furent encerclés puis massacrés. Bukavu fut d’abord occupée par les mercenaires qui durent ensuite l’abandonner sous les assauts des forces gouvernementales. Entre-temps, Schramme et ses hommes, partis de Stanleyville, se dirigèrent vers Bukavu dont ils s’emparèrent le 9 août. Ils s’y installèrent dans l’attente du renfort provenant de l’Angola où Bob Denard s’était rendu en vue de se diriger vers le Katanga et de reconquérir le pays.
L’occupation de Bukavu se doubla d’une action politique qui s’assura de la collaboration des Simbas que le bataillon Léopard avait pourtant combattus pour le compte du gouvernement de Kinshasa. Un des gendarmes katangais, ancien élève de l’Ecole Royale Militaire, le colonel Léonard Monga, se déclara en effet chef d’un gouvernement de « Salut public ». Dans sa proclamation du 10 août, il s’exprimait en ces termes :
Ce gouvernement de Salut public a pour but de mettre fin à la guerre civile qui ravage le Congo depuis la proclamation de l’indépendance, le 30 juin 1960. Sept ans d’anarchie, sept ans de guerre civile, sept années de malheur pour notre malheureuse patrie ont mis le peuple congolais à genoux. Un homme au pouvoir tyrannique essaie de régner sur le Congo : l’ancien sergent-chef Mobutu. A partir d’aujourd’hui, cet homme est déclaré traître de sa patrie… Il a violé la Constitution congolaise en s’attribuant tous les pouvoirs. Le traître Mobutu… sera jugé par un tribunal populaire, le peuple congolais réclame le droit de juger le tyran qui a fait du Congo… le pays le plus misérable de tout le continent africain (Schramme J., 1969 : 353-354).
Le gouvernement du colonel Monga, créé en désespoir de cause suite à la détention de Tshombe à Alger, avait peu de chance de subsister : ses troupes, bloquées à Bukavu dans l’attente d’un renfort hypothétique, étaient la cible d’un bombardement intensif des T28. A mesure que le temps passait, la solution préconisée par la Croix-Rouge avec l’appui de l’OUA s’avérait être la meilleure ; une dernière offensive de l’ANC, dans la nuit du 27 au 28 octobre donna le signal de ce repli sur le Rwanda, Schramme ayant espéré jusqu’à la dernière minute un renfort qui ne lui parvenait toujours pas. Lors de ce passage au Rwanda, les mercenaires de Schramme étaient au nombre de 129, encadrant 2 526 Diabos.
Du Rwanda, ils furent évacués en avril 1968 sans qu’une suite positive n’ait été réservée aux demandes d’extradition du Congo. Pour combien de temps cet épisode était-il clos ? Les gendarmes katangais vaincus et exilés allaient mener une véritable carrière militaire et guerrière en Afrique. Le Nouveau Régime venait de mettre un terme à une dernière bataille qui confirmait dans les faits la fin d’une période et le début d’une autre.
Au cours des années 64-65, deux catéchismes politiques ont été mis en circulation. Le premier fut diffusé par la révolution de l’Est pour éduquer le peuple dans le sens de la lutte engagée. Le second est un contre-catéchisme élaboré par le « gouvernement de Salut Public » de M. Tshombe pour soutenir sa campagne psychologique contre la révolution de l’Est et de l’Ouest.
- Le catéchisme du révolutionnaire (MNC/L)
(Congo 1964 : 66-67)
- Pourquoi luttons-nous ?
– Nous luttons pour libérer le Congo de l’emprise impérialiste et néocolonialiste et ce dans l’esprit de libérer et d’unir l’Afrique entière.
- Contre qui luttons-nous ?
– Nous luttons contre toutes les formes du colonialisme et de l’impérialisme.
- Qu’est-ce que le colonialisme ?
– Le colonialisme est tout régime qui tend à maintenir les peuples sous la domination étrangère.
- Qu’est-ce que l’impérialisme ?
– L’impérialisme est le colonialisme où il y a la domination des peuples par plusieurs puissances étrangères à la fois.
- Le Congo est-il indépendant ?
– Oui, le Congo est nominalement indépendant depuis le 30 juin 1960.
- Y a-t-il eu tentative d’améliorer cette situation de semi-colonialisme ?
– Oui.
- Par qui cette tentative a été faite ?
– Cette tentative a été faite par Patrice-Emery Lumumba, le Premier ministre du premier gouvernement légal congolais.
- Qu’est-il advenu à Patrice-Emery Lumumba ?
– Les ennemis du peuple congolais ont lâchement assassiné Patrice-Emery Lumumba.
- Ces ennemis ont-ils agi seuls ?
– Non, ils se sont servis des Congolais, traîtres à la nation.
- Quels sont ces traîtres ?
– Les principaux reconnus officiellement par l’histoire, l’Organisation des Nations Unies et le monde entier sont au nombre de 10.
- Citez-les dans leur ordre de culpabilité.
– Kasa-Vubu, Tshombe, Nendaka, Kandolo, Munongo, Kalonji, lleo, Bomboko, Mobutu et Ndele.
- Quels sont les ennemis extérieurs du peuple congolais qui se sont servis de ces traîtres pour assassiner Patrice-Emery Lumumba ?
– Ce sont principalement les Belges, les Américains et leurs alliés.
- Comment devons-nous nous comporter vis-à-vis de ces ennemis du peuple congolais ?
– Nous devons tout faire pour les mettre hors d’état de nuire.
- Et comment faire ?
– D’abord, nous devons écarter du pouvoir des traîtres congolais qui sont leurs instruments ensuite, nous devons organiser notre pays et nos institutions de telle façon que le Congo soit aux Africains.
- Comment peut-on réaliser l’idéal d’un Congo aux Africains ?
– Cela n’est réalisable que lorsque les Africains auront compris qu’ils sont et qu’ils doivent être maîtres chez eux dans tous les domaines comme le sont chez eux les Européens, les Américains, les Russes, et les Chinois.
- Faut-il pour cela adopter le capitalisme ou le communisme ?
– Non, parce que le capitalisme tout comme le communisme sont des théories et des méthodes qui nous sont étrangères et qui ne sont pas africaines.
- Quelle sera donc notre idéologie ?
– Le Lumumbisme sera notre idéologie.
- Qu’est-ce que le Lumumbisme ?
– Le lumumbisme est le patriotisme et le nationalisme africains, c’est-à-dire le Congo aux Africains et pour les Africains, de même que l’Afrique aux Congolais et pour les Congolais.
- Qui est Lumumbiste ?
– Tout Africain qui respecte et qui lutte pour la préservation de la souveraineté et l’unité africaines.
- Quelle est la devise du Lumumbisme ?
– La Patrie africaine ou la mort.
- Le catéchisme du nationaliste congolais de M. Tshombe
(Congo 1965 : 38-39)
- Pourquoi luttons-nous ?
– Nous luttons pour rendre au Congo sa dignité nationale et pour en faire le plus grand pays de toute l’Afrique.
- Contre qui luttons-nous ?
– Nous luttons contre toutes les formes de domination étrangère et notamment contre l’impérialisme.
- Qu’est-ce que le communisme ?
– Le communisme est un régime qui tend à maintenir tous les pays dans la misère.
- Pourquoi ?
– Pour en faire des esclaves.
- Le Congo est-il indépendant ?
– Oui, le Congo est politiquement indépendant depuis le 30 juin 1960.
- Y a-t-il eu tentative d’améliorer cette situation ?
– Oui.
- Par qui cette tentative a-t-elle été faite ?
– Par le gouvernement de Salut public de Monsieur Moïse Tshombe mis en place par le président Kasa-Vubu.
- Comment ?
– En rendant le Congo économiquement indépendant par le retour du portefeuille.
- Quels sont les ennemis du Congo ?
– Tous ceux qui ont trahi la nation congolaise en s’alliant aux Pays Arabes communistes de Ben Bella et Nasser, etc.
- Citez-les par leurs noms :
– Gbenye, Mulele, Kanza, Olenga et tous ceux qui, sous leurs ordres ont commis des actes qui déshonorent le Congo et l’Afrique tout entière.
- Comment devrons-nous nous comporter vis-à-vis d’eux ?
– Nous devons les rejeter de la communauté africaine et les empêcher de nuire au Congo.
- Quels sont les ennemis extérieurs du peuple congolais ?
– Ce sont principalement la Chine Populaire et ses alliés arabes.
- Comment peut-on réaliser l’idéal d’un véritable Congolais ?
– En collaborant à l’œuvre de redressement entreprise par le gouvernement de Salut public qui veut assurer le bonheur de tous tes Congolais.
- Faut-il pour cela adopter tes méthodes étrangères ?
– Non, parce que nous devons rester essentiellement Africains, fidèles à notre race.
- Quelle sera notre idéologie ?
– L’unité du Pays dans la paix et la prospérité de ses habitants.
- Qu’est-ce que le nationalisme ?
– Tout Congolais qui désire la paix et la grandeur de son pays et qui veut te faire respecter par l’étranger.
- Quelle est la devise du nationaliste ?
– Le Congo aux Congolais.
[1] Cf. Primordiale du sixième jour, Présence Africaine, 1963 : 41.
[2] La « revisite » de J.C. Willame à la crise congolaise (1990 :93-118) a permis de restituer le contexte dans lequel ce discours fut rédigé et prononcé. Il s’agissait surtout d’une réplique à Kasa-Vubu qui n’avait pas jugé bon de consulter son Premier ministre sur les propos à tenir pour la circonstance : c’était, après l’intervention du 26 juin, la deuxième fois que le président prenait une initiative non conforme à la Loi Fondamentale. Lumumba se sentit également offusqué par le roi qui n’accéda pas à sa demande de signer un armistice général à l’occasion de l’événement de l’indépendance. La suggestion de prononcer un contrediscours émanait de Jean Van Lierde qui conseilla à Lumumba de réagir. « On ne peut tout de même pas laisser passer cela » (p. 104), lui conseillera-t-il.
[3] La Tunisie présenta alors le Congo indépendant comme… « démocratiquement organisé, ayant en main un appareil de gouvernement normal, lui permettant d’assurer l’ordre et la stabilité à l’intérieur et de faire face à ses obligations extérieures » (Braeckman C. et alii 1990 : 79).
[4] L’Algérie poursuivait encore la guerre entamée en 1954 pour gagner son indépendance ; elle ne put faire partie du groupe.
[5] Aimé Cesaire, dans Une saison au Congo (1973 : 23-24). a bien rendu ce climat ambigu par cette conversation dans la foule en liesse : « Un citoyen – C’est quoi au juste, votre Dipanda ? Deuxième citoyen – Idiot, c’est la fête, notre fête ; tu vois bien : c’est quand c’est les Noirs qui commandent et les Blancs qui obéissent ! Premier citoyen – Oh ! je vois ! c’est très bien ! un grand carnaval quoi ! Eh bien : vive Dipanda ! Une femme – Comment elle arrive. Dipanda ? En auto, en bateau, en avion ? Un homme – Elle arrive avec le petit roi blanc, le Bwana Kitoko. c’est lui qui nous l’apporte (La pièce fut jouée pour la première fois au Théâtre de l’Est-Parisien. le 4 octobre 1967. par la Compagnie Serreau-Perinetti).
[6] La CONAKAT avait réclamé pour le Katanga deux portefeuilles ministériels : celui des Affaires économiques et celui de la Défense nationale. Elle obtint le premier ; quant au second, elle dut se contenter du poste de secrétaire d’État.
[7] II existe une abondante littérature consacrée à cette période, qu’on peut classer en trois genres : les témoignages des acteurs politiques eux-mêmes (Janssens E„ 1961 : Weber G., 19S3 : Van den Bosch J., 1986 ; Ganshof van der Meersh, W.J., 1960 ; Vandewalle F., 1974 ; Nkrumah K., 1967 : Dayal R., 1976), les biographies de ces acteurs politiques : J. Kasa-Vubu (Gillis CA. 1964 : Mpoyo Kasa-Vubu Z.J. 1985,1997), J.D. Mobutu (Monheim E. 1962,1985) mais surtout P.E. Lumumba (Devos P., 1961 ; Michel S., 1961 ; Rouch J., 1961. Lopez Alvarez I— 1964 ; Kashamura A., 1966 ; Kanza T., 1972 ; Manya K’Omalowete 1987. Willame J.L., 1990) puis des études, documentaires ou de fond (CRISP 60, 61, 62, 63, 64 ; Gendebien P.H., 1967 ; Gérard-Libois J., 1963. Gerard-Libois J. et Heinen J., 1989 ; Vandewalle F. et Brassine L. 1973 ; Kestergat, J., 1986 ; Lemarchand P., 1964 ; Hoskyns C„ 1965 ; Vanderlinden J., 1972 : Vanderstraeten L.F., 1985 : Braeckman C. et alii, 1990).
[8] Pendant les premiers 36 jours d’indépendance, l’ambassadeur de Belgique joua un rôle de pacificateur entre le Congo et la Belgique. S’il avait été écouté, peut-être les rapports belgo-zaïrois n auraient- ils pas pris une tournure aussi tragique, à une époque où le cordon n’était pas encore tout à fait coupé. Il fut finalement « mal coupé », pour reprendre ici le sous-titre de son ouvrage.
[9] Cette « piraterie aérienne » fut ordonnée par le général Cumont qui « fit tourner l’avion présidentiel en l’air jusqu’à ce qu’il soit arrivé lui-même à l’aéroport ». Sur insistance du Président et du Premier ministre qui voulaient se faire conduire à Stanleyville, on les fit décoller dans un avion sans carburant qui dut rebrousser chemin après avoir décollé (Willame J.C., 1990 : 185-186). Jamais gouvernants ne furent ridiculisés à ce point dans leur propre pays.
[10] En réalité, à peine nommé, il fut fait prisonnier par l’État sécessionniste et ne put gagner Léopoldville que par la suite.
[11] L’intéressé eut l’intelligence, dans la vague des promotions militaires, de placer des » hommes sûrs » pour lui à la tête des garnisons « stratégiques » : col. Kokolo au camp Léopold (actuellement Camp Kokolo), col. Bobozo à ThysviHe (Mbanza-Ngungu), major Tshatshi (bataillon de parachutistes à Binza). La révocation de Lundula le 12 septembre ne provoqua aucune « résistance militaire ».
[12] A propos de cet épisode, voir J. Gérard-Libois et B. Verhaegen 1961 : 254-256 ; W.J. Ganshof Van der Meetrsch 1960 : 132-177 ; J.C. Willame 1990 : 96.
[13] T. Kanza (1978 : 196) précise que Tshombe quitta Léopoldville, mécontent de n’avoir pas été reçu par Lumumba et non sans avoir lancé un avertissement à Kanza : » Je suis venu ici spécialement pour voir Lumumba, mais je n’ai pas pu le voir. Je rentre au Katanga. Lumumba regrettera de m’avoir ignoré »
[14] Le 12 juillet au lendemain de la déclaration de la sécession. Pierre Wigny, ministre belge des Affaires étrangères, fera une déclaration dénonçant la sécession. La raison invoquée par les Belges pour justifier leur immobilisme sur le terrain katangais était qu’ils craignaient, en s’opposant aux sécessionnistes, de leur offrir un prétexte qui leur permette de recourir à l’aide de la Rhodésie.
[15] d’Aspremont fut par la suite nommé ministre des Affaires africaines du gouvernement belge. Il fut remplacé au Katanga par M. Rothschild.
[16] Malgré cette déclaration, Tshombe omit de nommer des ministres « blancs » dans son gouvernement.
[17] A Elisabethville, se créa un camp de réfugiés (sous la protection de l’ONU) où furent entassées les populations luba du Kasaï pour éviter des représailles de la part des éléments de la CONAKAT.
[18] La déclaration de sécession (8 août) fut effectuée par A. Kalonii depuis Elisabethville, où un Traité d’alliance avait été signé avec Tshombe. A Bakwanga. la Forminière lui prêta une villa et des voitures ; elle mit également des fonds à sa disposition, d’après les témoignages de J. Ngalula et de Kadima (Muya bia L. 1980 : 173)
[19] Les négociations se tinrent à Genève du 14 au 24 août. La délégation congolaise était composée du ministre des Finances (P. Nkayi) et du ministre résidant en Belgique (A. Delvaux). Le professeur Hugues Leclercq y participa également en qualité de chef de cabinet adjoint du ministre des Finances. Elles aboutirent à la création d’un « Conseil monétaire » sous la tutelle de l’ONU et des services de l’ancienne Banque Centrale (Willame J.C., 1990 : 269-270)
[20] Cette réflexion fait l’objet du plaidoyer d’un jeune historien congolais Pilipili Kagabo (1990), sur lequel nous reviendrons plus loin.
[21] L’URSS ne livra finalement pas à Lumumba les 10 Ilyouchine espérés. Seuls 3 avions soviétiques intervinrent pour apporter une aide alimentaire au Congo en juillet. On les utilisa effectivement pour acheminer les troupes de Stanleyville à Luluabourg : mais à l’atterrissage, ils furent immobilisés par l’ONU qui refusa de les ravitailler en carburant.
[22] L. Martens (1985 : 83) soutient qu’il le fit sur l’ordre des Américains. F. Monheim, l’hagiographe officiel du futur Président (1962 : 115) estime qu’il le fit par compassion. »… écœuré, sans consulter personne, il donna l’ordre à ses troupes de revenir à Léopoldville ».
[23] La Constitution de « l’État fédéré du Sud-Kasaï » fut promulguée plus tard, le 28 mars 1961.
[24] Kalonji fut ainsi le seul Mulopwe qu’ait connu le Kasaï, la dynastie « impériale • se situant plutôt dans le territoire du Nord-Katanga. Les chefs coutumiers du Kasaï ne cachèrent pas que ce titre fut davantage usurpé que reçu. Ce « couronnement » se déroula le 8 avril 1961.
[25] A propos de ce complot, il faut consulter le rapport intermédiaire du Comité sénatorial américain (Heinz G. et Donnay H., 1976 : 187-188). J.C. Willame (1990 : 311-312) fait remarquer que, paradoxalement, ces complots furent menés au moment où le spectre du communisme s’était déjà éloigné. En effet, dès la mi-septembre, Mobutu procédait à la fermeture des ambassades des pays de l’Est. Vers le 25 janvier, alors que l’administration Kennedy était déjà en place, un policv paper établissait qu’au Congo » il n’y avait jamais eu ni parti communiste, ni personnalités communistes »
[26] L. Gillon (1988 : 163) rapporte qu’à la mi-août une délégation ecclésiastique de haute importance
était venue trouver Kasa-Vubu pour manifester son désaccord à propos de ce projet du gouvernement. Commentaire de l’auteur : « Entretien très constructif : Joseph Kasa-Vubu est un homme sage, plus soucieux de concorde et d’efficacité que de vaines satisfactions nationalistes ».
[27] Précisons qu’au cours du mois d’août, Tshombe avait reçu un émissaire de Léopoldville (Gilbert Pongo), venu lui faire part de la conspiration visant à écarter Lumumba (Kestergat J. 1986 : 67). Et ce dernier se doutait peut-être de quelque chose, car le 20 juillet il déclara qu’on avait tenté de les diviser, le chef de l’Etat et lui, mais en pure perte. « Entre le chef de l’État et moi-même, il n’y a même pas place pour une aiguille ».
[28] L’ordonnance de révocation était certainement illégale le 5 septembre parce que non contresignée par des ministres, ce qui fut fait le 6 par J. Bomboko et A. Delvaux. Cette ordonnance stipulait dans son art. 2 que A. Gizenga (Vice-Premier Ministre), R. Mwamba, C. Gbenye, A. Kashamura (ministres de la Justice, de l’Intérieur et de l’Information) étaient eux aussi révoqués, de même que les secrétaires d’État J. Lumbala et A.R. Bolamba. Il faut remarquer que P. Mulele, pour sa part, ne fut pas révoqué.
[29] La radio-Makala était animée par un inconditionnel de l’Abako, pourtant membre de gouvernement de Lumumba, R. Batsikama, qui passa quotidiennement à Brazzaville. Cette ville devint le siège de l’état-major des Forces antilumumbistes. Les Conseillers « belges » de Tshombe, Kalonji et Mobutu, qui se connaissaient bien parce que « anciens » de la Force Publique s’y donnaient rendez-vous avec l’appui de la Sûreté belge. Après l’arrestation de Lumumba, on y débattra aussi du sort à réserver au prisonnier (Cf. Willame J.C. 1990).
[30] Selon Boissonnade (1990 : 89), l’Ambassadeur des USA aurait menacé Kasa-Vubu de lui retirer l’appui de son pays s’il se réconciliait avec Lumumba. Les Américains y étaient farouchement opposés (Kalb. M. 1982 : 133-135), de même que les Belges (Heinz G. et Donnay H. 1976 : 31).
[31] La révocation de V. Lundula et de C. Muzungu, respectivement commandant en chef de l’ANC et chef de la Sûreté nationale, le 12 septembre 1960, constitue les premiers actes de l’éphemère gouvernement de J. Ileo. Le Colonel Mobutu devint alors commandant en Chef f.f., Lundula gagna Stanleyville le 8 novembre, et prit en main le commandement du 3e groupement.
[32] Le Collège des Commissaires Généraux devait rester en fonction jusqu’au 31 décembre ; il dura finalement jusqu’au 9 février 1961, date de la constitution du deuxième gouvernement Ileo.
[33] Il est clair que cette fuite était un coup monté en vue d’emmener Lumumba hors du contrôle de l’ONU. La CIA avait annoncé cette évasion dix jours avant qu’elle ait lieu ; autrement dit, avant même que Lumumba ait décidé de l’effectuer (Boissonnade E. 1990 : 92). Tout porte donc à croire que des émissaires furent chargés de lui « vendre » ce plan élaboré par ses bourreaux.
[34] Il y eut plusieurs variantes du scénario de l’arrestation. Pour les uns. Lumumba se serait fait reconduire spontanément sur l’autre rive pour se constituer prisonnier, sa femme et son fils étant déjà arrêtés ; pour d’autres, il aurait été appelé sur l’autre rive par ceux qu’il croyait être les siens, et arrêté dès qu’il eut abordé. Un témoin affirme que c’est sur la rive droite, bien après la première traversée qu’il fut arrêté et ramené à la rive gauche où se trouvait sa famille.
[35] A Mweka, « … profitant d’un relâchement de la vigilance des gardes ANC, le chauffeur de P. Lumumba – agissant selon les consignes reçues – fonça vers le camp des Ghanéens. D’après la version de ce chauffeur, la garde ghanéenne ignorant de quelle voiture et de quels passagers il s’agissait, aurait barré le passage et un lieutenant ghanéen qui sortait du camp aurait expliqué à Lumumba qu’il n’avait pas reçu mission de le prendre sous sa protection. Des soldats congolais arrivèrent alors sur les lieux ; trouvant Lumumba à l’arrière de la voiture, ils le frappèrent à coup de crosse et l’emmenèrent » (Heinz G. et Donnay H. 1976 : 53).
[36] Le dernier document consacré à la mort de Lumumba est un ouvrage collectif de Brassine et Kestergat (1991). Sur ce même thème, J. Gerard-Libois et J. Brassine avaient déjà publié un document remarquable déjà cité, sous les pseudonymes respectifs de G. Heinz et H. Donnay (1976).
[37] D’après Brassine (1991), tout aurait été décidé lors d’une réunion présidée par Kasa-Vubu le 14 janvier, à laquelle prirent part Bomboko, Nendala, Adoula, lléo, Ndele et Mobutu. A l’issue de cette entrevue, Nendaka chercha des exécutants qui mèneraient à bien, trois jours plus tard, le plan qui venait d’être élaboré.
[38] On se demande pourquoi Okito et Mpolo ont été mêlés à cette affaire. D’après certains, les « maîtres » du transfert ont voulu, en supprimant Lumumba, en finir avec leurs adversaires personnels. Mpolo était l’adversaire de Mobutu et Okito, celui d’Ileo, qu’il avait remplacé à la tête du Sénat ; celui-ci était surtout « coupable » d’avoir présidé la dernière séance des Chambres qui accorda les pleins pouvoirs à Lumumba (Gérard-Libois J., 1963 : 165). Mais d’après la version qui prévalait, et qui fut retenue par la Commission des Nations-Unies, c’est sur l’initiative de Lumumba qu’ils auraient été associés au drame. Au lieu de Nendaka, c’est Mukamba qui se serait présenté à la prison de Lumumba. Il lui aurait fait croire qu’un coup d’État venait d’avoir lieu à Léopoldville et que la population le réclamait. On comprend que Lumumba ait pensé se faire accompagner par Okito (officiellement la première personnalité du pays après Kasa-Vubu) et Mpolo (à ses yeux le vrai commandant en chef de l’armée à la place de Mobutu). Mais il n’est pas certain que ces deux autres prisonniers l’aient accompagné à Thysville. D’après Brassine et Kestergat (1991 : 128), ils auraient été internés à Luzumu et Nendaka serait allé les chercher cette même nuit, avant de se rendre à Thysville.
[39] II existe plusieurs versions de la manière dont Lumumba fut tué et de ce qu’il advint de sa dépouille. Gerard-Libois et Brassine {G. Heinz et H. Donnay 1976 : 125-173) les ont inventoriées et analysées de manière minutieuse. L’enquête récente de Brassine (1991) a l’avantage de démontrer le caractère convergent de ces différentes versions. Voici les éléments que nous retiendrons : à l’arrivée des prisonniers, trois ministres sont présents : Munongo, Kibwe, Kitenge. Les prisonniers sont acheminés à 3,5 km de là, dans la villa encore inhabitée d’un colon. Le soir même, le Conseil de ministres extraordinaire se tient à la résidence de Tshombe. Certains sont d’avis de conduire les prisonniers à Bunkeya, d’autres de les exécuter, d’autres encore de les renvoyer à Kinshasa. Après la réunion, le Conseil rend visite aux prisonniers. Les autres ministres se retirent. Quatre personnes demeurent sur place : Tshombe, Munongo, Kibwe et Kitenge. Avec les prisonniers et les exécutants européens (le colonel belge Huyghe et le capitaine Gat notamment) ; ils prirent la route de Likasi jusqu’à Shilatembo et là, à quelques kilomètres de la route de Mwandingusha, Lumumba et ses compagnons furent achevés puis enterrés. Le lendemain, pour déjouer la curiosité des villageois, les cadavres furent déterrés pour être enterrés ailleurs. Puis Munongo estima qu’il fallait faire disparaître ces corps. A nouveau exhumés, ils furent alors dissous dans de l’acide.
[40] En Afrique, Lumumba fut porté au rang de héros. Plusieurs écrits littéraires de l’époque lui rendirent hommage. Pierre Bambote lui dédia son chant funèbre pour un héros d’Afrique (Tunis. 1962) ; Tchicaya U Tamsi alla jusqu’à le comparer au Joseph biblique « vendu par ses frères pour quelques deniers » (le ventre, PA, 1964 : 19). Le résultat de l’enquête de Jean-Pierre N’diaye sur les étudiants noirs en France (1962 : 181, 195), est à ce sujet très éclairant. En réponse à la question « Quel homme africain suscite le plus votre admiration ? » Lumumba est cité en deuxième position (30,3 %) après Sekou-Touré (46,4 %) et avant Nkrumah (16.9 %). Quand on leur a demandé quel pays d’Afrique différent du leur les intéressait le plus, beaucoup ont cité le Congo. Les raisons données étaient les suivantes « … pour connaître ce peuple qui a donné l’homme le plus illustre que l’Afrique ait connu au XXe siècle : Lumumba » (un Togolais)… «pour me rendre à l’évidence des réalités de ce pays et des forces tribales auxquelles le Grand Leader a eu à faire face (un Malien) ». Au Congo, l’hommage qui lui fut rendu fut longtemps clandestin (on porta la barbiche en sa mémoire : plusieurs enfants qui naquirent à l’époque furent prénommés « Patrice Emery ») ; le 30 juin 1966. le président Mobutu le proclama officiellement « héros national ». Mais le monument érigé à sa mémoire n’est pas encore achevé. Des billets de banque portant son effigie furent retirés de la circulation en 1968.
[41] Il n’existe pas encore, à ce propos, de véritable littérature «du dedans», mis à part les écrits des « amis » de Lumumba dont les analyses se limitent trop au seul cas Lumumba (Van Lierde, Blouin, Lopez Alvarez, Michel etc.). Citons ici l’initiative louable de B. Verhaegen (1966, 1969), qui s’est efforcé d’étudier les « rébellions » à partir de leurs motivations premières, de même que celle de L. Martens (1985, 1991) qui a étudié l’itinéraire de P. Mulele et de sa femme. Des archives précieuses sont peut-être conservées à Pékin et à Moscou (ou dans d’autres capitales de l’Est), dont l’exploitation permettra un jour une saisie plus globale de l’itinéraire des « nationalistes ».
[42] Tshombe fut transféré à Kinshasa et promit de mettre un terme à la sécession. Une fois libéré et de retour au Katanga (22 juin), il revint sur ses promesses et la sécession reprit de plus belle.
[43] La réaction de Lumumba au coup d’État fut rendue publique lors d’un communiqué : « le gouvernement central de la république du Congo porte à la connaissance du peuple que le Colonel Mobutu… a été corrompu par les impérialistes pour jouer un coup d’État contre le gouvernement légal et populaire » (Michel S. 1961 : 233-234).
[44] L’expulsion du personnel de l’ambassade du Ghana créa un incident entre les Casques bleus ghanéens et les soldats de l’ANC. Au cours de ce combat, Kokolo trouva la mort.
[45] C’est là l’origine du mythe du » livre d’or » de l’indépendance, qui serait détenu par Gizenga. Le Congo ne pourrait jamais se rélever de ses crises, disait-on, tant qu’il n’entrerait pas en possession de ce livre d’or.
[46] Ludo Martens (1985 : 132) apporte d’autres précisions à cette affaire « Un avion de la compagnie Swissair, affrété par le gouvernement Gizenga, amena au mois de juillet (1961) 6 tonnes d’or au Caire, destinées à l’achat d’armes et de matériel. Samone Fall, Congolais d’origine sénégalaise et ambassadeur de Gizenga au Caire, se chargea d’en placer une tonne et demie dans une banque suisse. L’or, tout comme Monsieur Fall, disparurent avec beaucoup de discrétion.
[47] Même le Sud-Kasaï sécessionniste fut représenté dans ce gouvernement par J. Ngalula. Seul le Katanga sécessionniste manqua ce rendez-vous historique.
[48] Ces anciens d’Algérie trouvèrent dans l’affaire katangaise un exutoire à leur activité. Tshombe quant à lui cherchait à » internationaliser » l’origine de son personnel européen. L’abbé Youlou ne cessait de lui conseiller de faire appel aux Français plutôt qu’aux Belges (Cf. Davister P. 1960).
[49] On aurait pu penser que Youlou, qui avait des affinités avec Kasa-Vubu, allait favoriser un rapprochement entre celui-ci et Tshombe. Il n’en fut rien, il préféra s’arroger l’essentiel des relations avec le Katanga, au détriment de Léopoldville.
[50] Le 17 juillet, à l’Assemblée du Katanga, Prosper Mwamba – Ilunga déclara : « Au nom du Cartel, nous protestons contre la proclamation solennelle de l’État indépendant du Katanga» (Gérard-Libois J. 1963 : 32).
[51] O’Brien écrivit par la suite une pièce de théâtre – les Anges meurtriers (Murderous Angels) – mettant en scène les deux grands acteurs du drame katangais : Lumumba et Dag Hammarskjôld – Ils s’entretuaient par personnes interposées, victimes tous deux de leur radicalisme.
[52] Cf. l’émission télévisée de la RTBF consacrée à » Moïse Tshombe ».
[53] En mémoire de cet incident regrettable, on baptisa l’artère de la ville qui en fut le cadre « avenue des femmes katangaises ». Elle est par la suite devenue 1’ » avenue des femmes zaïroises ».
[54] Les archives furent transférées par avion à Boma ; de là, on les expédia par bateau aux USA. Des années plus tard, elles parvinrent à Bruxelles (Cf. Col. Vandwalle et Brassine J. 1973 : 219-224 : Vellut J.L. 1974 : 109-11)
[55] Arrêté, Muzungu fut au nombre des Lumumbistes qui furent transférés à Bakwanga en février 1961 et qui y furent massacrés le soir même de leur arrivée. Outre CD. Muzungu, J.P. Finant, président provincial de la Province Orientale, E. Nzuzi, président des Jeunesses MNC/T- et J. Lumbala, ancien secrétaire d’État de Lumumba furent exécutés dans les mêmes circonstances (Cf. Willame J.C. 1990 : 462).
[56] Kokolo, le fidèle de Kasa-Vubu, reçut le commandement du camp militaire principal de la ville : le colonel Bobozo, oncle de Mobutu, fut placé à Thysville, là où éclata la mutinerie. Avec l’aide du général marocain Kettani, Mobutu forma un bataillon de parachutistes stationné aux alentours de sa résidence, qui demeura jusqu’en 1962 sous le commandement de l’un de ses grands amis, le Major Tshatshi
[57] Ce contingent intervint plus tard dans l’histoire du Congo lors de la « guerre de 80 jours » (1976) et de la » guerre du Shaba » (1977).
[58] Jusqu’en 1963, il existait 3 Groupements. Le quatrième fut créé après la sécession katangaise et couvrit le territoire du Sud-Katanga. Il fut confié à Louis Bobozo devenu entre-temps général.
[59] Deux tentatives de réconciliation furent le fait du Balubakat en 1961. Tshombe estima qu’il ne pouvait pas s’allier avec Sendwe parce que celui-ci était communiste (Gérard-Libois J., 1963 : 229).
[60] « Bakwanga, Lipopo, boyani bandeko tosangana. Tomelani nsamba, lungwila, diluvu ya bankoko. Bawuta balongwani mbangu na minoko na bino. Mokili ya biso ya Congo ezali ya koteka te. Kivu, Bukavu, Maniema, Bakwanga, Kikwit, boya bankoko botelema. Yele ! Boyani bokita bankoko na biso. »
[61] Cf. l’émission de la RTBF intitulée « Tshombe et la sécession du Katanga » (selon Jacques Le Bailly).
[62] Toyini bino bikolo mitema mabe Bokosi kosi mikonzi na biso mingi Ebele ya mbongo bobebisi mitema Biso na biso tokomi kobomana Ata bosali bokozwa mpe Congo te Mabe malamu nde tobongisi se biso Na Table Ronde nde toyokani malamu Congo ezali mpe na bana mayele Ata bosali bokozwa mpe Congo te Mabe malamu nde tobongisi se biso Na Table Ronde toyokani malamu Congo ezali mpe na bana mayele.
[63] J.P. Peemans (1987 : 87-102) a démontré qu’au regard de la crise économique zaïroise des années 70,
cette situation n’était pas si catastrophique. L’effondrement économique n’était pas si important que pendant les années qui devaient suivre.
[64] En juin 63, quand Adoula lui-même se décidera à libérer Gizenga, Kasa-Vubu se montrera insensible à cette tentative de réconciliation alors que la première législature s’achevait. Gizenga sera finalement libéré par Tshombe, le 15 juillet 1964.
[65] Le Manifeste du CNL fut signé par Gbenye (MNC/L), T. Mukwidi (PSA/G), A.G. Lubaya (UDA), E. Lonji (PNCP). Sur cette question, on prendra connaissance avec intérêt de l’analyse de Mbaya E.R (1987 : 185-210)
[66] Le CNL-Gbenye fut dirigé notamment par Gbenye (président), S. Kama de PSA (secrétaire général aux Relations extérieures), Senghie-Assumani (secrétaire général à l’Intérieur,) G. Soumialot (secrétaire général des Forces armées révolutionnaires), L. Kabila (secrétaire général aux Affaires sociales, Jeunesse et Sports). Le CNL-Bocheley regroupait dans son comité : A. Gizenga (président d’honneur), Pauline Lumumba (vice-présidente d’honneur), E.D. Bocheley (premier secrétaire général), P. Mulele (secrétaire général des forces révolutionnaires), A.G. Lubaya (secrétaire général aux Affaires intérieures).
[67] Cf. le protocole d’accord signé pour le CONAKAT par Moïse Tshombe et pour le CNL par S. Kama et Asumani Senghie (Congo 1964 : 136-137)
[68] Bengila qui l’avait précédé avait dû mettre au point quelques scénarios de cette lutte, avec l’aide de Mabika-Kalanda, ministre des Affaires étrangères, qui facilita du reste l’octroi d’un passeport à Mulele (Martens L. 1985 : 137, 139). Attaqué plus tard sur ce dernier point par Kamitatu, Mabika- Kalanda niera avoir été impliqué dans cette affaire (Congo 1964 : 9).
[69] Grâce aux travaux du CRISP et à la plume de B. Verhaegen, on dispose d’une documentation de grande valeur (t.l 1966, t.2 1969). Avec la parution duT.3, annoncée depuis quelques années, on disposera d’une somme de témoignages uniques sur cette action. Lors du 20e anniversaire des » rébellions congolaises », un débat fut organisé à l’université de Paris VII et à la Columbia University (USA), dont les textes sont également disponibles (Coquéry-Vidrovitch C. et Weiss H. 1987, 2t). La biographie de L. Martens (1985) complète les données de Verhaegen concernant l’histoire complète du maquis de Mulele.
[70] B. Verhaegen (1966 : 134) considéra dans ses travaux que seule l’action de Mulele pouvait être qualifiée de « révolution ». Le débat de Paris ne put trancher et préconisa l’usage du mot « rébellion- révolution », qui fut adopté.
[71] Après des années, quelques Congolais émettent des jugements nuancés à propos des rebelles. Monguya Mbenge D. (1977 : 59) estime pour sa part que « ces gens étaient des révolutionnaires au même titre que Mao, F. Castro, Che Guevara. « Il ajoute : « Les vrais rebelles sont ceux qui ont pris les armes contre cette force populaire »
[72] Une fois sur le terrain, Gbenye, dans le cadre des conflits du CNL, dut intervenir fermement pour atténuer l’influence de Mulele. Systématiquement il fit remplacer dans les invocations révolutionnaires le nom de Mulele par celui de Lumumba (Verhaegen G. 1969 : 739).
[73] Sitaolewa, sitaolewa
Mpaka Mulele ashinde
Sitaoke mayi, sitaoke mayi
Mpaka Mulele ashinde (Kasoro T. 1988 : 732).
[74] Le recueil d’instructions politiques et militaires a pu être publié grâce à des cahiers de partisans qui furent saisis : cf. Les Cahiers de Gamboma. Instructions politiques et militaires des Partisans congolais (1964-1965), Bruxelles, Dossier documentaire du CRISP, n° 3, novembre 1965.
[75] Il y en eut plusieurs – Mulembe fut le centre où Mulele lui-même assisté de ses adjoints formait les instructeurs des autres camps ; Kitombe était le siège d’une sous-direction : Mukoso, le siège de la sous-direction où était installé le camp des éjectés et des insoumis ; Laba, le petit séminaire, transformé en un centre de formation pour les jeunes ; Lukamba, village de Mulele près de la Mission Atene, servait de camp » central » ; Lukole, près de Kilembe, fit office de centre d’organisation et d’entraînement.
[76] L. Martens, l’hagiographe de Mulele, doute (1985 : 230-232) que le leader révolutionnaire ait pu se faire passer pour invulnérable, que les partisans aient pu le croire omniprésent et capable de se transformer, et qu’ils aient recouru à des recettes traditionnelles pour s immuniser contre les balles. En réalité, ces faits ne sont nullement invraisemblables ni extraordinaires. Ils se réfèrent simplement à des techniques de combat qui avaient cours dans l’univers traditionnel, et qui furent déjà utilisées lors de « batailles coloniales », notamment pour échapper au recrutement forcé. Le recours à ces techniques par Mulele s’inscrit dans cette tradition.
[77] G. Soumialot fut nommé, ministre de la Défense nationale ; Assumani Senghie, ministre de l’Intérieur ; S. Kama, ministre des Finances ; F. Sabiti, ministre des T.P. En raison de l’absence à Stanleyville d’Assumani, de S. Kama et des autres ministres non encore nommés, on eut recours à des ministres intérimaires. Ainsi le chef de gouvernement Gbenye remplaça les titulaires des Finances, des Affaires économiques, des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, de l’Education nationale, de la Santé publique, du Plan et Coordination. Le ministre de la Défense (Soumialot) assura cette fonction pour l’Intérieur, la Justice, l’Information, les Affaires sociales, Travail et Jeunesse et Sports ; le Ministre des T.P. (F. Sabiti) le fit pour la Fonction Publique, les Mines, Terres et Energie, les PTT, l’Agriculture, les Eaux et Forêts (Congo 1964 : 268-269).
[78] La République populaire du Congo disposa d’une radio et d’un journal, Le Martyr. Les nouvelles étaient diffusées dans toutes les langues nationales y compris celles des régions non encore libérées : lingala, kikongo, ciluba, swahili.
[79] Dans les camps des Simba, il y avait toujours des malaxa (jeunes filles non pubères) chargées de la préparation de leurs aliments. Elles portaient le titre de « cuisinières révolutionnaires ».
[80] Voir à ce propos la chanson en swahili évoquée plus haut, qui était en quelque sorte un aide- mémoire permettant de se rappeler les tabous.
[81] D’après l’émission de la RTBF consacrée à » Moïse Tshombe », le pasteur Carlson était un agent de la CIA, que la Company tenait à récupérer.
[82] A propos de cette opération, il y a lieu de consulter « Congo 1964 : 361-362 ; Schramme J. 1969 : 129-218».
[83] Che Guevara, en janvier 1966, se serait rendu clandestinement à Brazzaville, où il fut accueilli par Ange Diawara et de là, il aurait encore tenté de rejoindre le Kwilu (Martens L. 1985 : 293) mais en vain.
[84] L’attaque par les militaires se produisit dans la forêt de Ndungu. Le 8, Mulele fut poursuivi par les militaires aux environs de la rivière Kamtsha ; ils tuèrent plusieurs partisans. Mulele y échappa en passant toute la journée dans l’eau (Martens L. 1985 : 297).
[85] Nous verrons plus loin que le » Mouvement Populaire de la Révolution » (MPR) était au départ un projet élaboré par Pierre Mulele.
[86] C’est dans sa pirogue, sur le Kwilu, que Mulele apprendra par la radio la nouvelle du coup d’Etat à Brazzaville. Connaissant personnellement Massamba-Debat, il était sûr d’être bien accueilli. Mais Marien Ngouabi, était pour lui un inconnu. Sa femme a retenu sa réaction à la nouvelle du coup d’État. « Mwana wana, nayebi te, ye moto akosukisa ngai » (Cet enfant, je ne sais pas, peut-être signifie-t-il ma fin.) (Martens L. 1991 : 229).
[87] Au lieu du tribunal militaire, c’est un simple ordre qui aurait été donné au colonel Bumba, commandant de la brigade des parachutistes. La besogne aurait alors été confiée à un peloton composé de l’adjudant-chef Okelo, les premiers sergents Morisho et Kwazi Senga et le sergent Makambo. Ce sinistre scénario aurait-il été prémédité ? Rien ne l’affirme. Mais il existe des détails troublants, telle la phrase codée de Bomboko qui confirma à Mobutu l’arrivée de Mulele à Kinshasa « liboke yango ebeli ! » (la cuisine est terminée ! ou encore la table est prête !).
[88] Le projet le plus important, intitulé « Développement Progrès Populaire » (DPP) fit l’objet d’une thèse de doctorat en sociologie (Cf. Kuyunsa Bidum 1980).
[89] La thèse d’Etat de Kasoro Tumbwe (1988, 2 tomes) est consacrée aux innovations lexicales engendrées par les rébellions (en particulier les pp. 242-678).
[90] En 1978, un prophète venu du Kasaï, Martin Kasongo, prétendit être Pierre Mulele ressuscité. Aussitôt la répression s’organisa. Des milliers d’adeptes furent exécutés, de même que la mère du leader révolutionnaire (Martens L. 1985 : 331-332).
[91] On s’inspira ici des réflexions de C. Young (1967 : 319-348) et des expériences qui en découlèrent, inspirées du vécu.
[92] Les chercheurs de TIRES (Lovanium) établirent à l’époque une étude systématique de chacune de ces entités, sous la direction de B. Verhaegen. Cf. Les provinces du Congo. Structure et fonctionnement I. Kwilu – Luluabourg – Nord-Katanga par J.C. Willame (n° 1, mai 1964) ; II. Sud-Kasaï – Uele – Kongo Centrai par L. Monnier et J.C. Willame (n° 2, octobre 1964) ; III. Nord-Kiuu – Lac Léopold II par J.C. Willame (n° 2, octobre 1964) ; IV. Lomami – Kivu Central — par J.C. Willame (n° 4, décembre 1964) ; V. Moyen-Congo – Sankuru par J.C. Willame (n° 5, octobre 1965).
[93] Sur le processus d’intégration de l’ancienne province de Léopoldville, il existe une excellente monographie politique qui est la thèse de doctorat de Loka ne Kongo (1979)
[94] En 1963, on dénombrait une quinzaine de territoires contestés devant être soumis au référendum. Cette contestation affecta alors les six anciennes provinces. Dans Léopoldville, le secteur de Kimuula était revendiqué à la fois par le Kwango et le Kongo Central ; au Katanga, Kabalo-Kabongo et les Songye de Kongolo étaient à cheval entre les provinces de Lomami et du Nord-Katanga ; il en était de même de Banzgville (Equateur) à cheval entre les provinces de TUbangi et du Moyen-Congo ; du groupement Musumba (Kasaï) entre l’Unité kasaïenne et le Sankuru ; de Dibaya entre l’Unité kasaïenne et le Kasaï-Central ; de Mwene-Ditu, de Lusambo et du secteur de Tshishila respectivement entre le Kasaï Central, le Sud-Kasaï et le Nord-Katanga, entre le Lomami et le Sankuru, enfin entre le Kasaï Central et l’Unité Kasaïenne. Dans le Kivu, quatre zones faisaient problème : Goma. Rutshuru, Shabunda et Fizi. Les deux premiers étaient réclamés à la fois par le Kiwi Central et le Nord-Kivu ; les deux derniers par le Kivu Central et le Maniema. En Province Orientale. VVatsa et Faradji étaient également en ballottage entre l’Uele et Kibali-Ituri (Cf. Verhaegen. EC, n° 4, avril. 1963, pp. 1-25).
[95] Cette analyse émane du Président Kasa-Vubu lui-même ; il l’exposa lors de son discours inaugural à la Commission constitutionnelle de Luluabourg (Congo 1964 : 102).
[96] L’Ordonnance n° 278 du 27 novembre 1963 créa la Commission Constitutionnelle, celle n° 295 du 13 décembre 1963 en nomma le président, J. Ileo ; celle n° 315 du 30 décembre 1963 fixa le siège de la Commission à Luluabourg et la convoqua pour le vendredi 10 janvier à 18h30 ; une autre ordonnance du 30 décembre 1963 (n° 316) établit la nomination des membres de la Commission et fut complétée par l’ordonnance n° 28 du 14 février 1964 (Congo 196o : 417-444).
[97] Dès le mois d’août, le solitaire de Bula-Mbemba reprit une action d’opposition contre le gouvernement Tshombe en fondant le Palu (Parti Lumumbiste Unifié) et en se démarquant du PSA et du MNC/Kiwewa, complaisants à l’égard du pouvoir.
[98] Dès juillet, on vit arriver le Sud-Africain Hoare, le futur chef des mercenaires et son compatriote Purren, le chef de l’ancienne aviation katangaise. Parmi les Belges se trouvaient le prof. René Clemens, l’auteur de la Constitution katangaise et M. Frankiel, ancien recteur de l’université d’État du Katanga. En août, réapparut le colonel Vandewalle qui devint son conseiller militaire, J. Brassine et tant d’autres encore. L’ancien » lobby » katangais était à peu près au complet.
[99] Ce décrêt-loi du 19 août 64 complété d’un autre plaçant sous séquestre les biens des personnes visées, eut des conséquences incalculables sur le plan humain, tant il suscita de traumatismes lors de son application.
[100] Le souci d’une partie de l’Abako de se muer en parti national et de soutenir la création du C.D.A. aboutit à une scission interne. La tendance conservatrice, opposée à toute fusion avec un autre mouvement continua à être dirigée par V. Moanda, tandis que la tendance progressiste, qui prit aussi le nom de Mwinda Bakongo, fut dirigée par E. Zola. Cette dernière fut à l’origine du C.D.A.
[101] Six cas furent retenus. On dut recommencer les élections législatives nationales au Kivu Central et à Goma – Rutshuru tandis que dans la Cuvette Centrale, à Fizi, au Maniema et au Kwilu, on dut réorganiser les législatives tant provinciales que nationales. Cependant, ces révisions ne modifièrent pas le statut majoritaire de la CONACO.
[102] Une occasion se présenta alors de régler à l’amiable les conflits avec ce qui restait de l’opposition armée. Mais à cause de cette ouverture, le gouvernement Kimba fut taxé de communiste. A l’ONU le 7 novembre, pour la première fois, le Congo vota nul (au lieu du non habituel) à propos de l’entrée de la Chine maoïste dans l’organisation internationale. Cette nouvelle position fut interprétée par les USA comme une confirmation de cette percée communiste.
[103] Le fait que Kasa-Vubu continua à l’appeler « général » (au lieu de président) déplut à Mobutu, qui le plaça dans une sorte de résidence surveillée. Résigné, Kasa-Vubu écrivit alors une lettre, adressée cette fois au « président de la République » pour demander quelques faveurs, y compris celle d’être acheminé au Mayumbe. Cela lui fut accordé. Ndele, le gouverneur de la banque, s’arrangea pour verser une somme importante à son compte (Monguya Mbenge D. 1977 : 144-145)
[104] Tshatshi, le commandant du Camp Hardy à Mbanza-Ngungu, fut chargé de diriger cette escorte présidentielle. Parvenu à hauteur de Mbanza-Ngungu, l’officier se ressaisit et demanda à Kasa-Vubu de lui donner ordre de rebrousser chemin. Il proposa d’occuper à nouveau la ville avec ses unités, d’arrêter les officiers supérieurs rebelles et auteurs du coup d’Etat et de le réinstaller comme président de la République. Ce dernier refusa (Boissonnade E. 1990 : 213).
[105] Ourdi par des militaires (Bangala et Efomi), le complot avait pour but d’inciter quelques civils à dévoiler leurs ambitions, ce qui donnerait lieu à l’application d’un châtiment exemplaire (Kamitatu C. 1971 : 166-184). Les malheureux condamnés furent Evariste Kimba (ancien ministre des Affaires étrangères du Katanga, ancien formateur du dernier gouvernement), Alexandre Mahamba (ancien ministre des Affaires foncières dans les gouvernements Lumumba et Adoula). Jérôme Anany (ancien ministre de la Défense nationale du gouvernement Adoula). Emmanuel Bamba (ancien ministre des Finances du gouvernement Adoula, dirigeant de l’Eglise « le Salut de J.C. par le témoin Simon Kimbangu) (Congo 1966 : 431-444).
[106] Cette prise de position donna lieu à une dissidence des étudiants Bakongo de Lovanium qui, sous la direction de J. Umba-di-Lutete, créèrent l’ASEBALO (Association des Etudiants Bakongo de Lovanium).
[107] Kayukwa fut limogé à cause de ses accointances avec Tshombe revenu d’exil. Il fut remplacé par André Nkanza-Dolumingu, le secrétaire aux Affaires nationales.
[108] Pour plus d’information, consulter les études consacrées à ce conflit belgo-congolais, notamment les travaux édités par Ibrahim Baba Kake (1990). A cette occasion, le CNCD (Centre National de Coopération au Développement) avait établi le bilan de la coopération belgo-congolaise (1989) du point de vue belge. A noter qu’une étude de J.C. Willame (1985) précise le point de vue belge sur la question. L’opinion congolaise s’est largement exprimée lors de la séance parlementaire extraordinaire du Comité central consacrée à la question.
[109] Cette option constitue le propos de plusieurs conférences effectuées par l’auteur et la matière de deux ouvrages, publiés successivement en 1989 et 1990.
[110] En 1975, il aurait pris en otages en Tanzanie une Néerlandaise et trois spécialistes américains des grands singes et exigé, pour leur libération, une rançon et l’élargissement de 30 de ses guérilleros incarcérés à Dar-es-Salaam. En 1984, un Français, responsable d’une coopérative de pèche aurait été également enlevé à Kalemie et libéré sept mois plus tard au Burundi (Le Vif/L ‘Express, n° 2394, 23-29 mai 1977, p. 64).
[111] Pour passer inaperçu, il se faisait qualifier aussi de « Raul Kabila » ou encore se faisait appeler « Mutuiale » avec trois prénoms différents, suivant les circonstances, de Collins, Christopher ou Mzee (Jeune Afrique, n° 1899, 28 mai – 3 juin 1997, p. 51).
[112] Cf. Imani Lukale, « Le développement de la lutte de libération nationale au Congo », L’Eclair (organe de combat des étudiants congolais révolutionnaires), n° 1, juin 1965, p. 6.
[113] Le curieux « cousinage » entre rébellion mulétiste de l’Est et lutte révolutionnaire tutsi aurait été facilité par les brassages ethniques de la période coloniale. Ainsi, note J.C. Willame (1997 : 72- 73), le fondateur de l’UNAR, monsieur François Rukeba, aurait été lui-même un Congolais d’origine tetela qui résidait à Kigali.
[114] Peu après, certains groupes banyamulenge seront déplacés vers Moba et Kalemie au Nord-Ka- tanga. Là, ils allaient acquérir un « nouveau » nom ethnique – les « Banyavira » (les gens d’Uvira) – . Quant au nom de « Banyamulenge », inconnu de l’anthropologie coloniale, il se popularisa à partir de 1967 pour les différencier des « autres » Tutsi, les réfugiés des années 59-62.
[115] Cf. Reyntjens, F., « Rencontres burundaises : ‘Inyenzi’ du Rwanda et rebelles du Kivu » Weiss H. et Verhaegen, B. (éd.), « Les rébellions dans l’est du Zaïre », Les Cahiers du CEDAF, n° 7-8, 1986, pp. 130-131. A noter que la position particulière des Banyamulenge, opposés aux rebelles, allait accentuer leur marginalisation, car les autochtones Bembe, Fulero et Vira s’étaient rangés derrière les Simba. La rébellion allait dégénérer en une sorte de « guerre » entre Banyamulenge et autochtones Bembe, Vira et Fulero (Willame, J.C., 1997 : 80-82)
[116] Déjà le 17 novembre 1965, Tshombe échappait à un premier complot qui aurait été monté par la CIA. Il prévoyait un coup d’État orchestré par Tshombe qui échouerait, offrant par là un prétexte pour sa « neutralisation ».
[117] Parmi ceux-ci, il y a lieu de citer le colonel Mike Hoare, ancien chef des mercenaires rentré en Afrique du Sud et le Français Bob Denard.
[118] D’après le témoignage de J. Schramme lui-même (1969) qui complète les informations rassemblées par le CRISP (Congo 1967).
[119] Tshombe, dans l’un des messages, nomma le major Schramme « colonel ».



