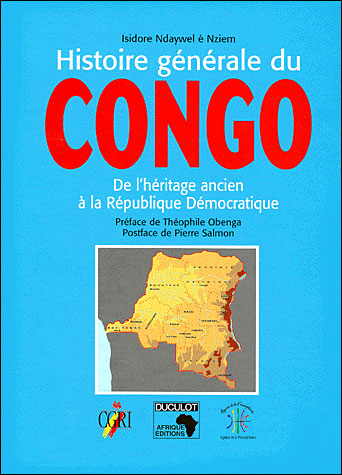
Partie 3 - Chapitre 2 : A la conquête de la savane du nord
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 2
A la conquête
de la savane du nord
L’aventure humaine dans les savanes septentrionales se résume habituellement à des « poussées » provenant du nord qui auraient présidé à la nouvelle occupation de l’espace. C’est du moins la manière dont on en rend compte habituellement. Le caractère récent de ce mouvement justifie le fait qu’il soit inscrit de façon si vivante dans les traditions historisantes de la région et qu’il ait éclipsé quelque peu l’histoire qui préexistait. Même si l’on n’en sait pas grand-chose, le fait est que le bassin de l’LJbangi et, plus globalement, le pays de l’entre-Congo-Uélé-Mbomu connaissait une occupation humaine fort ancienne faite de Pygmées dans la forêt et d’agriculteurs néolithiques dans la savane et à la lisière de la forêt. Cet espace fut ensuite dominé par des populations bantu. Il s’agit notamment des ancêtres des Ngombe. Doko et Binza dans sa partie occidentale, des peuples actuels de l’Itimbiri-Ngiri (Boa, Ndungu, Mba, etc.) et ceux de la région Balese-Komo (Ndaka-Mbo-Mbeke. Budu-Nyari, Komo, Bira) qui s’installèrent au centre et dans sa partie orientale (Vansina, J., 1966b : 27-28, 39-40, 93-94).
Dans ces régions particulièrement giboyeuses, on vivait de la pêche et de la chasse. Le plantain et l’igname constituaient les produits agricoles de base. La structure fondamentale de la parenté était la famille étendue patrilinéaire avec résidence patri- ou virilocale, répartie sur le plan spatial en lignages maximaux et minimaux. La structure politique se confondait avec la structure sociale, le principe de souveraineté étant le village qui était à la fois l’unité militaire, politique et religieuse. Il était dirigé par un conseil de chefs de famille qui concédait le principe de la préséance à l’un d’entre eux.
Les infiltrations soudanaises ont dû s’exercer d’abord de manière presque imperceptible, pendant des siècles, avant de s’exercer sous forme de poussées significatives. Sous cette première forme, ces infiltrations auraient-elles pénétré jusque dans des régions méridionales de la savane du sud ? La littérature ethnographique du début du siècle suggère une telle hypothèse (Swartenbroeck, J., 1948 : 351- 390 ; De Jonghe, E„ 1924 : 545-559).
D’ailleurs, sur le plan linguistique certains ont voulu caractériser cette influence en s’accrochant au concept de « semi-bantu ». On entendait par « semi-bantu », des locuteurs des langues à classes présentant en même temps certains aspects des langues soudanaises. On qualifiait par là essentiellement les habitants de la zone B (Yans – Ding, etc.). Même si la linguistique contemporaine a depuis lors discrédité ce terme à cause de l’ambiguïté qu’il présente, il demeure un témoignage de plus en faveur de cette hypothèse de l’expansion de la culture soudanaise.
Il est donc vraisemblable que l’essaimage des Soudanais vers le sud soit un phénomène ancien. Il s’est d’ailleurs maintenu jusqu’à des périodes fort récentes, les émigrés ne se déplaçant que par étapes successives, ne pensant à aller plus loin qu’à la suite d’une autre bousculade ou encore après épuisement des conditions d’approvisionnement.
L’époque de cette compression vers les terres méridionales n’est que trop connue. Ces poussées seraient parties du Soudan Central et Oriental, plus spécifiquement de la région de Darfur et du Kordofan, pays considéré dans l’histoire du continent comme étant le lieu de confluence raciale et ethnique à la suite de la chute de Nubie et de l’arrivée des Arabes (Ki-Zerbo, J., 1978 : 289). C’est là qu’il faut situer l’habitat primitif des ancêtres des populations du Nord-Ubangi et de l’Uélé. L’essor économique du Soudan à partir du XVIe siècle provoquant une explosion démographique, les guerres saintes décrétées par les Arabes contre les animistes méridionaux constituaient des motifs suffisants pour provoquer ces mouvements et indiquer la direction vers laquelle ils devaient s’effectuer. C’est en se référant à ces faits d’histoire du Soudan Central que l’on situe chronologiquement au XVIe siècle ces « grandes » migrations. Van der Kerken, en son temps, en avait déjà esquissé un schéma toujours d’actualité et qui peut se résumer comme suit : les « invasions » dans la partie septentrionale du pays ont affecté le bassin de l’Ubangi, de l’Uélé et l’espace de Kibari- Ituri. Les Soudanais auraient alors refoulé les Bantu qui occupaient ces terres. Les conquérants étaient les Banda, les Ngbaka, les Ngbandi, les Mangbetu et les Zande. Les refoulés étaient les Ngombe et certains éléments des populations actuelles de la Ngiri, qualifiés de « gens d’eau ». Ces invasions ont abouti à la constitution d’un certain nombre d’organisations centralisées, essentiellement celles des Ngbandi et des Zande. Une invasion plus récente apporta dans la région, plus spécifiquement dans le Kibari-Ituri, des populations nilotiques : Nyoro, Toro, Nkole en Uganda, Rwanda et Burundi ; au Congo, les A/ur et, dans une moindre mesure, les Hema, au départ pratiquant des langues nilotiques mais qui apprirent ensuite les langues soudanaises (lendu) et bantu (nande).
Dans cet élan de conquête faite de brassage de populations et d’une nouvelle distribution de l’espace, de nombreuses sociétés ethniques ont vu le jour et ont développé des formes d’organisation particulières. On s’en tiendra à deux cas suffisamment représentatifs de l’ensemble de la région : les Ngbandi d’une part, les Zande et les Mangbetu d’autre part.
Le concept du « Ngbandi » constitue actuellement le point de ralliement d’une série de populations de l’Ubangi réparties en trois groupes [1]. Le premier, le plus important, se situe dans le Nord-Ubangi, réparti dans les zones actuelles de Yakoma, de Mobaye-Mbongo et de Businga, dans le voisinage des Nzakara et Zande au nord, des Boa et Gboma au nord-est, des Bobenge et Mabinza à l’est, des Ngbaka et Mbanza à l’ouest, des Budja et Doko au sud. Ce sont des Ngbandi dits de Gbado- Lite mais leur localisation est en réalité moins étendue car il existe, au milieu de leur territoire, des essaims d’autres populations notamment les Mbanza, les Ngombe et les Gezo. Le deuxième groupe est constitué par les Ngbandi de Budjala localisés dans le Sud-Ubangi, dans l’entre-Saw, Ngiri et Mongala, dans le voisinage des Ngbaka, des Mbanza et des Ngombe. Un troisième groupe constitué par les Mbati, s’est installé dans l’actuelle zone de Libenge, entre l’Ubangi et la rivière Esobe. Mais dans l’acception courante, les deux derniers groupes sont ramenés à un seul qualifié de « Ngbandi de la Ngiri» par opposition aux «Ngbandi de l’Ubangi», ou encore de « Ngbandi de l’aval» (Ngbandi ya ngele) par opposition à ceux de l’amont (Ngbandi yo likolo).
Comment expliquer cet habitat disparate ? Comment comprendre cette dispersion ? Il apparaît nécessaire de rechercher d’abord l’origine de cette identité ethnique qui englobe des populations apparemment éloignées. L’on constatera que le phénomène de dispersion est en tout cas conforme à l’itinéraire vécu (carte 9). Le terme même de « Ngbandi », qui a connu une étrange carrière, justifie déjà une bonne part de cette extension qui paraît toujours possible. En effet, ce vocable apparut à un moment précis de l’histoire de ce peuple, au moment où de nombreux clans d’origine soudanaise atteignaient la région de Mbari-Shinko. Un personnage. Kola Ngbandi, un fils du pays, se distingua par sa bravoure dans les combats qui opposèrent son clan aux autochtones ban tu et d’autres concurrents de même origine. Les siens eurent tôt fait de se réclamer de ce nom ; les vaincus également s en emparèrent pour s’identifier aux vainqueurs. D’autres groupements soudanais le revendiquèrent pour des raisons de prestige. L’identité Ngbandi était née.
Mais comment s’appelait-on auparavant ? Les traditions n’ont pas souvenance d’un terme commun qui ait affecté l’ensemble des communautés. Cependant il existait une pluralité de noms qui ont d’ailleurs subsisté : Mbati, Yakoma, Sango. L’appellation de « Ngbandi » eut donc beaucoup de succès d’abord pour une question de prestige, non seulement auprès de sa descendance (Tara Ngbandi), mais aussi auprès de la descendance des vaincus. C’était une manière comme une autre de se ranger du côté des conquérants. Mais le mouvement prit de l’ampleur. Plusieurs autres groupements, tant soudanais (les Nzakara, les Mbanza, etc.) que bantu, (Ngombe, Mabinza) adoptèrent cette langue. Même certaines aristocraties ngbaka, considérant le ngbandi comme la « langue des chefs », se mirent, pour des raisons de prestige, à l’adopter et à l’utiliser. L’identité ethnique s’acquérant par la langue, ces différents groupes furent et demeurent quelque peu intégrés dans le grand ensemble Ngbandi. L’activité commerciale se chargea elle aussi d’étendre cette culture pratiquement dans tout le Haut-Ubangi où l’on se mit à utiliser, comme langue commerciale, une sorte de ngbandi simplifié qu’on appela le Sango. C’est ce terme qui sera retenu par les Français pour désigner les Ngbandi de l’Ubangi-Chari (l’actuelle République Centrafricaine). Voilà une première extension de la communauté ngbandi qui justifie aussi la superposition de deux terminologies ethniques, les termes préexistants étant désormais coiffés d’une superstructure ethnonymique (Ngbandi et Sango).
Dans la littérature des voyageurs européens du XIXe siècle, la première mention du « peuple mongbandi» date de novembre 1886. Mais à l’époque le terme était encore en concurrence avec d’autres appellations. Le terme « Sango » passait même pour être favori puisque l’on considérait volontiers les Ngbandi comme étant un sous-groupe des Sango (Thonner, F., 1910 : 92). S’il y a eu renversement de situation, du moins au Congo, la colonisation y est pour quelque chose. D’abord en 1891, pour une meilleure exploitation de la région, on fonda le poste de Mongbandi, lequel, à partir de 1894, servit de point de départ pour une route de caravane reliant la Mongala à l’Ubangi. Cette route joua un rôle déterminant dans la connaissance des Ngbandi et le renforcement de leur identité. On nota des similitudes culturelles entre différents groupes et l’on décréta même l’extension du terme « Ngbandi » à ceux qui partageaient cette culture sans le savoir. Basile Tanghe, le grand missionnaire de la région, fournit à ce sujet des témoignages fort éloquents. En 1911, venant de Banzyville (actuellement Zongo) en pays Mobaye-Mbongo où il s’était installé, il rencontra un autre missionnaire venant de la mission de Mbaya, sur la Melo. Lorsque Tanghe s’adressa à son boy, l’autre missionnaire se rendit compte qu’ils connaissaient la même langue « indigène », à la différence que son confrère appelait cette langue « Ngbandi » alors que lui-même la connaissait sous le nom de « Sango ». En une autre circonstance, il se rendit compte que les Mbongo, voisins des Gboma « parlaient la même langue » que les Ngunda de Mobaye et de Budjala. « Il est tout naturel », conclut-il, que ces langues soient simultanément reconnues comme la langue des Mongwandi. De là, le nom Mongwandi fut donné à tous ces parlers, même si les autres autochtones les qualifiaient différemment (Sango, Yakoma, Mbati, etc.).
La colonisation aida la langue ngbandi à assurer son extension d’une manière plus évidente encore. Cette langue et sa version simplifiée qu’est le Sango, largement diffusées pour des raisons commerciales, furent retenues comme les véhicules de l’enseignement et de l’évangélisation. On doit souligner ici le rôle particulièrement dynamique joué par Basile Tanghe, d’abord en tant que missionnaire, ensuite comme vicaire apostolique ; ses nombreuses études contribuèrent à faire connaître la culture ngbandi et à renforcer son identité officielle [2]. Sur cette lancée, les enquêtes ethnographiques de l’administration coloniale entérinèrent la nécessité de faire prévaloir l’identité commune des Ngbandi, en dépit de nombreuses différences manifestes. A Molegbe, le journal Fanalo fut édité en langue ngbandi (Ngbakpwa, M., 1977 : 41). Un dictionnaire de cette langue fut également établi (Lekens, P.E., 1952). L’unité ancienne, réelle ou présumée, des Ngbandi fut ainsi rétablie. Désormais c’est plutôt une distinction de type colonial qui prévaudra entre ceux du Congo belge qualifiés de « Ngbandi » et ceux de l’Ubangi-Chari, colonie française, appelés « Sango».
1.2 L’évolution et l’organisation sociale
Mais d’où proviennent les ancêtres des Ngbandi actuels ? Les témoignages sur la question vont tous dans le même sens. Leur habitat primitif se situait dans le Soudan Central. Ils faisaient partie des populations animistes qui occupaient les régions de Darfur et de Kordofan, point d’intersection de plusieurs routes commerciales allant de l’est à l’ouest, du nord au sud. Les maîtres de ces « routes » que sont les Arabes ne manquèrent pas de décréter une islamisation de la région. Les animistes étaient contraints d’émigrer, surtout que, en tant « qu’infidèles », ils constituaient une proie tout indiquée pour des razzias et des raids esclavagistes.
Dans cette logique, les peuplades soudanaises passaient pour être des réserves officielles d’esclaves. Les États musulmans exerçaient le droit d’y « chasser », par privilège (de Dampierre, E., 1967 : 215-216). Cette situation allait provoquer la ruée soudanaise et nilotique vers les terres méridionales. C’est ainsi que les ancêtres Ngbandi se retrouvèrent dans le pays de l’entre-Mbari-Shinko, deux affluents du Mbomu. Les colonnes soudanaises s’y mélangèrent sur des bases nouvelles. C’est là qu’apparurent les sociétés soudanaises bantouïsées du Congo, notamment l’ethnie ngbandi qui commença à acquérir l’identité qu’on lui reconnaît jusqu’à ce jour.
A cause des pressions démographiques, le territoire ne pouvait contenir tout le monde ; les pressions d’origine septentrionale n’avaient pas cessé, suscitant tensions et dissensions internes. Les traditions orales ont un langage particulier pour exprimer pareille situation. On parle dans ce cas-là de différends entre frères obligeant les « cadets » à quitter les « aînés». Les Ngbandi avaient pour ancêtres Bibino et Bandumbe, tous deux enfants de Mondolongbo. Bibino eut pour descendance Bangalapumba, Bandia et Gorogbe. Ngaro-ngu (Ngalongu) partit à la rivière avec ses cadets (Gboma, Dunga, Bandia, Mbambu, Tongu. Gorongbo, Lau et Kulegenge) dans l’intention de leur tendre un piège et de venger son fils mort en compagnie des enfants de ses cadets. Par l’indiscrétion de l’esclave chargé de porter la convocation
aux cadets, ceux-ci, loin de répondre à l’appel, se mirent d’accord pour fuir l’aîné en quittant la région de Mbari-Shinko [3]. Le prétexte officiel était ainsi trouvé pour justifier la seconde étape de migration qui les mena de l’hinterland de Mbari-Shinko aux rives de l’Ubangi. Le dernier lieu de rassemblement fut la plaine de « Kangbi da » (aux environs du village de Tongu). C’est à partir de là que s’effectua la dispersion finale qui conduisit chaque groupe dans le terroir qu’il occupe actuellement.
Préoccupons-nous d’abord de la localisation dans le temps de ce mouvement de migration. La datation convenue pour ce mouvement est celle du XVIe siècle. Mais rien n’indique que les faits ne sont pas antérieurs à cette date. Considérons que cela se passa au XVIe siècle au plus tard. Déjà, le séjour de Mbari-Shinko avait été évalué à 200 ans. Ce fut l’étape d’acculturation, où la langue d’origine soudanaise se mit à se « bantouïser », ce qui rendit possible une nouvelle formation sociale (Tanghe, B., 1938 : 361). Ce délai est vraisemblable. L’expansion de Mbari-Shinko à l’Ubangi, dans cette hypothèse, se serait donc étendue jusqu’au XVIIIe siècle au plus tard.
Cette expansion fut lente et laborieuse dans la mesure où elle se heurtait à l’opposition des populations méridionales. Le fait est plus que confirmé tant par les traditions de ceux qui ont été repoussés que par les traditions de ceux qui passaient pour être des conquérants. Les Ngombe, avions-nous dit, se souviennent d’avoir d’abord été chassés de l’outre-Ubangi, avant de l’être à nouveau de la région de Yakoma.
Les Ngbandi évoquent leur installation par vagues et par scissions successives. Les ancêtres des Ngbandi de la Ngiri (ceux de Budjala et de Libenge), descendants de Nyi et de Ngwe, constituent une vague plus ancienne que celle des descendants de Ngaro-Ngu (les Gbama, les Gbule, les Kulegenge), les Ngbandi de l’Ubangi. Au sein de ces grands embranchements, il y eut des segmentations entraînant par le fait même des décalages dans le temps. Les descendants de Ngwe, fils de Ngi, élirent d’abord domicile dans la région du confluent de Mbomu et de l’Uélé puis sur les rives de la rivière Modumbe, affluent de l’Ubangi. De là, une partie se dirigea vers le sud-ouest, vers le nord de Gemena ; une autre, accompagnée des Lite, s’engagea vers le sud pour occuper le pays de Musa et de Budjala, aux sources de la Ngiri et de la Saw ; une autre progressa vers le sud-est pour se retrouver aujourd’hui près d’Abumombazi et de Businga (Ngbakpwa, M., 1978 : 18-19).
De la seconde vague, dirigée par Gboma, qui s’établit dans la plaine de Kangbi-da il y eut encore plusieurs groupements plus restreints. On se situe déjà à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle au plus tard. Les Kulegenge furent les premiers à abandonner le groupe. Ils s’établirent près des Ngi, dont ils se séparèrent ensuite au niveau de la rivière Modumbe. Déjà on avait changé leur nom. L’entourage les appelait Bwato, du nom d’un adversaire redoutable qu’ils étaient parvenus à vaincre dans cette opération de confiscation du territoire bantu. Quelques populations bantu, notamment les Ngombe, se situèrent dans cette mouvance depuis Mbomu et en direction des terres méridionales. Quant aux Ndanu, qui se nommaient déjà Gboze depuis l’étape de Mbomu parce que leur ancêtre avait réussi l’exploit de capturer un léopard au moyen d’un simple filet (Gbo = arrêter, zê = léopard), ils finirent par s’installer dans la région d’Abumombazi (Ngbakpwa, M., 1978 : 15-21 ; 1980 : 19-30). Retenons que la réorganisation de l’espace suscita plusieurs déplacements, les Soudanais déjà fort bantouïsés repoussant les bantu, eux-mêmes bousculés par des vagues plus récentes, en provenance du Nord. Le XVIIIe et le XIXe siècle s’écoulèrent ainsi.
Les premiers Ngbandi qui occupèrent le pays de l’Ubangi sont incontestablement les Ngwe, les Kutu et les Daba au point même que certaines traditions les désignent comme originaires du pays, les propriétaires terriens, tant leur symbiose avec les Bantu est profonde. Lorsque les Mbati firent irruption dans la région, ils refoulèrent et absorbèrent non seulement des bantu mais aussi des Soudanais de cette première vague. Il en fut de même de l’invasion des Kulegenge qui reconnaissent, eux aussi, avoir trouvé sur place des Ngwe. L’écart entre les différentes vagues était tel qu’il n’existait plus de communauté de culture entre populations soudanaises. Les traditions Kulegenge ont retenu le fait que les Ngwe qu’ils rencontrèrent, constituaient une population « barbare » qu’ils ont dû « civiliser-. Leur habillement était d’une extrême modestie. Il était fait d’une calebasse attachée autour des reins, qui cachait tout juste le sexe et offrait les fesses en spectacle : il a fallu leur apprendre l’usage du pagne fait d’écorce d’arbre (nguba). De plus, ils avaient perdu toute notion de hiérarchie interne, puisque les Kulegenge eurent à leur réapprendre que, lors du repas, l’aîné s’arrête de manger, pour laisser aux cadets et aux esclaves le soin de vider le plat (Ngbakpwa, M., 1980 : 35).
En fait, c’est depuis leur origine la plus lointaine à Mbari-Shinko que les Ngbandi avaient un semblant de connaissance en politique. Plusieurs faits l’attestent. Les différents groupements humains, on l’a remarqué, sont désignés par rapport à un ancêtre précis, fondateur du groupe : Gbule, Gboma. Kulegenge. Nyi. etc. La mort de Ngaro-Ngu a été causée par le principe qui confère la préséance à l’aîné, en matière de bain à la rivière. De même, l’éloignement de Dunga par rapport aux descendants de Bangalapumba conduits par Gboma, est dû à une contestation politique. Au lieu de respecter le droit d’aînesse de Gboma. il s’autorisa à se baigner à la rivière avant lui. Ceci lui valut une malédiction selon laquelle jamais sa progéniture ne serait nombreuse (Ngbakpwa, M., 1980 : 26-27). Un autre détail et non des moindres peut être tiré de la conquête des Kulegenge auprès des Ngwe qu’ils rejoignirent. Comme on l’a déjà dit, les Kulegenge devaient leur réapprendre les « bonnes manières » à table et, par là, le sens du prestige du chef (gbia) et l’ordre politique dans son ensemble. Porteurs d’un système politique, les Ngbandi le mirent en application dans leur conquête des Zande sur qui une dynastie d’origine Ngbandi régna pendant toute une période. D’ailleurs les Bandipa qui se sont organisés en royaume ne sont que des Ngbandi zandeïsés.
Malgré tout, il n’y a pas eu de « royaume » Ngbandi. Ceci confirme qu’un système politique donné ne s’étend pas du seul fait de sa consistance interne ; il ne connaît un certain déploiement que si celui-ci est ressenti comme nécessaire et suivant les contingences. Les Ngbandi ont plutôt fait prévaloir un regroupement par chefferies. Les dignitaires responsables de chefferies constituaient l’instance suprême. On les qualifiait de « grands chefs » (Kota gbia), par opposition aux chefs de village (Gbia Kodore) ou plus pompeusement les « Chefs porteurs des insignes d’animaux à peau multicolore» (Gbia ti sa nzere). Dans le contexte de conquête et de pressions constantes caractérisant ces longs siècles de redistribution de l’espace de l’Ubangi, les rapports entre sociétés politiques étaient souvent de nature guerrière. On comprend que la guerre relevait de l’autorité politique suprême. Chaque chef disposait de guerriers (lombe) recrutés dans les villages dépendant de son autorité. Ces spécialistes de la guerre utilisaient aussi bien des armes offensives telle la lance (ngbuta) que des armes défensives (vara = bouclier). On pratiquait plusieurs formes de guerres y compris la guérilla (gine). Celle-ci consistait à semer l’insécurité en tuant n’importe quel membre du groupe ennemi qu’on rencontrait et dans n’importe quelle circonstance. Une autre preuve des rapports d’affrontement fréquents entre différents groupes en mal d’espace vital se manifestait par la pratique de pactes de sang. Le pacte de sang n’est en fait qu’une stratégie pour faire l’économie de guerres ou encore pour se prémunir contre certaines attaques afin d’en mieux mener d’autres. Le pacte de sang (mbele) pouvait se réaliser entre individus mais aussi et plus couramment entre deux chefferies ou deux villages représentés par leurs chefs respectifs.
Le pouvoir du gbia, comme dans les autres sociétés du Congo ancien, avait une profondeur qui dépassait le cadre strictement politique. Le chef était à la fois juge et grand prêtre, à même d’assurer la protection du peuple représenté par la confédération des villages qui se sentaient dans l’obligation de lui apporter un tribut. Sur le plan politique, son pouvoir était incontestablement d’essence royale, si l’on n’en juge que par le prestige qu’il possédait. Son entourage constituait toute une cour composée d’une pluralité de dignitaires dont certains résidaient avec lui à la capitale, tandis que d’autres avaient la gestion des autres villages. De tous, il recevait des tributs de toutes sortes. Le tribut « royal » était composé des produits suivants : la trompe d’éléphant, la cuisse de sanglier, le grand pangolin, le léopard et le zèbre qui passaient pour être la « viande des esprits» (sa toro). Plusieurs insignes particularisaient ce pouvoir, notamment le grand couteau biface (zama zabe), la lance à multiples pointes (zaga), la canne de voyage (ngbanzo), le collier à dents de léopard, la ceinture à peau de zèbre, deux bracelets en ivoire et un pagne spécial d’écorce de l’arbre nguba. Une autre caractéristique résidait dans l’existence d’une case des esprits (tor) et d’un échafaudage où l’on exposait le léopard apporté au chef (kengo).
L’architecture même de la capitale portait en elle-même les marques de cette « royauté aux allures guerrières ». Le quartier royal appelé Ngbanga, comme chez les Zandé et les Nzakara, ou encore Yangbo ou Gbongo, constituait à lui seul toute une agglomération faite de plusieurs types de cases, les rondes (Ngboto) comme les rectangulaires (danga). Mais un tel palais avait ses subdivisions internes. La première partie, la plus vaste, était une cour publique où le chef se tenait pour gouverner et gérer son territoire. C’était la partie publique du palais (ngbanga). Elle était séparée par une rangée d’arbres de la cour privée où le chef traitait des affaires importantes et recevait ses collaborateurs les plus proches (borondo). Il y avait enfin une troisième partie réservée à l’intimité du chef (ngbwadimo) ; c’était son harem. L’accès à cette partie de la résidence était strictement défendu, surtout aux hommes adultes.
Les épouses étaient hiérarchisées entre elles. La première femme (kozo wali) jouissait d’une préséance certaine en tant que première dame de la cour. Mais personne ne la confondait avec les épouses préférées (mbali) ; c’est parmi ces dernières qu’on choisissait celles qui devaient être enterrées avec le chef. Quant aux autres épouses, elles passaient pour être en quelque sorte des travailleuses que chaque village offrait au grand chef. Cette masse féminine était sous les ordres de la première femme.
L’étape finale de l’histoire particulière de ce peuple, au XIXe siècle, aura été marquée une fois de plus par un climat de luttes et de guerres. Non contents de guerroyer les uns contre les autres pour des motifs divers – problèmes de terre, rapt de femmes, etc. – les Ngbandi eurent à subir des agressions externes. La première fut le fait des Mahdistes qui se firent appeler dans la région Tamba-Tamba ou encore Nsekele. Les disciples du soudanais Mohammed-Ahmed qui s’était proclamé Mahdi, le prophète régénérateur de l’Islam, avaient conduit sa révolte du pays du Kordofan jusque dans la partie septentrionale du Congo, non sans avoir fait la guerre aux Anglais et aux Egyptiens et s’être emparés pour un temps de Khartoum en 1885.
Au Congo septentrional, les Mahdistes se livraient volontiers à la traite et au commerce des esclaves, ce qui était conforme à l’idéal qui déclarait légitimes et libres la chasse et le commerce d’esclaves (Wauters, A. J., 1890 : 37). Disons que les Tamba-Tamba étaient des marchands d’esclaves qui opéraient sous l’étiquette religieuse des Mahdistes. Ils envahirent le pays Ngbandi par la haute Ebola pour gagner la région d’Abumombazi. Ils attaquèrent ensuite les Nzobo et furent repoussés par ce vaillant peuple déjà aguerri à la lutte.
A la même époque, un courtier boa, Gbatala, travaillant pour le compte des Blancs d’Ibembo, s’aventura jusqu’à la région voisine d’Abumombazi en quête d’ivoire. Il n’hésita pas à utiliser la manière forte pour s’emparer des biens de la population. La riposte ne se fit pas attendre. Un combat s’engagea avec ses partisans. Il fut battu et quelques fusils à piston furent arrachés.
Dans le même sens, il faut signaler l’incursion bien connue de Nzengu. un autre traitant boa qui s’engagea à aller collecter de l’ivoire en pays ngbandi avec une escorte de partisans tous armés de fusils. Empruntant le même itinéraire que les Tamba-Tamba, il eut plus de succès, parce que ses compagnons étaient armés. Même les Gboze furent battus. Le langage populaire en a gardé un souvenir curieusement vivace jusqu’aujourd’hui : aller en guerre de Nzengo se dit de quelqu’un qui part sans grande chance de revenir indemne ou de revenir avant longtemps. C’est chez les Dondo de Kota-Koli que la progression de Nzengu fut freinée par des tirs de flèches enflammées. Obligé de battre en retraite et ne pouvant trouver une issue du côté de Yakoma, le conquérant dut s’installer sur un plateau de la rive gauche d’Ebola. Il s’y révéla un vrai tyran, faisant étalage d’une cruauté exceptionnelle à l’égard de la population (Tanghe, B., 1939 : 63-64).
Tous les sujets qu’il condamnait à mort étaient assommés à coups de bâton pour économiser la poudre. C’est ainsi que sa résidence fut qualifiée de « Boma-Mbasu» (tuer avec des bâtons) et que ses sujets furent appelés A-Boma-Mbasu (ceux qui assomment). Ce nom est resté, stylisé par les Blancs (Abumombazi, en abrégé Abuzi), pour qualifier le poste colonial qui fut fondé dans cette région, et qui est actuellement le chef-lieu de collectivité (Ngbakpwa, M., 1980 : 94-97).
A partir de sa capitale, ce trafiquant entreprit de faire construire tout un empire commercial. Pour éviter qu’il s’implante dans la région, l’administration de l’Etat Indépendant du Congo installée déjà à Nouvel-Anvers (Mankanza), n’était que trop consciente qu’il fallait se débarrasser de ce personnage. On préféra ne pas recourir aux armes, du moins pas tout de suite. On tenta d’abord de le capturer par ruse et cela réussit. Un agent commercial européen fut chargé de faire croire à Nzengo que l’État Indépendant du Congo était son allié et que l’administration voulait lui remettre des fusils. Pour ce faire, il construisit son camp en face de celui de Nzengo et se lia d’amitié avec lui. Le trafiquant, de bonne foi, accepta de l’accompagner jusqu’à Mankanza avec toute une suite pour recevoir ce lot de fusils. Une fois sur place, il fut arrêté et condamné à l’exil à Borna.
L’occupation de la région se fit d’autant plus aisément que le nouvel envahisseur se vantait d’avoir libéré le pays de la tyrannie de Nzengo. N’empêche qu’il eut lui aussi à user des armes pour se faire admettre comme nouveau maître du pays.
Le pays de l’entre-Mbomu-Itimbiri, baigné par l’Uélé, abrite depuis des siècles une mosaïque d’ethnies. Ce brassage de peuples, de langues et de cultures matérielles est dominé par deux groupes : les Zande et les Mangbetu (Hutereau, A., 1922 ; Denis, P., 1961 ; De Calonne-Beaufaict, A., 1921). Qu’il y ait une similitude entre les deux groupes, c’est une évidence, mais elle est davantage le résultat d’une diffusion que d’une origine commune. D’ailleurs la similitude la plus manifeste est liée au caractère étrangement extensif de l’un et l’autre vocables qui couvrent chacun une pluralité de références ethniques. Les Zande à eux seuls se subdivisent en deux groupes, les Vungura à l’Est qui sont les plus nombreux, et les Bandiga à l’Ouest. Mais il existe, en plus, des groupes zandéïsés au nombre desquels figurent les Barambo, les Madi, les Bangba, les Kare, les Sere-Baka, les Mundu et les Bari. Le concept de « mangbetu » draine lui aussi une série de réalités ethniques affiliées : il désigne d’abord les Mangbetu fondateurs, les Mabili, les Mando, les Mabisango et les Meje ; il recouvre également les « mangbetuïsés» : Mamuu et Mangutu du Haut- Bomokandi, Makere, Mayogo, Popi et Mangbelo (Keim, C.A 1979 : 28-35).
Les deux types de cultures ont bâti leur différence à partir de 1’ écologie. Les Zande sont des peuples de savane consommant volontiers des céréales traditionnelles (millet, sorgho, éleusine) et modernes (maïs) combinées avec des racines (taro, igname). Les Mangbetu sont des forestiers liés essentiellement aux tubercules et au plantain, et qui cultivent le palmier dont l’huile faisait l’objet d’échanges avec d’autres groupes (Vansina, J., 1966b : 39-41 ; Hubbard, M., 1975 : 7-11). Pourtant, sur le plan social, ils étaient organisés pratiquement de la même manière. On notait partout l’existence des clans patrilinéaires, en principe exogames, avec des exceptions pour les clans royaux, notamment celui des Vungura chez les Zande. Mais pour ce qui concerne la pratique politique, en dehors des clans royaux, les autres avaient peu de consistance, disséminés qu’ils étaient dans les différentes entités ethniques (carte 10).
La polygynie était générale, elle était favorisée par l’écart d’âge existant entre époux, les filles se mariant dès la puberté tandis que les garçons se mariaient rarement avant 30 ans. Les unions entre frères et sœurs, comme on l’a noté, n’étaient pas inconnues au sein des familles royales, ce qui contribuait à créer de véritables castes surtout chez les Vungura.
Sur le plan politique, ces peuples étaient organisés en seigneuries dirigées chacune par un roi. Ce dernier le devenait en évinçant tous ses frères qui s’étaient posés en rivaux, sauf s’il était un conquérant d’origine externe qui parvenait à s’imposer comme successeur. L’histoire zandé et mangbetu, on le voit, est essentiellement militaire, fondée sur des conquêtes.
Le processus de développement des royaumes Zande s’était établi ainsi : expansion sous la direction d’un grand chef de clan, assimilation des peuplades vaincues, éclatement du royaume et anarchie à la mort du chef, âpre lutte entre les candidats à la succession (Salmon, P., 1988 : 116). On comprend que l’histoire zande et même mangbetu soit essentiellement militaire car les candidats malheureux allaient à l’aventure et entreprenaient de nouvelles conquêtes pour aboutir à la constitution d’autres royaumes au sein desquels les populations locales étaient « zandeïsées». Bon pour la conquête, ce type d’organisation était visiblement incapable de promouvoir la construction d’un empire centralisé et durable (Salmon. P., 1988 : 116- 117).
Puisque tout conquérant devenait roi, c’est que la royauté n’était pas perçue comme étant d’essence supranaturelle, bien que les usages de la cour l’aient fait passer pour telle. Le roi disposait de son feu. il mangeait en secret, se faisait acclamer quand il toussait ou éternuait. L’aristocratie régnante Vungura et Bandiya chez les Zande orientaux et occidentaux (Mabiti chez les Mangbetu) avait ses représentants en province et même au-delà ; les gestionnaires de ces subdivisions administratives se recrutaient forcément parmi les proches parents du roi, spécialement chez les Mangbetu, ou encore parmi les parents maternels du roi (Ando).
Que faut-il retenir de l’histoire de leur peuplement ? Les premières investigations menées dans ce domaine ont mis l’accent sur les nombreuses vagues de « poussées » du nord, de l’est à l’ouest et même du sud vers le nord (de Calonne-Beaufaict, A., 1921 : 7-16, 27-134), En cela, ces traditions étaient en harmonie avec l’ensemble de celles des peuples septentrionaux. Mais les nuances qu’on a toujours apportées à propos d’une occupation plus ancienne de ces territoires se justifient pleinement ici. Plusieurs traditions affirment que ces peuples étaient sur place depuis plusieurs siècles. Cette perspective vient renforcer la conviction selon laquelle lesdits conquérants du nord s’étaient infiltrés en Afrique Centrale depuis fort longtemps jusqu’à atteindre les régions méridionales, et que cette insertion fut plus discrète, moins perceptible qu’on l’a toujours pensé.
En tout cas, les « maîtres du pays » les plus anciens demeurent les Pygmées, particulièrement établis dans ce terroir. Les Zande ont occupé le pays plus tardivement, tout comme les Mangbetu ; les structures politiques centralisées ont été façonnées ou adaptées progressivement. L’apparition des structures centralisées est sans doute antérieure à l’occupation du territoire. Pour avancer une première approximation chronologique, rappelons que la tradition orale faisait remonter ces faits à 10 ou 12 générations en arrière, soit à quelque trois cents ans si l’on considère qu’une génération fait environ 27 ans (Denis, P., 1961 : 132 ; Hubbard, M., 1975 :3). Ceci nous situerait donc au XVIIe siècle. On constatera que la cohérence est plus ou moins parfaite avec les éléments ngbandi dont l’installation en terre congolaise avait été située vers cette période des XVI-XVIIe siècles.
Mais les études linguistiques récentes nous renvoient à un passé plus reculé encore. Elles estiment que les langues est-centrales soudanaises (parmi lesquelles le zandé et le mangbetu) sont utilisées dans le nord-est du Congo depuis quelques milliers d’années (Hubbard, M., 1975 : 9). On serait en présence d’une longue période qui a caractérisé la période de brassage entre Pygmées, Bantu et Soudanais ; les récits de migrations désigneraient davantage les étapes d’intégration ou de « colonisation » qui se sont déroulées sur place sans avoir nécessité de grands déploiements de groupes humains.
2.2 L’évolution et l’organisation sociale
L’histoire particulière des Zande et des Mangbetu peut se diviser en deux étapes : la première est celle des origines, la seconde étape est le moment de l’affirmation des institutions sociales et politiques, en attendant de voir arriver de grandes transformations avec les débuts de la modernité.
Bien que fort complexe, l’origine Zande se ramène aux traditions d’origine des multiples groupes d’origine soudanaise dont l’expansion prit la direction méridionale après avoir quitté les rives d’une « grande eau ». Mais ces groupes prétendent tous être issus d’une même origine. Les raisons d’essaimage étaient nombreuses ; parfois elles étaient extérieures au groupe. Il suffisait, à la traversée d’une rivière, que le pont de liane cède pour que ceux qui étaient demeurés sur la rive d’origine se trouvent dans une situation de séparation par rapport à ceux qui avaient déjà traversé. Le motif du déplacement vers le sud, tel que dénoncé par les traditions, demeure la fuite à l’approche des « hommes pâles » semblables aux mânes (Atolo) et qu’on qualifiait d’« Azudia». Le fait que ce terme fut utilisé plus tard pour qualifier les troupes égyptiennes (De Calonne-Beaufaict, A., 1921 : 31) permet de supposer que les premiers envahisseurs furent des personnages semblables (nubiens ou égyptiens). Les Zande ont gardé le souvenir de plusieurs ancêtres – Bwendi, Luzia, Mabenge, Tomba, Shinko, Gura – appartenant tous au même arbre généalogique mais à des niveaux variables suivant les traditions consultées.
L’ancêtre le plus unanimement reconnu est Gura. Peu importe qu’il soit l’un des fils de Bwendi et qu’il ait eu lui-même plusieurs descendants au nombre desquels il y a eu Ganzi, Goro, Tomba et surtout Mabenge : le fait est qu’il a eu droit à une immortalité plus grande par rapport aux autres « fondateurs » de groupe. II est en effet à la base de la dynastie prestigieuse des Vungura (Avu-Gura). Une autre légende, bien que contradictoire dans son contenu, précise l’origine de l’appellation de ce groupe : alors qu’ils s’appelaient jusque-là différemment, un membre de ce groupe parvint à battre à la lutte Gura, un chef local qui profitait de sa force physique pour dépouiller de leurs biens tous ceux qui passaient sur ses terres. En souvenir de cette victoire, ils se firent appeler Vungura (ceux qui ont lié Gura) (De Calonne- Beaufaict, A., 1921 : 27-40).
Plus complexe est la question de l’origine des Mangbetu. Il existe sur la question au moins deux points de vue, suivant les traditions zande et suivant celles des Mangbetu eux-mêmes. La tradition zande explique que les Mangbetu descendaient d’un Vungura répondant au nom de Gara ; il quitta les siens à la suite d’une querelle familiale, chercha refuge chez les Kere et finit par y épouser une femme du lignage cheffal. Par la suite, il se distingua par son comportement guerrier. Les Kere finirent par en faire un chef. Il adopta la langue et les usages du clan et fonda la dynastie mangbetu (Denis, P., 1921 : 32-33, 137-138). Les Mangbetu reconnaissent cette explication non pas comme celle de leur origine, mais plutôt comme celle d’une acculturation zande à un moment donné de leur évolution. C’est de Gara qu’ils apprirent l’organisation zande. On sait que, par la suite, le fils de Gara fut le chef d’une migration vers le sud, traversant la rivière Bomokandi (Hubbard, M., 1975 : 11-12).
Voilà posée une question complexe : lequel des systèmes zande et mangbetu, est-il le plus ancien ? On a toujours cru que le système zande, bien mieux assumé au niveau de la littérature anthropologique, était mieux organisé et qu’il aurait donc influencé les Mangbetu. Cette vision est en contradiction avec les données du terrain, et les études récentes le reconnaissent de plus en plus. Déjà l’histoire du peuplement est à elle seule suffisamment éclairante. A l’inverse des traditions zande, celles des Mangbetu indiquent qu’ils seraient venus du pays du sud, situation quelque peu embarrassante quand on sait que les Mangbetu constituent un peuple centre- soudanais (Denis, P., 1961 : 8-9). Cette tradition constitue une preuve significative de l’occupation fort ancienne des Mangbetu dont le souvenir s’est émoussé pour ce qui concerne l’étape historique antérieure à leur migration du sud vers le nord. La réalité est que, partis du nord, ils ont évolué vers les régions méridionales, absorbant les autochtones, jusqu’à ce qu’ils rencontrent les colonnes bantu qui les ont obligés à rebrousser chemin et à s’immobiliser sur leur territoire actuel. Dans la zone de transition entre la forêt et la savane, chassant à la fois l’okapi (forêt) et le zèbre (savane), ils vont élaborer une civilisation florissante qui va influencer les conquérants zande sur les plans social, culturel et technologique.
Pour s’en rendre compte, il suffit de considérer les éléments de civilisation de cette région au travers de ces deux peuples zande et mangbetu. Sur le plan de la subsistance d’abord, il est reconnu que grâce aux Mangbetu la région s’est enrichie de plusieurs plantes alimentaires, notamment la canne à sucre, une grande variété de bananes, l’arbre dont l’écorce servait à fabriquer des vêtements. Les Zande leur doivent également leur système de croyance et certains cultes spirituels utilisés pour résoudre les problèmes de la vie. On se rendait volontiers en pays mangbetu pour chercher du poison benge, particulièrement meurtrier, utilisé pour des ordalies ; de même les sociétés secrètes qui ont existé chez les Zande étaient d’origine mangbetu.
L’empreinte de cette influence est surtout manifeste en art, dans les domaines de l’artisanat et de la technologie. Le patrimoine artistique mangbetu est considéré aujourd’hui encore comme l’un des plus prestigieux et des plus influents sur toutes les sociétés environnantes : Medje, Niapu, Boa et même Zande (Neyt, F., 1981 : 65-67). Même les observateurs européens du XIXe siècle l’avaient noté. Schweinfurt a traduit ainsi ses impressions à la vue de l’architecture royale : « Ces constructions peuvent être classées parmi les merveilles du monde… Je ne sais quels matériaux, ayant à la fois assez de légèreté et de force, nous pouvons employer pour élever des édifices de cette dimension » (Schweinfurt, G., 1875 : 41-42). On a noté leur grande habileté dans la confection des instruments de musique (trompes royales, xylophones, harpes à cinq cordes) et la sculpture de décorations à motifs anthropomorphes (boîtes à miel, armes décorées, vases en terre cuite, appuie-tête). L’esthétique des arts de cette région est vraiment influencée par les Mangbetu.
Le forgeron zande était davantage orienté vers la production des armes de jet ; il fallait répondre à la demande de cette société belliqueuse en lutte continuelle pour conquérir la domination de la région. Mais dans ce domaine encore, l’influence mangbetu était sensible ; c’est à elle que l’on doit l’existence de différents types de lances (ngbingbi, gbabaza), de poignards (mawida, nadada et abeni) et de haches (bamwenga) (Hubbard, M., 1975 : 23-25). La prédominance mangbetu est évidente. S’ils ont appris des Zande l’art de diriger la cité, en revanche, ils ont contribué à leur « humanisation » en les laissant communier à leur patrimoine culturel.
Les Zande firent l’expérience d’une gestion politique de type royal où se juxtaposaient plusieurs structures centralisées. Les plus célèbres furent d’une part celle des Bandiga installée sur le Bas-Mbomu, établie par une dynastie Ngbandi et, d’autre part celle déjà évoquée de Vungura. Ainsi, en ce XVIIIe siècle, la vie politique était faite essentiellement de luttes d’influence entre les différents prétendants au trône dans les États zande.
Chez les Mangbetu, l’initiative de centralisation politique est récente, mais elle fut brève et limitée dans le temps. Elle démarra avec Manzika, le chef qui décida d’emmener définitivement son peuple au nord de l’Aruwimi. Une conscience de groupe naquit certainement de cette situation. Son fils Nabiembali (1815-1860) arriva à matérialiser l’unité politique des Mangbetu à partir de 1815. Il commença par absorber des populations environnantes pour constituer un espace politique basé sur des échanges commerciaux. L’absorption se faisait par ruse, par conquête politique ou par des nécessités d’ordre commercial. Les mémoires en ont conservé un exemple : les Mabisanga étaient propriétaires de palmiers mais Nabiembali et les siens n’en disposaient pas. Il sollicita des noix pour les planter mais sa proposition de collaboration fut rejetée. En effet, alors qu’il cherchait des noix de palme pour les planter dans sa région, Nabiembali se vit remettre des noix de palme déjà bouillies pour que le secret soit conservé. Ceci provoqua une courte guerre qui coûta aux Mabisanga leur soumission. Il y eut également des raids contre les Mamuu qui disposaient d’une réserve importante d’esclaves et de chèvres.
Pour créer l’État, Nabiembali ne se contenta pas de pratiquer l’expansionnisme : il décida aussi, vers 1835, de renouer avec le nom de son ancêtre Mangbetu et le proposa pour désigner le royaume. On intensifia les échanges : la cour royale était ravitaillée en huile et noix de palme par les Mangbele, les Mamuu fournissaient des chèvres, les Medje des régimes de bananes, les Kere du poisson fumé, etc.
Même les alliances matrimoniales intervenaient en tant qu’instruments d’expansion. Nabiembali épousait des femmes appartenant aux peuples conquis, puis il élevait ses fils, quelle que soit leur origine, à sa résidence ; quand ils étaient suffisamment âgés, il les installait alors à la tête de chaque entité déjà soumise. C’est ainsi que Mokinda fut placé à la tête des Mangbele, Ningba des Medje. Mongomisi des Madjo, Dei des Madje et des Mande. La cohésion fut renforcée par le fait que des chefs soumis devaient envoyer leurs enfants mâles séjourner à la cour. Le résultat de cette politique était que ces jeunes princes retournaient chez eux porteurs de la langue, des coutumes et des croyances mangbetu.
Le règne de Nabiembali constitua un temps fort de l’histoire politique des Mangbetu mais la centralisation qu’il avait instituée était trop récente pour résister aux dissensions qui allaient se produire inévitablement à sa mort, d’autant que, à la soixantaine d’héritiers que constituaient ses fils s’ajoutaient les nombreux chefs de clan, tous candidats potentiels à la succession (Hubbard, M., 1975 : 13-16). II fut d’ailleurs lui-même à l’origine d’une certaine confusion. Alors qu’il se préparait à céder le trône à un autre de ses fils, Tuba, son fils aîné, qu’il voulait déshériter lui fit la guerre, l’enleva et l’emprisonna. Il devint roi et s’arrangea pour légaliser ce coup de force. Cela se passait en 1860. Déçu, Nabiembali, avant de mourir en exil, déshérita tous ses fils au profit de l’un de ses anciens esclaves. Dakpara. Ainsi fut fondée la dynastie Matshaga qui s’installa dans la partie septentrionale du territoire mangbetu, au nord de la rivière Bomokandi, chez les Abarambo. Cette dynastie avait des raisons d’être ambitieuse car sa légitimité avait trouvé sa confirmation dans le mariage qui avait uni la sœur de Dakpara au vieux Nabiembali.
Tuba se maintint quelque peu mais fut tué en 1867, à l’occasion d’un raid contre Dakpara. Il fut remplacé par Munza qui connut un règne sans doute bref (1867- 1873) mais riche en événements d’une grande importance pour les peuples du Haut-Uélé (Hutereau, A., 1922 : 285-286 ; Denis, P., 1961 : 59). C’est lui qui ouvrit la porte du royaume aux influences extérieures. Mais avait-il le choix ? Les premiers étrangers qui pénétrèrent dans le pays furent des commerçants nubiens qui installèrent, là où ils passaient, des comptoirs fortifiés (zeribas). Mais Munza conservait une certaine autorité dans son royaume : il osa refuser à ces étrangers l’autorisation de commercer et de voyager au-delà des frontières méridionales de son royaume. Il croyait conserver ainsi son monopole sur le commerce du cuivre.
Mais une coalition des commerçants nubiens et des descendants de Dakpara finit par organiser un complot. Munza fut assassiné en 1873 et l’événement mit un terme à cette période de pouvoir centralisé en Haut-Uélé car l’effet immédiat de sa mort fut la division du territoire.
De nombreux chefs se partagèrent le royaume ; l’un des plus prestigieux fut sans conteste Niangara, un Matshaga. Mais celui-ci se rendit vite compte que l’ère des aristocraties politiques indépendantes était révolue et qu’il fallait désormais satisfaire la volonté des nouveaux maîtres. Une succession d’événements, l’activité madhiste qui se développa au Soudan en 1884-1885, supplantant des raids nubiens, l’arrivée des commerçants swahili provenant de la côte orientale et finalement les campagnes de « pacification » de l’État Indépendant du Congo, tout cela finit par détruire les dernières vélléités d’organisation autonome. Les peuples du Haut-Uélé n’en conservèrent pas moins leur dynamisme culturel, mais désormais au sein d’une entité plus grande. Ils étaient plus que jamais mêlés aux Bantu.
Texte : Les Niam-Niam et l’art
Ceux que la littérature ethnographique présente comme étant exclusivement des « indigènes » voués à la guerre et ne dédaignant pas, en temps de paix, de chasser le gibier humain, savaient aussi être sensibles. En réalité, ils étaient des hommes comme tous les autres qui n’ont fait que s’adapter aux conditions de leur environnement.
« Les Niam-niam (Zandé) ont des jouissances d’un ordre plus élevé que le jeu, plus douces que la chasse et le combat : ils possèdent l’amour instinctif de l’art. Passionnés pour la musique, ils tirent de leur mandoline des sons qui retentissent jusqu’au plus profond de leur être. La durée des concerts qu’ils se donnent à eux-mêmes est inimaginable… Un Niam-Niam jouerait de son instrument pendant vingt-quatre heures sans le quitter d’une seconde, oubliant de boire et de manger (…) leur instrument favori tient à la fois de la harpe et de la mandoline. Par la disposition verticale des cordes il ressemble à la première, et se rapproche de la seconde par la caisse sonore, le manche et les chevilles qui servent à tendre les cordes. Construit exactement d’après les lois de l’acoustique, le fond est creusé dans un morceau de bois et recouvert d’une peau qui est percée de deux trous. Ces cordes, solidement tendues au moyen de chevilles, sont parfois composées de fibres végétales, parfois des crins d’une queue de girafe (…).
Il y a chez eux des musiciens de profession, gens d’une classe à part… Ces chanteurs ambulants sont toujours parés d’une manière extravagante, coiffés de plumes fantastiques, couverts de morceaux de bois et de racines, de pieds d’oryctérope, d’écailles de tortue, de becs d’aigle, de serres d’oiseau de proie, de dents de maintes espèces, en un mot, de tout ce qui peut prétendre à quelque rapport avec l’art occulte du magicien. A peine arrivé, l’homme aux talismans commence à relater ses voyages dans un récital plein d’emphase, et n’oublie jamais de conclure par un véhément appel à la générosité de ses auditeurs, leur rappelant que des anneaux de cuivre et des perles lui sont dus pour salaire. A cela près de quelque différence dans la parure, on retrouve ces chanteurs ambulants dans l’Afrique entière »
(Schweinfurth, G., 1875, tome 2, pp. 29-30).
[1] Les travaux récents des lettrés de la région nous ont permis de nuancer certaines vues de la littérature ethnographique « classique » (Cf. Nzaka, K., 1975 ; Yewawa, G.. 1977 ; Ngbakpwa. M.. 1978. 1980,1993).
[2] Sur cette région B. Tanghe a entre autres produit les textes suivants : 1922 : 366-394 ; 1924 : 203-217 ; 1929 ; 1939/1940 : 61-65 ; 1944 : 35-41.
[3] Voir à ce propos Tanghe B (1939 : 43) ; la tradition a été reportée en langue ngbandi par Ngbakpwa, M., (1980 : 24-26).



