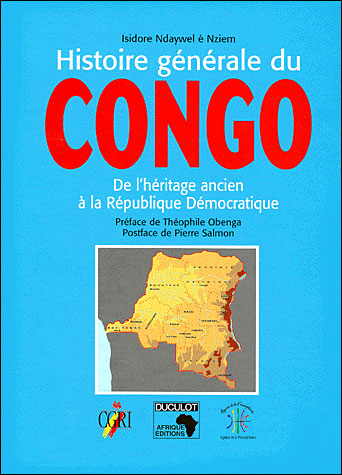
Partie 4 - Chapitre 1 : Le tournant
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Pour comprendre les événements qui allaient caractériser le Congo au XIXe siècle, il faut revenir au contexte dans lequel se réalisèrent au XVe siècle les premiers contacts avec l’Europe. L’on doit, en effet, se rappeler qu’au-delà des considérations humanitaires, de la curiosité scientifique et des arguments religieux, la motivation essentielle justifiant les expéditions sur les côtes africaines fut d’ordre commercial. S’il fallait accéder par la voie africaine aux Indes, on se préoccupait aussi de fonder tout le long de ces côtes des comptoirs commerciaux. Déjà ce premier contact ne fut pas sans conséquences pour la vie des autochtones, puisqu’il créait des voies d’infiltration des premiers produits importés.
Mais ce qui se faisait de manière sporadique allait connaître un autre rythme. Une décennie après qu’il fut donné aux populations côtières d’entrer en contact avec Diogo Câo, on « découvrit » en 1492 l’Amérique. Ce continent s’avéra plus intéressant aux yeux des exploiteurs. Mais il fallait une main-d’œuvre abondante et suffisamment robuste pour le mettre en valeur. L’Afrique allait être l’objet d’une nouvelle « découverte » puisque de la « terre inconnue et inutile » qu elle était, elle allait devenir une « terre utile », le réservoir privilégié de la main-d’œuvre pour servir dans les plantations d’Amérique et des Antilles (Mahn-Lot. M., 1970).
1 LA TRAITE DES ESCLAVES [1]
L’esclavage, on le sait, est un phénomène aussi vieux que le monde. Dans sa forme la plus archaïque, il se présentait comme une manière de rentabiliser le « butin humain » acquis à l’issue d’une victoire militaire. Il y avait aussi le cas de l’esclavage épisodique, assez répandu dans le monde, comme forme de gage ou comme une manière de s’acquitter d’une dette.
En Afrique traditionnelle, ce phénomène n’était pas inexistant. Les esclaves constituaient une classe sociale relativement reconnue. Du reste, si la traite des esclaves a pu se développer, c’est parce qu’elle a pu compter sur une certaine compréhension du phénomène auprès des aristocraties locales. Pourtant ce second type d’esclavage, sollicité par les forces « du dehors », était bien différent de ce qui se pratiquait au niveau interne. Jusqu’au XIXe siècle, la plupart des princes africains qui se firent complices de ce commerce ne pouvaient pas encore saisir pleinement cette différence, car ceux qui partaient ne revenaient jamais pour raconter ce qu’ils avaient vécu.
Avant de parler de ce commerce inhumain, précisons d’abord qu’il n’est certainement pas né du racisme ; les premiers esclaves utilisés furent des Indiens et même des marginaux européens (clochards, vagabonds, forçats, bagnards). C’est plutôt la conséquence d’une certaine situation économique qui allait faire de ce fléau le lot exclusif des Noirs d’Afrique. D’abord, les Indiens comme les Européens étaient peu endurants, leur rendement était minime (un nègre valait quatre Indiens, estimait-on). Ensuite, le réservoir d’Indiens était limité, alors que celui des Noirs paraissait inépuisable. Que l’idée « généreuse » de Bartholomé de Las Casas préconisant la protection des Indiens ait apporté une contribution au développement de la traite des esclaves, cela est certain, mais on ne peut en exagérer l’importance puisque le recours aux Africains était la seule issue possible. Puisqu’il fallait à tout prix une main-d’œuvre abondante et surtout efficace, elle ne pouvait être que d’origine africaine (Deschamps, H., 1971 : 47-58 ; Williams, E., 1968 : 19-46 ; Rinchon, D., 1929 : 43-64). Les bâtisseurs des Pyramides et des Murailles de Zimbabwe allaient bâtir l’Amérique et, à travers elle, l’Europe moderne.
La traite n’a pu s’installer vraiment que vers la fin du XVe siècle, mais son essor véritable se situe au XVIe siècle qu’on considère à juste titre comme le « siècle d’or » des populations ibériques. Les Noirs importés en Amérique étaient utilisés pour l’exploitation des minerais, pour les travaux publics, surtout pour les cultures d’exportation (canne à sucre, cacao, coton, etc.). Quelques privilégiés étaient affectés à des travaux domestiques.
Dans cette opération, au niveau des côtes kongolaises, les Portugais rebelles de l’île de Sâo Tome jouaient un rôle de toute première importance. Située au fond du golfe de Guinée, cette île où l’on envoyait en exil des condamnés portugais, intervenait au moins dans trois rôles différents. D’abord, elle faisait importer du continent des esclaves pour ses propres plantations de canne à sucre ; ensuite elle était le point de relâche et de ravitaillement des navires « négriers » venus prospecter les côtes ou se rendant en Amérique ; enfin elle avait fini par servir de dépôt permanent d’esclaves pour les navires qui étaient pressés ou qui n’avaient pu avoir une cargaison suffisante sur le continent. C’est à cette époque que la traite prit des proportions suffisamment inquiétantes pour effrayer le roi Ndo Funsu du Kongo.
On vendait déjà aux négriers non seulement des prisonniers de guerre mais même des citoyens libres du pays. Jusqu’ici, cette exploitation criminelle était le fait des seuls Portugais et Espagnols, les premiers opérant sur les côtes d’Afrique Centrale et les seconds dans la région du Cap Vert. Mais au XVIIe siècle, le succès de ce commerce attira la concurrence de nouvelles nations négrières ; la Hollande fut la première intéressée. En 1631, elle créa la « Compagnie des Indes Occidentales » chargée essentiellement de ce commerce. Ses premières prospections, elle les tourna vers les côtes sénégambiennes et, à partir de 1641, elle s’employa à supplanter les Portugais à Sâo Tome et même à Loanda. Ce fut « l’âge d’or » de la Hollande (Pope- Hennesy, J., 1969 : 84).
Dans cette lutte entre adversaires négriers, on sait qu’au Kongo, les Portugais essayèrent de limiter l’influence des Hollandais en les présentant comme étant des hérétiques parce que protestants. Mais cet argument s’avéra peu probant car les autochtones qui ne percevaient pas de grande différence entre Européens, les premiers comme les nouveaux venus n’hésitèrent pas à commercer avec ces nouveaux Blancs. Le problème vint d’ailleurs. Le succès des Hollandais suscita l’inimitié d’autres nations, telles la France et l’Angleterre qui décidèrent, elles aussi, d’entrer dans la danse. Pour ce faire, il fallait d’abord acquérir des terres en Amérique. C’est ce qui fut fait aussitôt par l’occupation des îles : les Antilles devinrent françaises et anglaises. Ainsi, vers 1670, avec l’apport de nouvelles nations négrières, la traite acquit une importance toute nouvelle. Dans le troisième quart du siècle, la moyenne annuelle passa de huit mille au début du siècle à quatorze mille ; au dernier quart, elle dépassa les vingt-quatre mille (Deschamps, H., 1971 : 65 ; Curtin, P., 1969). C’était déjà une belle performance, mais elle devait être dépassée au siècle suivant, en attendant que ce commerce soit en déclin au XIXe siècle.
Il existait en Afrique, tout au long de la côte atlantique, des régions « privilégiées » où se recrutaient les esclaves ; la côte de Loango-Kongo-Angola (les deux Congo et l’Angola actuels) constituait une de ces zones de recrutement, aux côtés du Golfe de Guinée (Côte d’Ivoire et Côte d’Or), de la Sénégambie et Cap Vert (Sénégal, Gambie, Sierra Leone). Ses ressortissants étaient envoyés principalement au Brésil si bien que de nos jours encore, cette identification est encore possible au travers des multiples réminiscences d’ordre culturel et surtout linguistique [2].
Dans cette région d’Afrique Centrale, il existait à la fin du XVIIe siècle trois « voies » suffisamment distinctes par lesquelles les esclaves étaient acheminés vers les côtes. Ces voies aboutissaient aux quatre ports principaux de 1 époque. Loango, capitale du royaume portant ce nom, Mpinda, le port principal du royaume Kongo situé dans le Soyo occidental ainsi que Loanda et Benguela en Angola.
La voie septentrionale menant à Loango était fréquentée par des caravanes Teke et même Yaka qui passaient par le massif boisé du Mayumbe. Leurs esclaves provenaient du marché de Pumbu (Kinshasa actuel) où ils avaient été rassemblés à partir des convois descendant le fleuve et le Kwa (Kasaï et Mfimi). Les esclaves achetés à ce port passaient pour être la « fine fleur » de la région ; ils étaient hautement appréciés en Amérique à cause de leur endurance et de leur ardeur au travail. On comprend alors pourquoi l’on trouvait en permanence sur le rivage de Loango, dix à vingt navires attendant leur chargement d’esclaves. Ce sont les Hollandais qui furent les premiers à fréquenter ce port, suivis des Français et des Anglais. Mais dans cette concurrence, les Français finirent par l’emporter (Deschamps, H., 1971 : 109-111). Par ce statut, le royaume de Loango, au point de départ vassal du Kongo, ne tarda pas à devenir autonome et cela déjà vers 1587. Au XVIIe siècle, l’activité commerciale dans le royaume battait son plein, et la cour du Maloango comprenait même un ministre spécial chargé des « affaires de l’océan », c’est-à-dire du « commerce avec les Blancs » (Dapper, O., 1696 : 533-534).
La voie centrale par le port de Mpinda n’eut pas autant de succès, sans doute à cause des réticences du Mani Kongo vis-à-vis de ce genre de trafic. Aussi ce royaume fut-il en pleine décadence, au XVIIe siècle, le commerce d’esclaves étant mené par des anciens vassaux devenus indépendants. C’est ainsi que le gros trafic se reporta sur l’Angola.
La voie méridionale était donc la plus importante. Les marchands d’esclaves s’enfonçaient à l’intérieur des terres jusqu’à Kasanje et même à Musumba au cœur de l’empire lunda. D’autres exploraient des zones situées plus au nord au point de prospecter pratiquement tout le Kasaï actuel.
On se rend compte que la grande partie du Congo actuel était concernée par ce trafic. Les esclaves originaires de l’Equateur et du lac Maindombe étaient récupérés à partir de Pumbu d’où ils étaient acheminés vers la côte sur Loango ou sur Mpinda. La savane du sud, dans son ensemble, était sillonnée de part en part pour alimenter les ports d’Angola (Loanda-Benguela).
On pourrait à juste titre se demander quel a pu être l’impact de ce commerce nouveau sur les populations du Congo ancien. Le changement démographique, à cause des ponctions opérées, en est incontestablement l’aspect le plus spectaculaire, puisque même les chiffres ne traduisent pas toute la réalité. On sait que la mortalité était fort élevée pendant la traversée de l’Atlantique tout comme pendant le séjour à la côte, en attendant que le bateau ait sa cargaison complète avant de lever l’ancre. En Amérique même, « la moyenne de vie d’un esclave était de cinq à sept ans » (Ki-Zerbo, J., 1978 : 222). Avançons malgré tout quelques chiffres.
Rien qu’au Brésil, en deux siècles et demi, de 1600 à 1852, furent emmenés à peu près trois millions d’esclaves provenant, en particulier comme on l’a noté, des côtes du Kongo-Angola. Ceci donne alors une moyenne de douze mille personnes par an (Chaunu, P., 1964 : 109) ; ce chiffre rejoint particulièrement les extrapolations de H. Deschamps effectuées sur base des chiffres de P. Curtin et suivant lesquelles les exportations annuelles à partir de cette côte auraient oscillé entre treize et vingt mille, du moins avant le dernier quart du XVIIIe siècle. Rien que des ports d’Angola, le chiffre annuel des exportations serait passé de sept à dix-sept mille à la fin du XVIIIe siècle (Deschamps, H., 1971 : 110-111).
Mais le changement démographique, s’il était manifeste, était du moins ponctuel et, à la limite, réparable au cours de l’histoire. Certains autres phénomènes, moins spectaculaires mais plus meurtriers, s’inscrivaient à l’époque de manière irréversible dans l’évolution de ces peuples. C’est que le commerce à longue distance, qui n’était pas une nouveauté, acquérait maintenant une vigueur nouvelle. De plus, innovation de l’époque, il était nécessairement orienté vers la côte atlantique surtout mais également vers la côte indienne et plus tard vers le monde soudano-égyptien, à travers le Haut-Nil. La vie au cœur du pays était désormais liée à des pulsations d’origine externe.
Dans la pratique du commerce, on nota l’apparition d’une « bourgeoisie » commerciale africaine que constituaient les Pombeiros. Ces personnages vivaient dans des centres de commerce : Loanda, Mpinda, Loango ; leur subsistance ne dépendait guère de l’agriculture ni de la chasse, à la différence des autres populations. Mulâtres ou détenteurs d’une certaine culture d’origine occidentale, ces personnages étaient les auxiliaires des Européens. Ils s’en allaient à l’intérieur du pays capturer ou sinon acheter des esclaves et les acheminaient dans les ports où les négriers, leurs maîtres, les attendaient dans les salons de leurs navires. Ils ont donc constitué pendant toute une époque les intermédiaires obligés entre les marchands d’esclaves et les chefs ou les vendeurs autochtones [3].
Parallèlement à ces personnages qui agissaient en tant qu’individus, certaines sociétés composites se créèrent sur des bases plus ou moins ethniques, commandées par les nécessités de ce trafic. Ces ethnies nouvelles, créées pour les besoins de la cause, s’adonnaient surtout à des activités militaires et commerciales. Négriers et autochtones tiraient profit de cette situation. Avec leurs armes à feu. ils opéraient des razzias et capturaient plus facilement des esclaves qui étaient alors acheminés vers les côtes, en même temps qu’ils installaient leur domination et leur loi sur les peuples conquis. Parmi ces peuples courtiers, il y avait notamment dans la région côtière, les Yaka et les Teke, mais surtout les Lunda et les Cokwe.
On se rappellera le cas Lunda, société composite dont l’unité était basée sur des intérêts économiques. Même les conquêtes militaires obéissaient à cet impératif. Le fait de dominer toute la savane du sud, au XVIIIe siècle, a eu pour effet la création et l’entretien d’une route commerciale remarquable joignant Loanda à l’embouchure de Zambèze, en passant par Kasanje, Musumba, le royaume de Kazembe et enfin Tete sur le Haut-Zambèze (Greindl, L., 1974 : 137). Parmi les peuples qui épaulaient les Lunda, il y avait surtout les Cokwe qui, du reste, finiront par les évincer au nord de l’Angola menant une vie de nomades dans la région des sources du Kasaï et du Kwango. Ils parvinrent à absorber un noyau conquérant d’origine lunda. Avec l’avènement du commerce luso-africain, ils devinrent rapidement des intermédiaires importants, reliant par caravanes les marchés de l’intérieur à la côte atlantique et recevant en retour des biens importés (étoffes, bijoux, ustensiles et surtout armes à feu). Il faut dire que leur organisation sociale simplifiée à l’extrême et, partant, fort souple, les prédisposait à toute adaptation nouvelle, de même que, en tant que nomades, ils étaient habitués aux déplacements et aux déménagements. C’est donc tout naturellement, dans le cadre de cette entreprise commerciale, qu’ils se mirent à essaimer partout, cherchant des esclaves à emporter, chassant l’éléphant pour avoir ses défenses et détruisant toute forme d’organisation qui risquerait de gêner leur activité de pillage. Il faut dire que cette option leur a parfaitement réussi, au point qu’on peut leur attribuer la responsabilité de la disparition des modes de vie traditionnels, au moins dans la moitié ouest du Katanga, au Kasaï et dans les parties méridionales de la région du Kwango-Kasaï (Denolf, P., 1954 : Colle, P., 1913). La destruction de l’empire lunda leur incombe également en grande partie.
Lunda et Cokwe n’agirent pas seuls. Dans leur entreprise, ils parvinrent aussi à entraîner certains groupes autochtones. Au Kasaï, ce furent les Luluwa qui s’illustrèrent dans cette collaboration. Le terme même de Luluwa provient des Cokwe. En effet, ce sont les Luba, qui entrèrent en relation avec ces Cokwe, qui se firent appeler Luwa (le « b » intervocalique étant difficile à prononcer en langue Cokwe) ; ce mot désigna d’abord le cours d’eau puis son environnement humain (Bena Luluwa), qualifiant ceux qui s’estimaient « propriétaires » des terres baignées par ce cours d’eau (Vansina, J., 1965 : 165). Au XIXe siècle, les « Luba de la rivière Luluwa » revendiquèrent leur particularité par rapport aux « autres » Luba. L’ethnie Luluwa, distincte de celle des Luba, était ainsi née dans ce contexte finalement difficile et complexe. Le chef Luluwa Kalamba Mukenge fut le premier à accueillir les Cokwe, croyant favoriser ses ambitions expansionnistes à l’égard des seigneuries voisines. Mais bientôt, ce fut le tour d’autres chefs Luluwa d’offrir l’hospitalité aux « conquérants » pour les mêmes raisons. Les victimes de cette collaboration furent les Luba Lubilanji ; l’avance Luluwa n’allait être vraiment freinée que par la résistance des Bakwa Kalonji (Mpoyi, L.M., 1966 : 104).
Au moment où l’on décrétait, au XIXe siècle, l’abolition de la traite atlantique, un autre commerce d’esclaves tout aussi criminel battait son plein avec les Arabes sur les côtes d’Afrique Orientale et à Zanzibar. Ce commerce n’est pas vraiment récent. Il est même fort ancien car l’installation des Arabes dans cette région maritime remonte à la fin du premier millénaire. Avant cela, cette région d’Afrique Centrale bénéficiait même d’un contact avec les Asiatiques, Indo-Malais et peut-être même Chinois. La preuve habituellement évoquée pour attester ce contact est la girafe africaine qui était parvenue à se faire admettre comme emblème impérial en Chine (Halle, A., 1971 : 12-34).
Mais toutes ces influences venues d’abord de l’Extrême – et ensuite du Moyen- Orient se cantonnaient dans la seule région côtière, surtout à l’île de Zanzibar. Avec les Arabes dont les comptoirs commerciaux étaient établis tout le long de la côte, la traite orientale s’instaura de manière furtive et occasionnelle. Elle s’estompa momentanément aux Temps Modernes du fait de la domination portugaise. A la fin du XVIIIe siècle, cette activité reprit peu à peu. Le sultan arabe de Mascate qui avait établi sa domination sur les îles de Zanzibar et Pemba, se préoccupait d’y faire pousser des cannes à sucre, des caféiers et des girofliers. Il fallait de la main-d’œuvre pour ces travaux.
Jusque-là, les centres de la côte étaient surtout peuplés d’Africains nés de pères arabes ou d’autochtones parfaitement assimilés à leur culture. Us parlaient un dialecte bantu mélangé à l’arabe. On les appellera plus tard des « Arabisés » ou plus correctement des Swahili parlant une langue qui finira par être qualifiée de Kiswahili. Curieusement l’initiative de contact avec les autochtones de l’arrière-pays n’est pas venue des Arabes, mais des peuples de l’intérieur eux-mêmes dont le dynamisme artisanal incita les Arabes à s’enfoncer de plus en plus à l’intérieur des terres. (Deschamps, H., 1971 : 258). A l’occasion, on vendait aussi quelques esclaves, des prisonniers de guerre, des débiteurs insolvables ou des personnes condamnées par la société. Il en fut ainsi jusqu’au début du XIXe siècle.
Il existait trois grandes routes par lesquelles les autochtones acheminaient l’ivoire et les esclaves vers la côte. L’itinéraire du nord reliait le Lac Victoria à Mombassa, celui du centre partait du Tanganyika à Bagamoyo, celui du sud enfin allait du lac Nyassa jusqu’à Kilwa (Mendiaux, E., 1961: 127-128). Si, au XIXe siècle, la chasse à l’esclave acquit une plus grande importance, c’est parce que le nombre d’acheteurs avait augmenté. Les Européens n’osant plus se présenter sur la côte atlantique à cause de l’abolition officielle de la traite, se débrouillaient pour acquérir cette marchandise par l’entremise des Arabes.
C’est vers 1820 que les premières caravanes organisées par les Arabes allaient utiliser ces voies, cette fois-ci en sens inverse, en partant de la côte vers l’arrière- pays. La traite arabe allait connaître une intensité jamais atteinte jusque-là. La route de Bagamoyo était fréquentée par les Nyamwezi. On créa au cœur du pays de ces derniers le centre de Tabora. Mais ce relais s’avéra insuffisant puisque, la pénétration se poursuivant vers l’ouest, elle amena les Swahili à créer le poste düdjidji au bord du Tanganyika. Dans la deuxième moitié du siècle, les esclavagistes poursuivirent leur incursion au-delà du Tanganyika jusqu’au Lualaba et puis au-delà, atteignant le Lomami et même le San kuru. Sur le Lualaba, les deux grands marchés d’esclaves instaurés furent ceux de Kasongo et surtout de Nyangwe dont la population en 1886 atteignait déjà les dix mille âmes (Haddad, A., 1983 : 55). Les différentes régions contrôlées par ce commerce allaient connaître des évolutions différentes à cause de l’absence d’un pouvoir central qui se donnât pour tâche de contrôler l’ensemble du mouvement et d’imposer sa loi aux différents trafiquants.
Le premier marchand à s’établir au Maniema fut Mwinyi Dugumbi, vraisemblablement vers les années 1860 (Cornet, R., 1952 : 20). Il se fixa à Nyangwe. Pourquoi à cet endroit ? Parce qu’un grand marché s’y tenait et que l’habitude était prise de ne commettre aucun acte hostile contre ceux qui s’y rendaient ou qui en revenaient. Mwinyi Dugumbi se partageait donc avec un autre Swahili, Abed bin Sa- lim, l’influence sur ce point de polarisation de la région.
A leur mort, ils furent remplacés respectivement par Mwinyi Muhara appelé également Ntagamoyo bin Sultan et par Saïd bin Abedi. Mais d’autres marchands vinrent également s’établir, ici et là, au Maniema, notamment à Kabambare, relais important conduisant au dépôt de Mtoa (actuellement Kalemie). Descendant le Lualaba, Muzelela s’établit à Lokandu non loin de Kindu et Mwinyi Kayumba dans le bas Lokandu ; Hamed bin Ali, connu sous le nom de Kibonge, régnait à Kirundu.
La pénétration, à partir du Maniema, allait se poursuivre vers le nord-ouest dans la région des Falls, à l’initiative de Saïd bin Sabiti. Mais le Maniema n’en demeurait pas moins le centre le plus important, le noyau à partir duquel se dispersaient tous les « conquérants » en terres congolaises. A partir de la côte orientale, transitant par Udjidji, on pénétrait dans le Maniema par trois voies : la première piste traversait le Tanganyika vers l’ouest, via Fizi et Kabambare jusqu’à atteindre Nyangwe et Kasongo sur le Lualaba ; la deuxième piste coupait vers le nord pour joindre les Falls par Lubutu et Kirundu ; enfin, la troisième piste contournait le lac par le sud avant de remonter au nord pour s’orienter vers les Etats Luba-Lunda (Haddad, A., 1983 : 50-52).
Au Katanga, les conséquences de ce commerce furent pour le moins inattendues. L’entrée des chasseurs Nyamwezi y fut le prétexte à une redistribution du pouvoir dans la région. On les avait surnommés Yeke, c’est-à-dire « chasseurs d’éléphants » (Legros, H., 1994). Au contact des autochtones Sanga et Lamba, ils eurent l’occasion de se rendre compte de la richesse minière de cette région. Ils apportèrent la nouvelle, à leur chef Kalasa, à leur retour dans le pays Nyamwezi (entre Tabora et le Tanganyika). Ce chef organisa toute une expédition dans le but de tirer profit de ces mines de cuivre. Une fois sur place, il eut tôt fait de se lier d’amitié avec les chefs locaux, notamment Katanga, seigneur des mines, Mpanda, chef des Sanga, Sampwe des Bena Mitumba et Kanyama des Aushi. On noua des relations principalement commerciales, grâce auxquelles la caravane de Kalasa repartit au pays chargée de lingots de cuivre et de bien d’autres présents.
Lors d’un voyage postérieur, Kalasa se fit accompagner de son fils Ngelengwa. Celui-ci, s’étant rendu compte sur place des grandes possibilités qu’offrait pour lui le Katanga, obtint de son père l’autorisation de s’y installer. Mais il fallait s’assurer des bonnes grâces de tous les grands maîtres du pays. A l’époque, dans le Luapula, aux alentours du lac Moëro, c’est Kinyata Munona qui était Kazembe. Il contrôlait le passage du Luapula et faisait payer des tributs à tous les chefs locaux. Ngelengwa se fit son allié en lui enseignant le remède contre la variole appris des Arabes. Plus loin, sur la Lufira, il fallait arriver à se concilier les faveurs du Katanga. Le nouveau venu y parvint. Il obtint en mariage une princesse locale et fut autorisé à occuper une terre. C’était l’embryon d’un futur État. Une nouvelle société ethnique, celle des Yeke, allait ainsi prendre corps. En bon guerrier, Ngelengwa ne tarda pas à se faire remarquer, surtout que ses hommes étaient armés de fusils à silex. Il organisa des expéditions punitives contre des villages insoumis, pour le compte de ses alliés Katanga et Mpanda, belle occasion d’acquérir des esclaves à faire expédier dans le pays d’origine. Son prestige n’en fut que plus grand.
Mais il restait à accomplir la dernière étape, celle de la conquête effective du pouvoir. Il allait y parvenir. A la mort de Katanga, Ngelengwa s’empara de la succession et finit également par s’imposer chez les sujets de Mpanda. Grâce à son armement, il arrêta le mouvement de descente des Luba vers le Sud et les repoussa jusqu’au lac Kisale et à la Luvwa. Le Kazembe, Katanga voyant s’accroître la puissance du nouveau conquérant, décida d’envoyer son armée contre lui mais il se fit battre. Ainsi donc, vainqueur du Kazembe et s’étant assuré la collaboration de ses plus grands vassaux, Ngelengwa était devenu le nouveau maître du pays, contrôlant un vaste territoire situé au sud de l’axe reliant Lubudi à l’extrême nord du lac Moëro. Cela se passait vers 1869. Il se proclama roi de Garenganze (du nom de sa sous- ethnie d’origine) et prit le titre de Mushid, terme qu’une mauvaise compréhension transformera en Msiri (Tshibangu, K., 1979a : 269-270; Verbeken, A., 1956). L’activité commerciale allait battre son plein, à partir de sa capitale, Bunkeya, située dans une vaste plaine, non loin du petit affluent de la Lufira. Ce commerce affecta un vaste territoire s’étendant depuis la Luvua au nord jusqu’à la crête Congo- Zambie (frontière méridionale du Congo) au sud, depuis le Luapula à l’est jusqu’au Lualaba à l’ouest. Pendant quinze ans environ (1870-1885) Bunkeya devint le plus grand centre commercial d’Afrique Centrale. Les Yeke vendaient aux Swahili du cuivre, de l’ivoire, mais surtout des esclaves et recevaient en contrepartie des fusils et des munitions grâce auxquels ils tenaient toute la région en respect. Cette activité ne sera interrompue que vers 1886 à cause des révoltes des Sanga, peu avant que les convoitises européennes ne viennent mettre un terme à cette hégémonie [4].
Au Kasaï, l’influence arabe fut l’œuvre de Tippo-Tip, surnom célèbre d’un afro- arabe qui s’appelait en réalité Ahmed ben Muhammed El-Murjebi. Ce personnage dont le souvenir reste fort heureusement encore vivace, est le seul traitant swahili qui soit parvenu à donner à son action commerciale une expression politique (Bontinck, E, 1974a). Originaire du Zambèze, d’une mère arabe et d’un père métis, Tippo-Tip fut formé sur le tas, n’ayant pas dépassé, sur le plan de l’instruction, le niveau de l’école coranique. Il prit part aux expéditions organisées par ses aînés et finit par arriver à Tabora puis à Udjidji. C’est dans la région de Moëro qu’il fit ses premières armes ; il y vainquit le Kazembe qui tentait de s’opposer à son action. Par la suite, il s’orienta vers l’ouest, osant dépasser le Maniema alors que tous ses amis swahili se cantonnaient dans des centres situés sur la rive droite du Lualaba : Nyangwe, Kasongo, etc. Avec sa caravane, il atteignit le Lomami, entra en contact avec les Lunda et parvint à s’imposer comme chef politique de cette grande région située entre le Lomami et le Lualaba. Il désignait leurs chefs aux peuplades environnantes, tout en s’attribuant à lui seul le tribut sur la chasse à l’éléphant. Sa demeure principale fut établie sur le Lomami ; de là, ses caravanes se mirent à sillonner les alentours, faisant main basse sur l’ivoire et les esclaves et cela jusque dans le Sankuru.
Un de ses lieutenants dont le nom est resté célèbre, Ngongo Leteta, s’illustra surtout dans la conquête du Kasaï, spécialement du Sankuru (Tshund’OIela, E., 1979 : 292-294 ; Lohaka-Omana, E., 1972).
On n’est guère renseigné sur l’identité originelle de ce personnage à qui certains attribuent une appartenance tetela (Boelaert, F., 1936 : 79 ; Vansina, J., 1966b : 82 ; Storme, M., 1970 : 5) alors que d’autres estiment qu’il aurait été songye (Van Zandijke, A., 1953 : 136 ; Turner, T, 1971 ; 64 ; Eluhu, D.D., 1976 : 96). Il est plus vraisemblable qu’il fut tetela, à moins qu’il ait été originaire du Maniema et donc kusu, comme on l’a également supposé (Hinde, S., 1897 : 54 ; Verbeken, A., 1966 : 24). Au départ, rien de particulier ne semblait destiner ce personnage à une carrière de conquérant. Le hasard a voulu que lors de son passage chez le chef Kilembwe, Tippo-Tip demanda à celui-ci de lui adjoindre un homme qui l’accompagnerait à Kasongo pour prendre les cadeaux qu’il lui destinait. On confia à Tippo-Tip le jeune Mwanza Kasongo, celui-là même qui serait surnommé plus tard Ngongo Leteta [5]. Tippo-Tip, aussitôt séduit par le dynamisme et les qualités guerrières du jeune homme, le retint à sa cour et l’utilisa par la suite pour des razzias dans le Sankuru dans le but d’étendre son influence dans cette région. Ngongo Leteta s’entendait fort bien avec Tippo-Tip, qui lui accorda la permission de capitaliser pour son propre compte une partie des marchandises sur lesquelles il parvenait à mettre la main. Avec les fusils et les munitions reçus, il parvint à organiser des campagnes, aidé par ses propres lieutenants. Il devint le maître incontesté d’un vaste territoire s’étendant au-delà des deux rives du Lomami. Vers la fin du siècle, en 1890, lorsqu’il apprit l’arrivée des hommes blancs à Lusambo, il eut l’idée de s’y rendre pour entrer en contact avec eux. Mais son arrivée à Lusambo créa une méprise regrettable. On crut à une attaque et on le vainquit avec ses troupes. Pourtant, s’il cherchait à entrer en contact avec les Blancs, c’était, entre autres, pour se défaire de la tutelle des Swahili. Pour cela, il lui fallait une autre source d’approvisionnement en armes et en munitions, pour conquérir son autonomie. Mais en dépit de tout, il finit par prendre ses distances et cessa de traiter avec eux au début de 1892. Pour ce faire, il se fit l’allié des Luluwa, comme un peu plus tôt, celui de Cokwe, en vue d’une conquête plus totale du Kasaï. Plusieurs expéditions furent organisées, avec l’aide de ses nombreux auxiliaires (Sambala) recrutés parmi les populations de l’entre-Lualaba-Lomami (Eluhu, D.D., 1976 : 106). Mais à la suite d’une série de défaites des troupes de l’État Indépendant du Congo, il se décida enfin à signer un traité d’alliance avec les représentants de ce pouvoir nouveau, comme le firent ses alliés Lumpungu et Pan y a Mutombo, deux autres auxiliaires des Swahili (Nyampara) (Muteba, K.N., 1979 : 240-242).
Les raids swahili, comme on le constate, auront atteint le cœur du pays. L’État Indépendant du Congo, décrété à Vivi en juillet 1885, se chargea de mettre fin à cette domination en organisant des campagnes anti-esclavagistes. On aspirait alors à l’instauration d’un nouvel ordre politique.
En attendant, l’on peut mesurer l’ampleur mais aussi la profondeur de cette autre activité négrière. Les données chiffrées sont suffisamment éloquentes, sur base des seules recettes de douane de Zanzibar. En 1810, elles indiquaient 10 000 esclaves importés par an de 1830 à 1873 ; la moyenne annuelle n’était pas inférieure à 15 000 soit 700 000 pour le siècle. Il faudrait pour bien faire y ajouter les exportations des autres villes et surtout le nombre d’individus morts avant d’atteindre la côte. Il arrivait que Zanzibar exporte vers l’Asie 20 000 esclaves par an (Deschamps, H., 1971 : 290). En conclusion, le chiffre total des esclaves exportés à Zanzibar devait approcher le double des estimations, soit 1 400 000 personnes.
Reconsidérons ce commerce comme un phénomène global. En se situant à la fin du XVIIIe siècle où l’on devait faire un double constat : d’abord celui, déjà évoqué, de la généralisation de l’emprise commerciale sur toute l’étendue du pays, ensuite celui d’un nouveau « découpage » de cette région du continent, à partir de ce phénomène.
Que le commerce à longue distance soit devenu un phénomène généralisé, c’était une évidence. Toutes les populations en ressentaient les effets. Si l’on n’était pas soi-même courtier, c’est qu’on était à tout le moins victime, réelle ou sinon potentielle, des raids de ce dernier. En considérant ce courant généralisé, il faut cependant demeurer sensible à l’évocation interne du phénomène, au risque de ne pouvoir se rendre compte d’un aspect important du problème. Cette activité commerciale a connu elle-même des variations, non seulement d’une région à l’autre, mais aussi d’une période à l’autre. Elle n’a pu avoir qu’une intensité variable et a, du reste, suscité des réactions inégales, parfois même divergentes. Si l’appel de la côte atlantique a démarré très tôt au XVe siècle, celui de la côte orientale et surtout de la région soudano-égyptienne a attendu le XVIIIe siècle pour prétendre à un intérêt équivalent.
Par ailleurs, la structure même du commerce a connu des modifications ; tant qu’elle était dépendante de la traite des esclaves, elle était un phénomène essentiellement côtier mais dont les résonances atteignaient, il est vrai, les régions lointaines. Mais il se fait que, à partir de la fin du XVIIIe siècle, et surtout au début du XIXe siècle, on se mit à passer de la recherche de l’esclave à celle de plus en plus exclusive, des produits de « cueillette » : ivoire, huile de palme, etc. C’est le passage du commerce « illégal » au commerce « légal ». L’esclave devint un sous-produit, même si une diminution vraiment sensible du volume de transactions, particulièrement à l’Est, n’interviendra pas avant le début du XXe siècle (Curtin, P.D., 1969 : 266).
Ce changement fut important : si jusqu’ici les négociants européens dirigeaient le commerce à partir de leurs bateaux, désormais il sera question de les quitter pour créer des comptoirs commerciaux à l’intérieur du pays ; le passage des produits de cueillette d’un groupe à l’autre nécessitait la multiplication des relais dans les circuits de commerce à longue distance. L’arrière-pays commença donc à être valorisé. C’est d’ailleurs dans le cadre de cette valorisation que l’Arabe et l’Européen ressentirent le besoin de se rapprocher de la source de ces produits nouveaux, de monopoliser au besoin les mécanismes de leur transmission.
La quête désormais plus systématisée des produits de cueillette allait avoir d’autres conséquences. Les produits ne circuleraient pas seulement par système de relais, au gré du hasard, en passant d’un marché à l’autre jusqu’à parcourir des distances importantes, mais ils bénéficieraient du système de réseau réservé jusque-là au trafic des esclaves. On organisa des caravanes pour acheminer la marchandise à travers d’autres territoires ethniques et linguistiques jusqu’au point d’arrivée prévu. Contrairement au système de relais, le système de réseaux entraînait un plus grand brassage de populations, et faisait oublier les frontières, qu’elles soient d’ordre politique, linguistique ou ethnique, en même temps qu’il rendait le terrain propice à l’accueil d’autres modes de structuration de l’espace.
C’est précisément ce qui allait se passer. La projection spatiale de l’activité commerciale généralisée en Afrique Centrale amorça un nouveau découpage en fonction de ce phénomène. On vit apparaître de véritables « régions » regroupant en leur sein des Etats ou des ethnies subissant une même emprise commerciale. A la faveur d’un tel contact, d’autres sociétés ethniques, même politiques, voyaient le jour aux côtés des anciennes qui, dans certains cas, s’affaiblissaient au point de se laisser dominer par les nouvelles.
A la fin du XVIIIe siècle, trois grandes régions commerciales se partageaient l’ensemble de l’espace du Congo [6]. Il s’agissait de la région dite du Grand Commerce du fleuve, la région du commerce luso-africain et la région Swahili. Repérons d’abord de manière plus précise ces régions commerciales, avant de considérer les transformations qu’une telle structuration a pu entraîner. On parlera ici de « région » pour qualifier un ensemble commercial, celle-ci pouvant réunir en son sein plusieurs « espaces » plus particuliers.
2.1 La région du grand commerce du fleuve
Le premier grand réseau commercial était celui qui, commençant à la côte atlantique, se prolongeait dans le cours supérieur du fleuve y compris dans ses affluents : Kasaï, Ubangi. Qualifions cette région de Grand Commerce du Fleuve (Mfiri, M., 1973 ; Sabakinu, K., 1981 : 31-43). Telle qu’elle apparaissait au XIXe siècle, elle constituait la jonction de deux espaces commerciaux distincts, l’espace du Bas-Fleuve et l’espace du Haut-Fleuve réunifiés désormais par le grand marché de Pumbu.
L’espace du Bas-Fleuve couvrait la zone de l’embouchure depuis Ambriz jusqu’à Loango environ, englobant les territoires des anciens royaumes de Loango, Kongo et se prolongeant dans l’arrière-pays, dans les territoires des Yaka et des Teke. Les factoreries côtières exerçaient donc une forte attraction qui se faisait sentir jusque dans la région du Pool. La suppression de la traite et plus tard l’ouverture par Brazza de la route du Haut-Ogoué vers la côte allaient élargir sensiblement l’étendue de cette zone vers le nord-ouest. Ceci ne fera qu’augmenter l’importance de la région du Pool dont les marchés étaient censés pourvoir les côtes en marchandises.
Les nouveaux modes de transactions commerciales du XIXe siècle nécessitèrent la diversification des voies reliant le Pool à la côte. On en relève quatre principales. La première, partant de Pumbu, conduisait au grand marché de Kimbalambala en Angola, en passant par Musuku et Mbanza Kongo. C’était l’ancienne route fréquentée par les Pombeiros du XVIe siècle et qui menait du Pool à Luanda. La deuxième se contentait de longer la rive gauche du fleuve jusqu’à aboutir à la côte. Avec la troisième, on longeait la rive droite, en passant par Borna puis Banana avant de joindre la côte. Cette route sera la plus fréquentée dans la deuxième moitié du siècle car elle présentait une possibilité de connexion avec l’itinéraire menant à Loango. La quatrième voie est celle qui choisissait de traverser la région du Mayumbe et aboutissait à Borna. Par toutes ces voies, toute une zone économique dynamique prit son envol, polarisant l’ensemble du Bas-Congo actuel, c’est-à-dire, toute la région située en aval du Pool.
Il faut noter, dans ce contexte, l’essor de deux principaux centres dans le Bas- Fleuve : Borna et Banana. L’importance de Borna était en réalité bien antérieure à cette époque, à en croire les témoignages des voyageurs et missionnaires qui le visitèrent dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. C’était déjà, suivant les estimations de l’époque, « une grande île extrêmement peuplée et très bien approvisionnée » (Bontinck, F., 1979b: 298-299). Les témoignages du XIXe siècle mettent l’accent, de manière plus explicite encore, sur l’importance marchande de ce centre. On y trouvait une centaine de maisons, la ville était fréquentée par des populations de l’intérieur. Des navires y étaient constamment présents ; parmi les commerçants installés, il y avait des grossistes et des détaillants, véritable préfiguration d’une métropole moderne (Tuckey, J.F., 1818 ; Hubaut. P., 1953 : 314-315). Banana démarra plus tardivement, en 1853, à la suite de l’installation des factoreries portugaises d’abord, hollandaises et anglaises ensuite. Le site était attrayant ; il s’offrait comme un véritable port naturel en eau profonde, endroit rêvé pour ceux qui entendaient s’installer en dehors de Cabinda où l’influence portugaise était trop forte (Bontinck, F., 1976b : 218). D’ailleurs la zone côtière de l’ancien Kongo était l’unique zone qui échappait à l’occupation politique effective des Portugais, à cause de l’importance qu’y attachaient toutes les grandes puissances intéressées au commerce sur le fleuve.
A partir de Pumbu, en direction de l’amont, s’étendait l’autre partie de la région du fleuve. L’espace du Haut-Fleuve couvrait en fait l’ensemble du réseau fluvial : le Kasaï, la Mfimi conduisant jusqu’au Lac Maindombe ; l’ensemble des affluents de gauche entre le Sankuru et la Lulonga ; la Mongala, la Ngiri et surtout l’Ubangi sur la rive gauche, la Sanga, la Likuala-Mosaka et l’Alima situées au Congo/Brazza. Bref, toute la partie ouest du bassin du fleuve se retrouvait dans cet espace qui ne s’effaçait que dans les régions du Sud et de l’Est où il subissait la concurrence des activités de la région luso-africaine et de la région swahili.
Le Pool, ou plus précisément le marché de Pumbu constituait donc un point de jonction. Le mode de transport était différent de part et d’autre de ce point. D’un côté, il était d’ordre fluvial et de l’autre, il passait pour être terrestre. Pourtant, malgré ces différences, c’est la même production qui était écoulée depuis les régions lointaines de l’Equateur et du lac Maindombe jusqu’aux ports situés sur l’Atlantique. Il s’agissait surtout de l’ivoire, de la cire et d’autres produits encore tels que l’huile de palme, l’arachide, etc. Les produits importés, quant à eux, faisaient le trajet inverse. Ils consistaient essentiellement en baguettes de métal mitako pouvant servir à la fois de moyens d’échange et de matière pour le travail de la forge, perles, tissu, et armes. Il faut donc savoir qu’à l’époque c’est de la côte atlantique que provenaient la plupart des métaux non ferreux consommés sur le fleuve et même jusqu’au Haut- Ubangi.
Outre ces échanges à grandes distances, il faut noter aussi l’intensité de la circulation de la production locale à des niveaux plus restreints. Dans l’espace du Haut- Fleuve particulièrement, on notera une grande activité dans le domaine, entre populations « terriennes et riveraines » plus soucieuses, par la force des choses, de leur complémentarité au point de vue de la production. Le poisson était ainsi échangé contre de la viande, du vin de canne à sucre ; le produit agricole des marais (la banane) s’offrait en échange contre d’autres productions : artisanat ou vannerie, etc. (Mumbanza, M.B., 1979a : 131-132).
Une série de peuples s’étaient spécialisés dans l’activité commerciale de cette région, se relayant pour acheminer les produits exportables, c’est-à-dire ceux qui étaient recherchés par les Blancs, jusqu’aux ports atlantiques et, en sens inverse, pour ramener jusque dans l’arrière-pays les produits importés, c’est-à-dire ceux que les Blancs offraient. Ces peuples marchands étaient nombreux : le circuit Mfimi- Lukenye-Lac Maindombe était dominé par les Borna (Nunu, Dia), ainsi que les Ntomba et les Bolia au niveau du lac (Tonnoir, R., 1970 : 114 ; Bentley, W.H., 1900 : 65). Sur la Ruki, les peuples marchands avaient l’habitude de s’adonner à de longues expéditions commerciales pouvant durer plusieurs mois ; ils menaient également leur activité sur la Busira et la Lomela (Boelaert, E., 1956 : 191-211). Sur la Ngiri et l’Ubangi, on retrouvait les Loyi, riverains de la Ngiri, et les Bobangi.
La Sangha, la Likuala-Mosaka et l’Alima subissaient le même type d’exploitation commerciale. Les Likuba d’Alima, en contact avec les Mboshi, venaient rencontrer à Bonga les gens de la Haute-Sangha et les marchands de l’Ubangi qui échangeaient volontiers du manioc, de l’huile de palme et les produits de vannerie contre l’ivoire et le ngola (Sautter, G., 1966 : 271 ; Coquery-Vidrovitch, C., 1971).
Mais ces différents circuits régionaux aboutissaient tous à la seule voie principale qui était celle du fleuve. Avant d’aboutir au Pool, cet ensemble de produits passaient par les mains des Teke et des Bobangi, les deux plus grands peuples marchands de cet espace commercial. En amont du confluent de l’Ubangi, le commerce fluvial était l’affaire des Bangala, population composite, dont l’identification est malaisée. H.M. Stanley qui fut le premier à employer le mot Bangala en 1877 pour qualifier le peuple du Haut-Fleuve (Stanley, H.M. 1878 : 286-287), se rendit vite compte qu’il était pour le moins confus. Mais il était trop tard pour retirer de la circulation un terme qui avait déjà tant de succès d’autant qu’il qualifiait le peuple le plus belliqueux du fleuve. C’est après Stanley qu’on accordera à ce terme une plus grande extension, l’étendant pratiquement à tous les riverains de l’entre-Congo-Ubangi (Coquilath, C., 1888 : 244-245, 248-249). L’administration de l’État Indépendant du Congo s’en mêlera aussi en appliquant le terme « Bangala » aux habitants du district des Bangala créé en juillet 1895. Cette appellation incluait donc aussi les Ngbaka, et les Ngombe [7].
En définitive, il faut s’entendre sur l’usage de ce terme. D’aucuns se sont proposé de décoder l’énigme qui a été à la base de l’apparition de ce terme. (Van Overbergh, C. et Jonghe, E., 1907 : 55-56 ; Van der Kerken, G., 1944 : 187 ; Burssens, H., 1958 : 37) ; Mumbanza a fait le point de la question en essayant de fixer l’emploi de ce mot (Mumbanza, M.B., 1973 : 471-483). En fait, son origine même est fort confuse. Provient-il de « Mongala » (bras du fleuve), de « Bai ngele », « Batu ba ngele » (gens d’aval), ou au contraire de « Bai Mankanza », « Batu ba Mankanza » (gens de Mankanza) comme le suggère cet auteur ? Cette opinion est contestée par G. Hulstaert qui estime que c’est à partir du seul mot « Mongala » qu’il faut chercher cette étymologie (Hulstaert, G., 1974a : 178-179). Quelle que soit l’origine africaine du mot, son emploi est d’origine européenne, forgé par les circonstances, à la fin du siècle.
Ce terme est tombé bien à propos, puisqu’il venait sanctionner la multiplicité des peuples riverains de l’entre-Ubangi-Ngiri et le fleuve, en pleine homogénéité culturelle et linguistique. Cette unité virtuelle a donc trouvé un signifiant qui l’explicite. Le mot « Bangala », une fois introduit dans le langage, ne pourrait plus jamais en être exclu : il faut s’en réjouir (Tanghe, J., 1930 : 344). Il affecte les « gens d’eau », les démarquant de la sorte des Mongo et des Ngombe, encore que, dans la pratique des choses, il inclue parfois dans cet emploi des éléments limitrophes, notamment Ngombe, et parfois même Mongo.
L’homogénéité culturelle et linguistique des « gens d’eau », fortement ressentie de l’intérieur par notre historien de l’Equateur, l’a poussé à avancer l’hypothèse d’une ethnie de Bangala. A quoi Hulstaert rétorque que l’autonomie culturelle des « gens d’eau » n’est pas certaine puisqu’il y a une forte ressemblance avec les Mongo. Cet argument est évidemment faible, ne serait-ce que parce que la ressemblance culturelle entre deux groupes ethniques donnés ne signifie pas forcément I absence d’une autonomie de leur part [8]. Il reste cependant un problème car la projection d’une homogénéité culturelle ne constitue pas forcément non plus une ethnie. Dans le cas présent, il faut considérer la naissance d’une ethnie bangala comme un phénomène de la fin du XIXe siècle, avec la naissance de la prise de conscience de l’existence de cet ensemble. Cette ethnie réelle s’est élaborée à partir d’une ethnie virtuelle que constituait le grand ensemble des gens d’eau qui ne réalisaient sans doute pas encore vraiment le lien qui les unissait par rapport aux autres (Ngombe- Mongo).
En principe, les Bobangi constituent aussi un groupe bangala (Harms, R., 1979 ; 1981). Les grands maîtres du commerce sont ceux-là mêmes qui donnèrent à l’Ubangi son nom actuel, en la laissant s’appeler « Mai ma Bobangi ». Georges Grenfell, explorant cette rivière, l’appelait encore « Mai Mobangi » avant que les cartographes transforment ce nom en Ubangi (Johnston, H., 1908 : 529-530). La surpopulation qui affecta le bief inférieur de l’Ubangi les contraignait à émigrer du Bas-Ubangi pour occuper la zone riveraine s’étendant du Kwa à l’Ubangi. Cette expansion en aval de leur habitat originel se situe vraisemblablement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à moins que ce soit plus tard, dans la première moitié du XIXe siècle (Harms, R., 1979 : 35-40). Ce peuple que plusieurs voyageurs étrangers qualifient erronément de « Yansi », était au départ fort restreint. Il a acquis une plus grande importance au XIXe siècle grâce à l’absorption des éléments autochtones et à l’intégration des esclaves capturés (Mfiri, M., 1973 : 52-53). Cette situation confortable l’autorisait à contrôler tout le trafic qui s’effectuait entre le Kwa et l’Ubangi ; simultanément, ce commerce favorisait la progression démographique.
Cette situation d’échange n’a pu se mettre en place sans poser un problème de langue. Un tel commerce ne pouvait en effet se réaliser sans les instruments de communication linguistique adéquats. Les nécessités de circulation allaient y pourvoir en créant des conditions favorables à l’éclosion de langues plus simplifiées par rapport à celles des ethnies en présence. Dans l’espace côtier, c’est parmi les esclaves entassés pendant des mois à la côte, attendant d’être assez nombreux pour pouvoir embarquer, que serait née une certaine langue de traite. A partir des besoins de communication entre ces personnes d’origines linguistiques diversifiées, on comprend que soit né un parler situé « à mi-chemin » entre les différents dialectes Kongo (Houis, M., 1971 : 128-133 ; Fedherau, H.W., 1966). Le kikongo, appelé alors le Fioti, était né [9]. Il ne restait plus qu’à l’enrichir avec une série d’emprunts d’origine portugaise, anglaise et française, langues des négriers, avant que les Pombeiros et autres courtiers ne se chargent par la suite de sa diffusion dans l’arrière-pays jusqu’au Pool et tout au long de leurs itinéraires terrestres dans le Kwango et le Kwilu.
Dans l’espace du Haut-Fleuve, on constata le même type de phénomène. Les échanges commerciaux ne pouvaient se faire plus longtemps sans l’existence d’un outil de communication approprié. Une langue commerciale devait nécessairement voir le jour et elle se fit qualifier de lingala, marquant ainsi sa relation avec les Bangala, les riverains du fleuve. Les conditions de naissance de cette langue paraissent évidentes, après que de nombreux travaux datant du début de ce siècle lui ont été consacrés, au moment où elle se réalisait comme l’une des principales langues nationales. En fait, tant que les échanges commerciaux restaient cantonnés essentiellement au sein de la Cuvette – ce qui fut le cas jusque dans la première moitié du XIXe siècle – cette langue de contact n’avait pas de raison d’être. Les hommes de la Cuvette usant tous des langues de la Zone C arrivaient toujours à se comprendre. Les parlers Ngombe, Mongo et ceux des riverains tendaient à se rapprocher, les uns assimilant facilement et avec bonheur les dialectes des autres. Mais le développement du commerce à longue distance dans la deuxième moitié du siècle accentua les contacts avec les riverains méridionaux, notamment les Bobangi, avec les courtiers Tio qui les mettaient en contact avec les marchands Kongo. Il fallait s’initier à un nouveau registre lexical fait de termes techniques qualifiant les nouveaux produits et les nouveaux systèmes d’échange. Le nouveau langage fut véhiculé dans le pays des eaux et se fit passer pour la langue nouvelle des Bobangi. En fait, elle l’était au point de départ mais elle s’était enrichie d’emprunts nouveaux issus du Pool et du Bas- Fleuve. Il y eut ensuite un autre apport, celui qui fut façonné à la faveur des premières installations d’Européens dans la région. Au départ, ils ne connaissaient que leur langue (portugaise, anglaise, française) ou celles des régions déjà « explorées » (Swahili, Kikongo, Haoussa, etc.). Dans leur apprentissage de la langue locale, ils ne pouvaient s’empêcher de l’enrichir de mots issus de ces langues surtout si ces signifiants faisaient défaut dans les parlers locaux. Le lingala s’appauvrissait en s’enrichissant. En tout cas son identité s’affermissait. Cette même simplification le vouait à une expansion facile. Pour l’heure, sa zone d’extension entrait en compétition avec celle du Kikongo, en aval du Kwa. Vers le nord, elle rencontrait le domaine du Sango, langue de traite de l’Ubangi. Le recul du Sango par rapport au lingala, noté au XIXe siècle, accusait une réalité d’extension de l’espace du fleuve qui érodait en quelque sorte l’espace de l’Ubangi (carte 15).
2.2 La région du commerce luso-africain
Au sud de la région du grand commerce du fleuve, se trouvait la région du commerce luso-africain, région vaste dont la structure commerciale passe pour être la mieux connue. La région partait des ports angolais (Loanda et Benguela). Elle s’étendait dans la grande partie de la savane du sud, dans le Congo méridional et I Angola septentrional. Au XIXe siècle, cette extension englobait les terres du Kasaï mais aussi la partie méridionale de la Cuvette Centrale où elle rencontrait 1 espace du fleuve. Plus nettement dans le sud, elle traversait le Katanga, continuait vers le Haut- Zambèze, touchait la côte indienne, du moins avant la grande période de la traite orientale. Avec les Yeke, l’extension orientale s’arrêtera pratiquement au Katanga pour laisser la place plus loin à la région du Swahili. Ce commerce, comme on l’a dit, était le mieux structuré. Il jouissait du reste d’une avance confortable puisqu’il était déjà intense pendant les siècles d’or de la traite. Ce commerce était purement terrestre et employait un nombre impressionnant de pombeiros ; ses itinéraires étaient fort fréquentés par des caravanes (Vellut, J.L., 1970 : 75-136 ; Tambwe, L.L., 1971).
Notons ici aussi l’existence d’un certain nombre de peuples marchands. Dans toute la partie congolaise et angolaise, de fameux commerçants se recrutaient parmi les Cokwe et les Ovimbundu. Au Kasaï, les Cokwe se faisaient relayer par les Luluwa. Au Shaba, ce sont les Lunda qui étaient les maîtres de ce trafic, avant que les Yeke ne s’en mêlent et orientent cette partie du commerce dans le cadre d’une autre région commerciale.
On peut s’étonner qu’aucune langue de traite ne soit parvenue à s’imposer. Pourtant, implicitement, on peut dire qu’il y en avait une, dans la mesure où les plus grands maîtres de commerce étaient de culture Lunda (Yaka, Cokwe, Ruund, etc.). Plus tard, lors du partage de l’Afrique par les Occidentaux (1885), une grande part de cette région fut cédée aux Portugais. C’était la colonie d’Angola. Le peu de souci qui les caractérisa en matière de promotion de langues locales, du moins par rapport aux Belges, justifie sans doute le fait que la langue lunda n’ait pu obtenir un retentissement égal à celui qui fut attribuée aux langues de la colonie belge (Lingala – Kikongo). Mais la langue ovimbundu qui jouait également ce rôle dans la partie angolaise a conservé son audience jusqu’à ce jour.
Une troisième réalité commerciale, la région Swahili, était tournée vers la côte orientale. Tout partait en effet de cette côte, particulièrement de Zanzibar qui, au XIXe siècle, restait le débouché principal et la grande source de financement de cette région. Depuis cette côte, l’accès au Congo passait par deux itinéraires : celui de Bagamoyo, Tabora puis Udjidji sur la rive du Lac Tanganyika [10], et celui de Kilwa jusqu’au lac Nyassa, reconquis pratiquement sur le commerce luso-africain. Cette voie sera fort fréquentée, vers 1865 pour écouler les produits du marché de Bunkeya. Mais la voie la plus courante était celle de Tabora – Udjidji.
Le Maniema constituait le centre de cette région. On peut estimer que c’est la partie congolaise la plus imprégnée de culture arabe. Même le mot Maniema dont on pensait qu’il voulait dire le « pays des forêts » rempli des « mangeurs d’hommes » serait simplement d’origine arabe (Manama) et signifierait « lieu où l’on dort », « pays où l’on vient se reposer » après des razzias opérées dans la périphérie [11]. Le premier marchand swahili qui s’installa dans le Maniema se fixa à Nyangwe (Cornet, J., 1952 : 20). De là, s’est établie une zone d’influence à partir de laquelle on pouvait s’aventurer plus loin. Partout où ils passaient, les Swahili créaient une série de postes, véritables relais et points de diffusion de leur commerce qui étaient sous l’autorité des « sultans », tous soumis à Tippo-Tip, le plus grand traitant du pays. Les sultans les plus fameux qu’on ait pu connaître furent Rashidi aux Falls, Kibonge à Kirundu, Bwana Nzige à Kabambare et surtout Mwinyi Muhara et Sefu qui régnaient respectivement à Nyangwe et à Kasongo. Les sultans ne travaillaient pas seuls. Ils se faisaient épauler par des collaborateurs autochtones appelés Nyampara et à qui incombait l’organisation du trafic. Les plus connus parmi ces collaborateurs furent Ngongo Leteta chez les Tetela et Lumpungu chez les Songye. Le kiswahili, au point de départ une langue bantu de la région côtière, s’est enrichie très tôt largement des emprunts arabes. C’est sous cette forme qu’il s’est diffusé suivant les multiples itinéraires évoqués ; des courriers furent établis pour permettre aux sultans swahili d’être au courant de la situation générale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région. A l’actif de ce commerce, signalons un certain nombre d’apports sur le plan social et agricole. Des remèdes connus dans le monde arabe et efficaces pour enrayer certaines maladies tropicales furent introduits. C’est ainsi que les Yeke venant de l’outre-Tanganyika purent introduire le vaccin contre la variole, déjà bien présent dans le monde swahili. Par ailleurs, le développement du commerce avait suscité une concentration humaine autour de certains postes tels que Kasongo et Nyangwe. C’est ainsi que ces premières villes du pays avaient été créées. C’est à cette époque que furent introduites plusieurs plantes d’origine orientale notamment le riz, le sorgho, les oignons, les tomates ainsi que certains arbres fruitiers (avocatier, goyavier, citronnier, oranger, manguier, etc.) (Nicholls, C.S., 1971 ; Renault. F., 1971 ; Barahimu, 1973).
Mais tout ceci ne constituait qu’un seul espace ; un autre espace était celui du commerce soudanais. Au départ, une région autochtone, le nord du pays à partir de l’Ituri était devenu un ensemble lié au Soudan oriental et central. C’est pourquoi on l’appelle région soudanaise. C’est vers 1860 que des commerçants soudano- égyptiens, habitant le Bahr el Ghazal, parvinrent à l’Uélé à la recherche d’ivoire, protégés par des fusils. Ils étaient aussi en quête d’esclaves qu’ils obtenaient en échange de tissus, de perles et d’armes. Plus tard, ces prospections, loin de rester sporadiques, seront systématisées car le commerce dans cette région deviendra un monopole étatique. S’il ne s’effectuait que par une seule voie, de 1 Uélé à Dem Ziber au Soudan, à partir de ce point, il connaissait l’existence de plusieurs pistes. La première est celle qui se dirigeait vers le grand marché de Kuba au sud-ouest du lac Tchad et de là vers le Fezzan, porte d’entrée vers Tripoli et la Basse-Egypte ; la deuxième piste conduisait, quant à elle, à Khartoum. De là, elle se dirigeait soit vers la mer Rouge et l’Arabie, soit vers la Basse-Egypte en descendant le Nil. Lorsque la révolte madhiste (1884-1885) mettra fin à la mainmise des marchands soudanais sur cette région, celle-ci fusionnera avec l’espace swahili, prolongeant ainsi cette région économique vers le nord. Nous sommes aux environs de 1890 (Tshund Olela, E., 1981 : 134-135).
Même en admettant que cette région a été absorbée par une autre, il reste encore une zone distincte, celle du Kivu qui s’étend du Tanganyika au lac Kaihura (ldi Amin) tenue longtemps sous la coupe des royaumes interlacustres. Protégée par son relief peu favorable aux traversées des caravanes, cette partie du pays a longtemps échappé au commerce swahili, avant d’y être insérée mais de manière partielle. Ce sont davantage les implications culturelles de la présence swahili qui ont envahi cet espace, et avec un bonheur certain, sans que l’activité commerciale puisse finalement s’y installer. Avec ces trois zones, l’espace du Maniema, l’espace soudanais et l’espace agro-pastoral du Kivu, la région swahili passait pour être la plus vaste, contrôlant tout l’est du pays.
Que retenir de cette période ? On notera d’abord l’apparition de rapports de violence dans tout l’espace congolais, inaugurés avec la « chasse à l’homme ». D’un bout à l’autre, on constate la formation de bandes armées interethniques, s’équipant auprès des factoreries et semant l’insécurité. A l’ouest, c’étaient des groupes lunda, yaka, cokwe et ovimbundu ; au centre, il y eut des bandes songye, tetela et luba qui, dans le sillage des conquérants swahili, s’étaient initiés à l’art de détruire (sambala). De toute façon, quand cette violence n’était pas le fait des autochtones, elle provenait de personnes externes ou semi-externes : Pombeiros, Swahili, Soudano-Egyptiens, etc.
Sur cette toile de fond faite d’insécurité, venaient s’inscrire une série de transformations politiques. D’abord le pouvoir politique tendait à dépendre davantage de l’argent que d’une préoccupation de légitimité. Ce principe entraînait plusieurs conséquences. Dans la région swahili et même dans l’espace côtier où il a existé une floraison d’Etats, certaines chefferies profitaient de la situation pour se libérer de la tutelle d’une cour lointaine ou encore pour en imposer à des voisins jusque-là insoumis. Le premier cas est celui des chefferies Kongo ou Teke qui devinrent indépendantes par rapport au Mani Kongo ou à Makoko ; le second est celui de quelques Balopwe qui tentèrent d’imposer leur pouvoir jusqu’au Tanganyika. Il y eut aussi les Ant Yav qui projetèrent de placer sous tutelle des populations lointaines (Salampasu, Kete). Les Etats érigés sur cette base commerciale connurent un développement prodigieux (Kiamfu, Mwene Mputu Kasongo, Mushid, Kazembe).
Partout on remarqua l’apparition d’une nouvelle classe de chefs. Il s’agissait en fait de chefs liés au commerce et dont les titres, plus ou moins fantaisistes, reposaient sur des relations d’échange avec les marchands et sur l’accès aux armes à feu ; le cas le plus typique se situe dans la région swahili puisqu’il existait deux types de chefs, avec compétences différentes. Le réseau de chefs légitimes constituait l’autorité autochtone, propriétaire du sol. Le réseau des chefs « parvenus » était constitué d’auxiliaires des Swahili s’occupant du commerce. Le second réseau, plus puissant que le premier, détenait le vrai pouvoir : il reposait sur la force militaire. Avec Tippo-Tip, le pouvoir autochtone fut réduit à sa plus simple expression au point de tendre à un amenuisement complet puisque les chefs autochtones étaient désormais imposés par les maîtres swahili.
Disons, en manière de synthèse, que le développement du commerce correspondait à une prolifération des chefs, signe d’une redistribution des forces, les chefs commerçants arrachant aux chefs traditionnels leurs prérogatives. D’ailleurs, au plan de la gestion, le pouvoir politique, afin de servir les impératifs du commerce, tendra à se segmenter pour ne plus admettre comme ensemble que ceux qui se constituaient sur base de ce critère ou qui se remodelaient en fonction de cette exigence.
Dans le domaine social et culturel, les innovations étaient plus nombreuses encore. Le fait d’une plus grande circulation était déjà en lui-même un bienfait. Il entraînait une amélioration technologique évidente, notamment sur le plan de l’agriculture et de l’artisanat à l’occasion des marchés. Les lieux mêmes où se tenaient ces marchés se constituaient en « gros villages » ; ils représentaient de la sorte les premières expressions d’urbanisation du pays : Boma, Banana dans le Bas-Fleuve ; Pumbu, Bolobo, Lukolela, Mankanza, Upoto, Lisala, le long du fleuve ; Kasongo- Lunda, Musumba, Kapanga, Bunkeya dans la savane du sud ; Nyangwe, Kasongo dans le Maniema, etc. [12](12).
Mais les plus grandes transformations affectaient les populations elles-mêmes où l’on notait un plus grand brassage et une plus grande circulation d’une région à l’autre. Les frontières ethniques perdaient en consistance. Les formations qu’elles délimitaient modifiaient leur contenu sur base des données nouvelles. Cohabitaient à présent, sur le sol congolais, au moins trois types de formations ethniques : celles issues des premiers mouvements de peuplement : Bemba, Mongo, Mbundu, Kete, Luba-Shaba, etc. ; celles qui étaient nées des aventures de l’occupation de l’espace : Luba-Kasaï, Kongo, Kuba, Lunda, et. ; celles enfin qui s’étaient créées à la faveur des campagnes commerciales : Bobangi, Cokwe, Luluwa, Yeke, Bangala. Comme pour les aristocraties politiques, on constate ici que ces dernières formations, forgées à partir de l’entreprise commerciale, étaient les plus dynamiques et évinçaient les anciennes couches ethniques.
Avec le développement du commerce, on constate que les populations congolaises étaient réellement parvenues à un tournant décisif de leur évolution. Du stade traditionnel fait de microsociétés, on passait maintenant au stade moderne avec des macrosociétés. En pratique, les réactions face à ces bouleversements étaient fort variables : les uns, on l’a vu, en ont tiré une nouvelle raison de vivre : de nouveaux États comme de nouvelles sociétés ethniques se sont développés : d’autres y ont vu l’origine de leur déclin. Mais les deux phénomènes passaient pour être les deux versants d’une même réalité. La prospérité tout comme la décadence échappaient désormais complètement à la maîtrise de ceux qui vivaient cette situation de contradiction apparente. Ces réalités dépendaient plutôt des nécessités d’un commerce régi d’ailleurs par l’Européen et l’Arabe au travers de leurs hommes de main : les Pombeiros et les Swahili. Au fond, le destin du pays échappait déjà au contrôle des autochtones incapables de s’opposer à un courant dont ils subissaient à la fois les bienfaits et les méfaits.
La dépendance à l’égard de l’étranger, depuis les côtes, était désormais une donnée tangible. L’occupation sporadique du territoire par le commerce ne pouvait trouver son aboutissement logique que dans une occupation plus efficace de l’ensemble du territoire. Avec la recherche de plus en plus effrénée de produits d’origine agricole (huile de palme, caoutchouc, etc.), on ne pouvait s’en tenir à la même méthode de prélèvement sur le terrain que lors de la quête de l’esclave. A présent, une occupation plus effective de l’espace était indispensable et celle-ci impliquait, selon les impératifs commerciaux, une démarche à la fois politique et militaire. C’est ce qui allait se produire. D’ailleurs, lorsqu’il sera question de passer à ce second stade sous les termes de « l’État Indépendant du Congo » puis du « Congo belge », on partira des acquis de l’occupation commerciale, ce qui met en lumière le rapport de continuité qu’il y avait de l’une à l’autre. Les voyageurs européens, qui se chargeront de sillonner le territoire congolais, utiliseront les mêmes voies que les Pombeiros et les Swahili ; ils feront appel aux mêmes porteurs et aux mêmes guides. Mieux encore, ils se serviront des mêmes auxiliaires, y compris des auxiliaires esclavagistes (Tippo-Tip, Ngongo Leteta, etc.) qu’ils auront intégrés dans le nouveau système [13]. Une ère s’achevait, celle de la libre initiative locale, elle cédait la place à celle de la modernisation par la soumission à un ordre nouveau.
Pourtant, si ces contacts du XIXe siècle avec le monde extérieur avaient été fondés sur des échanges à caractère égalitaire, ils auraient pu avoir des retombées autrement plus intéressantes et favoriser un autre type d’accession à la modernité qui ne passait pas forcément par l’exploitation et la colonisation. Mais, à ce stade, une telle progression était inéluctable.
Texte : Les méfaits du commerce
Cette correspondance du 6 juillet 1526 du roi Dom Afonso du Kongo à son « frère » Dom Joâo III du Portugal explique dans quelle mesure l’influence extérieure introduite à la faveur du commerce est à la base de la destruction du royaume et des structures anciennes. Le roi marque son opposition à l’égard de la traite et de l’introduction des produits importés, tout en se plaignant du comportement du personnel européen.
« Le 26 juin, nous avons appris l’arrivée dans notre port de Sohio d’un navire de V. Altesse. Nous nous en sommes réjouis grandement, car il y avait bien longtemps qu’aucun de vos navires n’avait abordé dans notre royaume en apportant des nouvelles de V. Altesse, nouvelles que nous avons bien souvent souhaitées, comme il est juste. De plus, nous manquons presque complètement de vin et de farine pour le saint sacrifice. Cela, d’ailleurs, ne nous étonne pas tellement, parce que nous nous trouvons souvent dans la même nécessité. Cela prouve, Seigneur, combien les officiers de V. Altesse se soucient peu de nous et ne nous apportent pas ce que nous demandons. Et pourtant, nous avons appris que V. Altesse le leur avait ordonné par décret, car c’était aussi bien le service de Dieu que le vôtre (…).
Seigneur, V. Altesse doit savoir que notre royaume va à sa perdition, de sorte qu’il nous faut apporter à cette situation le remède nécessaire. Ce qui cause beaucoup de dévergondages, c’est le fait que le chef de votre factorerie et vos officiers donnent aux marchands la permission de venir s’établir dans ce royaume, d’y monter des boutiques, d’y vendre des marchandises, même celles que nous interdisons. Ils les répandent à travers nos royaumes et provinces en si grande abondance que beaucoup de nos vassaux, que nous tenions jusqu’ici dans notre obédience, s’en dégagent. C’est qu’ils peuvent désormais se procurer, en plus grande quantité que nous, ces choses mêmes avec lesquelles autrefois nous les maintenions soumis et contents dans notre vasselage et juridiction. Il en résulte un grand dommage tant pour le service de Dieu que pour la sûreté et le calme de nos royaumes et de nous-mêmes.
Nous ne mesurons même pas toute l’importance de ce dommage, car les marchands enlèvent chaque jour nos sujets, enfants de ce pays, fils de nos nobles vassaux, même des gens de notre parenté. Les voleurs et hommes sans conscience les enlèvent dans le but de faire trafic de cette marchandise du pays, qui est un objet de convoitise. Il les enlèvent et ils les vendent. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est entièrement dépeuplée. V. Altesse ne doit pas juger que cela soit bon ni en soi, ni pour son service. Pour éviter cet abus, nous n’avons besoin en ce royaume que de prêtres, et de quelques personnes pour enseigner dans les écoles et non de marchandises, si ce n’est du vin et de la farine pour le saint sacrifice. C’est pourquoi nous demandons à V. Altesse de bien vouloir nous aider et nous favoriser en ordonnant à vos chefs de factorerie de ne plus envoyer ici ni marchands, ni marchandises. C’est en effet notre volonté que ce royaume ne soit un lieu ni de traite ni de transit d’esclaves, pour les motifs énoncés ci-dessus.
Nous demandons à V. Altesse, une fois encore, de l’imposer ainsi, car nous ne pouvons pas, d’une autre manière, remédier à un dommage si manifeste.
Que Notre Seigneur, dans sa clémence, ait toujours V. Altesse en sa garde et vous permette de le servir. Je vous baise les mains plusieurs fois.
De notre ville de Congo, le 6 juillet 1526, Joao Teixeira l’écrivit.
Adresse : au très puissant et excellent prince Dom Joâo, notre frère.
Expéditeur : roi de Manicongo.
(Jadin, L, et Dicorato, M„ 1974, pp. 155-156).
[1] On s’inspirera ici des travaux de Rinchon, D. (1929) de Williams. E. (1968) et de Deschamps. H. (1971).
[2] Cette piste de recherche tendant à démontrer la contribution des Africains à la « construction » du Brésil, fait actuellement l’objet d’une exploration passionnante au départ du Congo (Angenot, J.M., Jacquemin, J.P. et Vincke, J., 1976 ; Santana Braga J., 1977 ; Khang Zulbal. K. et Makwanza. B., 1982).
[3] Quand on passera à la phase du commerce légitime, les Pombeiros se feront relayer par les interprètes qui joueront le rôle d’intermédiaires en matière commerciale (Sabakinu, K., 1979 : 125-131).
[4] Comme expliqué plus loin, Mushid Ngelengwa fut tué le 20 décembre 1891 par le capitaine Bodson agissant pour le compte de l’État Indépendant du Congo. Il fut lui-même massacré aussitôt par les Yeke. C’est à ce prix que cette région du pays échappa à l’Angleterre pour revenir à l’État Indépendant du Congo (E.I.C.).
[5] Ngongo provenait du nom d’un grand chef tetela (Ngongo l’Okole) qui lui avait opposé une résistance farouche avant de se soumettre ; Lotela (du verbe Mbeteta signifiant se promener) lui fut donné comme autre surnom pour qualifier sa grande mobilité en vue des conquêtes. A propos de ce personnage, voir encore chapitre 3 (4® partie).
[6] Voir à ce propos Jewsiewiski, B. (1972 : 227-230). On a préféré considérer l’espace côtier et celui du fleuve comme faisant partie d’un même ensemble, de même celui du Haut-Nil et de la zone Swahili classique.
[7] Bulletin officiel de l’État Indépendant du Congo (E.I.C.), Bruxelles, 1985. p. 230 (Ce district a existé jusqu’en 1932).
[8] Voir à ce propos Mumbanza, M.B., (1973 : 480-483) ; Hulstaert, G., (1974a : 180-185). Voir aussi la réponse de Mumbanza à Hulstaert (1974a : 625-632 ; 1974a : 129-149).
[9] Le Kikongo est également qualifié de Kituba, Mono kutuba ou tout simplement appelé le Kikongo de l’État. On fait allusion ici au fait qu’il a dû être imposé par l’administration qui a ainsi contribué à accroître son extension.
[10] A peu près le chemin de fer actuel de la Tanzanie.
[11] Voir Haddad, A., (1983 : 94-95). Dans les emprunts toponymiques d’origine arabe, l’auteur signale encore Baraka (signifiant en arabe « bénédiction »), Shaba (cuivre jaune = Shabah), Moéro (Murru = Amer).
[12] Les villes » précoloniales » constituent un champ de recherches à peine exploré jusqu’ici (Cf. Randles, W., 1972 : 891-897). La plupart des anciennes villes ont servi de sites pour la naissance de nouvelles villes. Le cas le plus étudié est celui de la ville de Kinshasa (Cf. De Saint Moulin, L., 1971 : 83-119).
[13] Cf. chapitre 3 de cette quatrième partie.



