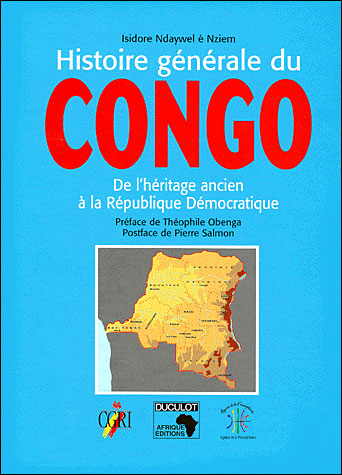
Partie 1 - Chapitre 1 : L'espace et les hommes
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 1
L’espace et les hommes
La tranche de l’Afrique qui constitue le Congo-Kinshasa concerne les quelque 2 345 000 km2 qui s’étendent entre le 5°2′ de latitude Nord et le 13° 15’ de latitude Sud (Gourou, P., 1970 : 279-306) ; en longitude Est de Greenwich, elle va de 12° 15 à 31°15′. Cette position la place exactement au cœur du continent, de part et d’autre de l’Equateur. Par le cours du Congo, de l’Ubangi puis du Mbomu, elle fait ainsi frontière, au nord-ouest avec la République du Congo/Brazza. au nord avec la République Centrafricaine, puis avec le Soudan, du moins dans l’angle nord-est. A l’est, la frontière serre de près l’axe tectonique des Grands Lacs. Cet axe démarque le Congo de l’Ouganda par le lac Albert, la Semliki. le Ruwenzori et le lac Edouard. Il le sépare du Rwanda par le lac Kivu, puis du Burundi par la Ruzizi et le nord du lac Tanganyika. Avec la Tanzanie, la frontière passe par les 600 km du Tanganuika. lac qui a donné son nom à l’ancienne colonie allemande devenue territoire sous mandat au sein de l’administration coloniale anglaise. Au sud. le Congo fait frontière vers l’est avec la Zambie, frontière qui suit la ligne de partage des eaux Congo-Zambèze. Avec l’Angola, la limite des frontières est particulièrement embrouillée : le cours de Kasaï sur 400 km, une ligne suivant à peu près le 8e parallèle joignant le Kasaï au Kwango, le cours du Kwango sur 300 km et enfin, le parallèle de Matadi qui rejoint l’estuaire du fleuve Congo. La frontière occidentale est assurée par le mince littoral du pays sur l’océan Atlantique, puis l’Outre-Congo que constitue la République du Congo/Brazza ville.
La situation géographique de cette région de l’Afrique se trouve être évidemment l’aboutissement de toute une évolution au cours des temps immémoriaux. Le socle de l’Afrique, relativement stable de la fin des temps primaires à la mi-tertiaire, s’est progressivement arasé au cours de cette longue période. Puis entre la mi-tertiaire et la mi-quaternaire, il y eut des changements. Sur la vieille pénéplaine se creusèrent de vastes dépressions, en même temps que les reliefs périphériques s’accentuaient et qu’un nouveau cycle hydrographique et érosif s’installait. L’identité géographique du Congo était née. Au centre de la zone, il y avait une immense cuvette à fond plat ; c’est le bassin du Congo. Sa partie la plus déprimée comprenait non seulement de vastes zones marécageuses comme le lac Maindombe et le lac Tumba, mais aussi de véritables expansions fluvio-lacustres comme tout le bief constitué par le fleuve, depuis l’amont de Bolobo jusqu’au confluent de Lomami. Mais de la zone déprimée vers la bordure de la cuvette, on notait un relèvement graduel, quelle que soit la direction qu’on choisissait. L’élévation la plus impressionnante qui représente l’altitude congolaise la plus élevée se trouve à 1 est du pays, au Katanga mais surtout au Kivu (Robert, M., s.d. 203-268) (carte 1).
Le climat qui prévaut est celui des pays chauds. La moyenne annuelle est de 25° C à la côte, de 24 à 25° C dans le nord à la Cuvette Centrale, le Nord-Katanga, le Kasaï, Kinshasa et le Bas-Congo. Dans les zones montagneuses, la température devient modérée à cause de l’altitude : 19° C à Goma à 1 550 m d’altitude et 20° C sur les hauts plateaux du Katanga.
La température la plus élevée s’observe en mars-avril pour la plus grande partie du pays (Cuvette Centrale, Nord du Pays, Bas-Congo), en septembre pour le sud du Kasaï et le Nord-Katanga, en octobre pour le Sud-Katanga et le long du lac Tanga- nyika. C’est au Katanga que s’enregistre l’amplitude maximale du pays : 23,8° C en octobre et 16,8° C en juillet : une différence de 7° qui atteint 8° dans le sud. Kinshasa et le Bas-Congo connaissent également une amplitude élevée qui atteint 6° à la côte. Ailleurs, elle est plutôt faible et ne dépasse pas les 2° de différence entre les deux mois extrêmes. Dans l’ensemble, le pays est humide, les précipitations dépassent presque partout 1200 mm par an ; le centre de la cuvette recueille plus de 2 000 mm, mais les précipitations diminuent à mesure qu’on s’éloigne de l’Equateur. Les masses d’air sont d’origines diverses : la mousson atlantique qui constitue la principale source d’humidité, l’alizé du nord-est qui souffle du Soudan au cours de la saison sèche du nord, l’alizé du sud-est qui est actif au cours de la saison sèche du sud, le courant équatorial d’est qui souffle de l’océan Indien (Atlas Jeune-Afrique – République du Zaïre : 1978 : 14-15).
L’ensemble du territoire national est fort bien arrosé. Le fleuve Congo dont 1 immense bassin couvre les deux tiers de la surface du pays, l’a pourvu en effet d’un réseau hydrographique dense et bien réparti. Seules deux régions échappent à l’emprise du fleuve : le nord-ouest du Mayumbe drainé par un petit fleuve côtier, le Shiloango, et les abords des lacs ldi-Amin et Albert qui se rattachent au bassin du Nil. Cinquième fleuve du monde par la longueur de son cours (4 374 km), le Congo qui est le symbole de 1 unité du pays, draine effectivement les eaux de toute provenance, alimenté par tout un éventail d’affluents qui sillonnent l’ensemble de l’étendue nationale : la Lubudi et la Lufira du Katanga, la Luvua qui lui déverse les eaux du lac Moero, la Lukunga qui en fait autant pour ce qui concerne le lac Tanganyika, 1 Aruwimi et Htimbiri qui se chargent d’amener au fleuve les eaux du Haut-Congo, le Lomami qui part du Katanga et côtoie le Lualaba pour rejoindre le Congo à Isangi en aval de Kisangani, la Mongala, la Lulonga, Hkelemba, la Ruki et surtout ÏUbangi, réceptacles de toutes les eaux équatoriales ; le Kasaï enfin, riche de ses embranchements : Sankuru, Lukenye, Kwilu, Kwango drainant une véritable masse aquatique. Le fleuve est donc toujours pleinement alimenté par ses affluents du nord et du sud de l’Equateur, ce qui lui assure un débit de 21 à 75 000 m3 par seconde en moyenne, le second du monde après l’Amazone (Gourou. P.. 1970 : 279).
Le manteau végétal qui couvre les différentes régions du pays demeure tributaire de l’identité géologique et hydrographique. Son histoire révèle que celui-ci, en gros, n’a pas subi de modifications physiologiques importantes depuis le tertiaire. Si sa composition a dû se modifier, c’est à la suite des variations climatiques et des changements subis dans faire d’extension de la forêt, ce qui aurait provoqué des phénomènes d’adaptation. La régression de la forêt semble avoir également été accentuée par l’action de I homme. En effet, nombre de savanes congolaises le seraient devenues à cause de l’homme et la savane arborescente, comme celle du Katanga, ne serait elle-même que de la forêt dégénérée. Avec toutes ces vicissitudes qui justifient sa physionomie, le paysage végétal congolais s’offre au visiteur de manière simplifiée. Dans la cuvette centrale s’étend la forêt toujours verte : celle-ci se prolonge, sous forme de galeries, le long des cours d’eau qui l’entraînent au-delà des zones à climat équatorial. La forêt, suivant les estimations des spécialistes, couvre 43 % du territoire national. Elle occupe, en plus de la Cuvette Centrale où elle est sempervirente, la région du Mayumbe dans le Bas-Congo et les approches immédiates des cours d’eau. Au-delà de la forêt, c’est la savane qui domine le paysage congolais, savane herbeuse dans le Kasaï et le Sud-Bandundu, savane arborescente dans le Katanga et le Kivu où elle a l’avantage d’avoir l’allure de la forêt mésophile de montagne (Delevoy, G., s.d. : 1-74) (Carte 2).
Il faut savoir que ce paysage abrite en son sein une faune diversifiée, naguère abondante, mais qui va s’appauvrissant à cause de l’action destructrice de l’homme. Aucun inventaire exhaustif n’a pu être établi de tous les éléments de la faune locale, sauf peut-être pour les oiseaux et les papillons. Cependant, même partiellement décimée, celle-ci demeure encore impressionnante : mollusques, crustacés, insectes, poissons, reptiles, mammifères, carnassiers, etc. Tant de ressources naturelles sont au service de l’homme qui leur fait subir sa loi. en dépit des risques que cela entraîne. En effet, s’il faut rechercher le gibier, il faut par ailleurs redouter la morsure du serpent qui habite, lui aussi, le même environnement. La nature qui offre à l’homme l’approvisionnement nécessaire pour sa subsistance lui est donc également hostile ; c’est ainsi que, sur l’espace congolais, comme partout ailleurs, l’homme n’a pu subsister que dans la mesure où il est parvenu à dominer la nature ou du moins une partie de celle-ci.
Dans son ensemble, la population congolaise a été estimée à 24 320 000 en 1974 et à 30 981 382 habitants en 1985 (Atlas Jeune-Afrique. République du Zaïre, 1978 : 34 ; De Saint Moulin L., 1978 : 20-58) suivant les projections établies à partir des chiffres des recensements de 1970 et 1974.
Compte tenu de sa superficie, on peut estimer que le pays est fort peu peuplé. Toutefois, les perspectives de la croissance de la population demeurent prometteuses. Déjà entre 1937 et 1970, en près de 30 ans, la population aurait doublé. Au rythme de croissance enregistré pendant la période 1970-1974, ce doublement se serait réalisé en 23 ans seulement ; le taux de croissance demeure en effet fort élevé par rapport au taux de natalité. On comprend alors que la population congolaise soit essentiellement jeune et ce constat vaut pour toutes les régions du pays. Si celui- ci compte encore une grande majorité de ruraux, la croissance urbaine, libérée avec la décolonisation, connaît une réelle accélération depuis trois décennies.
Déjà en 1980, la population urbaine était estimée à 40 % de la population totale alors qu’en 1970, elle n’en représentait que 23 %. En effet, cette croissance urbaine a été provoquée par un exode rural important, toujours en cours, soutenu par une forte natalité. C’est ainsi que, dès 1970, le Congo comptait une soixantaine de villes de 5 000 habitants ou plus, parmi lesquelles au moins onze dépassaient les 100 000 habitants (De Saint Moulin, L., 1977 : 35-52). Cela ne va pas sans poser de nombreux problèmes socio-économiques, fort bien identifiés par les études du B.E.A.U. (Bureau d’Etudes et d’Aménagement Urbain) du moins en ce qui concerne les budgets ménagers [1].
La variation de la population est assez sensible d’une région à l’autre. Les projections dont on avait fait mention fournissaient la répartition ci-après par régions pour l’année 1985 : 3 302 665 pour la ville de Kinshasa ; 2 007 514 pour le Bas- Congo ; 3 994 971 pour le Bandundu ; 3 331 639 pour l’Equateur ; 4 333 120 pour le Haut-Congo ; 5 350 149 pour les trois régions du Kivu [2] ; 4 291 869 pour le Katanga ; 1 978 631 pour le Kasaï-Oriental et enfin 2.410.424 pour le Kasaï-Occidental.
Il existe en réalité trois axes de fort peuplement qui mobilisent pratiquement la moitié de la population du Congo. Le premier couvre la région méridionale de Banana à Kabinda ; les points forts de ce peuplement sont le Bas-Congo spécialement le Mayumbe, le Kwilu, les régions de la Luluwa et de Mbuji-Mayi. Le deuxième axe de haute densité est le versant congolais du fossé des Grands Lacs qui s’étend de Fizi à la frontière du Soudan. Le troisième axe enfin est septentrional. Moins dense et de structure plutôt discontinue, il couvre les plateaux du nord, spécialement le plateau de Gemena et celui des Uélés autour d’Isiro (De Saint Moulin, L., 1976 : 19-20). On pourrait s’étonner de l’existence d’une réelle discordance entre les zones de peuplement dense et les régions clés de l’économie du pays qui sont en principe des points de polarisation tout indiqués. En effet, les densités de population les plus importantes, au lieu de se rencontrer au Katanga, région industrielle par excellence, ou dans la boucle du fleuve qui est la grande région de l’agriculture d’exportation (café, cacao, palmier, hévéa) se trouvent plutôt dans les zones d’activités agricoles vivrières traditionnelles : Bas-Congo, Kwilu, Kasaï. C’est que la nouvelle organisation de l’espace, depuis le début du siècle, n’a pas encore eu suffisamment d’impact sur la physionomie démographique du pays. La variation de peuplement, encore manifeste de nos jours, est d’origine historique [3]. La savane du sud et la zone agro-pastorale du Kivu ont toujours été les points les plus peuplés : ils contrastent avec la Cuvette Centrale qui demeure la région la moins occupée du pays. L’insertion de l’homme dans cette région du continent correspond donc à une situation particulière et celle-ci se serait réalisée suivant des modalités qui méritent d’être saisies de manière plus précise (carte 3).
Le fait géographique et géologique du Congo est aussi archaïque que celui de l’ensemble du continent ; il sert de terroir à l’aventure de l’homme depuis plusieurs millénaires, du moins si on se réfère à des critères archéologiques qui associent l’apparition de l’homme à la production de l’outil. En effet, l’outil n’est rien d’autre qu’une modalité de prolongation de la main. On y recourt parce que la main est fragile et qu’elle ne peut se livrer à toutes les nécessités de préhension. Avec la main, on ne peut tenir une braise chaude, de l’eau bouillante ou un serpent ; il faut recourir à un objet approprié, conçu par le cerveau dans l’intention de suppléer à la déficience de la main nue. C’est cela l’outil. Si l’utilisation de l’objet n’est pas exclusivement réservée à l’espèce humaine – certains animaux sauvages y ont recours – la fabrication et l’usage systématique de l’outil, instrument standardisé lié à un usage bien défini, est l’apanage exclusif de l’homme (Leroi Gourhan. A.. 1945. 1974 : 93-105).
Si donc l’homme recourt à l’outil, c’est qu’il a atteint un certain stade d’évolution qui veut que la main ait pris la relève de la mâchoire dans l’activité de préhension. En effet, tant que les mains sont nécessaires pour la locomotion et que l’on se déplace, pour ainsi dire, à quatre pattes, on est obligé de tenir ou de prendre quelque chose par la bouche. Les mâchoires jouent alors un rôle polyvalent : elles sont utiles tant pour consommer la nourriture que pour soulever, transporter ou déplacer un objet. A ce niveau, il est nécessaire que les mâchoires soient développées, que les dents soient d’une extrême solidité et que la bouche ait la forme d’un museau. Le cerveau, dans cette masse osseuse, ne peut être que de dimension réduite. On est alors en présence d’une espèce animale, pas encore d’une espèce humaine. Mais lorsqu’on adopte la position debout, une véritable révolution physiologique s’opère.
La main enfin libérée des contraintes de la locomotion reprend enfin à la mâchoire les fonctions de préhension qui lui étaient dévolues jusqu’alors. Ne servant plus qu’à la consommation de la nourriture, la bouche ou plus précisément la gueule se rétrécit, laissant davantage de place à la boîte crânienne pour que celle-ci se développe. L’homme se démarque enfin nettement de l’espèce animale pour devenir un sujet pensant à part entière. L’apparition de l’outil, à une époque donnée, témoigne donc de l’accomplissement d’une telle révolution biologique. Il suppose l’adoption de la position debout et le développement de la boîte crânienne et donc, l’existence de l’homme pensant.
Il va de soi que l’outil ne pouvait être fabriqué qu’à partir d’une matière solide. L’élément le plus solide qui puisse être trouvé dans la nature est la pierre. Elle sera utilisée abondamment, malgré son caractère encombrant, tant qu’on ne pourra trouver une autre matière aussi solide, mais plus malléable. Ainsi la pierre sera employée jusqu’à ce qu’on connaisse le fer. Au Congo, dans cette partie de l’espace africain, l’évolution n’a pu être différente. L’hominisation s’est exprimée par tout un éventail d’industries lithiques. Certains sites ont déjà pu être identifiés et ont fait l’objet d’investigations sérieuses, notamment les sites de Pupa (A. Anciaux de Faveaux) et de Kamoa (D. Cahen) ainsi que ceux de Sanga et de Kamilamba dans la dépression de l’Upemba au Katanga (J. Hiernaux, J. Nenquin, P. de Maret) ; la Pointe de la Gombe (J. Colette, H. Van Moorsel, D. Cahen) ; la grotte de Matupi dans le Haut-Congo (F. Van Noten) ; les grottes de Mbanza-Ngungu dans le Bas-Congo (P. de Maret ; Cahen, D., 1977-78 : 33-36 ; Muya K., 1977-78b : 137-151) ; sans oublier le site d’Ishango au Kivu (De Heinzelin, 1957) [4] et les abords du lac Tumba (Preuss).
On commence donc à être suffisamment renseigné sur la situation archéologique du pays ; de plus ces renseignements se trouvent complétés par des données émanant d’autres matériaux de l’ensemble de la région d’Afrique Centrale.
On peut d’ailleurs affirmer que l’Afrique Centrale constitue un tout. Son histoire archéologique atteste globalement l’existence de tous les stades reconnus de l’évolution préhistorique depuis l’âge de la pierre taillée jusqu’à l’âge du fer. Dans cette région, les plus anciennes manifestations humaines ont pu être identifiées au Kenya à l’est du lac Rodolphe et ont été datées de 2 600 000 ans. Mais c’est à Olduvai, en Tanzanie, que l’association des restes humains à des industries a été fermement établie. De là découle l’appellation d’Olduwayen, généralement conférée à ces restes primitifs, appellation qu’il faut préférer à celles de « Pebble culture » ou de « galets aménagés ». Ces premiers êtres humains étaient d’assez faible stature, vraisemblablement nomades, préférant les sites ouverts à proximité des lacs et des rivières. Leur subsistance dépendait de la cueillette et du ramassage de petits animaux : batraciens, reptiles, rongeurs, etc. Ils chassaient peu et se contentaient des charognes abandonnées par les grands fauves. En tout cas, l’existence de campements est attestée à Olduvai et sur les rives du lac Rodolphe.
Vers 1.000.000 d’années environ, est apparu un nouveau type humain : Y Homo Erectus (connu aussi sous les noms de Pithécanthrope, Sinanthrope, Atlanthrope). On le retrouve dans tout l’ancien monde, à Java, en Chine, en Europe, mais aussi en Afrique, depuis le Maghreb jusqu’en Afrique du Sud.
En Afrique Centrale, c’est à Olduvai que l’association de VHomo Erectus et d’une industrie bien connue dans tout l’ancien monde, Yacheuléen (de Saint Acheul en France), a été mise en lumière. Dès ses origines, l’Acheuléen se distingue de l’Olduwayen par une gamme plus vaste d’outils plus spécialisés. Les instruments caractéristiques sont les bifaces et les hachereaux. On rencontre en outre des pics, des racloirs, des rabots. En dépit de leurs ressemblances, il serait pourtant erroné de considérer que l’Acheuléen d’Afrique, d’Europe et d’Asie sont trois manifestations d’une même civilisation. En fait, ces termes ne désignent qu’un vaste complexe d’industries dont les similitudes indiquent qu’à un même stade d’évolution, les mêmes problèmes recevaient des solutions techniques analogues.
Au cours de sa longue existence, l’Acheuléen a évolué. On distingue l’Acheuléen ancien et l’Acheuléen évolué, ce dernier se terminant en Afrique entre 100 000 et 60 000 ans avant notre ère.
L’Acheuléen est extrêmement bien représenté en Afrique. En Afrique Centrale toutefois, il n’apparaît guère que sous une forme évoluée. Il semble que les conditions climatiques et la présence d’une épaisse forêt soient responsables de ce fait. En République démocratique du Congo, ses principaux gisements, tels ceux de Kamoa ou de Pupa, sont situés au Katanga. L’image que l’on peut se faire de l’artisan des industries acheuléennes est déjà pleinement humaine. Il a accompli des progrès décisifs dans l’art de tailler la pierre et il a conquis la maîtrise du feu. On lui attribue également la naissance du sentiment esthétique.
L’Homo Erectus a progressivement évolué et, vraisemblablement entre 300 000 et 100 000 ans, apparaît I’Homo Sapiens. Il s’agit d’abord de l’Homo Sapiens Neanderthaliensis (ou Rhodesiensis), puis, vers 50 000 ans environ, de l’Homo Sapiens Sapiens qui n’est sans doute que le résultat de l’évolution du précédent. Dans la suite, la période assez aride, qui avait caractérisé l’Acheuléen final, fut suivie d’une certaine humidification du climat. Les industries préhistoriques traduisent ce phénomène et l’on observe une grande variété d’outils destinés au travail du bois.
La première industrie postacheuléenne. le Sangoen (du nom de la baie de Sango sur le lac Victoria en Uganda) sur le site des Kalambo Falls en Zambie, se situerait chronologiquement entre 45 000 et 55 000 ans avant notre ère. Sa position stratigraphique est imprécise, de même que sa typologie. On admet généralement qu’il s’agit d’une industrie assez fruste, contrastant avec la perfection de l’acheuléen final. Elle serait l’œuvre de l’Homo Sapiens Néanderthaliensis.
Le Sangoen a été suivi par le complexe Lupembien (de Lupemba affluent du Kasai) qui est remarquablement représenté dans toute la partie sud et ouest du bassin du Congo. Les industries lupembiennes sont caractérisées essentiellement par une grande variété de pointes foliacées bifaces finement travaillées et par de nombreux ciseaux, haches et herminettes. Le lupembien est divisé en une phase ancienne qui débute vers 30 000 et une phase récente qui se termine vers l5 000 ans avant notre ère.
La carence des données archéologiques ne nous permet pas de connaître l’artisan du Lupembien ni son mode de vie. Il ne fait cependant guère de doute que ses aptitudes physiques et intellectuelles ne le cédaient en rien aux nôtres. Dans de nombreux sites, on a retrouvé des traces d’usage de matières colorantes. Ceci constitue un indice tangible de préoccupations s’élevant au-dessus des problèmes immédiats de subsistance.
Dans la partie sud-ouest de l’Afrique Centrale, le Tshitolien (de Bena Tshitolo) poursuit la tradition du Lupembien. Mais au Katanga et au Kivu, cette tradition disparaît au profit d’un complexe d’industrie différent, caractérisé par un outillage microlithique.
Le Tshitolien, approximativement daté entre 15 000 et 3 000 ans avant notre ère, comporte, outre des outils Lupembiens, de nombreuses pointes de flèches foliacées ou pédonculées ainsi que quelques outils microlithiques. C’est à cette période aussi qu’apparaît la technique de retouche par pression. Vers la fin du Tshitolien, il semble que les outils de pierre polie et la céramique aient fait leur apparition.
L’économie des populations de l’âge de la pierre récent était, comme auparavant, basée sur la récolte des produits sauvages. En dépit du fait que les techniques du polissage de la pierre et de la fabrication de poterie soient moins anciennes en Afrique que dans les autres continents, il ne semble pas que l’on puisse affirmer l’existence d’un stade « néolithique » du moins au sens socio-économique de ce terme, à la fin des âges de la pierre. Tout indique au contraire que le passage à une économie de production de nourriture, l’agriculture, l’élevage et une certaine sédentarisation, soit le fait des premières populations de l’âge de fer.
En Afrique subsaharienne, il n’existe aucune trace d’un âge du cuivre ou du bronze antérieur à l’âge du fer. La sidérurgie, l’agriculture et l’élevage sont apparus assez rapidement dans des régions qui, jusque-là, étaient restées à lage de la pierre. Cependant, l’arrivée des premiers forgerons n’a pas sonné le glas des tailleurs de pierre. De nombreux témoignages attestent leur coexistence jusqu’à des époques très récentes (XVIIe, XVIIIe siècles notamment).
L’évolution archéologique, comme on le constate, peut être appréhendée jusqu’à accéder pratiquement à 1 époque contemporaine. Celle-ci témoigne, à chaque niveau, d’un type de civilisation particulière. Mais la question fondamentale qui se pose est de savoir si toutes ces réalisations sont à mettre effectivement au compte de nos ancêtres. Cela n’est pas attesté. Il n’y a pas nécessairement un lien génétique entre les Congolais d’aujourd’hui et les producteurs des industries lithiques. Un même espace, comme on le sait, peut être le théâtre de l’aventure de plusieurs couches de populations. Il suffit d’un cataclysme ou d’une transformation géologique pour qu’un peuple entier disparaisse et laisse le terrain disponible pour l’épanouissement d’un autre peuple, mieux adapté aux nouvelles conditions de vie.
Si l’on se place dans l’optique d’une histoire des populations actuelles du Congo, on doit signaler que leurs vestiges les plus anciens ne datent pas d’avant l’âge de la pierre récent, les ancêtres des Pygmées actuels ayant vécu à cette époque. Ils occupaient en ce temps-là un espace plus large, n’étant pas confinés dans les forêts de Kibali-Ituri, du Maniema, de Tanganyika, de la Tshuapa et de Maindombe. S’ils préféraient des zones forestières, ils choisissaient volontiers celles qui étaient proches de la savane. De la sorte, ils jouissaient des bienfaits de la forêt sans subir pour autant le contrecoup de ses méfaits. La cueillette et la chasse étaient à l’honneur en vue de l’autosubsistance, deux activités qui ont prévalu à peu près partout avant l’apparition de l’agriculture et de l’élevage. Ce premier mode de subsistance exigeait de fréquents changements de résidence à la recherche de terrains propices à l’approvisionnement en viande, en poisson et en légumes.
Ce mode de vie assurait aux intéressés une somme de connaissances du milieu, des conditions physiques, du climat, de la flore et de la faune. Si l’on n’avait pas suffisamment de loisir et de quiétude pour s’adonner à la domestication des animaux et des plantes utiles, du moins pouvait-on protéger dans la forêt ou dans la savane des essences qu’on estimait nécessaires à l’homme, arbres à fruits, arbres à chenilles, etc. Parfois, en cas de déménagement, on emportait certaines espèces végétales pour les transplanter dans le nouveau territoire ; et lorsqu’on utilisait le feu pour les besoins de la chasse, on prenait les précautions nécessaires pour que l’incendie ne détruisît pas ces plantes utilitaires. Cette pratique de la végéculture, encore de mise aujourd’hui, existe donc depuis ces époques reculées.
Sur le plan artisanal, le travail n’était guère avancé, du moins l’imagination créatrice de l’homme était employée à la mise au point de nouvelles techniques de pêche et de chasse. Cette première expérience d’occupation de l’espace comptait pour beaucoup dans l’avenir de l’ensemble de la société car c’est sur elle qu’allait s’inscrire l’apport de toutes les autres couches de populations à venir.
Les locuteurs de langues bantu furent les premiers à venir se joindre aux Pygmées. Leur histoire lointaine semble être une véritable odyssée. Localisés dans ce qui correspondrait au Nigeria oriental actuel, à proximité des rives occidentales du lac Tchad, les ancêtres des Bantuphones menaient une vie relativement sereine, n’ignorant pas, dans le voisinage des Néolithiques du Sahara, l’agriculture et l’usage du fer (Obenga, T., 1985). Tout se passait pour le mieux jusqu’au moment où le Sahara commença à se désertifier. En effet, avec le phénomène d’assèchement des terres fertiles, les populations sahariennes commencèrent à chercher à émigrer ; c’est alors qu’ils commencèrent à exercer une pression progressive sur leurs voisins méridionaux, les contraignant à envisager à leur tour un déménagement éventuel.
Le phénomène de migration se serait alors déclenché. Il fallait se diriger vers le Sud puisque la pression était de provenance septentrionale. La plupart prirent la direction du sud-est et du sud-ouest, pour éviter d’affronter la forêt, mais certains choisirent de s’y engager. C’est ainsi que vers le début de notre ère, les Bantu formant actuellement le peuple du Congo ont pu accéder à leur terroir actuel par trois voies différentes : la voie occidentale qui est à la base du peuplement des régions actuelles du Bas-Congo et de Bandundu, la voie centrale qui a assuré le flux de populations de l’Equateur et de Bandundu, la voie orientale enfin qui est venue meubler les savanes du Katanga et du Kivu. Il n’est pas exclu qu’une nouvelle concentration de populations dans la vallée du Lualaba, dans le Nord-Katanga, ait donné lieu à une autre dispersion en direction du sud, de l’est et de l’ouest au point d’occuper, dans les régions congolaises, toute la zone qui va de l’Atlantique à la ligne de partage des eaux du Nil et du Zambèze (Hiernaux, J., 1968 : 505-515 ; Posnansky, N., 1968 : 1-11 ; Crine-Mavar, B., 1974 : 163-165 ; Oliver, R., 1974 : 159-197). C’est à l’issue de ces différents mouvements que la quasi-totalité de l’espace du Congo fut envahie par les Bantu (carte 4).
On suppose qu’une telle occupation a été progressive, quelle a revêtu des formes diversifiées allant des initiatives les plus organisées jusqu’à des mouvements d’expansion presque inconscients. La complexité du phénomène, de même que la diversité des formes qu’il pouvait revêtir, justifie la difficulté qu’il y aurait à le dater. La vraisemblance incite à affirmer qu’il s’est déroulé au cours du premier millénaire. En tout cas, au VIIIe et certainement au IXe siècle, les populations disposaient déjà dans la savane du Sud des moyens techniques leur permettant de créer des sociétés et des cultures ethniques semblables à celles qui prévalaient encore au XIXe siècle (Obenga, Th., 1982). C’est du moins ce que révèlent les matériaux tirés des fouilles qui ont été faites dans la vallée du Haut-Lualaba (De Maret, P., 1978 ; Cornet, J., 1980.- 609-616).
Cependant, il faudra attendre l’arrivée des populations d’origine soudanaise et nilotique pour que l’identité démographique congolaise soit entièrement réalisée.
Venus des régions de Darfur et Kordofan, des Soudanais essaimèrent dans la partie nord-est du pays, notamment dans le Kibali-Ituri et l’Ubangi. Là, ils se mélangèrent avec les Bantu. Ces contacts créèrent des brassages et des métissages qui justifient l’existence dans la région de groupes de Soudanais bantouisés, entre autres les Ngbandi, les Ngbaka, les Zande et les Mangbetu. Mais là ne s’arrêta pas le peuplement du Congo. Il y manquait l’apport nilotique. C’est ce qui se réalisa dans la suite. Venus des plateaux d’Ethiopie, des pasteurs nilotiques finirent, en remontant la vallée du Nil, par s’installer dans les régions des Grands Lacs, notamment dans le Kivu. La rencontre avec les Bantu les amena à se mêler à eux au point d’adopter leurs langues.
Le patrimoine démographique s’imposait ainsi par sa diversité : aux Pygmées se sont superposées tour à tour des couches bantu, soudanaise et nilotique. On peut cependant affirmer que, dans cette diversité, les Bantu constituent le groupe le plus important qui aura marqué le destin démographique du pays. Leur arrivée et leur contact avec l’espace congolais et la couche autochtone constituent les premiers actes de l’histoire nationale. En effet, avec l’arrivée des Bantu, il faut le constater, la trame culturelle du pays s’est trouvée esquissée de manière décisive ; une part du destin du pays était du même coup déterminée. Le Congo était voué à devenir un état essentiellement bantu. A ce niveau, il apparaît nécessaire, après avoir perçu d’abord le peuplement comme un phénomène géographique et démographique, de le considérer à nouveau en tant que phénomène culturel dynamique [5].
L’arrivée des Bantu eut pour effet de refouler les autochtones vers les régions les plus défavorisées. L’aspect agressif de ce contact est évident. Il transparaît dans l’attitude chargée de mépris sinon de condescendance que les Bantu affichent parfois encore. Ceux-ci prennent toujours soin, malgré ce contexte de métissage, d’entretenir le clivage entre les deux communautés. Ainsi, pour se débarrasser de l’enfant qui insistait pour que les contes lui soient racontés pendant la journée, pour l’effrayer, on le menaçait de ne plus grandir, c’est-à-dire de se voir réduit au rang de pygmée.
Pourtant, le contact entre les deux groupes ne s’est pas seulement exprimé en termes d’opposition, loin de là ; une harmonie discrète s’est créée progressivement. Les autochtones ont été pour la plupart absorbés peu à peu pour constituer les groupes ethniques que nous connaissons actuellement. A cette synthèse, les autochtones ont surtout apporté leur expérience du terrain et la somme de connaissances accumulées tout au long de l’évolution : connaissances essentiellement géographique, botanique, zoologique. Les autochtones avaient déjà mis au point des techniques de piégeage, de vannerie, de pêche et bien d’autres. Ceci constituait déjà un acquis pour cette nouvelle communauté faite du brassage des nouveaux venus et des autochtones. S’il y a eu un apport d’origine externe, il se situe ailleurs. La contribution particulière des Bantu semble être plutôt l’introduction ou l’extension de l’agriculture, du moins dans la forme où elle se trouve pratiquée dans le monde traditionnel. Avant cela, la cueillette et la végéculture prévalaient. S’il n’est pas exclu que cette pratique préagricole se soit transformée ici et là en une activité véritablement agricole ; toutefois, cette dernière ne fut systématisée qu’avec les Bantu. du moins dans sa forme itinérante sur brûlis.
« » Désormais, avec la présence de ceux qui avaient été les voisins des populations d’Afrique occidentale, cette activité ne pouvait être davantage ignorée. On cultivait certes des plantes d’origine autochtone, palmier, légumes divers, millet, sorgho, etc. mais aussi des plantes d’origine asiatique : igname, taro, banane dans sa double variété (musa paradisiaca et musa sapientum) introduites par les Indonésiens entre – 400 et + 200 (S. Lwanga-Lunyiigo et J. Vansina 1990 : 175).
Il va de soi que l’agriculture n’a pu connaître un essor décisif sans être appuyée par la connaissance du fer. C’est l’usage du fer, bien davantage que le simple recours au feu, qui permet un déboisement important et le labourage éventuel. Mais on est incapable de dire avec précision depuis quelle époque cette connaissance était assurée. Jusqu’il y a quelques années, on liait étroitement ce phénomène à l’expansion des Bantu qui en auraient assuré la diffusion là où ils seraient passés. Mais le lien entre les deux phénomènes ne s’impose plus comme une évidence, du moins dans l’état actuel des connaissances. En Afrique de l’Est, des traces très anciennes de la métallurgie du fer ont été découvertes ; certaines dates au radiocarbone (1 500 et 1 000 BC dans le Buhaya en Tanzanie) laissent même suggérer l’éventualité d’une invention autonome dans cette partie du continent (Muya, K., 1977-78 : 28).
En attendant des confirmations, il faut s’en remettre à la vision classique des choses qui veut que les techniques métallurgiques aient été importées en Afrique Centrale par trois relais qui ont agi ensemble ou de manière séparée. En premier lieu, Meroe sur le Haut-Nil. L’empire meroétique fut, entre le IVe siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère, un centre important de sidérurgie. De là, la connaissance du fer aurait pu être acheminée, par le Soudan, à l’actuel Congo. D’autre part, des contacts transsahariens entre la côte méditerranéenne et l’Afrique Occidentale ont pu entraîner une maîtrise précoce de la métallurgie dans cette région. Déjà au IIIe siècle avant notre ère, la métallurgie du fer était connue à Nok, au Nigeria. Cette connaissance a pu se diffuser dans le reste du continent et donc en Afrique Centrale à la faveur des migrations Bantu dont le point de départ se situait précisément dans cette région. Mais ce n’est pas tout. Le dernier relais éventuel, c’est la côte de l’océan Indien. Celle-ci, dès avant notre ère, était fréquentée par des navigateurs Indo-Malais à l’époque où la navigation asiatique était plus développée que celle de l’Europe. Ce contact a pu être une occasion pour l’implantation de cette technique dans la région côtière, avant sa diffusion dans le reste de l’Afrique Centrale.
Qu’elles soient d’origine interne ou externe, les connaissances métallurgiques en Afrique Centrale apparaissent comme définitivement acquises aux premiers siècles de notre ère. Les vestiges les plus importants ont été repérés en Afrique Orientale (Kenya, Tanzanie) et même dans la région immédiate des Grands Lacs (Ruanda, Kivu) (De Maret, P., Van Noten, F., Cahen, D., 1977 : 497-505). Dans la partie occidentale, plus précisément dans la région de Luozi, des fouilles menées en 1985 (de Maret et Clist) ont abouti à la datation du IIe siècle de notre ère (Clist, B., Oslisey, R. et Peyrot, B., 1986 : 49). Au Katanga, le plus ancien âge du fer connu – le Kamilambien (de la localité Kamilemba) – indique plutôt une période du milieu du Ve siècle de notre ère (de Maret, P., 1977 : 325-326, 337 ; Cornet, J., 1980 : 611). C’est le stade le plus archaïque qui ait été repéré dans la dépression de l’Upemba. Le Kamilambien aura donc succédé à l’âge de la pierre récent. Il se réfère à une population relativement importante qui aurait remplacé celle qui utilisait la pierre polie. Le Kamilambien fut remplacé par le Kisalien (du lac Kisale), période brillante de production de fer qui a connu trois stades différents : le Kisalien ancien (IXe siècle), le Kisalien classique (du XI au XIVe siècle) et le Kisalien classique final (du XIII-XIV’! siècle). Le Kabambien (du lac Kabamba) enfin qui se confond à ses débuts avec le Kisalien classique final, durera jusque vers la fin du XVIIe siècle. Voilà les éléments d’utilisation et de datation du fer connus pour le Congo, à partir des éléments tirés des sites de Sanga, Katoto et quelques autres encore situés sur les rives du lac Kabamba (Cornet, J., 1980 : 611-613 : De Maret et Kanimba. M.. 1977-1978: 115-122).
Au-delà de tout effort d’utilisation des éléments de l’espace, il faut préciser que les Bantu n’ont pu occuper l’espace congolais sans être dotés d’une organisation interne. On peut en effet supposer que dès la phase proto-bantu, ils devaient être regroupés par clans unilinéaires. A l’époque, le clan constituait une communauté de résidence. Avec les migrations, il ne fut plus possible à tous les Bantu d’user de la même langue. Des diversifications linguistiques s’introduisirent et des dialectes firent leur apparition au sein de la langue proto-bantu. Le clan, unité résidentielle, devint par le fait même une unité linguistique, se différenciant ainsi des autres. Si cette différenciation posait un problème, c’était davantage à cause des exigences de l’exogamie. Il fallait à tout prix recruter des partenaires conjugaux dans d’autres cercles linguistiques et parentaux. Les épouses recrutées ailleurs finissaient par adopter, par la force des choses, le parler de leurs maris. Elles parlaient de la sorte le dialecte d’un clan donné sans pour autant en faire partie. On peut dire que, par leur présence, ce même dialecte était désormais utilisé par plus d’un clan, celui des hommes et celui de leurs femmes. Cette communauté linguistique nouvelle, pluriclanique, était une nouvelle structure sociale. L’ethnie était née. Au point de départ, basée sur la communauté de langue, elle allait peu à peu consolider son unité interne par l’usage des mêmes institutions. Le clan, réalité homogène sur le plan de la parenté, allait désormais coexister avec l’ethnie, élément interclanique.
La structure ethnique était donc une excroissance de la structure clanique : elle allait acquérir une plus grande importance au point d’évincer pratiquement l’autre en tant que mode d’organisation de la société. Les ethnies allaient donc faire du chemin. Les premières, avec les impératifs des déplacements, se segmentèrent à leur tour et donnèrent naissance à d’autres unités semblables. Dans la mesure où la diversification était consommée, se forgeaient de nouveaux noms pour les qualifier. De toute façon, ces ethnies allaient connaître des évolutions totalement divergentes suivant les circonstances et le dynamisme des aristocraties en place. Certaines allaient se doter d’une hiérarchie interne au point de se constituer en unités politiques ; d’autres allaient évoluer dans le sens d’un émiettement plus grand, créant une multiplicité d’autres structures semblables : d’autres encore allaient absorber ici et là des groupes d’autochtones ou de nouveaux immigrants et se transformer ainsi en des entités culturelles composites. En tout cas, ce mode d’organisation s’est généralisé dans tout le Congo ancien, ce qui explique la multiplicité des ethnies d’aujourd’hui, car suivant son principe de création, une nouvelle unité de ce genre peut encore se créer, même de nos jours.
Dans la recherche de meilleurs territoires d’installation, il apparaît nettement que les régions les plus recherchées étaient les zones de transition entre la forêt et la savane, particulièrement propices parce qu’elles permettaient de jouir des bienfaits de la forêt mais sans les risques qu’elle fait courir par ailleurs. Les abords des rivières présentaient également un grand intérêt à cause de l’approvisionnement en poissons. Mais la différence de milieu notamment entre la forêt et la savane était un autre élément qui allait différencier ces populations unies au départ. On sait en effet que le milieu finit toujours par influencer le mode de vie des habitants. Les agriculteurs bantu de la savane allaient surtout se livrer à la culture des céréales (millet, sorgho), plus adaptées à ce terrain, tandis que ceux de la forêt allaient se spécialiser dans l’agriculture des tubercules (taro, igname, etc.).
Cette simple distinction allait avoir des conséquences importantes sur l’évolution ultérieure. Comme les céréales ont une plus grande capacité nutritionnelle par rapport aux tubercules, l’écart démographique entre les deux milieux allait se creuser davantage. On dirait que cette variation a subsisté jusqu’à nos jours puisque, comme on l’a déjà noté, la savane du nord comme celle du sud se trouvent être, surtout dans la zone de transition, bien plus peuplées que les régions forestières de la Cuvette Centrale. De plus, le travail des céréales est plus pénible que celui des tubercules. Il ne suffit pas seulement de les planter ; il faut aussi et surtout entretenir le champ, protéger la production contre les oiseaux et les rongeurs. Et quand sonne la période de la récolte, il faut prélever toutes les graines afin qu’elles ne s’abîment pas en demeurant sur les épis. Dans le domaine des racines, toutes ces préoccupations sont vaines. La terre assure à la fois le développement et la protection des produits agricoles jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être récoltés. Ici aussi, point n’est besoin de déterrer à la fois tous les tubercules ; on ne prélève que la quantité nécessaire. La terre assure également la conservation de la production alors que, pour les céréales, il est nécessaire de l’assurer soi-même. L’utilisation des céréales est manifestement plus exigeante. Une population qui consomme essentiellement ce produit a un plus grand effort à fournir ; elle doit pouvoir organiser son calendrier agricole de manière plus rationnelle.
C’est ainsi qu’on constate que les agriculteurs de savane ont été obligés d’inventer une technique spéciale de conservation de graines – le grenier – alors que leurs partenaires, dans la forêt, ne ressentant pas ce besoin, n’ont pas fourni d’effort similaire pour la mise au point d’une telle technique. Autant d’éléments qui contribuaient à distinguer les différents groupes de Bantu installés sur le sol congolais, ceux de la savane et de la forêt, mais aussi ceux des plaines et des régions montagneuses, ceux installés le long des cours d’eau et ceux situés loin de ceux-ci. Une expérience de vie se tissait progressivement et se communiquait d’un groupe à l’autre.
La civilisation s’élaborait. Elle s’était exprimée, on l’a vu, dans une potentialité manifeste de créer des formes d’organisation nouvelles ; elle transparaissait finalement aussi dans cette capacité de maîtriser l’environnement et de s’adapter à ses particularités. Tout cela n’allait pas sans le développement d’une technologie appropriée.
Vers la fin du premier millénaire, l’outillage en fer demeure sans doute modeste mais il peut être considéré comme un phénomène généralisé. On se servit d’abord du couteau à la fois comme outil et comme arme. On connut ensuite la lance puis la flèche. La houe fut également inventée très tôt en tant qu’instrument conçu pour la femme. L’agriculture, grâce à cela, continuait à s’affirmer comme une activité essentielle, évinçant progressivement la cueillette. Dans le même ordre d’idées, à côté de la chasse, émergea bien plus timidement une autre activité domestique. C’était l’élevage. On ne saurait avancer une date pour déterminer la période de son apparition. Mais on sait que c’est un phénomène plus tardif que l’agriculture et que son extension a été plus lente. Du reste, jusqu’il y a peu, en dehors de la zone agropastorale de l’Est, il ne s’est guère intégré à l’univers traditionnel. Ceci est dû à la réticence encore sensible des populations rurales à consommer la viande d’origine domestique, tandis que cette réserve ne vaut plus pour les légumes cultivés. Cette réticence est spécialement le fait des populations qui occupent ou qui ont occupé des terrains giboyeux et pour qui la nourriture carnée était essentiellement d’origine sauvage.
Dans la nomenclature des animaux domestiques, les gallinacés figurent certainement parmi les premières espèces connues introduites vraisemblablement à partir des côtes orientales en provenance de l’Asie. Mais la connaissance du chien est peut-être plus ancienne encore. Certaines espèces ont fait l’objet d’une domestication locale. Le chien était utilisé à la fois comme auxiliaire de la chasse et comme objet de consommation ; il sera évincé plus tard, du moins dans son second rôle, par la chèvre, le porc et le mouton, bien qu’actuellement certaines régions du pays, comme le Kasaï, aient conservé cet usage.
Sur le plan artisanal, il faut souligner l’invention de plusieurs techniques dont la vannerie, la poterie, le tissage. Les paniers, les hottes, les pots et les tissus se diffusaient de proche en proche jusqu’à parcourir quelquefois des distances surprenantes. La pratique artisanale tendait ainsi à se généraliser. On peut de la sorte affirmer que l’élément social le plus significatif après la phase du peuplement est incontestablement le développement des échanges. Il permettrait aux peuples de bénéficier de leurs créations et de leurs productions réciproques.
Les premiers vestiges de commerce sur le terrain archéologique congolais apparaissent à la période du Kisalien ancien ; la datation au carbone les situe au début du IXe siècle et peut-être même dans la seconde moitié du VIII- siècle. Le commerce s’effectua d’abord par troc, mais rapidement il sera çà et là monétarisé. Au Katanga, l’usage des anneaux de cuivre comme monnaie est attesté précisément depuis le IXe siècle. Cette monnaie aura cours par la suite dans la partie est de la savane du sud et elle sera complétée par l’usage des perles et de cauris provenant de 1 Océan Indien (Cornet, J., 1980 ; 612). L’usage de la monnaie était parfois réservé à un secteur de la vie : l’acquisition des produits agricoles se réalisait le plus souvent par troc, alors que celle des produits artisanaux était soumise plus sûrement à 1 usage de la monnaie ; de même une certaine monnaie de prestige, thésaurisée uniquement par les Aînés, avait également cours. On la faisait intervenir presque uniquement dans des transactions matrimoniales et quelquefois aussi pour l’acquisition d’esclaves.
Autant dire que le Congo ancien du début de ce millénaire bénéficiait déjà d’une certaine circulation interne des biens, des hommes et des idées. Au-delà de la diversification des ethnies, c’est un même mode de vie qui s’affirmait avec, çà et là, des nuances différentes dues à certaines conditions particulières.
TEXTE : ORIGINE DE LA MANIÈRE DE FAIRE LE FEU
La légende Kuba sur la diffusion de la technique de production du feu a le mérite de rappeler que les connaissances les plus rudimentaires en vue de l’autosubsistance ont été adoptées en des circonstances bien déterminées avant de se diffuser. Le feu, comme en général toute innovation d’envergure, était considéré comme étant d’origine supranaturelle.
« Pendant le règne de Muchu Mushanga (le vingt-septième roi) vivait un certain homme appelé Kerikeri. Une nuit, il rêva que Bumba (Dieu) venait le voir et lui disait d’aller sur une certaine route, de casser les branches d’un certain arbre et de les conserver soigneusement. Il le fit et quand les branches furent tout à fait sèches, Bumba lui apparut à nouveau dans un rêve, le félicita de son obéissance et lui enseigna à faire du feu par frottement. Kerikeri garda son secret pour lui-même et quand, par accident, tous les feux du village s’étaient éteints, il vendait du feu à ses voisins. Tous les hommes, sages et sots, essayèrent de découvrir son secret, mais il le gardait soigneusement. Or Muchu Mushanga avait une très jolie fille nommée Katende ; il dit à celle-ci : « si vous pouvez découvrir le secret de cet homme, vous serez honorée et vous siégerez parmi les anciens comme un homme ». Alors Katende fit des avances à Kerikeri et celui-ci tomba éperdument amoureux d’elle. Lorsque Katende vit cela, elle ordonna que tous les feux du village soient éteints et envoya un esclave pour dire à Kerikeri de l’attendre pour le soir dans sa hutte.
Quand tout le monde fut endormi, elle se glissa jusqu’à sa hutte et frappa à la porte. La nuit était obscure. Kerikeri la fit entrer et elle s’assit et resta silencieuse. Son amoureux lui demanda : « Pourquoi êtes-vous silencieuse Katende ? Ne m’aimez- vous pas ? ». Elle répondit : « Comment puis-je penser à l’amour quand je grelotte dans votre maison ? Allez chercher du feu afin que je puisse vous voir et mon cœur pourra se réchauffer ! ». Alors Kerikeri courut chez ses voisins pour se procurer du feu, mais ceux-ci se souvenant des ordres de Katende, avaient éteint leurs feux. Il revint sans en avoir trouvé. En vain implora-t-il Katende de céder à ses désirs, elle insista pour qu’il commençât par allumer le feu. Enfin, il céda, chercha ses bâtons et fit du feu, pendant qu’elle regardait attentivement. Alors elle se mit à rire et dit : « Avez-vous pensé que moi, fille de roi, je vous aimais pour vous-même ! C’est votre secret que je désirais avoir et maintenant que le feu est allumé, vous pouvez le faire éteindre par un esclave ! ». Alors, elle se leva, s’enfuit de la hutte, annonça sa découverte à tout le village et dit à son père : « où un roi puissant échouera, une femme rusée réussira ! (…) Avant cette époque, les gens devaient compter sur la foudre pour rallumer leurs feux lorsque par hasard ceux-ci s’étaient éteints » (Torday, E. et Joyce, T.A, 1910, pp. 236-237).
[1] Signalons ici une série d’études menées par Joseph Houyoux notamment (1973, 1975) et en collaboration avec Lecoanet, Y. (1975).
Pour 1987, les estimations pour la population totale du Congo avancent le chiffre de 31.726.019 (avec un taux de croissance moyen de 3 %). Elles présentent les projections ci-après : 34.668.000 (pour 1990), 40.190.000 (pour 1995) et 46.591.000 (pour 2000). (Profils de l’économie du Zaïre, 1955-1987, p. 22)
[2] Nord-Kivu (Goma), Sud-Kivu (Bukavu) et Maniema (Kindu).
[3] Cette hypothèse est soutenue, entre autres, par P. Gourou (1971) et par H. Nicolaï (1963).
[4] Une belle synthèse de ces fouilles a été établie grâce à la thèse de doctorat en Archéologie et Histoire de l’Art, de Muya wa Bitanko Kamuanga (1986)
[5] Sur la question bantu, on consultera les Actes du Colloque international sur les migrations bantu édités par Th. Obenga (1989). Une synthèse dynamique de l’état des connaissances sur les peuples bantuphones et leur expansion – fruit de la collaboration entre S. Lwanga-Lunyiigo et J. Vansina – a été publiée dans le tome 3 de l’Histoire générale de l’Afrique (1990. 165-188). Les auteurs affirment la provenance d’un seul habitat et la formation subséquente de deux blocs de langues bantu, celui de l’Ouest qui s’étend surtout sur la forêt équatoriale et celui de l’Est qui va de l’Ouganda au Cap. Le phénomène d’expansion aurait été motivé par l’explosion démographique causée par l’introduction de l’agriculture soutenue par la maîtrise du fer.



