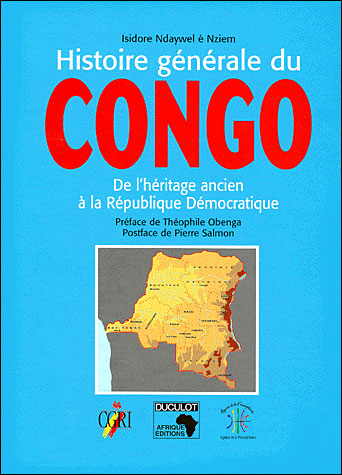
Partie 5 - Chapitre 1 : Le premier ordre colonial
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 1
Le premier ordre colonial
Au moment où se généralisait ce climat de violence, les structures d’organisation du nouvel Etat se mettaient en place. La transition touchait à sa fin. L’État nouveau était né. Du point de vue des autochtones, il était colonial, en dépit de la fiction juridique de Léopold II, sans doute significative et perceptible au-dehors mais pas au-dedans. Par sa politique, le souverain belge passait en effet pour être un virtuose dans le domaine de la fiction. De même que l’AIA avait été faussement humanitaire et que l’AIC n’avait dans les faits associé qu’un individu avec lui-même, l’État léopoldien n’était que faussement indépendant ; il était une « colonie sans métropole » ou plus exactement, une colonie dont la métropole était un individu et non pas une nation (Vellut J.L., 1984 : 672). Cette aventure a pu se poursuivre pendant 23 ans, jusqu’au moment où la Belgique prit possession de l’héritage. En réalité, le testament fut sans grandes conséquences puisque la propriété personnelle du Roi passa à la Belgique avant la mort de celui-ci. L’État indépendant du Congo devint donc le Congo belge et fut régi par une disposition constitutionnelle plus orthodoxe en matière de colonisation que ne le fut la Charte coloniale.
Même s’il connut deux statuts juridiques distincts, de 1885 à 1908 (État indépendant du Congo) et de 1908 à 1960 (Congo belge), le pays vécut en réalité au cours de cette période un seul et même état de colonisation ; cette évolution linéaire fut caractérisée par l’installation d’un nouveau type d’organisation et de gestion de l’espace. Ces trois quarts de siècle peuvent être répartis en trois moments successifs. Le premier alla jusque vers 1910, peu avant la première guerre mondiale, soit une décennie après le terme officiel du statut d’État indépendant. C’est la grande période de la mercantilisation des rapports sociaux, associée à la mutation technologique ; ce premier ordre colonial, caractérisé par la mise en place de l’organisation nouvelle, marquait le début de l’exploitation systématique du pays avec son cortège de violences. Pourtant, malgré les abus dont on parlera plus loin, la présence coloniale ne disposait pas encore d’une tradition stricte ni d’assises suffisamment solides, ni même d’un personnel suffisant pour s’imposer totalement partout et dans tous les domaines.
Avec la première guerre mondiale, on assista à une radicalisation du comportement du colonisateur. Les impératifs de la guerre, l’imposition de l’effort de guerre, dissipèrent la mauvaise conscience née des excès du régime léopoldien. C’était l’âge d’or de la colonisation, le second ordre colonial. L’expérience de la première guerre, les préparatifs de la seconde guerre mondiale justifiaient une accélération de l’exploitation. Ce second ordre colonial se caractérisait dans sa première phase par une identification précise du colonisateur : il était belge et non plus issu d’une pluralité de nations européennes. La seconde phase commença vers les années 45, lorsque les Congolais tirèrent de l’expérience de la souffrance l’aspiration à une vie meilleure, qui se rapproche davantage de celle du colonisateur que certains d’entre eux avaient côtoyé pendant la guerre. Curieusement le colonisateur, tout en combattant cette tendance, partageait cette même opinion pour d’autres raisons. L’expérience de la guerre, la participation remarquée de la colonie à la victoire des Alliés, avaient convaincu la métropole de la nécessité de doter la colonie d’un plan de développement socio-économique réel, à l’instar de ce qui se passait dans les autres systèmes coloniaux. Le développement de la métropole devenait inconcevable sans une économie prospère et solide de la colonie. Mais les Congolais mirent cette modernisation à profit pour voir plus clair en eux-mêmes et dans leurs aspirations ; elle les prédisposait à la revendication de leur propre prise en charge.
Nous sommes encore au lendemain de la Conférence de Berlin. Puisqu’il y avait un Etat, il fallait assumer son organisation suivant les normes nouvelles. Dans cette optique, la question des frontières était primordiale, parce qu’elle délimitait le champ précis où devait s’exercer le pouvoir léopoldien. La frontière, selon la conception nouvelle des choses, devait être rigoureusement dessinée (Jentgen P., 1951).
La première description officielle ou plutôt semi-officielle des frontières congolaises date du 8 août 1884. Elle fut consignée dans la lettre que Léopold II fit parvenir au Prince Bismarck, chancelier de l’Empire allemand. Dans celle-ci, le futur Souverain de l’EIC donnait quelques précisions cartographiques sur le Congo, incluant grosso modo les deux tiers du futur Congo : au nord, le quatrième parallèle ; à l’est, le lac Tanganyika ; à l’ouest, le fleuve Congo et au sud, le sixième parallèle. A noter que la grande différence se situe dans la partie méridionale : le Katanga n’y est pas inclus. Au regard de l’occupation réelle, ces frontières sont fort étendues, dépassant de mille ou mille cinq cents kilomètres les stations existantes. Ce sont ces frontières, sans commune mesure avec l’occupation effective, que Bismarck reconnut à l’EIC, non sans hésitation, pour ne pas faire trop de peine à ce roi philanthrope (septembre 1884).
Mais peu après, le 24 décembre exactement, le roi changea d’avis. Il établit un autre tracé de son Congo, allant jusqu’au 6e degré de latitude sud, annexant le Katanga. Cette nouvelle carte, la première qui soit digne d’intérêt, fut annexée à la Déclaration de neutralité du 1er août 1885. La raison de cette modification du dessin de la frontière ne tient pas compte, comme on pourrait le croire, du Katanga. En effet, à l’époque, nul ne se doutait des richesses qu’il contenait. En fait, pour compenser la perte du Kwilu-Niari (à l’ouest), le roi trouva bon d’annexer ce territoire au sud. Il le choisit en fonction du fleuve qui y prend sa source. L’EIC étant chargé de la liberté commerciale sur le fleuve, Léopold II pensait avoir le fleuve dans sa totalité. Le nouveau tracé, supposé comprendre toute la rive du Tanganyika, atteignait les lacs méridionaux, Moero et Bangwelo, et croisait la ligne de faîte Congo-Zambèze. Par un heureux hasard, ce nouveau tracé fut à nouveau accepté par l’Allemagne, peu préoccupée de ces questions ; la France n’insista pas, en tant qu’ héritière potentielle de toutes ces possessions de l’EIC, et l’Angleterre, par méprise, n’y trouva aucun inconvénient.
Mais les appétits annexionnistes de Léopold II ne s’apaisèrent pas pour autant. Après le tracé de 1885, son objectif fut d’atteindre le Haut-Zambèze, le lac Nyassa, le lac Victoria, le Haut-Nil. Il y travailla au cours des années 1888-89. Pour l’extension vers l’est, il pensa à des alliances avec eux. Mais on ne parvint pas à s’entendre avec les Arabes. Tous les efforts convergèrent alors vers le projet d’extension vers le Haut-Nil. On connaît à présent le détail des actions qui furent menées dans ce sens : l’expédition Van Kerkhoven en 1890 et l’occupation du Soudan méridional. En 1894, l’Angleterre, reconnaissant les faits, conclut un traité par lequel elle accordait à bail à l’EIC tout le bassin sud du Nil, dans le souci d’écarter la France de cette région. Mais cette dernière ne se laissa pas faire et fit pression pour que Léopold II renonce aux bénéfices de cet accord et ne garde que le droit d’occuper la partie la plus méridionale du bail, la fameuse enclave de Lado. Léopold II ne désarma pas. Il organisa en 1896 la fameuse expédition Dhanis. On sait à présent qu’elle visait non seulement à atteindre l’enclave de Lado, mais surtout à aller au-delà, à dépasser la région où la France interdisait toute occupation, c’est-à-dire le parallèle de Fachoda en direction de Khartoum, et de planter le drapeau de l’EIC au bord du Nil. Ceci n’était d’ailleurs pas définitif puisque, au-delà de Khartoum, le roi pensait à 1 Erythrée, qu’il avait déjà proposé à l’Italie de lui céder à bail. Parti des rives du Congo, cet empire aurait pu s’étendre jusqu’à la mer Rouge (Stengers J., 1989 : 57-60. 105- 106). On sait comment ce grand rêve s’acheva : l’expédition Dhanis fut anéantie par la révolte. L’occupation de Lado ne subsista que jusque 1906 : par un nouvel accord avec l’Angleterre, Léopold II acceptait que l’EIC se retire de l’enclave de Lado après sa mort.
Les premières précisions cartographiques dignes d’intérêt, figuraient d’une part dans la Déclaration de Neutralité notifiée le 1er août 1885 aux puissances signataires de l’Acte général de Berlin et d’autre part, dans la Déclaration complémentaire du 18 décembre 1894 (BO, 1888 : 252). En reportant sur une même carte les frontières indiquées par les deux Déclarations, on ne peut s’empêcher de faire les constats suivants (carte 15) : depuis 1894 jusqu’à nos jours, les limites du pays sont demeurées stables, exepté quelques rectifications dues aux opérations de bornage.
Par contre, entre 1885 et 1894, elles ont connu des modifications énormes : le Congo a perdu, à l’ouest, au profit du Congo, le triangle rectangle dont la pointe repose sur Lukolela au 1er degré de latitude sud, l’un des côtés étant représenté par le 17e méridien est de Greenwich et l’autre par le 4e parallèle de latitude nord, et dont l’hypoténuse est constituée par le cours du Congo-Ubangi. En revanche, il avait gagné plusieurs autres territoires. Au nord, il reprenait à la République centrafricaine actuelle la large bande d’Ubangi et de l’Uélé, s’étendant entre le 4e parallèle de latitude nord, le cours de l’Ubangi-Bomu et la crête du Congo-Nil ; à l’est, il gagnait la région aurifère de Kibali-Ituri comprise entre le 30e méridien est et la crête de partage des eaux du Congo-Nil ; au sud, il s’était enrichi des territoires immenses des Lunda-Cokwe, formés par la partie méridionale du Kwango, du Kasaï et du Lualaba- Ouest, descendant en dessous du 6e degré de latitude sud (Jentgen P., 1951 : 21-22).
Les changements ultérieurs furent minimes ; ils firent l’objet de quelques autres conventions conclues entre l’État indépendant du Congo ou la Belgique et les Puissances voisines. Voici du reste un aperçu de toutes les Conventions qui ont eu lieu depuis le début, c’est-à-dire depuis celle conclue avec l’Allemagne le 8 novembre 1884 jusqu’à la dernière, avec le Portugal le 22 juillet 1927.
La frontière avec Kabinda a fait l’objet de la Convention du 14 février 1885 ; celle avec les pays de l’Afrique équatoriale française (Congo, Centrafrique) a été déterminée par la Convention de Paris du 5 février 1885 à laquelle participait Jules Ferry mais elle dut subir quelques rectifications lors des Protocoles de Bruxelles du 29 avril 1887, et de Paris du 14 août 1894, ainsi qu’au cours des Déclarations échangées entre les deux gouvernements à Bruxelles le 23 décembre 1908.
Quant à la frontière orientale, il en a été question pour la première fois dans la Convention du 8 novembre 1884 par laquelle l’Allemagne reconnaissait le pavillon de l’AlC ; mais celle-ci a connu, elle aussi, des modifications d’abord par la Déclaration de neutralité du 1er avril 1885, ensuite par la Déclaration de Bruxelles du 18 décembre 1894 et enfin par les Conventions conclues avec chacune des puissances voisines. Vis-à-vis du Rwanda-Urundi, possession allemande qui deviendra territoire sous mandat belge, la fixation de la frontière datait déjà de la Convention du 8 novembre 1884. Elle n’a connu que des explicitations, des mises au point de détails, par exemple lors de la Convention de Bruxelles du 11 août 1910, approuvée par la loi belge du 4 juin 1911 (BO, 1911 : 683). Avec l’ancienne possession allemande de Tanganyika, devenue depuis lors la Tanzanie, le tracé frontalier, facilité par la présence du lac Tanganyika, n’a pas eu besoin d’être déterminé de manière plus précise par une Convention internationale. Celui-ci doit donc être considéré comme la ligne médiane du lac. En revanche, pour le territoire britannique de la Rhodésie du Sud, qui deviendra plus tard la Zambie, le tracé frontalier fort sinueux a fait l’objet d’une Convention signée à Bruxelles le 12 mai 1894. Avec le Portugal, la situation n’a pas été facile : le litige frontalier a fait l’objet d’une succession de dispositions ; d’abord la Convention de Berlin du 14 février 1885, ensuite celle de Bruxelles du 25 mai 1891 déterminant les délimitations dans la région Lunda, puis surtout celle de Saint-Paul-de-Loanda, du 22 juillet 1927, approuvée par la loi du 12 janvier 1928 où l’on procéda par échange de terres (Jentgen P., 1951 : 22-61).
La délimitation de l’actuelle frontière nationale demanda donc un travail ardu et long. Elle fut le fruit de négociations nombreuses mais où n’entraient nullement en ligne de compte les formations ethniques en place. C’est ainsi que les anciennes entités politiques ont été dispersées. L’ancien royaume du Kongo fut découpé entre l’Angola, l’EIC et le Moyen-Congo ; l’empire Lunda entre l’Angola, EEIC et la Rhodésie du Nord ; l’empire Luba entre l’EIC et la Rhodésie du Nord , le domaine des Bami se retrouve à la fois à l’EIC et au Rwanda-Urundi ; les Zandé entre l’EIC et le Soudan et l’Ubangi-Chari ; les Ngbandi entre l’Ubangi-Chari et l’EIC.
Que le tracé frontalier ait été laborieux, cela est évident et il fallut toute l’adresse d’un Léopold II pour y parvenir. Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler par exemple comment s’est déroulée la récupération de l’embouchure du fleuve, pour éviter que le nouvel Etat soit étouffé par l’absence d’un débouché à la mer. Le Portugal, pour faire prévaloir ses droits sur cette embouchure avait eu recours à la protection de l’Angleterre lors du traité anglo-portugais du 26 février 1884 qui interdisait à toutes les puissances l’accès à celle-ci. Comment contourner cet écueil ? Léopold II s’employa d’abord à faire reconnaître l’AIC par la jeune grande puissance des USA. Ce qui fut fait en avril 1884. Ensuite il offrit à la France le droit de préférence sur le territoire congolais. Celle-ci accepta. Ce droit de préemption signifiait que les territoires de l’AIC reviendraient automatiquement à la France en cas de dissolution de cet organisme. L’Allemagne et l’Angleterre se retrouvèrent devant un fait accompli. Pour ne pas avoir à affronter la domination française dans le bassin du Congo, il fallait adopter les positions de celle-ci et reconnaître l’AIC. Ce que fit l’Angleterre le 16 décembre 1884. Le Portugal se retrouva isolé et fut bien obligé de reconnaître l’EIC (Banning E., 1927 : 6).
Parfois, les rivalités frontalières suscitèrent des conflits armés par personnes interposées. Les épisodes de guerre évoqués ont été pour la plupart des batailles menées dans l’espoir d’élargir les frontières au maximum. Certains conflits sont restés célèbres dans l’histoire de la conquête coloniale à cause de l’importance qu’ils ont eue pour la suite des événements. Stanley et Savorgnan de Brazza ont donné le ton dans la course qui les opposa pour l’occupation du Pool. Cette opposition survit encore aujourd’hui dans la position concurrentielle et donc conflictuelle de Brazzaville et de Kinshasa et les rapports tumultueux qu’entretiennent ces deux métropoles. La cession du Kwilu-Niari aux Français a rétréci considérablement 1 espace maritime du Congo. Sans cet arrangement, le littoral du Congo aurait été plus long, rendant par le fait même possibles bien des réseaux d’échange.
L’occupation puis la perte de l’enclave de Lado dans le nord-est ont provoqué des réactions. Comme on l’a vu, malgré l’échec de l’expédition Dhanis, T occupation du sud du Soudan se réalisa partiellement avec cette enclave. Mais à la Convention du 9 mai 1906, on décida que toute cette région devait être abandonnée au profit de l’Angleterre ; celle-ci préféra ménager l’Egypte, qui avait également quelque ambition sur cette région. On allait évoluer vers le statut du Soudan anglo-égyptien. L’évacuation de l’enclave et du Bahr el-Ghazal se fit en 1907. La grande conquête de l’EIC ne demeura plus qu’un souvenir, avec un nom glorieux comme Redjaf, et la victoire de Chaltin (F.P., 1952 : 325-348).
A part la question frontalière qui s’est réglée progressivement, l’autre préalable à la structuration administrative du pays était le choix d’une capitale.
On sait que, depuis 1880, Vivi était la base à partir de laquelle l’occupation du pays prenait forme. Fondé en octobre 1879, ce poste, à l’extrême limite de la navigation sur le fleuve, pourtant bâti sur un sol sablonneux, passait en effet pour être le point de départ idéal pour la conquête de l’arrière-pays ; c’était effectivement le cas. De là, comme on l’a dit, Stanley avait créé trois autres postes en aval du Pool : Isangila, Manianga et Kintambo ; le capitaine Hanssens en fit autant dans la direction du haut-fleuve et créa les postes de Bolobo, de Kwamouth, d’Irebu et de Lukolela ; von Wissmann, qui séjourna dans le pays de Mwant Yav, s’orienta vers le Kasaï et institua le poste de Luluabourg, la future ville de Kananga. D’autres en firent autant dans la direction du Kwilu-Niari… En avril 1884, on dénombrait une trentaine de stations créées au départ de cette base qui comptait à l’époque 128 Européens (MG, n° 4, 18 mai 1884). Station la plus importante à l’époque de l’AIC, Vivi fut confirmée dans ce statut lorsque l’AIC se transforma en EIC. Le colonel Francis de Winton qui y résidait déjà comme représentant de Léopold II, président de l’AIC, y fut maintenu avec le titre d’administrateur général. Il fut nommé responsable des institutions administratives qu’on y installa.
Pourtant cette localisation posait un problème. Depuis que la rive droite du Pool, grâce au traité passé entre Savorgnan de Brazza et Makoko, avait échappé à l’occupation léopoldienne, l’avenir des postes créés sur cette rive était compromis. C’était le cas de Isangila, Manianga et Vivi. De plus ce site, qui servait de capitale, se prêtait difficilement à un certain développement à cause de son terrain sablonneux et de sa localisation portuaire difficile. Techniquement parlant, c’était même une erreur que d’avoir pensé à installer un port à pareil endroit (Chapaux A., 1894 : 431). Il fallait donc déménager mais pour aller où ? A Boma ?
Effectivement, Boma aurait dû jouer le rôle de base de lancement des stations de l’arrière-pays dès le début et donc, servir de capitale à l’EIC. S’il ne l’avait été, c’est parce qu’il se situait totalement en dehors de l’influence de Léopold II. D’abord vassal du Mani Kongo, Boma avait ensuite joué un rôle important dans le développement de l’activité commerciale, en tant que carrefour entre le royaume du Kongo, la région du Pool et l’Europe. Ce statut fut confirmé par l’expédition Tuckey qui témoigna que des transactions commerciales importantes se déroulaient à cet endroit, sur la rive droite du fleuve, et que le souverain portant le titre de Tshinu résidait à Mbanza-Emboma (Bontinck F., 1979 : 279-297). A cet endroit s’étaient installées pratiquement toutes les factoreries des puissances engagées dans la traite, notamment Hatton et Cookson de Liverpool (Angleterre), Jules Lasnier Daumas et Lartigue de Bordeaux (France), Nieuwe afrikaansche handels Vennootschap d’Amsterdam en abrégé NAHV (Hollande), etc.
Mais en 1878, un grave conflit opposa les Tshinu aux factoreries suite à leur décision d’augmenter le taux de transit des produits commerciaux. Ce conflit se solda par l’échec de l’aristocratie locale, ce qui brisa à jamais son prestige (Delcommune A., 1922 : 103). Entre-temps les Spiritains français y débarquaient en mai 1880 et jetaient, comme on le verra plus loin, les bases de ce qu’il est convenu d’appeler la seconde évangélisation du pays. Les factoreries en place et l’implantation des missionnaires français avaient déjà suffi, bien avant l’action de l’AlA et du CEHC, à donner son importance à la ville.
Pour des raisons tactiques, Léopold II se désintéressa d’abord de Boma ; il s’engagea même auprès de la Société hollandaise NAHV à ne pas faire concurrence aux factoreries qui s’y étaient établies. Mais après s’être débarrassé de ses souscripteurs gênants, lors de la suppression de la CEHC, il commença à manifester de l’intérêt pour ce site important. Alexandre Delcommune, le premier Belge à se fixer à Boma pour le compte d’une factorerie française, se chargea de cette mission délicate, manipulant l’aristocratie politique locale et exploitant ses dissensions avec les factoreries européennes. Malgré la signature du traité anglo-portugais en février 1884. cet agent léopoldien obtint la reconnaissance de la souveraineté de l’EIC par les autochtones de Boma. L’Acte général de Berlin répartit le pays du bas-fleuve entre l’AIC, la France et le Portugal, et Boma revint à l’AIC devenue l’EIC à partir de ce moment-là (Delcommune A., 1922 : 144-145).
En avril 1886, Boma devint le siège de l’EIC. Plusieurs raisons justifiaient cette décision ; non seulement Vivi posait un problème quant à sa situation, mais il était nécessaire de mettre un terme aux ambitions du Portugal sur Boma. De plus, cette ville était la mieux connue des Européens ; c’est là qu’ils résidaient surtout et qu’ils pouvaient communiquer plus facilement avec l’Europe. Il était normal pour eux que le siège du Gouvernement de l’EIC soit situé dans la station la plus importante du pays. Par ce transfert, c’est l’administration locale elle-même qui gagna en consistance. Dès le 17 avril 1887, un Décret royal plaça le gouvernement local sous la haute direction non plus d’un Administrateur général, mais d’un Gouverneur général, représentant du Roi, assisté d’un Inspecteur général, d’un Secrétaire et d’un certain nombre de Directeurs. Un autre Décret royal, celui du 22 juin 1889 créa les fonctions de vice-gouverneur général et fixa les services de l’État à sept directions administratives.
Boma était à la fois la capitale de l’EIC et le chef-lieu du district portant ce nom. En janvier 1898, ce district comptait deux cent quarante-huit Européens dont deux cent dix à Boma même. C’est à Boma que le pays connut en 1908 le transfert du statut de « EIC » à celui de Congo belge. L’inspecteur d’État Ghislain, au nom du vice-gouverneur absent, proclama l’annexion en ces termes : « J’ai l’honneur de faire savoir au personnel de l’EIC, à tous les résidents non indigènes des races européennes et de couleurs, et à tous les nationaux, qu’à partir du 15 novembre 1908, la Belgique assume la souveraineté sur les territoires composant l’EIC » (MG, 1908 : 708). Boma devint ainsi la première capitale de la colonie belge et joua ce rôle pendant onze ans. Par la suite, il fut menacé dans son statut de capitale. On lui reprochait sa position géographique nettement excentrique par rapport au reste du pays. Déjà à l’époque de l’EIC, Wauters notait ceci :
Il est probable que Boma, dont la situation n’est pas suffisamment centrale, ne demeurera pas la capitale de l’État ; il est question du transfert de l’administration à Stanlep-Pool ; il est aussi possible que l’on choisisse un emplacement entre le Pool et le Bas-Congo sur les hauts plateaux que dessert le chemin de fer (Wauters A.J., 1889 : 437-438).
Boma subissait effectivement la concurrence sérieuse de Léopoldville, située au milieu d’une population dense, juste en face de M’Fua, centre des opérations françaises. Sa situation avantageuse le désignait comme capitale du vaste empire belge. A peine quatre ans après l’annexion du Congo à la Belgique, Georges Moulaert, alors commissaire de district du Moyen-Congo, celui-là même dont le nom allait désigner un des quartiers de Léopoldville, plaida auprès des gouverneurs généraux Wahis (le 12 février) et Fucks (le 15 juin) pour que la capitale du Congo soit installée sur les rives du Pool (Whyms, 1956 : 33). L’Arrêté Royal du 1er juillet 1923 opta pour le transfert. Pourtant, ce n’est qu’en octobre 1929 que le déménagement eut lieu de manière effective et que Léopoldville commença à exercer effectivement son rôle de capitale. Boma l’avait été pendant quarante-trois ans, au cours desquels il avait vu défiler sept gouverneurs généraux, d’abord de l’EIC et ensuite du Congo belge : Camille Janssens (1887-1890), Th. Wahis (1892-1912), F. Fuchs (1912-1916), E. Henry (1916-1920), M. Lippens (1921-1923), M. Ruttens (1923-1927) et A. Tilkens depuis 1927 (voir tableau 12).
La station de Léopoldville existait depuis décembre 1881. Quatrième station à avoir été créée, elle se situait au point de jonction des caravanes venant de l’océan et du bief navigable le plus important du fleuve. C’était un lieu de passage obligé. La firme hollandaise NAHV fut la première à y installer une factorerie. Le 1er avril 1886, elle acquit son premier statut administratif en devenant le chef-lieu du district de Stanley-Pool. Le 16 mars 1896, la future capitale inaugura sa nouvelle gare. Georges Moulaert fut nommé commissaire de district en 1907 et en 1908, quand le pays changea de statut, Léopoldville reçut la visite de Jules Renkin, le premier ministre des Colonies du royaume de Belgique. A l’époque, la ville comptait 2 531 Européens dont 1 755 Belges et 776 Etrangers contre 37 634 Noirs.
Le transfert fut retardé de 1923 à 1929, parce qu’on ne voulait pas que Léopoldville soit une capitale de fortune à l’instar de Boma et de Vivi. Il fallait un site qui puisse se prêter à l’érection de bâtiments administratifs ; de plus, on tenait à y construire d’abord un quartier neuf. Pendant cette période intermédiaire, son statut privilégié n’avait fait que s’affermir. En effet, l’Ordonnance n° 58/56 du 10 août 1923 l’éleva au rang de district urbain pendant que Boma jouait toujours le rôle de capitale. Plus tard, en 1933, Léopoldville devint à la fois capitale du Congo belge, chef-lieu de la province de Léopoldville et chef-lieu du district urbain de Léopoldville. En 1941, les autorités coloniales substituèrent le terme de district urbain à celui de ville, dotée d’une personnalité juridique. On sait que cette ville a réussi à conserver son importance même après la colonisation, lorsqu’elle a repris son nom véritable, à savoir Kinshasa (Whyms, 1956 ; Mpinga H., 1967 ; Kolonga M., 1979 ; VanhoveJ., 1968).
Depuis la capitale, il fallait assurer la gestion de l’État et mettre en place une structure administrative efficace. L’État léopoldien d’abord et le Congo belge ensuite y avaient pensé. Soulignons que cet État comptait deux centres de décision : Bruxelles, la capitale de la métropole où résidait le roi-souverain et Viui ou Boma, la capitale de l’État (et plus tard de la colonie) qui constituait le centre d’exécution des décisions de la métropole. Nous allons examiner tour à tour ces deux instances.
A Bruxelles, l’AIA puis le CEHC et l’AIC s’étaient reposés sur une administration réduite à sa plus simple expression. En 1879, au moment où le CEHC fut dissous, le personnel de cette administration se limitait pratiquement à une personne, le colonel M. Strauch qui avait succédé dans cette fonction au baron J. Greindl. Il était assisté dans sa tâche par quelques officiers d’ordonnance du roi. En 1882. Strauch fut nommé président de l’AIC tout en demeurant secrétaire général de l’AIA. C’est à ce titre qu’il négocia avec les différents participants de la Conférence de Berlin la reconnaissance des territoires occupés par son association. Avec la création de l’EIC, l’administration se structura davantage. Elle aboutit à la création de trois départements : l’Intérieur, les Finances et les Affaires étrangères, la Justice et les Cultes. Les responsables de ces départements furent des administrateurs, puis des secrétaires d’État à partir de septembre 1891. Mais le Décret du 1er septembre 1894 centralisa encore l’organisation de l’administration centrale. Celle-ci consista alors en un seul secrétaire d’État assisté d’un cabinet, de trois secrétaires généraux (des départements des Affaires étrangères, de l’Intérieur et des Finances) et d’un trésorier général. L’administration centrale conserva cette structure d’organisation pratiquement jusqu’à la transformation de l’État en colonie de la Belgique. Entre 1894 et 1908, elle ne connut en effet qu’une seule modification de type conjoncturel : M. Van Eetvelde qui exerçait les fonctions de secrétaire d’État depuis cette date, dut démissionner en 1901 ; Léopold II ne crut pas utile de lui trouver un remplaçant et devint lui-même son propre secrétaire d’État, de 1901 à 1908 (Vanhove J., 1968 : 7-14).
C’est cette administration que le législateur belge préféra commuer en « Ministère des Colonies » en 1908. Juridiquement, ce changement de statut s’effectua le 15 novembre 1908, conformément à l’Arrêté Royal du 4 novembre 1908 qui fixa à cette date la prise en main par la Belgique du droit de souveraineté sur les territoires de l’ancien EIC (Vanhove J., 1968 : 20). Léopold II, souverain de l’EIC, perdit cette prérogative sans avoir jamais vu cet État dans la réalité. Il exerça pourtant un pouvoir plus qu’absolu, se déclarait « propriétaire » du Congo. Il est difficile aujourd’hui de justifier et surtout de comprendre une telle prétention. Il n’empêche qu’elle était réelle : Léopold II estimait posséder notre Congo comme on peut posséder un terrain ou une maison. C’est ainsi que dans son testament, en 1890, il légua à la Belgique ses « droits souverains ». Pour retrouver un tel absolutisme, note-t-on en Belgique, il fallait remonter aux rois mérovingiens (Stengers J., 1989 : 93).
Pourtant Léopold II n’avait rien d’un souverain médiéval ; il était capable de se conformer aux institutions de son époque. A l’égard de la Belgique, il était roi de droit constitutionnel et on considère que, de tous les souverains belges, c’est lui qui fut le plus scrupuleux dans l’application des règles constitutionnelles. C’est uniquement vis-à-vis du Congo que sa gestion ne fut régie par aucune norme précise puisqu’il n’avait même pas à en rendre compte auprès du gouvernement belge.
Sur le terrain, le roi souverain était représenté par un administrateur général, Sir Francis de Winton, qui succéda à Stanley dans cette fonction et qui eut à proclamer, on l’a vu, la fondation de l’État à Vivi le 1er juillet 1885. Peu après, le titre de « gouverneur général » se substitua à celui d’administrateur général. A Boma, l’administration centrale fut composée du gouverneur et de ses adjoints (vice-gouverneur général, inspecteur d’État), d’un secrétariat et de services administratifs (directions de la Justice, de la Marine et des Travaux publics, du Service administratif, de l’Agriculture, de l’Industrie et des Mines, des Travaux de défense, de la Force publique et des Finances) (Vellut J.L., 1974 : 115-116). A part quelques réajustements administratifs, cette structure demeurera à peu près inchangée, jusqu’en 1960.
L’histoire administrative proprement dite du Congo prit corps en 1888, quand le pays connut pour la première fois une structuration interne mise en place pour les impératifs de la nouvelle gestion. En effet, par Décret Royal du 1er août 1888, le pays fut divisé en onze districts : Banana, Boma, Matadi, Cataractes, Stanley-Pool, Kasaï, Equateur, Ubangi et Uélé, Aruwimi et Uélé, Stanley-Falls et Lualaba. Administrés par des commissaires assistés par des adjoints, les districts constitués par ce décret étaient pratiquement délimités par des frontières conventionnelles : parallèles, méridiens, limites de bassins fluviaux, cours d’eau et lacs (carte 16). Ceci trahissait une connaissance encore élémentaire de la géographie et de la population. Le décret était d’une portée politique suffisamment explicite. Il entendait démontrer que l’EIC occupait effectivement et contrôlait les territoires qu’il revendiquait.
On notera que l’actuel Bas-Congo, le pays allant de la côte atlantique au Pool, regroupait à lui seul cinq districts. Toutes les autres régions se partageaient les six autres districts. Le tracé n’avait pas obéi aux mêmes motivations dans l’une et l’autre série de districts. Dans le secteur côtier, le découpage était essentiellement un acte de souveraineté, soucieux de la protection des limites frontalières : le commissaire de district de Banana devait faire respecter les droits du nouvel État depuis l’océan Atlantique jusqu’à la crique de Malela, celui de Boma en faisait autant jusqu’à l’embouchure de la rivière Ango-Ango, celui de Matadi assurait cette protection jusqu’aux rivières Lufu sur la rive gauche du fleuve et Ntomba sur la rive droite. Cette dernière rivière marque encore aujourd’hui la limite occidentale de la zone de Luozi. Dans le Mayumbe, les districts étaient délimités par les méridiens de la crique de Malela et l’embouchure de Ango-Ango.
La concentration des districts sur le secteur côtier obéissait aussi au souci de favoriser la rentabilité économique de la partie du pays la plus apte à assurer les premières exportations ; de 1887 à 1891, l’huile de palme et les noix palmistes du Mayumbe et du Bas-Congo représentaient respectivement 15,7 % et 23,7 % des recettes d’exportation de l’EIC (Plan décennal, 1949 : 582).
EVOLUTION DES FRONTIERES – Carte 15
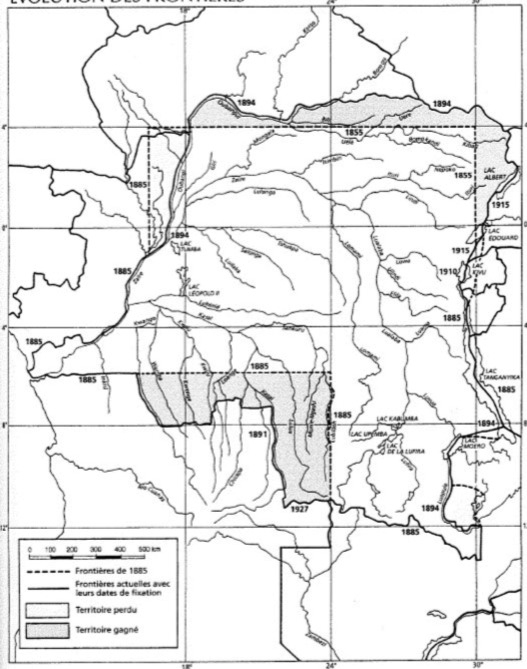
LA PREMIERE ORGANISATION DU PAYS EN 1888 – Carte16
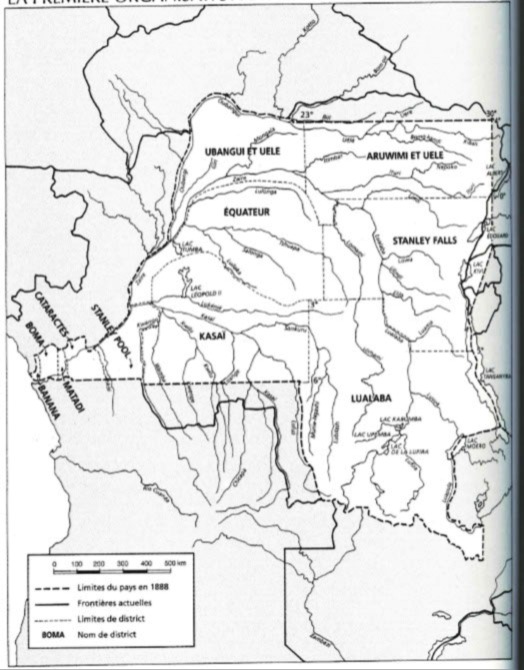
LES DISTRICTS DE L’E.I.C. EN 1895 – Carte 17
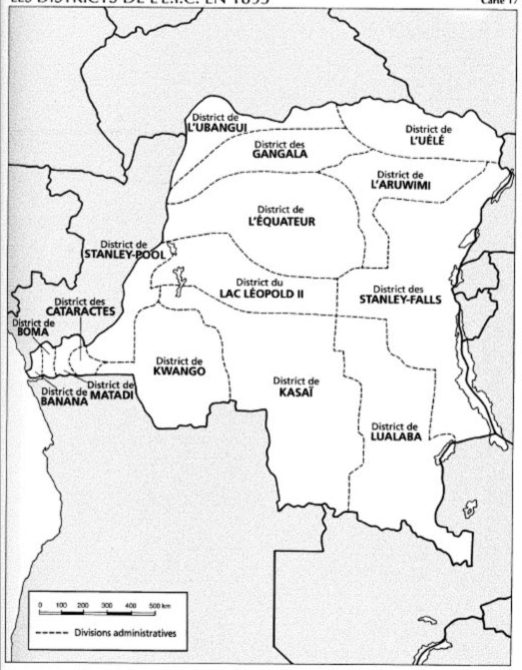
OCCUPATION ECONOMIQUE DU CONGO – Carte 18
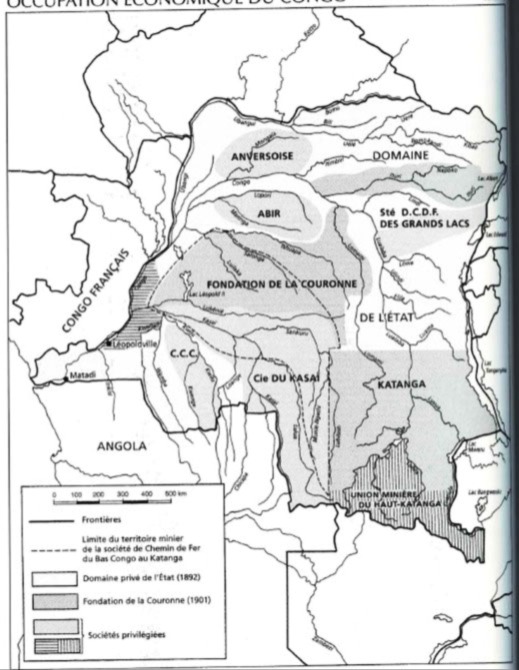
Dans les autres régions, le découpage en districts s’est plutôt opéré en fonction de la lutte contre les Arabes et les Swahili. La délimitation de Stanley-Falls a tenu compte de la nécessité de bloquer l’extension de l’influence arabe et d’éviter dans le nord une jonction possible avec le courant madhiste. Le 23e méridien Est, choisi comme ligne de démarcation entre l’Ubangi-Uélé et l’Aruwimi-Uélé d’une part et le Kasaï et le Lualaba d’autre part, correspond à celui de l’embouchure de l’Itimbiri. Son choix découle de la nécessité de diviser en deux la protection de la frontière nord, jugée trop vaste. La division purement conventionnelle entre les régions actuelles de l’Equateur et du Haut-Congo tire son origine de là. Le reste était structuré en fonction du fleuve, des affluents et des rivières qu’il draine. Les responsabilités se répartissaient comme suit : le commissaire de district de Stanley-Pool s’occupait de la liberté de navigation et du respect des lois de l’EIC jusqu’au bassin de Kasaï ; celui de l’Equateur exerçait cette responsabilité du Kasaï à Mbandaka ; celui de l’Ubangi- Uélé de Mbandaka à l’Itimbiri et celui de Aruwimi-Uélé, enfin, avait pour mission d’arrêter les poussées des Swahili vers le nord et l’ouest. Enfin, la crête septentrionale du bassin du lac Maindombe, adoptée comme limite des districts du Kasaï et de l’Equateur en 1888 marque aujourd’hui encore la frontière entre les régions de Bandundu et de l’Equateur.
On constatera qu’une bonne part des intuitions, qui ont présidé à la délimitation de ces premiers districts, ont prévalu jusqu’à nos jours et déterminent encore des éléments de l’organisation territoriale du Congo contemporain (De Saint Moulin L., 1988 : 198-202).
Certains changements allaient s’opérer. Le 10 juin 1890, un nouveau Décret créa un douzième district appelé « Kwango oriental ». Par cet acte, Léopold II s’appropria les parties du Kwango, aujourd’hui intégrées au territoire national. L’appellation de « Kwango oriental » indiquait que l’EIC revendiquait uniquement les terres situées sur la rive droite du Kwango. Malgré tout, le Portugal protesta vivement avant de consentir à ratifier en 1891 l’état actuel de la frontière entre le Congo et l’Angola (Mukoso Ng’ekiel, 1981 : 106-110).
Au fil des temps, plusieurs modifications furent apportées de manière pragmatique : le 25 juin 1889, le gouverneur général décida que le district de 1 Equateur serait provisoirement géré par le commissaire de district de l’Ubangi-Uélé. La conjonction des deux districts fournissait d’ores et déjà une première configuration de la région actuelle de l’Equateur. En 1892, le roi institua une région administrative du lac Tanganyika, correspondant approximativement à la zone de guerre contre les Arabisés. En 1895, le nombre des districts fut porté à quinze, et certains furent subdivisés en zones mais cette disposition ne fut pas générale (carte 17). Dans la même optique pragmatique, le district des Stanley-Falls fut nommé « Province orientale » et son chef-lieu, Stanleyville, mais sans changement de délimitation ni d’attribution. En 1904, des secteurs furent créés en tant qu’unités administratives de police. Cette organisation arbitraire à laquelle s’ajoutaient des pouvoirs particuliers accordés à telle ou telle compagnie laissait libre cours à l’anarchie. Il a fallu attendre l’avènement du Congo belge, qui succéda à l’EIC, pour que l’on se préoccupât de rétablir l’ordre par l’harmonisation des structures et l’instauration d’une hiérarchie de pouvoir clairement définie. Dans un Arrêté Royal promulgué en 1910, une des premières mesures ramenait le nombre de districts à douze : c’était l’aboutissement des vicissitudes de l’histoire administrative de l’EIC (Vellut J.L., 1974 : 111-115). Par la suite, d’autres types de changement interviendront pour répondre aux impératifs du second ordre colonial.
2 LA MORPHOLOGIE DE L’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE
L’impératif économique, nous l’avons vu, fut la première motivation à la base de cette aventure léopoldienne. La pierre angulaire de l’exploitation économique résidait dans l’attitude adoptée à l’égard de la question foncière. La production de cueillette, les prospections minières et la production agricole qui allaient suivre n’étaient que les conséquences de cette première attitude.
Le régime léopoldien répartit les terres locales en trois catégories : les terres indigènes, les terres vacantes et les terres concédées à des tiers, personnes physiques ou morales.
La notion de « terres indigènes » n’a jamais été définie avec précision. D’après les textes réglementaires de 1885-1886, on entendait par là les terres occupées par des populations indigènes sous l’autorité de leurs chefs et régies par les coutumes et les usages locaux. Or, d’après l’entendement congolais, toutes les terres entraient dans cette catégorie et il n’y en avait pas qui fussent « libres ». En effet, la terre que l’on possède ne se limite pas à la superficie du village. Les immenses surfaces destinées à la chasse, à la pêche et à la cueillette auraient dû être considérées comme « rentabilisées », et donc respectées en tant que telles. C’est au sein de ces surfaces que le village changeait d’implantation, devant la nécessité constante de conserver une distance réduite par rapport aux régions d’approvisionnement. On ne comprit pas les choses de la sorte, de même qu’on négligea le culte des ancêtres qui n’autorisait pas que l’on puisse « céder » la terre. Or, jusqu’au Décret du 3 juin 1906, le nouveau pouvoir estima que n’appartenaient aux autochtones que les terres habitées, cultivées et exploitées suivant les usages locaux, ce qui signifiait : presque rien, vu le dépeuplement qui s’était opéré. Du reste, d’après les lois de l’EIC, ces terres « indigènes » pouvaient à tout moment changer de statut si un étranger venait à s’y intéresser. La loi coloniale, dans ce cas-là, autorisait les villages qui s’y trouvaient enclavés, à continuer leur activité agricole et d’autosubsistance tant que le mesurage officiel n’avait pas encore été effectué ; après le mesurage, il fallait penser au déménagement. Les terres indigènes étaient en définitive des terres en sursis auxquelles les Etrangers n’avaient pas encore trouvé d’affectation, mais qui étaient habitées par les autochtones.
Devant une étendue dépourvue de villages, les terres étaient simplement déclarées « vacantes », donc propriété de l’État. L’idée de déclarer terres domaniales toutes les étendues non occupées par les autochtones était une technique qui avait fait recette ailleurs… En Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Léopold II s’était fort bien informé. En s’emparant des terres vides, l’État empêchait les colons de venir s’installer sans devoir quelque chose à l’administration. A la place des propriétaires autochtones, c’est l’État qui encaissait le profit d’une telle redistribution générale des terres. Cette attitude était par ailleurs la conséquence de la conquête qui venait de se réaliser, confirmée ou sinon appuyée par les arguments juridiques issus de la Conférence de Berlin. Sur ces terres domaniales, on reconnaissait encore aux autochtones les droits de cueillette mais ceux-ci étaient temporaires et pouvaient être suspendus ou supprimés. En réalité, les Congolais ne se savaient pas expropriés tant que l’État ne vendait pas ou ne cédait pas la terre à un tiers.
Les terres vacantes étaient réparties en terres non mises en valeur et en domaine national, exploité en régie pour permettre à l’État de financer les dépenses de première installation. Au départ, le système mis en place imposait aux autochtones habitant le domaine national de fournir une certaine quantité de produit de cueillette (caoutchouc). De cette quantité, une portion était prélevée en guise d’impôt, une autre était échangée contre des produits importés (sel, cotonnade, etc.). Toutefois, cela ne suffisait pas à couvrir les multiples besoins de l’État. Léopold II pensa alors faire appel aux capitaux privés, dont les taxes à l’importation et à l’exportation allaient renflouer les caisses de l’État. Un problème subsistait, là aussi, car on doutait encore de la rentabilité du jeune État. Il fallait offrir des garanties. Le roi s’inspira une fois de plus des recettes qui avaient présidé au développement de l’Amérique et de l’Australie. Là-bas, de grandes concessions avaient été cédées à d’importantes compagnies de chemin de fer et elles étaient devenues les artisans de la mise en valeur du pays. Il pensa en faire autant, et concéder de vastes régions à des sociétés qui jouiraient de la liberté la plus totale pour disposer tant des populations que des ressources qu’on pourrait découvrir. Les « terres vacantes » étaient donc le capital à partir duquel tout allait se bâtir (Kimena K.K., 1984 : 279-292).
Pour mieux comprendre la logique de cette politique dans ses grandeurs et servitudes, il faut resonger à l’ambition première de Léopold II. Quand il s’était engagé dans l’aventure coloniale, il n’avait dissimulé ni son objectif final, ni le type de colonisation qu’il voulait voir s’instaurer. Encore duc de Brabant, au retour de son voyage d’Orient, Léopold II n’avait-il pas offert à Frère-Orban, ministre des Finances (en réalité premier ministre, puisque à l’époque cette fonction n’existait pas encore officiellement), une pierre de l’Acropole sur laquelle il avait pris soin de faire graver une phrase prophétique : « Il faut une colonie à la Belgique ». La colonisation, il entendait la mener comme on mène une « affaire » en se préoccupant avant tout de la rentabiliser, le profit devant à tout prix dépasser les dépenses. En 1885, au lendemain de la création de l’EIC, quand les Chambres belges accordèrent à Léopold l’autorisation d’être souverain du Congo, ils s’entendirent fort bien sur le fait que les deux États sur lesquels ce même roi devait régner désormais devaient être entièrement distincts, leurs administrations et leurs finances complètement indépendantes les unes des autres. Dans l’esprit du roi, les choses étaient encore plus claires. Non seulement la gestion devait être séparée (pour ne pas attirer sur lui les foudres de l’opinion belge et des Chambres), mais l’État du Congo devait apporter à la Belgique de larges profits tout comme les colonies indonésiennes vis-à-vis de la Hollande. Le succès de cette entreprise était garanti par l’attrait qu’exerçait le bassin du Congo sur les amateurs du commerce de traite. L’État, mieux qu’une entreprise privée, pourrait, en s’organisant bien, en retirer un plus grand profit.
Mais le gain supposait d’abord l’investissement. Comment Léopold II pourrait-il financer la réalisation de cet État ? Comment avait-il assuré son aventure coloniale ? A partir de la création de l’AIA, il prit l’option de payer de sa personne, en faisant appel à sa fortune personnelle, pour prendre en charge les frais qu’impliquaient ses initiatives en matière de colonisation. Il n’hésita pas à ouvrir un compte chez son banquier principal, Léon Lambert [1]. Le roi était très riche, par sa femme Marie- Henriette, une archiduchesse qui lui avait apporté en dot une fortune colossale. En réalité, ce n’est pas à proprement parler sa fortune mais plutôt les revenus de celle- ci qui furent investis dans l’aventure coloniale ; ils représentaient une somme non moins considérable, évaluée en totalité à onze millions et demi de francs-or environ (Stengers J., 1989 : 47). Certaines ressources provenaient aussi des fonds recueillis par les comités nationaux de l’AIA. Le Comité hollandais apporta notamment une contribution considérable pour supporter les expéditions du CEHC ; le Comité belge et des souscriptions des membres du CEHC financèrent, pour une part non négligeable, les premières expéditions par la côte orientale. Mais tout cela était insuffisant. Entre 1879 et 1885, le roi eut beau débourser personnellement plus de dix millions de francs-or, son entreprise frôla la faillite avant même que l’EIC n’ait commencé (Stengers J., 1957 : 29). Le territoire qu’il briguait était trop vaste et trop stratégique pour être entretenu par ses seuls fonds. Il fallait que l’État ait ses propres revenus. Autrement dit, il fallait que le Congo de l’époque paie lui-même la facture de sa colonisation.
Les ressources tout indiquées de l’État sont les douanes et les monopoles. Or, dans ces cas-ci, pour faire reconnaître son État par les autres puissances, Léopold II avait promis une liberté commerciale complète. L’EIC serait un État sans douanes, c’est-à-dire un État dont il était le seul à faire les frais, tout en permettant à tous de profiter librement du commerce. A Berlin, l’idée avait paru si généreuse, si merveilleuse qu’elle avait valu au roi des applaudissements unanimes (Stengers J., 1985 : 26).
Dans les faits, l’application de cette disposition présentait des difficultés. Ne l’avait-on pas prévu ? La suite démontrerait que le plus naïf n’était pas celui que l’on croyait. On se mit à tricher. Officieusement, à partir de 1886, l’État instaura le régime des droits de douane sur les produits provenant des territoires français et portugais qui transitaient par Banana. Et on enregistra immédiatement des protestations.
Ces droits d’entrée et le régime douanier n’apportèrent que des revenus fort modestes. Le premier budget officiel de l’EIC, qui date de 1886, ne signale aucune recette. Les premières prévisions dans le domaine datent plutôt de 1887, l’année qui marque le début officiel de cette pratique d’autofinancement (Vanhove A., 1968 : 8-9).
Comme les droits de douane n’apportaient que de maigres revenus, le roi instaura le régime de faire-valoir direct. L’Etat se mit alors à acheter les produits de cueillette à son propre compte pour les mettre en vente. En réalité, cette pratique existait officieusement depuis longtemps. Le produit le plus recherché, à l’époque, était l’ivoire, avant de devenir le caoutchouc. De l’ivoire, il y en avait encore et en grande quantité. Malgré l’intérêt que les Arabes manifestaient depuis des années pour ce produit, il en existait encore de très grosses quantités, entassées au fond des cases dans les villages, surtout dans la grande région forestière. Pendant de longues décennies, dans le passé, les populations autochtones avaient chassé l’éléphant ; elles en consommaient la viande mais conservaient ses défenses pour des raisons de prestige (Mumbanza mwa Bawele, 1988 : 381-422). Les étrangers vinrent ainsi s’emparer impunément de la production de plusieurs années de travail, et en même temps d’une marque de prestige traditionnel.
Les agents de l’État utilisèrent d’abord le troc. L’ivoire était échangé contre des produits européens, généralement de la pacotille, mais qu’on s’arrachait sur les marchés locaux. Ensuite, l’EIC acheta – quand il ne le ravissait pas – l’ivoire amassé par les Arabes. L’argent n’avait pas d’odeur. On se rappellera que Tippo-Tip, en tant que Wali de Stanley-Falls, exigeait que ses pairs lui vendent tout l’ivoire qu’ils collectaient ; lui-même le vendait à son tour aux Blancs. C’est ainsi que Stanley-Falls devint un immense marché d’ivoire. Plus tard les agents de l’État ne se gênèrent pas de confisquer purement et simplement l’ivoire des Arabes, sous prétexte qu il avait été collecté sur le territoire de l’EIC. Pendant « la campagne arabe », presque toutes les victoires étaient suivies de confiscation d’ivoire. Rien que la prise de Kasongo avait permis une prise de vingt-cinq tonnes (F.B., 1952 : 140). D’ailleurs à partir de 1890, le marché d’ivoire d’Anvers se mit à concurrencer sérieusement celui de Liverpool où se traitait pourtant depuis longtemps l’ivoire asiatique et africain de l’empire colonial britannique. Entre 1884 et 1904, l’EIC parvint à y écouler 454 467 défenses pour un poids de 3 660 236 kg au prix moyen de 20 frs le kg, soit un total de 73 204 720 francs (Massoz M., 1989 : 203) [2]. L’ivoire d’origine congolaise était de qualité supérieure, et les gains étaient importants.
Cet effort d’autofinancement ne se réalisa pas sans problèmes. Aussi longtemps qu’il mit en cause le seul monopole commercial des Arabes, il ne suscita aucune contestation sérieuse. Le malheur était qu’il constituait aussi une concurrence pour les sociétés commerciales européennes qui, à partir du Bas-Congo, progressaient de plus en plus vers le haut-fleuve. La concurrence de l’État, l’instance même qui était censée protéger leurs droits, constituait pour elle une réelle provocation ; de plus, ce comportement était en lui-même une remise en question d’une des principales clauses de l’Acte de Berlin. Le roi était contraint de soutenir cette contradiction dans sa politique. Aussi pouvait-il tout au plus ordonner à ses sujets d’être discrets, de fuir la confrontation directe avec les sociétés commerciales et, s’il le fallait, de recourir à des replis tactiques pour éviter les conflits sur le terrain, surtout dans la zone « sensible » de Stanley-Falls. Pour preuve, cette lettre envoyée au lieutenant Van Kerkhoven, le 10 décembre 1887, par le gouverneur général C. Janssens qui lui communique, de manière explicite, les consignes de prudence :
Le courrier officiel vous apportera une lettre concernant l’achat de l’ivoire ; ces instructions viennent de Bruxelles. Vous lirez entre les lignes. Nous pouvons toujours dire que les achats effectués l’ont été là où le commerce régulier n’a pas encore pénétré ou selon les nécessités de notre politique. Si toutefois une maison de commerce s’établit dans le haut, il ne faudra pas acheter dans les environs.
Du reste, les archives relatives à ces transactions, gardées secrètes, firent partie du lot qui fut impitoyablement brûlé (Salmon P., 1988 : 437-460).
Quelles étaient donc ces grandes maisons de commerce qui opéraient au Congo et dont on redoutait le mécontentement ? Il s’agissait essentiellement de la NAHV, de la Sanford Exploring Expédition ainsi que de la CCCI et ses filiales. La Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap (NAHV) fut constituée à Rotterdam en octobre 1880. Cette société était elle-même la reconstitution rénovée d’une autre société, la AHV (Afrikaansche Handels Vereening) fondée en 1868 et liquidée en 1879. L’entreprise fut en contact avec Léopold II par l’intermédiaire du Comité néerlandais de l’AIA et soutint ses initiatives notamment dans la constitution du CEHC. Mais par la suite, elle connut des revers qui provoquèrent la liquidation de l’affaire, et sa reconstitution sous une forme nouvelle. La « nouvelle » société, la NAHV fut prospère et ses affaires en Afrique ne firent qu’augmenter en importance (Wesseling H.L., 1988 : 468-475) [3]. A l’inverse de la NAHV qui était déjà sur le terrain avant Berlin, les deux autres compagnies se constituèrent sur la base de la liberté de commerce qui venait d’y être proclamée. La Sanford Exploring Expédition (SEE) fut créée à Bruxelles le 26 août 1886 par Sanford, Brugmann et Consorts en vue d’entreprendre le commerce de l’ivoire et du caoutchouc dans le haut-fleuve. Ses agents fondèrent la première factorerie européenne de Luebo, au confluent de Luebo et de la Luluwa. On y récoltait l’ivoire et le caoutchouc.
Quant à la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie (CCCI), elle fut constituée en décembre 1886 à l’initiative du capitaine Thys, officier d’ordonnance du roi et de quelques-uns de ses amis, avec un capital de 1 227 000 francs-or. Cette société fut créée dans le but de pourvoir à la fois à la construction et à l’exploitation du chemin de fer Matadi-Stanley Pool ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exploration des richesses « naturelles » du haut-fleuve. Une année après sa création, elle mit sur pied plusieurs expéditions, à la fois pour entamer les études en vue de la création du chemin de fer (expédition Cambier) et l’exploitation commerciale du bassin du Kasaï et des cours d’eau du haut-fleuve (expédition Delcommune) : elle s’octroya cent cinquante mille hectares le long de la future voie ferrée Matadi- Léopoldville. Deux ans après sa création, elle décida de se subdiviser en plusieurs filiales : la Compagnie des magasins généraux du Congo fut constituée en octobre 1888 avec un capital de six cent mille puis d’un million deux cent mille francs pour l’exploitation des hôtels et des magasins de vente au détail d’articles d’importation, notamment à Matadi et à Banana. La deuxième et la plus importante des filiales de la CCCI fut fondée en décembre 1888 sous l’appellation de Société anonyme belge pour le Commerce du Haut-Congo (S.A.B.) avec un capital initial d’un million deux cent mille francs, porté après à cinq millions cinquante mille francs. Destinée principalement au commerce de l’ivoire et du caoutchouc, elle absorba dès sa création la Sanford Exploring Expédition dont elle reprit les établissements. Elle entreprit de manière systématique l’occupation commerciale du pays du haut-fleuve.
Quant à la troisième filiale de la CCCI, la Compagnie des Produits du Congo, constituée avec un capital initial de trois cent mille, porté ensuite à un million deux cents mille francs, elle fut destinée essentiellement à l’élevage du bétail et à la commercialisation des produits agricoles de Factuel Bas-Congo.
Entre-temps, avec le soutien de Léopold II, le capitaine Thys parvint à convaincre certains milieux financiers des perspectives économiques heureuses que constituait le financement du chemin de fer Matadi-Stanley Pool. C’est ainsi que la Compagnie du Chemin de fer du Congo (CCFC) fut constituée en juillet 1889 en tant que quatrième filiale, avec un capital initial de vingt-cinq millions de francs ; dix furent souscrits par le gouvernement belge et quinze autres par les milieux privés belges, anglais, allemands et américains (Cornet R. J., 1947 : 145.163. 178 : Sikitele G., 1986 : 191-192). Le premier coup de pioche pour la construction du chemin de fer fut enfin donné le 15 mars 1890 par H. Charmanne, qui dirigea la seconde mission de prospection en 1888-1889 et qui devint en 1890 directeur de la construction du chemin de fer (Sabakinu K., 1981 : 68-69). Les rails qu’on commença à poser n’atteignirent Léopoldville, à 398 km de là, que huit années plus tard, tant l’entreprise était difficile.
Grâce à ses filiales, la CCCI était très prospère. Pendant que la CCFC acquérait une importance grandissante dans le Bas-Congo, la S.A.B. occupait une position dominante dans le Haut-Congo, où elle racheta les établissements des firmes françaises qui opéraient sur le territoire de l’EIC. Belle opération politique où le capitalisme belge s’efforçait d’éloigner le capitalisme français de son futur territoire. Vers 1892, il ne restait plus que deux sociétés commerciales concurrentes dans le Haut- Congo et dans le bassin du Kasaï, la S.A.B. et la NAHV, qui subissaient la concurrence de l’État, un État encore et toujours en mal d’argent, malgré ses ressources supplémentaires.
Pensant à emprunter, le roi se tourna vers la Belgique. Dans une lettre au premier ministre, il exposa le problème dans des termes suffisamment explicites. « … Je viens en toute franchise vous dire que cette fortune [celle du roi] ne suffit pas pour élever l’édifice belge dont les bases ont été établies avec tant de succès. Le moment est venu pour la Nation d’intervenir » (Stengers J., 1957 : 30-31). Deux fois, en 1890 et en 1895, la Belgique accepta de voler au secours du roi en lui accordant des prêts. En 1890, le roi avait besoin de vingt-cinq millions de francs. Cette somme lui fut accordée par la Convention de Prêt du 3 juillet 1890 mais échelonnée sur une période de 10 ans : 5 millions étaient versés dans l’immédiat et le reste en dix versements annuels de 2 millions chacun. Au moment où cette Convention était en pleine exécution, le budget de l’EIC était à nouveau déficitaire, en 1895. Plusieurs millions étaient nécessaires pour faire face à ses obligations ; le montant réclamé était ventilé comme suit : 1 million et demi environ pour combler le déficit de l’exercice courant et plus de 5 millions pour pourvoir au remboursement d’une créance détenue par un banquier anversois. La Belgique consentit une seconde fois à intervenir, en dépit des réticences des socialistes qui, en 1890, ne siégeaient pas encore dans les Chambres. La loi du 29 juin 1895 autorisa le gouvernement à avancer à l’EIC une somme globale de 6.850.000 frs ; mais en réalité, le Congo reçut en 1895-96 des versements pour un total de 6.847.376,12 frs ; le solde restant ne lui parvint pas, comme c’était pourtant prévu pour 1897. La somme totale des prêts consentis au Congo par la Belgique fut de l’ordre de trente-deux millions de francs, plus précisément de trente et un millions huit cent quarante-sept mille trois cent soixante-seize francs, douze centimes.
Par la suite, il ne fut plus nécessaire de renouveler ce genre d’exploit. En effet, après avoir frôlé longtemps la faillite, l’EIC connut soudain la prospérité grâce à la mise en valeur de l’exploitation du caoutchouc. La politique d’achat des produits de cueillette au profit de l’État avait porté ses fruits. Le caoutchouc s’avéra une véritable fortune. Il était en vogue en Europe où il intervenait dans la fabrication des pneus. Les recettes étaient abondantes. En 1896, le budget fut en équilibre ; les années suivantes, il fut fréquemment positif (Stengers J., 1957 : 31-33). En effet, dès 1896, les exportations atteignirent mille trois cents tonnes ; en 1898, deux mille tonnes et en 1901, six mille tonnes, soit plus du dixième de la production mondiale (Stengers J., 1989 : 102).
Quand vers les années 1906-1907 la crise du caoutchouc se déclara aux USA où les cours s’effondrèrent sous le prix de revient de la cueillette en Amazonie, l’EIC entrevoyait déjà des perspectives de changement de la structure économique. En effet, des expéditions organisées au Kasaï et au Katanga en 1890-1891 proposèrent la création de deux sociétés minières en 1906 : la Société forestière et minière du Congo (Forminière) et l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK). La production minière allait supplanter au moment venu l’économie de cueillette (ivoire, caoutchouc), en tant que dominante de l’économie coloniale (Merlier M., 1962 : 34). L’économie du Congo avait définitivement pris son essor.
La potion magique qui transformera la misère de l’État en une grande prospérité était donc l’instauration du régime du monopole sur les produits les plus réclamés en Europe. On décida en effet, à partir de 1891, de réserver exclusivement à l’État le soin de récolter de l’ivoire et du caoutchouc. De cette source de revenus, les autres partenaires furent exclus d’autorité. L’idée n’était pas récente. Elle fut énoncée pour la première fois à l’issue de l’expédition Emin Pacha en 1887 ; au retour, Stanley mit le roi au courant de l’existence de réserves d’ivoire fort importantes dans cette partie du pays, Uélé, Haut-Nil et Bahr el-Ghazal. Certains de ses meilleurs agents coloniaux, connaisseurs de la région, suggérèrent au roi d’adopter une politique commerciale qui assurerait à l’EIC le monopole exclusif de ces produits.
La conférence anti-esclavagiste qui s’était tenue à Bruxelles du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 avait permis de préparer le terrain, en brisant la rigueur des barrières juridiques susceptibles de faire obstacle à ce projet. Léopold H, au cours de cette conférence, se posa en leader de la lutte contre les marchands d’esclaves arabes. Pour ce faire, il lui fallait des moyens financiers. Ces moyens passaient par l’instauration de douanes et de monopoles.
En même temps, on supprimait la liberté de commerce instaurée lors de la Conférence de Berlin. En réalité, c’est la NAHV, la plus grande société commerciale non belge sur le terrain, qui allait être la première victime de cette décision. La Hollande, malgré l’euphorie générale due à la prétendue philanthropie du roi, s’y opposa. Elle fut la seule à ne pas signer le 2 juillet 1890, l’Acte général et la Déclaration de Bruxelles. Le Royaume-Uni se contenta d’émettre des réserves, estimant qu’on n’avait pas le droit de changer un traité international sans le consentement de tous les partenaires (Wesseling H.L., 1988 : 473). En dehors de ces deux oppositions, cette disposition fut adoptée. Le roi pouvait enfin donner libre cours à sa nouvelle politique commerciale. La récolte de l’ivoire et du caoutchouc était désormais rigoureusement interdite. Elle était réservée à l’État et à des sociétés d’État. Les entreprises privées n’avaient plus leur raison d’être dans ce secteur performant.
Une fois au courant de cette disposition, les milieux d’affaires privés protestèrent avec véhémence, tant en Belgique qu’ailleurs (Allemagne, France. Angleterre. Hollande, Italie, Portugal, etc.). Les deux sociétés commerciales les plus concernées – la S.A.B. et la NAHV – en firent même l’objet d’une lutte acharnée, refusant catégoriquement de se transformer en compagnies concessionnaires. Le conflit avec la S.A.B. prit une allure publique et mit personnellement aux prises le président du Conseil d’administration de la société avec le secrétaire d’État Van Eetvelde. Dans sa lettre du 14 août 1892, il écrivait entre autres :
… l’Etat cherche à nous imposer l’obligation de demander des concessions. Nous n’avons pas à nous munir de concessions pour trafiquer… nulle part au monde, pour commercer, il n’est besoin de concessions ; au Congo moins qu’ailleurs puisque la liberté complète du commerce y est garantie par un Acte international… (MG, n° 18, 14 août 1890 : 75).
Cette politique portait un coup à la NAHV juste au moment où sa position commerciale devenait prépondérante dans la région. Ainsi en 1890, les exportations qui passaient par Banana vers la Hollande étaient douze fois plus importantes que celles destinées à la Belgique. Six ans après, grâce à la nouvelle politique, les rôles furent inversés. La Belgique exportait ainsi onze fois plus que les Pays-Bas. La NAHV qui possédait 75 factoreries, un navire pour le transport sur l’océan, quatre vapeurs sur le bas-fleuve, trois autres sur le haut-fleuve, trente barques à voiles et cinq barcasses, eut à revoir sa structure commerciale en se retirant du territoire de l’EIC pour investir davantage en Angola et dans le Congo français. Dans ce dernier pays, c’est paradoxalement et ironiquement l’application de ce même système qui facilita son insertion par la création de filiales françaises (Wesseling H.L., 1988 : 471-475). La nouvelle politique fit de l’État le principal bénéficiaire de la prospérité en cours. Il était propriétaire des terres vacantes ; et c’est dans celles-ci qu’on trouvait les produits recherchés, l’ivoire et le caoutchouc. Ces deux produits devinrent donc « domaniaux », propriété de l’État, seul habilité à les recueillir.
La crise provoquée par l’instauration de cette nouvelle politique commerciale n’était pas encore achevée quand Léopold II décida d’aller de l’avant en fondant les deux premières sociétés commerciales concessionnaires auxquelles seraient cédés certains territoires « vacants », de même que le droit de les exploiter en monopole pour le compte de l’État. Concrètement, ces sociétés concessionnaires reçurent le droit de récolter les produits du domaine et celui de percevoir l’impôt, c’est-à-dire d’exiger à leur profit le travail des indigènes. L’État, en échange, obtenait des actions des sociétés et touchait par conséquent la moitié des dividendes.
La première à être fondée fut la Compagnie anversoise du Commerce au Congo, généralement désignée sous l’abréviation de l’Anversoise. C’était le 2 août 1892. Cette nouvelle société reçut en concession dans le district des Bangala, les territoires riches en ivoire et en caoutchouc qui forment le bassin actuel de la Mongala. Quatre jours plus tard, soit le 6 août 1892, fut fondée l’Anglo-Belgian India Ruber and Exploring (ABIR) qui deviendra plus tard la plus célèbre des sociétés concessionnaires de l’EIC à cause de ses innombrables abus. Sa création relevait d’un arrangement entre le roi et ses amis anglais. Elle reçut en concession dans le district de l’Equateur, les régions non moins riches en ivoire et en caoutchouc qui forment les bassins de la Lopori et de la Maringa.
L’État avait également la faculté de nommer auprès de chacune de ces entreprises un commissaire spécial qui jouissait d’un droit de contrôle illimité. Tout cela confirmait le fait que ces sociétés étaient des biens de l’État qui les utilisait comme ses agences de commerce pour opérer la récolte forcée du caoutchouc auprès des populations africaines. Cette vérité était évidente pour tous, puisque l’Anversoise et l’ABIR reçurent en outre le droit d’administrer « au nom de l’État » les régions qu’elles avaient reçues en concession.
Ces créations ravivèrent le conflit avec les sociétés commerciales privées qui avaient tenu bon jusque-là. La constitution de ces sociétés d’État passait pour être une véritable provocation, d’autant qu’elles avaient reçu en concession les régions les plus riches et les plus intéressantes, d’où l’on venait précisément de chasser la S.A.B. et la NAHV. Les critiques à l’égard de la politique de l’EIC en matière commerciale fusaient de toutes parts, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières belges. Le roi jugea bon de faire un geste pour calmer les esprits. Par un Décret, le 30 octobre 1892, il répartit les terres « vacantes » de l’EIC en trois zones distinctes. Une première zone fut réservée au commerce libre. Elle comprenait essentiellement le bassin du Kasaï et le bas-fleuve mais aussi la courte vallée de la Ruki, la petite partie de la vallée de la Lulonga, allant de son embouchure jusqu’aux confluents de la Lopori et de la Maringa et enfin, les deux rives du haut-fleuve de Stanley-Pool aux Stanley-Falls. Une deuxième zone fut déclarée « réservée », pour cause de sécurité publique. Il s’agissait des régions qui venaient à peine d’être explorées par l’EIC et dont l’accès passait encore pour être difficile : l’amont de Stanley-Falls, les régions du Katanga et le bassin du Lomami en amont de 2°30′ latitude sud. La troisième zone, la plus intéressante, Léopold II se la réserva en la plaçant sous le régime de son monopole commercial. Il s’agit de l’immense pays de la cuvette dont une partie sera déclarée domaine privé, le 5 décembre 1892, et dont une autre venait d’être cédée aux deux compagnies concessionnaires, l’Anversoise et l’ABIR. De 1893 à 1901, le bassin du Kasaï, la seule région encore libre, joua le rôle de la contrée privilégiée de la liberté du commerce, où se ruèrent les différentes sociétés privées qui venaient faire fortune en Afrique.
En décembre 1901, la fondation de la Compagnie du Kasaï entraîna un nouveau changement. Quand il avait été contraint d’abandonner cette région au commerce libre, Léopold II avait pris soin de préciser que cet abandon était provisoire, qu’il ne valait que jusqu’ « à l’époque où la Belgique pourrait exercer son droit de reprise conformément à la convention du 3 juillet 1890 » (Art. 1 du décret du 30 octobre 1892). Cette Convention arrivait à terme en 1901. N’étant plus lié par elle ni par le décret du 30 octobre 1898, encouragé par le profit énorme de la production du caoutchouc, Léopold II chercha à récupérer rapidement le riche territoire du bassin du Kasaï qu’il avait été contraint d’abandonner au commerce libre. Une nouvelle bataille s’annonçait surtout qu’entre-temps quatorze sociétés s’étaient implantées dans cette région : il s’agissait de la S.A.B. et de la NAHV, de la Société anonyme des produits végétaux du haut-Kasaï, de la Compagnie anversoise des Plantations de Lubefu, des Plantations Lacourt, de la Belgika, des Comptoirs congolais Velde, de la Kasaïenne, de la Djuma, de la Loanje, de l’Est du Kwango, de la Centrale africaine, du Trafic congolais et de la Compagnie des Magasins généraux du Congo.
Pour ne pas renouveler son exploit de 1892, le roi renonça à l’idée de bâtir sa société concessionnaire « sur une table rase ». Il préconisa plutôt que les quatorze sociétés se constituent en un syndicat commercial dans lequel chacune d’elles serait actionnaire. Dans un premier temps, ces compagnies privées montrèrent peu d’empressement à s’exécuter mais devant la détermination royale, elles comprirent qu’elles n’avaient pas le choix. L’EIC voulait plus particulièrement avoir accès au caoutchouc des herbes, une spécialité de cette région. Le syndicat commercial fut constitué sous le nom de Compagnie du Kasaï. Elle obtint la sanction du Décret royal le 24 décembre 1901 et fut définitivement constituée par la Convention du 31 décembre 1901. L’État s’octroya la moitié des actions et des parts bénéficiaires ; le reste fut partagé entre les quatorze sociétés, qui se virent par ailleurs obligées d’abandonner à la nouvelle compagnie leurs installations, leur matériel et leurs agents (Sikitele G., 1986 : 214-295).
La Compagnie du Kasaï fut l’avant-dernière compagnie commerciale concessionnaire à être créée. En effet, l’American Congo Company fut créée par la Convention du 5 novembre 1906, et reçut en concession un premier lot de terres situé au nord du Kasaï, constitué par une bande de 25 km de largeur le long de la rive gauche du Congo jusqu’à la rivière Yumbi en amont de Bolobo et un second lot contigu au premier situé au sud du Kasaï et s’étendant au sud jusqu’à la ligne passant par Bankana et aboutissant au confluent de la N’sele au Stanley-Pool et à l’est jusqu’à la limite supérieure entre le Congo et le Kwango. Entre-temps le Comptoir commercial congolais fut reconstitué le 11 juin 1904 sur le modèle de la Compagnie du Kasaï et reçut à cette occasion le bassin de la Wamba en concession, de même que le droit au monopole commercial dans les régions comprises entre la rive du Kwango et la rive gauche de l’Inzia.
Tableau 9 — Quantité et valeurs de l’ivoire et du caoutchouc exportés de l’ElC (1896-1901)
| Années | Ivoire | Caoutchouc | ||
| Quantité (en kg) | Valeurs (en francs) | Quantité (en kg) | Valeurs (en francs) | |
| 1896 | 191316 | 3826320 | 1317346 | 6586730,00 |
| 1897 | 245824 | 4916480 | 1662380 | 8311900,00 |
| 1898 | 215963 | 4319260 | 2113465 | 15850987,50 |
| 1899 | 291731 | 5834620 | 3746789 | 28100917,50 |
| 1900 | 262665 | 5253300 | 5316534 | 39874005,00 |
| 1901 | 289912 | 5798240 | 6022733 | 43965950,00 |
Tableau 10 — Part des valeurs du caoutchouc dans les valeurs totales du commerce spécial de l’ElC (1896-1901)
| Années | Valeurs du caoutchouc (en francs) |
Valeurs totales du commerce spécial d’exploitation de l’ElC (en francs) |
Part des valeurs caoutchouc dans les valeurs totales (en %) |
| 1896 | 6586730 | 12389600 | 53 |
| 1897 | 8311900 | 15146976,32 | 54,8 |
| 1898 | 15850987,5 | 22163481,86 | 71,4 |
| 1899 | 28100917,5 | 36067959,25 | 78 |
| 1900 | 39874005 | 47377401,33 | 84 |
| 1901 | 43965950 | 50488394,31 | 87 |
Sources : BO-EIC, 1897 :113 ; 1898 :56 ; 1899 : 76 ; 1900 :41 ; 1901 :108 ; 1902 : 60.
Le grand rêve de Léopold II était enfin réalisé. Le dernier rempart de la liberté commerciale au Congo venait de tomber. Le Congo était soumis à une exploitation personnelle, sous des formes variées : domaine privé, compagnies privées, le tout géré par ses amis ou des fonctionnaires fidèles. En 1901-1906, au stade final de l’exécution de ce vaste programme commercial, la répartition générale de l’espace national se présentait comme suit : le domaine privé de l’État comprenait les bassins de l’Uélé, de l’Ubangi, de l’Itimbiri, de l’Aruwimi, du Lualaba en amont des Falls, le bassin du Lomami, une partie du bassin du Kwango : ce domaine était exploité par le roi mais par l’entremise des agents de l’EIC. Le domaine de la Couronne, devenu vers 1896 Fondation de la Couronne, concernait les bassins du lac Maindombe, de la Lukenye, de la Busira-Tshuapa et de la Momboyo. L’ABIR exploitait les bassins de la Lopori et de la Maringa ; ÏAnversoise. le bassin de la Mongala ; la Compagnie du Lomami avait en propriété les territoires situés dans la partie de la vallée du Lomami en aval du Bena-Kambu. Le Comptoir commercial congolais dominait la vallée de la Wamba et la région de l’entre-WambacInzia. Le Comité spécial du Katanga (CSK), créé seulement le 19 juin 1890 à la suite de la suppression de la « Compagnie du Katanga », avait le droit d’exploiter tous les territoires situés au sud du 5° de latitude sud et à l’est de la Lubilash. La Compagnie du Kasaï, enfin, occupait le bassin du Kasaï, au sud de la Lukenye et à l’ouest de la Lubilash (carte 18).
C’est dire que les recettes de l’État, à partir de 1897, ne cessèrent de croître : l’État sortait de la période des grandes dépenses dues à la campagne arabe et aux expéditions vers le Nil. La grande prospérité de l’État résultait, comme on l’a vu, non seulement du monopole des sociétés concessionnaires, mais aussi et surtout du « Domaine privé de la Couronne ». Une manière de donner une forme institutionnelle à des transferts de fonds du Congo à la Belgique.
Parlons un peu de ce fameux « Domaine » et des bénéfices qu’on a pu en tirer pour se faire une idée de ce que le Congo léopoldien a pu dans l’ensemble rapporter à son roi et à la future métropole belge. Aborder cette question revient aussi à ouvrir l’une des pages les plus controversées de l’histoire léopoldienne. L’accumulation des richesses et leur utilisation se sont réalisées suivant des méthodes absolument inadmissibles de la part de ceux-là mêmes qui se déclaraient humains, une décennie plus tôt. Léopold II lui-même était conscient que son comportement était incorrect puisqu’il en a volontairement caché certains aspects. Ainsi donc, on ne peut aujourd’hui trouver les circonstances précises de la création du Domaine de la Couronne. « Il est peu de questions d’histoire du Congo », note un éminent historien belge, « dont l’étude présente tant d’obstacles : on s’y heurte à chaque pas à des décrets demeurés secrets, à des textes portant des dates fictives, à des dispositions légales remaniées postérieurement à la date qu’elles portent » (Stengers J., 1957 : 151). La première disposition officielle portant sur ce Domaine est le Décret du 9 mars 1896 qui, bien que portant sur des réalités du moment, n’a été pris qu’en août 1901. Il a donc été antidaté pour légaliser un comportement ancien. Dans ce Décret, le « territoire » de la Couronne est défini comme s’étendant aux bassins du lac Maindombe (appelé alors Léopold II) et de la rivière Lukenye ainsi qu’aux terres « vacantes » voisines. En 1901, la superficie du Domaine fut agrandie ; elle incluait le bassin des rivières Busira et Momboyo ainsi que des territoires du bassin de la Lubefu, soit une surface couvrant huit fois la Belgique. A partir des années 1900- 1901, le Domaine fut soumis à une exploitation distincte et déclaré propriété personnelle et privée du roi. La formule, déjà à l’époque, fut reçue comme peu élégante, voire offensante. Aussi, sur les conseils d’amis, le roi déclara-t-il le Domaine « personne civile », sous la dépendance totale de son fondateur. Le Décret du 23 décembre 1901 sanctionna cette nouvelle présentation des choses. On fit mieux plus tard, en 1906, en organisant ce Domaine privé en une « Fondation de la Couronne ». La réalité ne changeait pas mais la terminologie en était juridiquement et socialement plus acceptable.
Grâce à ce Domaine, Léopold II fit des bénéfices considérables. La seule exploitation du caoutchouc garantissait une production annuelle de l’ordre de 50 000 kg. Vendu en Europe à 7 frs le kilo, il représentait un rendement total de 350 000 frs. En 1900, le budget de l’État enregistra une recette de 700 000 frs provenant du Domaine de la Couronne. Le roi s’en servit pour réduire le déficit de l’État puisque, chaque année, c’est lui qui décidait de l’emploi des revenus du Domaine (Vangroenweghe D., 1986 : 222-223). On ne pourra jamais connaître avec exactitude l’importance des revenus puisque, comme on l’a dit, sa comptabilité fut détruite. Ce qui est certain, c’est qu’elle fut plus que considérable. Les affaires étaient tellement prospères qu’en 1906, on se préoccupa d’étendre encore ce Domaine pour y inclure le bassin de l’Aruwimi et les affluents de la rive gauche de l’Uélé-Kibali (Vangroenweghe D., 1986 : 226). On a fait quelques évaluations. La plus plausible estime à 40 millions de francs les revenus réalisés entre 1900 et 1907 (Stengers J., 1957 : 170) et à 50 millions ceux de 1896 à 1908 (Vangroenweghe D., 1986 : 227).
Si le bénéfice réalisé est scandaleux, l’usage qu’on en fit le fut davantage. Devenu richissime, ayant une fortune importante à gérer en dehors de toute pression des Chambres, de l’opinion publique, et même des fonctionnaires, le fondateur de l’AIA avait enfin les mains libres pour implanter la civilisation au coeur de l’Afrique. Il est important de mettre en évidence ici le comportement du roi. Cette fortune ne fut pas investie pour bâtir des édifices publics, créer des routes ou construire des usines au sein de l’État. Elle ne servit pas davantage à améliorer le niveau de vie des autochtones puisqu’on sait que, jusqu’à la Première Guerre mondiale, il n’y avait toujours pas d’hôpital sur le territoire de la colonie. Cette fortune servit à l’embellissement de la Belgique.
Les Travaux publics constituaient, avec la Défense nationale, les deux domaines qui préoccupaient Léopold II alors qu’il n’était encore que duc de Brabant. Si jusque-là, son goût pour les édifices somptueux n’avait pu se manifester, c’était faute de moyens. Avec les revenus du Domaine de la Couronne, il eut enfin la possibilité de satisfaire ses ambitions.
Dès 1905, il fit construire l’arcade monumentale du Cinquantenaire, acheta l’Hôtel de Belle-Vue qu’il rattacha au Palais royal ; il entama les travaux de transformation du Château de Laeken où il fit construire une tour japonaise et un pavillon chinois, pour satisfaire son goût pour l’exotisme. On construisit aussi le musée du Congo à Tervuren. Ostende, qui devait, d’après lui, devenir « la plus belle ville balnéaire d’Europe », reçut une galerie couverte le long de la mer, un golf et une tribune à l’hippodrome. Le roi avait d’autres projets, dont certains connurent un début de réalisation. Il s’agissait de démolir des maisons autour du Palais de Justice, de manière à dégager le monument, de transformer la porte de Namur pour y créer une grande place, de construire un hôtel de luxe entre la rue de Namur et la place du Trône, etc. Tous ces travaux n’ont pu être achevés, pas même dans le cadre de la Fondation de Nierderfullbach que Léopold II créa clandestinement lors de la suppression en 1908 de la Fondation de la Couronne, pour faire face aux engagements pris en la matière. Il étendit même ses appétits immobiliers hors de la Belgique, spécialement en France, dans la région parisienne et dans le midi. Aux environs de Paris, en effet, il loua le Château de Lormoy et acheta le Château de Balincourt qu’il fit reconstruire entièrement selon ses goûts ; dans le Midi, il fit construire la villa des Cèdres et en acheta trois autres au nord de la rade de Villefranche, ainsi que de nombreux terrains au cap Ferrât où il se constitua un très beau domaine. Il fit aménager un débarcadère particulier pour son yacht Alberta, où il passait la moitié de son temps (Massoz M., 1989 : 570).
Cette politique de grands travaux fut l’objet de critiques acerbes, tant de la part du gouvernement que du public belge. Le Congo apparaissait plus que jamais sans défense : paradoxalement Léopold II, son souverain, était la personne qui jouait le plus la carte « nationaliste belge », tandis que le gouvernement belge et les fonctionnaires coloniaux critiquaient cette exploitation où le bénéfice net était utilisé au seul profit de la métropole. En 1908, le premier ministre belge, Auguste Beernaert, s’interrogeait sur le bilan de la « Fondation de la Couronne ». « Qu’a fait la Fondation ? » Et lui-même de répondre : « En Afrique, rien. En Belgique, des travaux exclusivement somptuaires » (Stengers J., 1957 : 181). Plus tard pendant la colonisation, un ancien colonial se fit l’écho des sentiments de la plupart de ses collègues au retour d’Afrique, à la vue des réalisations architecturales de Léopold II « L’arcade du Cinquantenaire de Bruxelles était l’ennemie personnelle des coloniaux ». Revenant du Congo, où il n’y avait pas de routes, presque pas d’hôpitaux et d’édifices publics, ils avaient du mal à supporter la vue des bâtiments grandioses construits avec l’argent du Congo en Belgique (Stengers J. : 334).
Il est intéressant d’évaluer ce que le Congo a coûté à la Belgique, ou plutôt ce que la Belgique a coûté au Congo. Stengers a tenté de reconstituer avec minutie cette comptabilité. Rien que le coût des travaux réalisés grâce au bénéfice de la Fondation de la Couronne est impressionnant : 6 millions de francs-or pour l’arcade du Cinquantenaire, 12 millions et demi pour les travaux de Laeken, plus de
8 millions pour Tervuren, 43 millions pour le Palais de Justice et l’aménagement de son environnement. Avec les autres constructions subsidiaires, les fonds mis au compte de la Fondation Nierderfullbach, la Fondation de la Couronne avait fourni à la Belgique un total approximatif de 66 millions de francs-or. Les dépenses de l’État belge au Congo, pour la même époque, avant 1908, sont estimées à un peu moins de 34 millions de francs-or, soient 31 847 376,12 frs de prêt, environ 1 020 000 frs pour l’indemnisation des officiers belges qui ont servi en Afrique avant 1908, 200 000 frs pour l’aide de la diplomatie belge au Consulat du Congo à Zanzibar. On obtient ainsi un bénéfice net pour la Belgique de 32 millions de francs-or (environ 3 milliards deux cents millions de francs belges actuels), chiffre minimum quand on sait que les estimations surévaluaient volontiers les recettes et sous-évaluaient les dépenses. De plus, ce calcul n’a pas comptabilisé certains autres éléments, notamment le profit réalisé grâce à des transferts de fonds effectués du Congo vers la Belgique en dépit du principe de la séparation des deux gestions étatiques, le gain perçu par l’exploitation des sociétés concessionnaires, le bénéfice réalisé par l’acquisition de certains biens qui ont été simplement spoliés, telle l’accumulation des œuvres d’art qui allaient constituer les merveilles des galeries de Tervuren (Stengers J., 1957 : 28-66, 144-280). Jamais une colonisation n’a pu être aussi exceptionnellement rentable, et cela grâce à l’ivoire et surtout au caoutchouc.
L’aventure de Léopold II a donc été payante car son succès économique – le seul auquel il tenait vraiment – fut inespéré. Dans le même temps, le Congo, de manière rapide et brutale, a été offert en pâture à l’impérialisme mondial. On sait à présent que le cours de son histoire sera jalonné de plusieurs épisodes du même genre, le confirmant dans ce triste privilège d’être l’un des terrains d’élection de l’impérialisme le plus pur et le plus sanglant. C’est cet impérialisme qui, en cette fin du XIXe siècle, avait produit des effets meurtriers considérés aujourd’hui parmi les plus grands crimes contre les droits de l’homme.
Quel fut l’impact de la politique économique de Léopold II sur ces populations qui étaient chez elles et ne demandaient qu’à vivre en paix ? De nos jours, ce n’est plus un secret pour personne, on sait que le régime léopoldien fut une catastrophe sur le plan social. Même les compatriotes de Léopold II le reconnaissent et le dénoncent (Vangroenweghe D., 1986 ; Massoz M., 1989 : 450-571). Cette histoire tragique trouve son fondement dans la conception possessive que Léopold II avait de « son » Congo. De même que toutes les terres vacantes lui appartenaient d’office, toutes les populations que le hasard de l’histoire avait placées sur le territoire du Congo constituaient automatiquement, elles aussi, une main-d’œuvre vacante et disponible : « vacante » parce que sans propriétaire et « disponible » parce qu’inoccupée. Avec des espaces libres et un personnel sans emploi, Léopold II se trouva en présence d’une situation rêvée, où le prix de revient constituerait un intérêt net car il n’y avait pas de prix d’achat à défalquer. Pourtant l’économie d’autosubsistance qui prévalait au sein de ces populations n’imposait pas un régime de tout repos. Les habitants des villages avaient un calendrier de travail avec ses exigences strictes au fil des saisons : les champs, la chasse et la pêche, la construction des habitations, les palabres à trancher, etc. Il fallait désormais bouleverser ce rythme pour s’acquitter des obligations des Blancs. La vie devenait difficile.
La première rentabilité exigée fut celle du portage, suivie presque immédiatement de celle des corvées pour les vivres. Puis vint le travail du caoutchouc, point d’orgue de ce régime de terreur. On examinera l’une après l’autre ces différentes étapes.
Le portage fut un véritable enfer. Le Congolais, soumis brutalement à un rythme de travail d’une intensité inhabituelle, manifesta peu d’empressement à exécuter les travaux dont il ne comprenait pas la finalité, et pour lesquels il ne ressentait aucune motivation. Il fallait porter des caisses, aller puis revenir sur ses pas sans raison apparente. On le traita de paresseux et de congénitalement peu enclin au travail. Ce mythe du « nègre paresseux » a servi de justification dans toute l’Afrique noire à nombre de comportements irrationnels. Mais pour Léopold II, l’affaire était simple. Il fallait absolument que le travail se fasse, comme en temps de guerre, pour rattraper le temps perdu par le tâtonnement de la première décennie et pour faire rapidement fortune. Pour amener les gens à un plus grand rendement, on instaura l’impôt. Comme la monnaie n’existait pas encore, celui-ci devait se payer en nature ou en travail. Le portage fut la manière la plus courante de s’acquitter du fisc.
En l’absence de la roue et de bêtes de somme, le portage, sur la tête, sur l’épaule ou à dos d’homme, était une nécessité. Il était en usage même avant le XIXe siècle. Ce qui était nouveau, avec l’arrivée des étrangers, Arabes d’abord. Européens ensuite, c’était le portage à longue distance et l’imposition d’un poids supérieur à la norme traditionnelle. Les paquets à transporter dépassaient souvent, les 40 kg. On se déplaçait le plus souvent par groupes, et donc par caravanes. Les hommes évitaient de se faire recruter à cause de ces multiples difficultés, auxquelles s’ajoutaient les intempéries, le manque de nourriture et l’absence de gîtes d’étape où s’abriter en cours de route. Devant le refus des gens qui préféraient prendre la fuite plutôt que se faire recruter, à partir de 1891 on fit du portage une imposition, c’est-à-dire une obligation soumise à la volonté des Européens ; cette disposition demeura d’application jusque vers les années 20 (Merlier M., 1962). Une année à peine après cette imposition, le spectacle de porteurs fut courant sur les routes. Dans le Bas-Congo, un témoin oculaire raconte :
Le service du portage à dos d’homme, dans la région des chutes, entre le Bas- et le Haut-Congo, continue à prendre un développement considérable. Le long des routes, le va-et-vient des caravanes montantes et descendantes est incessant. C’est ainsi qu’au mois de juillet, plus de 12 000 porteurs sont venus prendre charge à Matadi (MG, n° 29, 1892 : 133).
Léopold II était à la fois juge et partie, quand il légiférait pour mettre à la disposition de ses agents des instruments juridiques plus adéquats pour assurer l’exploitation. Les autochtones n’en étaient pas informés et demeuraient victimes des agents européens et de leurs auxiliaires, incapables de faire la part des choses entre ce qui était la décision de l’État et ce qui relevait de l’initiative de ses exécutants. Le système de portage mis au point dans le Bas-Congo s’étendit progressivement à d’autres régions, avec son cortège de souffrances et de misères. Jusqu’à l’introduction de l’automobile, il demeura permanent, avec ses excès et ses abus. Il n’était pas rare que le recrutement se fasse sous la menace du fusil. Ceux qui parvenaient à s’y soustraire s’exposaient à de lourdes peines (paiement d’amende, arrestation) qui ne supprimaient pas cette corvée. Bien au contraire, la charge à transporter était souvent augmentée.
Alors que les autochtones étaient soumis à ce régime de sanctions répressives en matière de portage, ils se retrouvèrent soumis à une autre obligation sévère, à laquelle ils ne pouvaient guère se soustraire. Ventre affamé n’a point d’oreille ! Il fallait fournir à manger à tous les Blancs qui sillonnaient les cours d’eau avec leurs soldats, leurs porteurs, leurs nombreux auxiliaires, contraints à mener une vie ambulante sans pouvoir s’occuper d’agriculture, de chasse et de pêche. Depuis les traversées de Stanley, le casus belli était souvent la recherche de nourriture. Le climat de guerre, présent pendant des décennies, avait multiplié les bouches à nourrir : les Arabisés, les Blancs et leurs auxiliaires, les maîtres des rébellions dont on a parlé… A la fin du XIXe siècle, il y avait au Congo pas moins de 2 000 Blancs, militaires et missionnaires, 15 000 hommes de troupes avec femmes et enfants, des missions protestantes et catholiques, et il fallait nourrir tout ce monde grâce à l’impôt en nourriture, poissons, produits d’élevage, viande de chasse, chikwangue, etc. La charge était lourde. Dans le Bas-Congo, cet impôt en chikwangue fut une véritable catastrophe. Pour nourrir la seule mission de Kisantu, ses postes et ses fermes-chapelles, 15 chefferies étaient mobilisées de manière permanente. Le ravitaillement de Léopoldville constituait un véritable cauchemar. Les villages voisins jusqu’à Madimba étaient tenus à ces prestations tous les 4, 8 ou 12 jours. Dans certains cas, ils devaient parcourir environ 150 km aller et retour pour amener à destination les kilos de chikwangue qui ne leur rapportaient pas grand-chose. Le cauchemar, c’était le caractère répétitif de cette opération sans qu’on puisse entrevoir des jours de repos (Massoz M., 1989 : 507-8, 533-4).
On a essayé d’en faire une évaluation précise. Pour nourrir les 3 000 agents de Léopoldville, il fallait tous les 12 jours 700 kg de chikwangue à raison de 35 kg de charge individuelle ; soient 20 personnes qui devaient assurer le déplacement. Si on évalue à 4 jours le trajet retour, avec un jour de repos à Léopoldville, cela faisait un minimum de 9 jours pour assurer le transport de nourriture ; après quoi ces marchands devaient repartir aux champs, récolter les carottes de manioc, les mettre à rouir puis à sécher au soleil, les cuire à la vapeur, emballer le produit fini dans des feuilles qu’il fallait également cueillir. Ils devaient refaire l’itinéraire à pied avec leurs charges au dos et sur la tête. Se soustraire à cette obligation exposait à subir une expédition punitive. Un missionnaire protestant rappelle un cas qu’il a vécu en 1894 :
Un village devait envoyer des vivres et négligea un jour de les fournir. Les habitants dormaient tranquillement quand ils entendirent tirer un coup de feu et sortirent pour voir ce qui se passait. Voyant que les soldats entouraient le village, leur seule pensée fut de s’enfuir. Pendant qu’ils se sauvaient de leurs maisons, hommes, femmes et enfants furent impitoyablement fusillés ; leur village fut complètement détruit. La seule raison de ce massacre était que les gens avaient omis d’apporter ce jour-là la chikwangue de l’État (Massoz M., 1989 : 461).
Les corvées en vivres obligèrent les Congolais d’alors à revoir du jour au lendemain leur rythme de production de nourriture, réglé jusque-là sur leur propre consommation. Le changement qui leur était imposé était si brutal qu’ils ne parvinrent pas à s’en sortir.
Les populations riveraines étaient exposées plus que toutes les autres à ces exigences intempestives des visiteurs étrangers. Il arrivait bien souvent qu’à court de provisions, ils soient obligés d’acheter ailleurs de quoi offrir aux passants, par crainte de représailles. Pour se dérober à cette situation, beaucoup choisirent de déménager pour se réfugier dans des zones extrariveraines. Les rives des grands cours d’eau se vidèrent au profit de l’arrière-pays. Mais ce repli n’était qu’un sursis, car on ne pouvait pas échapper à l’emprise de l’ordre nouveau. Si on n’était pas importuné par les corvées en vivres, on l’était par le portage ou par une autre utilisation abusive de la main-d’œuvre. Les travaux du chemin de fer Matadi-Léopoldville furent eux aussi à l’origine d’une véritable hécatombe. Des 7 000 travailleurs recrutés les premières années, mis à part 1 500 qui furent rapatriés, tous trouvèrent la mort dans cette opération.
Mais la plus grande hécatombe fut causée par la récolte du caoutchouc : la page la plus triste parce que la plus sanglante de l’histoire congolaise de la colonisation. En réalité, elle n’était que la conséquence d’une logique implacable du système économique léopoldien. L’État s’était déclaré propriétaire des terres vacantes. Or les produits les plus rémunérateurs – l’ivoire et surtout le caoutchouc – se retrouvaient essentiellement dans ces terres ; aussi furent-ils déclarés « produits domaniaux » parce que leur récolte revenait exclusivement à l’État, pour autant qu’elle soit réalisée dans les terres non occupées, qui représentaient la plus grande partie du territoire. A partir des années 1891-92, l’État se mit à récolter son caoutchouc par l’intermédiaire des autochtones, à titre d’impôt fourni en travail. Les agents de l’État, dans le Domaine privé, étaient chargés de veiller sur ce travail. C’était même la raison d’être de leur affectation. Pour qu’ils ne s’écartent pas de cet objectif majeur, ils étaient jugés, appréciés, promus, voire même rémunérés en fonction de leur capacité de production de caoutchouc. Les prestations à exiger des Congolais étaient laissées à leur libre appréciation (ce sera le cas jusqu’en 1903) car la maximisation des recettes était une priorité absolue. La seule faute grave, c’était la baisse ou la stagnation de la production. Sur tout le reste, le roi-souverain fermait les yeux. L’occasion était ainsi offerte non seulement à l’État mais aussi aux individus de faire fortune. Non seulement les grands édifices de Léopold II en témoignèrent, mais aussi de nombreuses villas coquettes en Flandre et en Wallonie, et aussi de grandes fortunes familiales, toutes bâties sur cette aubaine. Pour l’ouvrier congolais, la moitié du caoutchouc revenait à l’impôt, l’autre moitié lui revenait en principe. On le lui rachetait à un prix ridicule par rapport au gain escompté en Europe et de ce montant était encore déduit le prix des vivres et autres objets (Massoz M., 1989 : 459). Le Congolais d’alors préférait la liberté à ce salaire de misère qui ne lui permettait pas de mener une vie décente au village.
Pour obtenir les prestations requises, les agents de l’État disposaient de toute une gamme de moyens de contrainte et de répression : ils pouvaient faire surveiller les villages par des soldats affectés sur place – des sentinelles -, ils pouvaient administrer et faire administrer le fouet (la chicotte) ou encore prendre des otages et organiser des expéditions punitives. Le crime de l’administration léopoldienne fut de tuer et de faire tuer des gens dont la seule faute était d’avoir été dans l’incapacité d’atteindre la quantité requise de récolte.
Incapable d’assurer lui-même le travail de la récolte, l’État céda une région de ses « terres vacantes » à deux sociétés concessionnaires, l’ABIR et l’Anversoise, avec les pleins pouvoirs de récolter le caoutchouc et de percevoir l’impôt, et donc d’exercer la police. Tout cela allait de pair, car la récolte se réalisait grâce à l’impôt en travail. L’État en revanche touchait la moitié des dividendes. Les deux sociétés firent des bénéfices inouïs mais leurs concessions furent de véritables enfers (Stengers J., 1989 : 99-101). Pendant une décennie entière, les populations des régions caoutchoutières furent soumises à dure épreuve. Les conditions de vie furent décrites de manière sommaire dans le Rapport de la Commission d’enquête 1904-1905 :
Dans la plupart des cas, il [le Noir] doit, chaque quinzaine, faire une ou deux journées de marche, et parfois davantage, pour se rendre à l’endroit de la forêt où il peut trouver, en assez grande abondance les lianes caoutchoutières. Là, le récolteur mène, pendant un certain nombre de jours, une existence misérable. Il doit se construire un abri improvisé, qui ne peut évidemment remplacer sa hutte, et n’a pas la nourriture à laquelle il est accoutumé ; il est privé de sa femme, exposé aux intempéries de l’air et aux attaques des bêtes fauves. Sa récolte, il doit l’apporter au poste de l’Etat ou de la Compagnie, et ce n’est qu’après cela qu’il rentre dans son village, où il ne peut guère séjourner que deux ou trois jours, car l’échéance nouvelle le presse. Il en résulte que, quelle que soit son activité dans la forêt caoutchoutière, l’indigène, à raison des nombreux déplacements qui lui sont imposés, voit la majeure partie de son temps absorbée par la récolte du caoutchouc (Rapport de la Commission d’enquête, 1905 : 191).
Quant aux atrocités commises, elles furent générales. Limitons-nous à reprendre quelques témoignages de l’année 1895, tous d’origine non congolaise et du reste déjà retenus pour édifier le lecteur non africain (Massoz M., 1989 : 469-476).
C’est un médecin belge qui rapporte ce qui suit de son séjour à Kutu (lac Mai- Ndombe) :
Comme nous quittions Mushie, de dessus le bateau en marche, voilà un nouveau tableau stupéfiant qui se présente à nos regards : un grand troupeau de femmes et d’enfants est conduit à la promenade encadré de trois ou quatre soldats ; fusil sur l’épaule, cortège lamentable d’humanité presque entièrement nue, couleur brun chocolat… elles sont prisonnières parce que les hommes ne veulent pas faire du caoutchouc. On leur rendra la liberté quand les hommes voudront bien se soumettre… Quand je quitte Kutu, les Noirs viennent me saluer en me disant : Blanc, nous sommes peinés de ton départ, toi seul tu étais bon pour nous. Je n’avais pourtant rien fait que ne pas les maltraiter. Je ne me vante pas, mais par la douceur, j’en aurais fait tout ce que j’aurais voulu… Cinq kilos de caoutchouc, est la quantité moyenne que chacun apporte à échanger contre deux ou trois cuillerées de gros sel et une brasse ou deux de cotonnade pour le chef… (Rihoux R., 1948).
Un pasteur américain, en Equateur, note ce récit le 3 mars 1885, à la vue d’un spectacle plus désolant encore.
Imaginez-les [soldats] revenir d’avoir soumis quelques rebelles. Voyez à l’avant du canon une perche où pend on ne sait quelle grappe. Ce sont des mains, les mains droites de 16 guerriers qu’ils ont massacrés. Des guerriers ? Ne distinguez-vous donc pas parmi ces mains celles de petits garçons et de petites filles ? Je les ai vus, je les ai vus couper ce trophée pendant que le pauvre cœur battait encore… N’est-il pas possible qu’un Américain influent aille voir le roi des Belges et lui fasse connaître ce qu’on fait à son nom… Pour lui récolter du caoutchouc, des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été fusillés (Conan Doyle A., 1909).
Un autre pasteur, un Suédois, rapporte qu’il a assisté à la mort d’un vieillard qui n’en pouvant plus, avait choisi d’aller à la pêche au lieu de récolter du caoutchouc.
…La sentinelle le tua d’un coup de fusil sous mes yeux. Puis il rechargea son arme et la braqua sur les autres qui se dispersèrent comme la paille au vent. Il ordonna à un petit garçon d’aller couper la main droite de l’homme qui venait d’être tué. L’homme n’était pas mort et quand il sentit le couteau, il essaya de retirer sa main. Avec un peu de peine, le petit garçon coupa la main et la déposa près d’un arbre tombé. Peu après, cette main fut exposée au feu et fumée avant d’être envoyée au Commissaire…
Le pasteur s’aventura à parler de cette scène au Commissaire de district. La réaction fut symptomatique :
Il se mit en colère contre moi et me dit en présence des soldats qu’il m’expulserait si je me mêlais encore de ces choses…
On pourrait s’interroger longuement sur l’origine de la pratique des mains coupées. On aura beau noter que la justice autochtone pratiquait la mutilation pour empêcher le voleur de recommencer son exploit. La vérité est que les mutilations massives ont incontestablement été une innovation de l’ordre colonial. Celui-ci a imposé ces mutilations pour une question de comptabilité, afin que le Blanc ait, au retour des expéditions, la justification du nombre de balles non rapportées par ses guerriers (Stengers J., 1989 : 99). L’excès de zèle des sentinelles fit le reste. On ne mutilait pas seulement les morts mais aussi les vivants, pour tricher et garder pour soi quelques cartouches pour la chasse. Le nombre de mains coupées servait aussi de trophée de guerre. Leur grande quantité était un signe de bravoure.
Faut-il s’interroger sur les conséquences de ces violences, encore plus meurtrières que les batailles dont il a été question plus haut ? Ce dont il faut se rendre compte, c’est que ces phénomènes, décrits les uns après les autres, étaient en réalité simultanés. Au moment où les répressions des rébellions faisaient rage, le chemin de fer Matadi-Léopoldville était en construction, l’exploitation du caoutchouc était en cours, ce qui ne faisait qu’augmenter encore les besoins en vivres et en portage.
Pour compléter ce tableau désolant, d’autres fléaux apparurent. Il s’agit des maladies endémiques, inconnues jusque-là dans nos milieux. L’arrivée des travailleurs d’autres régions du continent a eu des conséquences fâcheuses. On a vu combien la présence de ces éléments étrangers était ancienne et importante dans l’armée. Et le secteur militaire ne constituait pas une exception ; ses effectifs renseignaient sur la provenance de la main-d’œuvre utilisée : il y eut un temps où elle était presque totalement d’origine étrangère. En effet, les premiers auxiliaires noirs des Blancs arrivaient dans la région en leur compagnie. Ils étaient zanzibaristes, comoriens, ouest-africains, etc. Pour les autochtones, ils étaient les premiers êtres acculturés rencontrés et suscitaient à la fois l’admiration, la crainte et la méfiance. Leur nombre ne fit que croître de même que la diversité de leur origine. Rien que pour la construction du chemin de fer Matadi-Léopoldville, la CCFC aligna à elle seule, en 1880, des travailleurs bien divers : 32 Sénégalais, 25 Sierra-Léonais, 535 Krouboys, 39 Accras, 19 Haoussa, 8 Cabindais et 400 Zanzibaristes (MG, 1980 : 39, 56). Ces proportions se modifiaient d’année en année, au rythme des recrutements, en attendant la « congolisation » progressive de ce personnel (Sabakinu K., 1981 : 122- 124).
La cohabitation des autochtones avec ces différentes communautés, arabe, européenne et africaine, est à la base de l’introduction puis de la diffusion de maladies « nouvelles » dont certaines furent très meurtrières et contre lesquelles les populations locales étaient sans défense. Les maladies vénériennes constituèrent ainsi, jusqu’à l’introduction des antibiotiques, une « peste » qui aggrava de manière insidieuse la crise démographique du pays. Ses effets se firent davantage sentir dans des régions où les traditions autorisaient une plus grande liberté dans les mœurs, ce qui conduisit à une baisse sensible des taux de natalité. Les régions de l’Equateur, de Tshuapa, les Uélé et la zone de Bafwansende ont gardé longtemps les traces de ces ravages (De Saint Moulin L., 1987 : 388-390 ; Lyons M., 1985 : 69-91). Le fléau dont les effets pernicieux ont été plus généralisés encore a été la maladie du sommeil ; à partir du Maniema et du Bas-Congo (axe Madimba-Kisantu), les deux portes d’entrée arabe et européenne, elle s’étendit à peu près partout. Rien que dans le Bas-Congo, entre 1899-1907, cette maladie emporta 85 % de la population. Dans la colonie scolaire de Berghe-Ste-Marie (Kwamouth), on enregistra en 1900, 607 cas de décès et en 1903, 580 cas ; en 1894 Kisantu avait déploré 723 décès. La situation devint critique et préoccupante, même pour Léopold II qui promit d’offrir une forte somme d’argent à quiconque, sans distinction de nationalité, trouverait le remède contre ce fléau.
Cette maladie avait été manifestement importée. Car dès 1742, elle avait pu être observée sur des esclaves venus de Guinée. On l’avait également décelée aux alentours du lac Victoria. Sa propagation au Congo n’avait pu se faire qu’au cours de l’installation des colonies africaines (Sabakinu K., 1974 : 151-164). Les diverses missions exploratrices, l’expédition au secours d’Emin Pacha, les raids antiesclavagistes, l’affectation des travailleurs venus d’autres régions du continent, tout cela a contribué à multiplier les contacts entre les porteurs de trypanosomes et les mouches tsé-tsé, lesquelles, à leur tour, infestèrent les populations des régions traversées (KivitsM., 1988 : 300-301).
Quant aux épidémies de variole, elles furent nombreuses, diffusées plus ou moins inconsciemment par la multiplicité des déplacements et les brassages des populations. Le R.P. De Deken nous rapporte un cas épouvantable de transmission qui démontre par ailleurs que les autochtones n’étaient pas totalement inconscients des effets néfastes de la présence étrangère :
Au départ d’un voyage de Léopoldville à Luluabourg avec le steamer ‘Stanley’, le Père amène Fataki, son petit serviteur. Deux jours plus tard, le gamin présente tous les symptômes de la variole. On l’isole dans la chaloupe remorquée par le steamer et le voyage continue. Bientôt, sur le bateau, des Noirs de plus en plus nombreux présentent les mêmes symptômes et pour tenter d’enrayer l’épidémie à bord, on en débarque seize un jour et dix autres quatre jours plus tard. Tous munis d’articles d’échange en suffisance pour se procurer à manger auprès des riverains pendant trois semaines au moins, jusqu’au retour du steamer. Ce geste inconscient fut la cause d’une véritable catastrophe. Les riverains qui se laissèrent attirer par les produits d’échange, reçurent la maladie et portèrent la contagion dans leurs villages avoisinants. Un an plus tard, la petite vérole désolait encore la région de Sankuru, 10 000 Nègres avaient succombé, des villages avaient été abandonnés ou brûlés par leurs habitants, émigrés ensuite vers le lac Léopold II. Et quand, ainsi que je le raconterai dans la suite, je revins par le même navire, le ‘Stanley’ amenant de Léopoldville les Soeurs destinées à Luluabourg, le bateau que l’on reconnut parfaitement et qu’on accusait d’avoir amené la peste dans le pays, fut assailli furieusement à coups de flèches et de sagaies. Nous dûmes fuir en toute hâte. Mais à son retour à Léopoldville, le capitaine s’avisa d’un expédient dont le succès fut complet. Son navire portait jusque-là une livrée de couleur grise ; il le fit peindre entièrement en noir. Les nègres trompés par ce nouvel habit laissent maintenant à ‘Stanley’ toute liberté de s’approcher des rives pour faire du bois et se procurer des vivres (De Deken, 1902 : 142-143).
Malgré toutes ces épidémies, l’encadrement médical demeura faible et dérisoire. Il est frustrant de se rendre compte que même les chiques, qui passent pour être si bien intégrées dans la vie villageoise, constituent un produit importé. En effet, la présence de ces puces, si promptes à s’enfoncer sous les ongles des orteils, fut signalée pour la première fois sur la côte atlantique en 1872 ; c’est un navire anglais provenant du Brésil qui jeta sur la plage d’Ambriz du sable contaminé de chiques qui traînait dans le bateau. Ces bestioles se mirent aussitôt à l’oeuvre en se propageant le long du littoral, puis en faisant à leur tour en sens inverse la traversée du « continent mystérieux ». En 1885, on se plaignait déjà des chiques au Pool et en 1898, à Zanzibar (de Grancey E., 1900).
L’effet le plus immédiat de ces multiples agressions se manifesta par une baisse de la démographie. Plusieurs estimations ont été avancées pour évaluer le peuplement de la période de l’EIC. Stanley, porté à l’exagération, estima que le haut- fleuve, à lui seul, avait une population de 43 millions d’habitants, en réalité 29 millions, si l’on corrige les erreurs de calculs qui ont conduit à ce chiffre. Wissmann prétend, quant à lui, avoir rencontré au Kasaï des villages dont la traversée prenait quatre ou cinq heures… (Nicolai H., 1988 : 25-31). Le peuplement devait être variable d’une région à l’autre et ces évaluations fantaisistes. Le chiffre le plus réaliste est certainement la moyenne qu’on peut établir à partir des tentatives diverses de dénombrement, qui ont été faites sur cette période. On retiendra dès lors que le Congo de 1880 avait une population globale de 25 millions d’habitants en moyenne (Massoz M., 1989 : 575).
Quel fut le niveau de peuplement au cours des années qui suivirent, plus particulièrement au cours de la décennie suivante ? On sait que vers les années 1925-26, la population totale était d’un peu plus de 10 millions d’habitants ; le chiffre est obtenu sur base des documents de recensement administratif de ces années-là, ajustés en 1953 et corrigés en 1987. Vers les années 1890, soit 35 ans plus tôt, on peut supposer que la population totale oscillait entre 7 et 8 millions car en 1930, cinquante ans après notre année charnière de 1880, la population totale n’était encore que de 10 252 515 habitants ; en 1935, elle atteignit 10 206 381 pour passer dix ans plus tard, en 1945, à 11 206 034 (tableau V). Il faudra attendre 1975 pour que le Congo retrouve le chiffre de population qu’il avait vers 1880 (De Saint Moulin L., 1987 : 390-391). Entre 1880 et 1908, environ 13 millions de vies humaines furent détruites, lourd tribut d’accès à la colonisation. Il ne s’agit encore que d’un préliminaire car l’âge colonial proprement dit causera également des pertes. L’introduction à la civilisation a incontestablement été synonyme de dépeuplement massif. Pourtant, parallèlement à ces massacres, de grandes transformations étaient en cours.
4 L’ÉVANGÉLISATION ET L’ENSEIGNEMENT
L’évangélisation constituait le troisième plan – avec l’administration et le commerce – sur lequel s’exerçait le processus de modernisation et donc, d’accès à la culture extérieure. Les trois éléments allaient constituer les composantes de la trinité coloniale. L’enseignement dépendait de l’évangélisation, et celle-ci continuait à se réaliser suivant deux optiques distinctes, celle du catholicisme et celle du protestantisme.
L’évangélisation catholique s’est déployée au Congo en deux temps : le premier, on l’a vu, se situait entre 1482 et 1835 et le second a démarré vers 1880 (la célébration du centenaire de la seconde évangélisation s’est déroulée au cours de l’année 1980). La première activité missionnaire s’est limitée à la zone côtière occidentale, soit le pays allant de l’océan Atlantique à la rivière Inkisi [4]. Pendant près de deux siècles environ, 400 missionnaires se succédèrent au Congo, depuis les Franciscains (1491) jusqu’aux Récollets (1674) en passant par les Jésuites (1544), les Dominicains (1570), les Carmes (1584), les Tertiaires de Saint-François (1604), les Capucins (1645) italiens et espagnols envoyés par la Propagande. Bien que peu nombreux et confrontés à de nombreux problèmes d’adaptation, ces missionnaires réalisèrent un travail remarquable, surtout les Capucins. Installés au Congo depuis la fin de la première moitié du XVIIe siècle, les Capucins ne quittèrent leur implantation qu’en 1835. Au cours des deux siècles de leur apostolat, il y eut 434 missionnaires qui se succédèrent, soit une moyenne de deux ou trois nouveaux arrivants par an ; la plupart laissèrent leur vie sur place. L’entreprise connut des difficultés croissantes dues, entre autres, au climat politique peu encourageant entretenu par le Portugal, à l’insuffisance du personnel – la mortalité était fort élevée – et à des malentendus provenant de la maîtrise insuffisante des cultures locales. Il faut ajouter que les efforts timides pour former un clergé local ne purent aboutir à un résultat tangible, en dehors du cas exceptionnel d’un fils de roi qui devint évêque. Cette première expérience de christianisation s’effaça d’elle-même au début du XIXe siècle.
Ce furent les Pères français de la Congrégation du Saint-Esprit qui reprirent pied au Congo. Ils se virent confier cette mission par un décret de la sacrée Congrégation de la Propagande, daté du 9 septembre 1865. L’ancienne mission capucine abandonnée trois décennies plus tôt fut remplacée par la préfecture du Bas-Congo ou de Landana dont les frontières furent fixées : au nord, par le cap Sainte- Catherine (en face de Sâo Tomé), au sud, par la rivière Kunene (extrémité méridionale de l’Angola) et à l’est, par le Kasaï.
Les missionnaires du Saint-Esprit n’entrèrent effectivement au Congo qu’en 1880. Ils s’installèrent à Boma, et par la suite ils établirent d’autres postes, soit sur la côte près de Banana, soit plus à l’intérieur des terres, à Linzolo (1884) et à Kwamouth (1886). Parmi ces missionnaires, il y avait le P. Augouard, esprit entreprenant et plein d’initiative que la Congrégation avait détaché du Gabon pour la préfecture du Congo. La Mission de Kwamouth (1886) reçut le nom de Saint-Paul- du-Kasaï ; mais ce poste missionnaire, à peine créé, dut être transféré à Brazzaville à cause des impératifs politiques qui introduisaient un strict clivage entre le Congo français et le territoire de l’EIC. Augouard fonda la Mission de Brazzaville en 1887 sans se douter que trois ans plus tard, il allait devenir le premier évêque de ce vaste territoire ecclésiastique qui porterait le nom de Vicariat apostolique du Haut-Congo français, avec Brazzaville comme chef-lieu. Après la Conférence de Berlin, suite à la décision de Léopold II de voir son Etat évangélisé exclusivement par des missionnaires belges, le Saint-Siège ordonna aux Spiritains de quitter le Congo. Ils évacuèrent en 1891 et cédèrent leurs postes aux missionnaires de la « Congregatio Immaculati Cardis Mariæ (CICM) », Congrégation du Coeur Immaculé de Marie de Scheutveld, plus couramment appelés missionnaires de Scheut (Nkulu Butombe, 1981 : 61-71).
En même temps que les Spiritains s’installaient dans la partie occidentale du pays, une autre conquête religieuse, plus systématique encore, s’organisait dans la région orientale. L’initiative venait de Mgr Lavigerie, archevêque d’Alger qui, dès 1877, intéressa le Pape Pie IX au « signe du temps » que constituait l’exploration, et donc l’ouverture du continent noir. Mais Pie IX mourut avant d’avoir réalisé, comme il le souhaitait, cette ouverture. Ce fut finalement son successeur, Léon XIII, qui signa la décision de l’organisation des Missions de l’Afrique équatoriale. Comme on l’a déjà signalé, deux missions furent alors créées, celles de Nyanza et du Tanga- nyika. Peu après, Lavigerie, le fondateur de ces missions, obtint de Rome leur transformation en provicariats et la création de deux nouvelles missions : celles du Congo septentrional et du Congo méridional, qui s’étendraient sur le cours supérieur du fleuve jusqu’à hauteur de Stanley Pool. On était en septembre 1880. Auparavant, Lavigerie s’était préoccupé d’intéresser la générosité internationale à son action ; ainsi avait-il sollicité l’appui de Léopold II afin qu’il sensibilise les catholiques belges. Le roi fut favorable à ce projet tout en souhaitant, conformément à son projet politique, que la primauté soit accordée aux prêtres belges. L’avènement de l’Etat indépendant du Congo, à l’issue de la Conférence de Berlin, favorisa les projets politiques du roi qui jugea inopportune la présence de prêtres non belges au Congo. Puisque, comme les Spiritains, les Pères Blancs étaient français, il fallait donc qu’eux aussi se fassent remplacer. Ce qui fut fait. Ils conservèrent toutefois la région située entre le Lualaba et le Tanganyika (Vicariat du Tanganyika occidental), à la condition que les Pères Blancs qui devaient y être affectés soient de nationalité belge. Au plan officiel, il fut question que la juridiction ecclésiastique sur le nouvel État soit confiée au cardinal de Malines, primat de Belgique. En 1886, un « Séminaire africain » fut créé à Louvain dans le but de former et de consolider des vocations pour l’Afrique ; ce Séminaire fut confié aux Pères de Scheut. Deux ans plus tard, en mai 1888, le Saint-Siège créa, pour la même Congrégation de Scheut, le Vicariat apostolique du Congo indépendant, comprenant pratiquement l’ensemble du territoire de l’EIC, à l’exception des terres orientales confiées aux Pères Blancs belges.
Pendant ce temps à Paris, Lavigerie décrétait la Croisade anti-esclavagiste, à la demande expresse de Léon XIII ; cette croisade fut le point de départ des préparatifs de la Conférence anti-esclavagiste et des campagnes contre les Arabes.
C’est à cette époque et dans un esprit antiarabe que les premiers Scheutistes débarquèrent au Congo, parmi eux le célèbre P. Cambier (août 1888). D’autres congrégations allaient suivre : les Jésuites s’installèrent au Kwango (1893), les Trappistes de Westmalle à Bamania (1894), pour être remplacés trente ans plus tard par les Missionnaires du Sacré-Cœur. Les prêtres du Sacré-Cœur occupèrent Stanleyville en septembre 1897, tandis que les chanoines Prémontrés de Tongerloo (1898) élirent domicile à Buta. L’occupation religieuse se poursuivit et s’intensifia les années suivantes avec les Pères Rédemptoristes à Matadi (1899), les pères de Mill-Hill à Basankusu (1905), les Spiritains belges au Katanga septentrional (1907), les Bénédictins de l’Abbaye de Saint-André-lez-Bruges à Elisabethville (1910), les Capucins en Ubangi (1910), les Salésiens au Luapula supérieur (1911), les Dominicains au Niangara (1911). Le mouvement allait se poursuivre jusque vers les années 40 avec les Franciscains (1920), les Chanoines croisiers (1920), les Missionnaires du Sacré-Cœur qui remplacèrent les Trappistes, les Lazaristes (1925), les Assomptionistes (1920), les Joséphites (1929), les Oblats de Marie Immaculée (1931), les Passionistes (1931), les Montfortains (1933) et les Prémontrés de Poste! (1937).
Les frères missionnaires manifestèrent le même enthousiasme pour s’installer au Congo, à commencer par les Frères des Ecoles chrétiennes (1909). D’autres ordres se signalèrent peu après notamment les Frères Maristes (1911) et plus tard les Frères de Saint-Gabriel (1928), les Frères Notre-Dame de Lourdes (1929) et les Xavériens de Bruges (1931).
Du côté des religieuses, on nota le même engouement et une progression similaire, depuis l’installation des Sœurs de la charité de Gand (1891) jusqu aux Sœurs du Sacré-Cœur de Marie (1939) en passant par les Sœurs de Notre-Dame de Namur (1894), les Sœurs Blanches (1895), les Franciscaines de Marie (1896), les Sœurs du Précieux Sang (1898), les Sœurs du Cœur Immaculé (1899), les Filles de la Croix (1911), les Sœurs Augustines (1919), les Chanoinesses de Saint- Augustin (1920), les Sœurs de la Charité (1922), les Bénédictaines Missionnaires (1922) et tant d’autres encore (De Meeus D.F. et Steenberghen D.R., 1947 : 31-42, 56-60). Bref, vers les années 40, on comptabilisera pas moins de vingt-deux institutions de prêtres missionnaires, six congrégations de frères et cinquante-deux congrégations de religieuses.
Entre 1880 et 1911, une pluralité de « missions catholiques » s’étaient déjà constituées, assurant à la fois l’évangélisation et l’instruction. Elles étaient de véritables avant-postes de la modernisation du pays : il s’agissait, dans le cas des Rédemptoristes dans le Bas-Congo, de Matadi (1891), Tumba (1900), Kimpese (1901), Thgsville (1904), Nsona-Bata (1910). Boma et Moanda, créées en 1888 et 1889 par les Spiritains, avaient été reprises en 1891 par les Scheutistes. Ces derniers créèrent ensuite les missions de Kangu (1899) dans le Bas-Congo, Léopoldville (1899), Kinshasa (1911), Inongo (1907), Bokoro (1910), Ibeke (1911), Nouvelle-Anvers (1889), Mbaya (1907) au Pool et dans le Haut-Fleuve ; dans le Haut-Kasaï, ils s’implantèrent à Luluabourg (1891), Merode (1894), Lusambo (1904), Mushenge (1906), Ndembe (1907), Luebo (1909), Kabinda (1911) et Tshumbe en pays tetela (1910). Les Jésuites, à cette époque, occupaient Kisantu (1894), Lemfu (1894), Kipako (1901) et s’étaient avancés jusque Wombali (1907) dans le Bas-Kasaï. Les Cisterciens-Trappistes au Sud-Equateur étaient à Bamania (1895) et à Coquilhatville (1902). Dans la même région, les Pères de Mill-Hill créèrent au début du siècle les missions Bakakata (1905), Baringa (1907) et Basankusu (1908). Plus à l’ouest, on dénombrait dans le Haut-Congo les postes de Stanleyville (1899), Yanonge (1902), Banalia (1903), Béni (1906) chez les Prêtres du Sacré-Cœur et d’Ibengo (1898), ainsi que Buta chez les Prémontrés. Dans les régions orientales du pays, existaient les missions de Mpala (1885), Baudouinuille St-Joseph (1893), Lusaka (1896), Lukulu (1899), Kasongo (1903), Nyangezi (1906), Katana (1910), gérées par les Pères Blancs ; Kindu (1907) et Kongolo dépendaient des Spiritains ; Elisabethville (1910) et Kambove (1910) revenaient aux Bénédictins. Dans le Nord, à la frontière avec l’actuelle République Centrafricaine, les Capucins installèrent la mission de Banzyville (1910) avant celles de Molegbe (1913), d’Abumombazi (1913) et de Libenge (1915). En Uélé oriental, les Dominicains reprirent en 1912 la mission de Gubari fondée en 1903 et qui sera transférée en 1917 à Watsa ; Dungu et Niangara ne furent fondées qu’en 1919 (Annuaire des missions catholiques…, 1989 ; de Meeus D.F. et Steenberghen D.R., 1947).
Les missionnaires protestants menaient une action semblable, créant des missions, se dépensant pour assurer l’instruction et l’évangélisation des populations. L’implantation du protestantisme au XIXe, plus ancienne que celle du catholicisme, a connu un tout autre rythme. Non seulement elle n’a pas bénéficié de l’appui politique du souverain de l’EIC, mais elle a même été combattue, tout en n’étant pas à l’abri de dissensions internes. En effet, la diversité de charismes religieux venait s’ajouter à la diversité des nationalités des missionnaires en présence. Ce qui favorisait l’émiettement des Eglises existantes.
Mais cette situation présentait aussi des avantages. L’évangélisation, dénuée de toute prise en charge politique, serait moins ambiguë, tout comme l’abnégation et la générosité des missionnaires. En 1884, les protestants applaudirent de deux mains l’initiative léopoldienne qu’ils trouvaient généreuse ; ils firent pression aux USA et en Angleterre pour la reconnaissance de l’EIC. Ce n’est que plus tard qu’ils devinrent hostiles à l’action léopoldienne à cause des méfaits qu’elle faisait sur le terrain. Vers les années 40, le pays abritait une quarantaine de sociétés missionnaires protestantes, notamment [‘American Baptist Foreign Mission Society (ABFMS), la Garenganze Evangelical Mission (GEM), la Baptist Missionary Society (BMS), la Svenska Missions Forbundet (SMF), l’American Presbyterian Congo Mission, l’Africa Inland Mission (AIM), la Congo Balolo Mission (CEM), la Heart of Africa Mission (HAM), la Mission Libre Suédoise (MLS), la Congo Evangelistic Mission (CEM), l’Assemblies of God et bien d’autres.
Les Eglises pionnières demeurent la Livingstone Inland Mission (LIM), la Baptist Missionary Society (BMS) et la Garenganze Evangelical Mission (GEM).
La Société de Mission anglaise BMS était déjà en activité vers 1844 sur la côte ouest-africaine et au Cameroun. La LIM naquit d’un groupe de dissidents de la BMS qui rêvaient d’un apostolat au-delà des régions côtières, et ses premiers missionnaires débarquèrent à Boma en 1879 ; l’Eglise ne demeura en activité que six ans. Sur 37 missionnaires, 8 trouvèrent la mort sur place, 14 revinrent en Angleterre et 15 continuèrent leur mission, mais dans le cadre d’une autre Eglise. La BMS au Congo s’exprima essentiellement par sa branche américaine qui se constitua en une entité autonome, l’American Baptist Foreign Mission Society (ABFMS). Celle-ci reprit à son compte les principales stations créées par la LIM, qui ne put poursuivre son action. Une de ses missions revint à la Société missionnaire suédoise, la Suenska Mission Fôrbundet (SMF) qui, bien que disposée à mener une action missionnaire au Congo, ne possédait pas encore de champ d’activité qui lui soit propre. Quant à la création de la GEM, elle répondait à une tout autre intuition. Edifié par la vie et l’œuvre de Livingstone, son fondateur Frédéric Stanley Arnot était, depuis l’Ecosse, un ami de la famille Livingstone. C’est la vie de ce dernier qui l’inspira, l’incitant à poursuivre son oeuvre. Embarqué pour l’Afrique du Sud en juillet 1881, il s’installa sur une colline en face de Bunkeya le 14 février 1886 et entama son évangélisation dans cette région, cinq ans avant la conquête de celle-ci par l’EIC en 1891. Le futur Shaba étant connu à l’époque sous le nom de Garenganze avant de devenir Ka- tanga ; la mission de Frédéric Stanley Arnot se réclama officiellement de ce nom. Le missionnaire eut de bons contacts avec Mushid Ngelengwa à qui il servit pendant tout un temps de secrétaire, sans parvenir pour autant à le convertir.
Au début du siècle, avant le début de la Première Guerre mondiale, plusieurs « missions protestantes » étaient déjà à pied d’œuvre. Les plus connues étaient les suivantes : à l’American Baptist Missionary Union (actuellement C.B.Z.A., Communauté Baptiste de Congo-Ouest) : Irebu (1896), Kimpese (1908), Kinshasa (1883/ 1884), Lukunga (1882), Moanza (1913), Nsona-Bata (1890), Vanga (1912) ; à l’American Presbyterian Congo Mission (actuellement CPZA. Communauté Presbytérienne du Zaïre) : Luebo (1891), Mutoto (1910), Ibanje (1897/1904) ; à la Baptist Missionary Society (actuellement CBFZ, Communauté Baptiste du fleuve Zaïre) : Bolobo (1888), Kinshasa (1882), Lukolela (1884), Monsembe (1890), Ngombe- Lutete (1884), Pimu (1890), Tondo (1894), Tshumbiri (1889), Upoto (1891), Yakusu (1896), Yalemba (1905), Yalikina (1912) ; à l’Eglise Svenska Mission Fôrbundet (actuellement C.E.Z., Communauté Evangélique du Zaïre) : Kibunzi (1885), Kinkenge (1897), Munkimbungu (1886), Kingoyi (1900) ; à la Livingstone Inland Mission (actuellement CBZO) : Palabala (1878), Banza Manteka (1879), Bemba (1880), Lukunga (1882), Kintambo (1883), Mukimuika (1881), Wangata (1883) ; à la Garenganze Evangelical Mission (actuellement CFCG. Communauté des Frères en Christ Garenganze) : Bunkeya (1886), Mont Koni (1899), Mutshatsha (1911) ; à la Congo Balolo Mission (actuellement CADELU, Communauté de l’Association des Eglises Evangéliques de la Lulonga) : Bonginda (1889), Ikau (1889), Bongandanga (1892), Mompono (1909), Yuli (1911), etc. (Irvine C., 1978). L’action missionnaire protestante se caractérisa par la préoccupation de mettre la Bible à la disposition des peuples congolais. Aussi entreprit-elle de la faire traduire dans les langues du pays. Parmi les précurseurs en ce domaine, il faut citer le Révérend Nils Westhings de la SMF qui parvint à terminer en 1891 la traduction en kikongo du Nouveau Testament. Le plus fameux fut Bentley. Aidé d’un compagnon congolais, M.D. Nlemvo Don Zoao, ce missionnaire commença par composer un Dictionary and Grammar of the Congo Language. Puis il entreprit avec le même compagnon la traduction du Nouveau Testament qui fut publié à Londres en 1893 ; il s’attaqua ensuite à la traduction de l’Ancien Testament. Mais épuisé par toutes ces activités, il mourut à Londres en 1905. Son oeuvre fut poursuivie par d’autres confrères, toujours assistés par Nlemvo. Finalement la première grande édition complète de la Bible kikongo (Nkand’a Nzambi) sortit de presse à Londres en avril 1926.
Les Protestants étaient conscients que l’extrême diversité qui existait entre eux nuisait à l’efficacité de leur action. Les impératifs du terrain exigeaient une plus grande concertation. Aussi, dès 1900, les représentants légaux de plusieurs missions décidèrent d’organiser une « Conférence des Missionnaires ». La première eut lieu à Léopoldville en janvier 1902. Le succès de la rencontre fut tel qu’on décida d’en organiser d’autres pour travailler en commun à l’installation au Congo d’une Eglise locale en dehors de tout clivage provenant des Eglises mères. A la septième conférence, à Luebo, on opta pour l’organisation d’une seule Eglise au Congo. C’est ainsi que furent élaborés les statuts d’un « Conseil protestant du Congo », qui allait aboutir en 1934 à une unité organique, l’« Eglise du Christ au Congo » (Beeckmans R., 1978 : 592-593 ; Kabongo-Mbaya P., 1992).
Mais le développement des implantations missionnaires dans leur ensemble et celui des rapports entre les deux types de mission, protestant et catholique, ne sont compréhensibles que replacés dans le cadre de la politique globale de l’EIC, et plus particulièrement dans celui de la politique foncière, comme on l’a déjà dit. Pendant les cinq premières années de l’EIC, Léopold II adopta une politique de grande générosité, accordant de vastes concessions aux entreprises commerciales pour encourager l’initiative privée dans l’exploitation des richesses naturelles du pays. Pour encourager la « nationalisation » (la belgicisation) de la christianisation, il afficha la même générosité à l’égard des missions catholiques dont les membres étaient belges. Mais vers 1891, la politique foncière fut restructurée pour tenter d’éviter la banqueroute qui menaçait l’œuvre léopoldienne. En effet, la liberté de commerce se trouva fortement restreinte. L’Etat entreprit pour son propre compte l’exploitation des « terres vacantes », inaugurant ainsi la deuxième phase de l’histoire économique de l’EIC, caractérisée par la montée de la fiscalité.
Cette exploitation directe ou indirecte (par l’entremise des fameuses compagnies concessionnaires) inaugura une période d’abus sans nombre. Les missionnaires protestants se mirent alors à les dénoncer, entre autres dans leurs revues, avec d’autant plus de zèle qu’ils étaient de plus en plus marginalisés au sein du nouvel Etat. Ainsi se développa la fameuse campagne « anticongolaise » ou plus précisément « antiléopoldienne ». Elle prit naissance en Angleterre, patrie de la plupart des missionnaires protestants qui œuvraient au Congo.
Léopold II essaya de réagir. Dans le cadre de cette contre-offensive, il encouragea des congrégations catholiques anglophones (donc d’origine anglaise) à s’installer au Congo. Ce fut le cas des missionnaires de Mill-Hill qu’on installa, et non pas par hasard, à la future préfecture apostolique de Basankusu, la région même où se commettaient les atrocités. Léopold II s’en prit également au privilège foncier dont bénéficiaient les missions. Comme il ne pouvait s’en prendre ouvertement aux protestants, histoire de respecter les libertés garanties par l’Acte général de Berlin, il adopta une mesure générale, visant officiellement protestants et catholiques, quitte à promettre à ces derniers d’être plus souple à leur égard dans l’application de ces dispositions. Ainsi, dès 1899, plus aucune mission ne reçut de terres en propriété ; les terres demandées pour les nouvelles fondations ne purent être cédées qu’en location. En d’autres mots, à partir de cette année-là, toute nouvelle expansion missionnaire dépendait exclusivement du roi-souverain. Et celui-ci préconisait de contenir les protestants dans leurs concessions anciennes et d’exercer une certaine pression sur les catholiques. Cette nouvelle décision déplut tant aux missionnaires protestants qu’aux catholiques. Les protestants comprenaient qu’il s’agissait d’une nouvelle offensive destinée à les déstabiliser, en contrecarrant leur volonté d’expansion. Les catholiques de leur côté estimaient hasardeux de se fier à une simple promesse verbale. Il fallait que l’État leur laisse le privilège des concessions. On ne pourrait garantir l’avenir si la promesse royale ne pouvait être officialisée par un texte. Les catholiques avaient une autre raison de mécontentement. Le rapport de la « Commission d’enquête internationale » instituée sur l’instance du gouvernement britannique en juillet 1904, dénonçait non seulement les atrocités des Compagnies concessionnaires, mais aussi les méthodes utilisées dans les fermes-chapelles des Jésuites, donc des missionnaires catholiques ; le rapport critiqua aussi la façon dont on traitait les enfants recueillis dans des missions.
Tout en protestant contre ces accusations, les missionnaires établirent un lien entre ces deux événements et en déduisirent que leur oeuvre d’évangélisation était méthodiquement attaquée par la franc-maçonnerie belge ; aussi les congrégations missionnaires s’organisèrent-elles autour du Vicaire apostolique du Congo indépendant, Mgr Camille Van Ronslé (nommé le 24 février 1897) pour réagir vigoureusement. Léopold II et ses collaborateurs se trouvèrent coincés. Concéder des terres aux catholiques signifiait en concéder aux « étrangers » protestants qui, d’après eux, risquaient d’envahir l’État. Il fallait trouver une astuce pour privilégier les compatriotes tout en échappant aux protestations éventuelles de l’Angleterre et des autres États signataires de l’Acte général de Berlin. La seule solution possible fut de mettre au point un programme que les Anglais protestants n’accepteraient pas ou ne pourraient être en mesure d’accepter et de faire de cette acceptation la condition nécessaire pour avoir droit à des concessions de terres.
Inutile de chercher trop loin : il existait un domaine inaccessible aux anglophones. En effet, ce que les Anglais étaient incapables de réaliser malgré leur bonne volonté, était… d’apprendre le français aux indigènes ! Léopold II fit donc de l’école la condition pour avoir accès au privilège de l’État. Les protestants furent effectivement exclus.
Léopold II poussa plus loin : il préconisa, pour satisfaire ceux qui se méfiaient des promesses verbales, que cet accord avec les missionnaires fasse l’objet d’une convention entre le Saint-Siège et le gouvernement de l’EIC. Cette Convention fut signée le 26 mai 1906 entre les représentants de ces deux instances à Bruxelles. La Convention assurait aux missions catholiques la possession des terres ; en revanche, les missionnaires étaient tenus d’assurer l’instruction et l’apprentissage des langues « nationales belges » (le français) par la création des écoles ; ils s’engageaient aussi à prêter leur concours à l’État, par l’exécution de travaux d’ordre scientifique, géographique et linguistique. Ce document est donc la base de l’histoire scolaire du pays ; il est l’amorce des travaux linguistiques et ethnographiques dont les missionnaires nous ont laissé d’abondantes monographies. Enfin, l’annexion des missions au processus de colonisation justifierait désormais les subsides octroyés par l’État colonial.
La Convention fut annexée à la Charte coloniale du 18 octobre 1908 et a continué à régler les rapports entre les missions et le gouvernement colonial en matière scolaire jusqu’aux années 1925-28, époque où s’organisa l’enseignement subsidié par les conventions dites « De Jonghe ». Mais ces conventions avec les sociétés de missions « nationales » laissèrent intacte la Convention de 1906 ; une nouvelle convention entre la Belgique et le Saint-Siège concernant le Congo fut signée le 8 décembre 1953, mais elle ne fut jamais ratifiée. Aussi la Convention de 1906 a- t-elle régi les rapports entre l’Eglise catholique et l’État durant toute la période coloniale (Bontinck F., 1980 : 261-303). Voici exactement son contenu :
Le Saint-Siège apostolique, soucieux de favoriser la diffusion méthodique du catholicisme au Congo, et le gouvernement de l’État indépendant, appréciant la part considérable des missionnaires catholiques dans son oeuvre civilisatrice d’Afrique centrale, se sont entendus entre eux avec les représentants de missions catholiques au Congo, en vue d’assurer davantage la réalisation de leurs intentions respectives. A cet effet, les soussignés Son Excellence Mgr Vico […] Nonce Apostolique […] dûment autorisé par sa Sainteté, le Pape Pie X et le Chevalier de Cuvelier […] dûment autorisé par S.M. Léopold II, roi-souverain de l’État indépendant, sont convenus des dispositions suivantes :
1° L’État du Congo concédera aux établissements de missions catholiques au Congo les terres nécessaires à leurs oeuvres religieuses dans les conditions suivantes :
2° Chaque établissement de mission s’engage, dans la mesure de ses ressources, à créer une école où les indigènes recevront l’instruction. Le programme comportera notamment un enseignement agricole et l’agronomie forestière et un enseignement professionnel pratique de métiers manuels ;
3° Le programme des études et des cours sera soumis au gouvernement général et les branches à enseigner seront fixées de commun accord. L’enseignement des langues nationales belges fera partie essentielle du programme ;
4° Il sera fait par chaque Supérieur de mission, à des dates périodiques, rapport au gouvernement général sur l’organisation et le développement des écoles, le nombre des élèves, l’avancement des études, etc. Le gouvernement général, par lui-même ou un délégué, qu’il désignera expressément, pourra s’assurer que les écoles répondent à toutes les conditions d’hygiène et de salubrité ;
5° La nomination de chaque Supérieur de mission sera notifiée au gouvernement général ;
6° Les missionnaires s’engagent à remplir pour l’État et moyennant indemnité, les travaux spéciaux d’ordre scientifique rentrant dans la compétence personnelle, tels que reconnaissance ou études géographiques, linguistiques, etc. ;
7° La superficie des terres à allouer à chaque mission, dont l’établissement sera décidé de commun accord, sera de 100 hectares cultivables ; elle pourra être de 200 hectares en raison des nécessités et de l’importance de la mission. Ces terres ne pourront être aliénées et devront rester affectées à leur utilisation aux oeuvres de la mission. Ces terres sont données à titre gratuit et en propriété perpétuelle ; leur emplacement sera déterminé de commun accord entre le gouvernement général et le Supérieur de la mission ;
8° Les missionnaires catholiques s’engagent, dans la mesure de leur personnel disponible, à assurer le ministère sacerdotal dans les centres où le nombre de fidèles rendrait leur présence opportune. En cas de résidence stable, les missionnaires recevront du gouvernement un traitement à convenir dans chaque cas particulier ;
9° Il est convenu que les deux parties contractantes recommanderont toujours à leurs subordonnés la nécessité de conserver la plus parfaite harmonie entre les missionnaires et les agents de l’État. Si des difficultés venaient à surgir, elles seront réglées à l’amiable, et si l’entente ne pouvait s’obtenir, les autorités locales en référeraient aux autorités supérieures.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention et y apposé leurs cachets.
(S) Chevalier de Cuvelier
(S) Vico, archevêque de Philippes, Nonce Apostolique.
Quel a été l’état de l’instruction pendant la période de l’EIC et même jusqu’au début de la première guerre mondiale ?
La première initiative de scolarisation fut une faible tentative d’éducation d’enfants autochtones en Europe, plus particulièrement en Belgique. Le premier programme du genre fut celui des Pères Blancs conçu à l’attention des missions du monde entier, dans le but de former des catéchistes-médecins. Ainsi, dans les années 1880, au moins cinq élèves originaires du Congo furent envoyés à l’île de Malte dans ce but. Une deuxième initiative vint des milieux protestants, au pays de Galles. Un ex-missionnaire baptiste fit démarrer une école en 1888 avec deux Congolais (Yates B.A., 1981 : 34-64). La troisième action du genre – qui date elle aussi de 1888 – fut spécifiquement belge, menée par l’abbé Van Impe, directeur de l’Institut Saint-Louis de Gonzague à Gijzegem en Flandre orientale. Il sollicita des pouvoirs publics la possibilité de disposer de quelques enfants africains à former. L’État, tout en prêtant attention à sa requête, manifesta peu d’empressement à y répondre positivement. Son but était d’encourager la formation des indigènes sur place, une formation essentiellement professionnelle pour disposer des auxiliaires de métier dont il avait besoin : menuisiers, forgerons, serruriers, cordonniers, jardiniers, etc. Déjà à cette époque, il préconisait l’instruction de ceux qui n’avaient presque plus d’attache avec la société, jeunes esclaves, orphelins et autres, afin d’en faire des « enfants de l’État », dont il pourrait disposer à sa guise pour les tâches diverses que nécessitait l’installation coloniale. La tendance visant à la formation en Belgique fut donc limitée : l’abbé accueillit son premier élève noir en avril 1889, deux autres arrivèrent en août. En avril 1891, un missionnaire scheutiste amena deux autres enfants et l’année suivante, en 1892, deux autres garçons et dix filles furent envoyés par les soins de l’administration de l’EIC. Les garçons furent confiés à Van Impe et les filles furent réparties dans plusieurs maisons religieuses. A partir de 1894, l’expérience d’intégration en Belgique fut arrêtée et l’on rapatria les « enfants » de Van Impe. Les derniers quittèrent la Belgique en novembre 1899, mettant un terme à cette première expérience de formation des jeunes Congolais en Belgique. Signalons ici qu’en 1897, un autre groupe de Congolais séjourna en Belgique dans le cadre de l’« Exposition internationale de Bruxelles-Tervuren ». Ils étaient au total 267, venus à bord de l’« Albertville » pou. être exhibés comme témoins et vestiges vivants du travail important que le roi réalisait au Congo. La plupart de ces témoins ne purent regagner l’Afrique ; ils reposent en terre belge… parmi les nombreuses tombes qui entourent l’église paroissiale de Tervuren (Luwel M., 1967 : 5- 43). N’y a-t-il pas eu de survivants ? Que sont devenus ces premiers « Belgicains » [5] ? On n’a trouvé aucun indice. En ce qui concerne les protégés de Van Impe, on sait que la formation reçue a plutôt été d’ordre religieux. Il n’est pas impossible que quelques-uns d’entre eux aient été faits à leur retour d’honnêtes catéchistes dans les missions.
Quand l’EIC prit officiellement l’initiative de l’instruction des enfants, ce fut surtout pour des raisons militaires, pour constituer une pépinière de jeunes recrues, destinées à devenir, suivant la vocation de l’époque, des soldats-ouvriers, des combattants et constructeurs de postes. La concrétisation de cette idée s’effectua pour la première fois lors de la création des « colonies d’enfants indigènes », le 12 juillet 1890. L’idée du regroupement en « colonie » provenait de la nature du recrutement visé, qui recherchait avant tout des enfants peu concernés par les traditions claniques : esclaves, orphelins, enfants délaissés ou prétendus tels. En effet, s’il existait un réseau d’enfants d’origine esclave, à côté de cela, beaucoup d’autres n’étaient que faussement abandonnés. Bon nombre d’entre eux étaient recrutés de force et retenus contre leur gré ; plusieurs ont risqué la mise aux fers et la peine de la chicotte, pour une tentative infructueuse qu’ils avaient faite de regagner leurs villages (Merlier M., 1962 : 218). C’était la période de la conquête, de la lutte avec les Arabes, de la répression des révoltes. Il fallait des soldats pour prendre la relève des volontaires.
Les premières « colonies scolaires » furent créées à Boma, capitale de l’État et à Nouvelle-Anvers, le poste administratif le plus avancé. L’orientation de la formation était essentiellement militaire. C’est à cette carrière qu’étaient destinés la plupart des élèves ; sur 83 élèves qui terminèrent leur formation à Nouvelle-Anvers en 1893, 55 devinrent soldats. La même proportion était respectée à Boma : sur 57 finalistes en 1901, 41 devinrent soldats.
Les « colonies scolaires », créées par l’État pour des besoins de recrutement militaire, furent dirigées dans un premier temps par des officiers. Suite à l’installation des nombreuses congrégations missionnaires, l’État pensa nommer à leur tête des responsables religieux. C’est ainsi qu’un Frère des Ecoles chrétiennes fut nommé à Boma et un Père de Scheut à Nouvelle-Anvers. Cette initiative engendra de nouveaux problèmes. Les missionnaires chargés de la direction étaient loin de trouver leur compte dans la finalisation essentiellement militaire assignée à leur action. Ils commencèrent à se préoccuper également de la formation religieuse de leurs protégés, en vue d’y recruter des catéchistes. Cette ambivalence de fait, l’État fut obligé par la suite de l’assumer de façon concrète. En 1894, une petite réforme intervint ; la colonie scolaire fut constituée désormais de deux groupes d’élèves : les candidats à la formation militaire et professionnelle et ceux qui, ayant des dispositions religieuses particulières, ne recevaient que la formation religieuse. On évoluait vers l’existence de deux types de colonies scolaires.
Pour répondre aux besoins croissants de formation militaire, une « école de candidats sous-officiers comptables » fut créée à Boma le 30 mars 1897. Les deux colonies scolaires acquirent du coup une autre finalité : celle de former des candidats capables d’être admis à ce nouveau cycle de formation plus poussé.
Vers la fin du siècle, les besoins militaires se mirent à décroître par rapport aux nécessités de former des ouvriers pour la construction des différents postes. Ceci influença le nouveau système d’instruction, en même temps que le besoin pour l’État de recruter des auxiliaires locaux pour son administration. Quatre nouvelles écoles furent créées en 1906 : une « école de candidats commis » à Boma (28 février 1906) et trois écoles professionnelles à Boma, à Léopoldville et à Stanleyville (3 juin 1906). Les écoles professionnelles étaient annexées aux ateliers que l’État possédait dans ces trois villes. Quelques années plus tard, le réseau d’écoles professionnelles s’agrandit, avec la création de celles de Kabinda, d’Elisabethville, de Buta et de Luebo, toujours liées aux ateliers existant dans ces villes.
On se rendit compte que le rendement de ces auxiliaires formés pouvait être meilleur, qu’il serait utile qu’ils disposent préalablement d’une formation générale en calcul, en dessin et en d’autres disciplines de base. On aboutit ainsi à la nécessité de créer des écoles primaires. La première « école primaire » fut créée à Boma le 16 décembre 1908. Elle fut suivie d’autres créations semblables, dans des centres où fonctionnaient des écoles professionnelles : Buta, Léopoldville, Stanleyville, Lusambo, Elisabethville et Kabinda. L’école primaire prenait deux ans et préparait l’accès à l’école professionnelle.
Jusqu’ici, il n’a été question que de l’initiative de l’État en matière d’instruction. Cette préoccupation fut partagée par les congrégations missionnaires, et dans des conditions à peu près identiques. Pour l’État, on a vu que c’est la nécessité de s’entourer d’auxiliaires militaires d’abord et professionnels ensuite qui l’amène à reconnaître le bien-fondé des centres d’apprentissage militaire et professionnel. Les missionnaires furent confrontés au même genre de problème. Leur préoccupation première fut certes l’évangélisation, mais très vite, ils ressentirent la nécessité de s’entourer d’un corps d’auxiliaires. Il fallait bien qu’ils sachent lire et écrire… pour faire la lecture du catéchisme et de la Bible, tenir un registre, déchiffrer un message écrit provenant du missionnaire etc. Les écoles ne furent donc pas l’aboutissement du souci de « civilisation », mais plutôt le résultat d’une certaine quête d’efficience dans l’effort de domination et d’évangélisation.
Les missionnaires, catholiques et protestants, assurèrent donc dès le début de leur action une certaine instruction. Celle-ci était d’une intensité et d’une extension variables, suivant le charisme des Eglises et congrégations et celui des missionnaires en présence. Certaines congrégations étaient plus entreprenantes que d’autres et, au sein d’une même congrégation, tel missionnaire donnait une plus grande impulsion à son action, à une mission plutôt qu’à d’autres. Ces différences représentaient les premières inégalités au niveau de l’instruction entre régions du pays ; elles devaient s’accentuer car les missions ou congrégations les plus dynamiques sur le plan scolaire allaient faire preuve de plus de zèle et de plus d’initiatives, grâce à l’aide financière de l’État.
La première intervention de l’État dans le réseau scolaire missionnaire date du 4 mars 1892. A cette époque, l’État confia aux missions catholiques la scolarité des enfants dont il s’était déclaré tuteur. Comme il s’occupait des colonies scolaires à caractère militaire, il préconisait l’instauration d’autres colonies scolaires, à caractère agricole et professionnel, gérées par les missionnaires. Le principe des « colonies scolaires agréées » fut donc admis. Elles étaient à charge des missions, tout en gardant un caractère officiel. En réalité, cette formule admise suscita peu d’engouement. La seule création qui se réclama de ce statut fut la colonie scolaire de Kimwenza. Elle adopta le programme des colonies de l’État mais remplaça la composante militaire par l’apprentissage agricole et professionnel. En 1894, une colonie pour jeunes filles fut également créée à Kimwenza pour servir de pépinière d’épouses chrétiennes aux jeunes gens élevés chez les Jésuites. La colonie scolaire déménagea ensuite à Kisantu, à cause de la recrudescence de la maladie du sommeil. Malgré son caractère éphémère, cette première prise en charge par l’État du réseau d’enseignement catholique constitue la genèse d’une politique qui fera recette dans la colonie. Par souci d’économie, l’État, au lieu de développer lui-même un réseau scolaire officiel, préféra en laisser l’initiative aux confessions religieuses à qui il allouerait des subsides. Par la Convention de 1906, on l’a vu, les missions furent encouragées dans cette voie, bien que le principe d’allocation des subsides ne se réalisât que fort timidement.
Au début du siècle, les deux réseaux d’enseignement étaient donc opérationnels. Celui de l’État concernait quelques colonies scolaires et écoles professionnelles ; celui des missions, qui se proposait de toucher le plus grand nombre d’enfants possible, visait l’évangélisation et la formation agricole et professionnelle. Cette dernière option intéressait de plus en plus l’État, pour répondre aux besoins croissants de son administration. Il fallait davantage populariser la scolarisation.
En 1909, il fut déclaré que chaque district devait être doté au moins d’une « école agréée et subsidiée par l’État ». Les conditions pour prétendre aux subsides étaient d’adopter le programme fixé et approuvé par le gouvernement et d’accepter le contrôle régulier des inspecteurs de l’État. Grâce à ce système, bon nombre d’écoles missionnaires furent intégrées dans un ensemble scolaire contrôlé par l’État ; de nouvelles écoles furent créées et celles qui existaient déjà furent adaptées aux nouvelles normes. Ce vaste programme d’intégration eut pour conséquence d’étoffer davantage le tissu scolaire de grands centres déjà connus tels Boma, Léopoldville, Stanleyville, Elisabethville et insuffla un dynamisme nouveau à des centres en plein essor : Nouvelle-Anvers, Mayumbe, Mongo, Lusambo, Niangara, Coquilhatville, etc. Un grand nombre de nouveaux centres, généralement des capitales de districts, prenaient de l’importance. Mais il faut préciser que cet essor ne concernait que les grands centres car l’État réservait toujours ses subsides pour quelques écoles situées dans des villes. L’immense réseau des écoles rurales n’était pas encore concerné, à tel point qu’en 1920, il n’y avait que 12 établissements, comptant 20 311 élèves au total, qui constituaient l’enseignement missionnaire subsidié (Kita K.M., 1982 :123- 165).
5 DE L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO AU CONGO BELGE
Revenons à la lecture des faits. L’événement politique marquant de ce début du siècle fut la cession du Congo à la Belgique. En réalité, tout s’était joué le jour où l’EIC avait été constitué et où les puissances signataires de l’Acte de Berlin avaient accepté de le confier à Léopold II qui devint souverain (absolu) du nouvel État (1885-1908), tout en demeurant constitutionnellement roi des Belges (1865-1909). Cette situation n’était que provisoire. Il ne fallait pas être un grand devin pour savoir que la « colonie sans métropole » allait finir par devenir « colonie belge ». Le reste ne serait qu’une petite histoire entre Belges, c’est-à-dire entre l’opinion publique, le Parlement, le Sénat et le roi lui-même. Déjà avant 1908, l’EIC n’était-il pas qualifié souvent dans le langage courant de « Congo belge » ? C’était même fréquent dans le langage diplomatique. C’était compréhensible. Le roi du Congo résidait en Belgique ; ses services centraux étaient basés à Bruxelles et tous les fonctionnaires qui en faisaient partie étaient belges. Au Congo même, le rôle essentiel était joué par des Belges, tout spécialement par des officiers de l’armée belge ; même les missions catholiques avaient un caractère nettement belge. Il était donc normal qu’on qualifiât ce « Congo indépendant » de belge.
Pourtant, même si cette évolution était évidente, la réalité juridique ne s’imposa pas spontanément. Bien qu’en 1890 et 1895, lors des emprunts contractés à la Belgique, il eût été question chaque fois de la cession du Congo à la Belgique, ce fut en définitive la violence de la campagne anticongolaise qui précipita les événements. La Belgique prit aussitôt conscience de la gravité de la situation qui lui imposait de réagir rapidement, sous peine d’être accusée de complicité avec le roi-souverain de l’EIC. Examinons ces différentes situations.
Cinq ans après la création de l’EIC, au moment où l’opération léopoldienne était nettement déficitaire, le roi jugea utile d’envisager la cession de son oeuvre à la Belgique. En 1890, en effet, il s’engagea à léguer ses possessions congolaises à la Belgique si jamais il ne remboursait pas les 25 millions de francs qu’il lui avait demandés en prêt. Pour conclure ce marché, avec un sens aigu de la psychologie politique, il rendit public son testament, par lequel il léguait le Congo à la Belgique. On fit même davantage en 1895 ; lorsqu’un nouveau prêt s’avéra nécessaire pour résorber la crise qui frappait l’EIC, le roi reçut à nouveau 6 millions de francs de la part de la Belgique avec la garantie pour celle-ci de pouvoir annexer le Congo en 1901, à moins de récupérer à cette date les sommes prêtées. Cette conclusion était en elle-même un compromis qui remettait à plus tard l’annexion préparée dès 1894 et qui aurait dû se faire en 1895.
A l’époque, la Belgique avait déjà pris ses précautions pour devenir colonialiste ; dès 1893, elle modifia la Constitution de manière à s’octroyer la possibilité d’annexer des colonies en cas de nécessité. Le scénario était donc au point. Mais il allait falloir attendre et, beaucoup plus que prévu. L’imprévu fut le boom du caoutchouc qui s’annonça en 1895 et qui se confirma en 1896. A partir de cette date, comme on le sait, le budget fut en équilibre et quelques fois en boni. Le roi eut enfin les moyens de rembourser à la Belgique les sommes empruntées, mais il n’en fit rien, on ne sait pourquoi. Ivre de cette fortune qui dépassait de loin ses espérances, aurait-il, par négligence, oublié cette échéance ? A moins qu’il ait agi délibérément, convaincu que le Congo devait nécessairement revenir par la Belgique ? On pencherait plutôt pour la seconde hypothèse. Pourtant, en mai 1901, lorsque le premier ministre Beernaert proposa la reprise immédiate du Congo à la Belgique, le roi fut mécontent. Il estimait n’avoir pas encore suffisamment profité de la prospérité congolaise pour renflouer ses caisses qui, à l’époque, n’étaient pourtant pas vides. Comme au Parlement, les Libéraux et les Socialistes s’opposaient également à ce projet ; l’échéance, jugée prématurée, fut reportée (Dorchy H., 1982 : 158-159). Le premier ministre fut contraint de retirer sa proposition. Le roi était donc opposé à toute idée de reprise de son Congo par la Belgique. D’après lui, cette échéance devait être reculée au maximum.
La solution vint d’ailleurs ; elle vint, d’une certaine manière, des autochtones congolais suite aux cruautés qu’ils enduraient. On se rappellera que les missionnaires protestants, qui furent les premiers à reconnaître la neutralité des territoires de l’EIC en 1885, furent également les premiers à prendre leurs distances vis-à-vis de l’oeuvre léopoldienne et ce, à cause des cruautés dont ils furent les témoins. Ils se mirent à témoigner et à en parler publiquement. La situation était tendue, d’autant que Léopold II n’était pas prêt à leur faire des cadeaux. L’antiprotestantisme du roi était, on l’a vu, la conséquence de son nationalisme. Il fallait que le Congo quitte son statut international qu’il avait d’abord réclamé à cor et à cri, pour devenir simplement belge.
A l’initiative de ses missionnaires, c’est l’Angleterre qui se mit à dénoncer les abus qui se commettaient au Congo. Un des maîtres de cette campagne, E.D. Morel, créa une association – la Congo Reform Association – pour lutter contre ces crimes et déstabiliser le régime qui les engendrait (Marchai, J., 1996). La Belgique, dans un premier temps, resta insensible à ces critiques, croyant que l’Angleterre, sous le couvert de l’humanitarisme, s’efforçait de déstabiliser Léopold II pour annexer le Congo dans son empire. De manière simpliste, on faisait le rapprochement avec la guerre des Boers qui venait d’avoir lieu, où l’Angleterre avait recouru à la force pour annexer le Transvaal. La campagne anti-congolaise, pensait-on, n’était qu’une autre modalité de cette guerre expansionniste qu’elle avait entamée. Morel, le fondateur de la Congo Reform Association, était considéré comme l’agent des « marchands de Liverpool », ce groupe dont les affaires avaient périclité à cause du Congo et qui était intéressé par sa ruine.
Mais cette vision n’était qu’une simplification de la situation. En réalité, si l’Angleterre s’était mise en branle, c’est parce qu’elle constituait le pays idéal pour servir de caisse de résonance aux revendications de ses ressortissants, les missionnaires protestants du Congo. Sa sensibilité, déjà mise en éveil, fut touchée plus vivement encore en 1904 lorsque le gouvernement anglais rendit public le « Report from His Majesty’s Consul at Boma respecting the Administration of the Indépendant State of the Congo ». Ce rapport est couramment appelé du nom de ce consul anglais de Boma, Casement, qui le rédigea. Cet homme jouissait de la plus haute estime en Angleterre. Il ne pouvait donc avoir écrit à la légère ; pour faire ce rapport, il avait dû voyager dans le pays du haut-fleuve et constater par lui-même les crimes perpétrés contre les droits de l’homme. Ce rapport fit scandale et commença à déstabiliser sérieusement le régime congolais de Léopold II Mais celui-ci réagit.
Vers 1900, quand démarra cette campagne, il semble que Léopold II ait été de bonne foi, demandant qu’on mette fin à ces scandales et qu’on réprime énergiquement les horribles abus (Stengers J., 1989 : 110). Faisait-il semblant de jouer au grand naïf ? Il savait par ailleurs que pour y mettre fin, il aurait fallu réformer 1 ensemble du système d’exploitation mis en place. Or, non seulement il n’en fit rien, mais il n’était même pas disposé à envisager pareille éventualité. Le fait que les accusations provenaient de l’Angleterre, et donc de l’extérieur, lui permit de se servir de l’argument nationaliste selon lequel la campagne relevait d’un complot de l’Angleterre, jalouse de son succès. Il s’accrocha à cet argument et entraîna toute la Belgique dans cette mobilisation contre l’ennemi externe. Pour lutter, il n’y allait pas de main morte. L’argent coulait pour faire écrire à son avantage et acheter des consciences. Son argumentation ne manquait pas d’habileté. Pourquoi, se demandait-il, la philanthropie anglaise n’étendait-elle pas impartialement son action sur les autres territoires coloniaux, en commençant par les possessions britanniques ? La campagne anglaise, concluait-il, était nécessairement suspecte. C’était un pur acte politique.
Faut-il imaginer qu’au temps de Léopold II déjà – ainsi le clamera plus tard le président Mobutu -, il n’était guère facile d’être le Congo ? Son statut international en faisait déjà un point sensible ! Léopold II, par son enrichissement rapide grâce au caoutchouc et sa volte-face, relativement brusque, à l’égard des protestants, avait oublié le statut particulier de cet État « indépendant ». La mutation était en cours mais elle n’était pas terminée. Son manque d’humanité à l’égard des faiseurs de caoutchouc avait provoqué une étincelle qui, loin de se consumer, prenait vigueur.
A la suite de la parution du rapport Casement, le roi prit une nouvelle initiative dans la contre-attaque, en déclarant que le rapport était partial, qu’il allait dépêcher sur les lieux une commission d’enquête qui allait enfin faire toute la lumière. Il entrevoyait sûrement un arrangement, où une commission gagnée à sa cause allait façonner un contre-rapport, le blanchissant des accusations rapportées par Casement. Et l’imprévu survint. L’Angleterre s’intéressa à la constitution de cette commission et fit pression pour qu’elle soit composée également de personnes intègres. Léopold II se trouva pris à son propre piège et dut donner à la commission une composition inattaquable : un Belge, un avocat général à la Cour de cassation ; un Italien, le président du tribunal d’appel de Boma et un Suisse, le conseiller d’État, chef du département de la Justice du canton de Lucerne. La commission se rendit sur les lieux et le 7 novembre 1904, elle entama ses interrogatoires à Bolobo et les poursuivit dans d’autres localités pendant quatre mois et demi. Elle ne retourna en Europe qu’en mars 1905. Le rapport, rendu public en novembre 1905, fut accablant, malgré toutes les précautions que le roi-souverain avait dû prendre au cours de sa longue rédaction (BO, 1905, n° 9-10 : 135-285). L’opinion belge apprit avec frayeur que le Congo de Léopold II était un véritable enfer… « Ce n’était point un État colonisateur, même pas un État mais plutôt une entreprise financière qui du Congo ne percevait que les terres et pas les populations qui y habitaient » (Cattier F., 1906 : 341). Pour la Belgique, la seule solution qui s’imposait était l’annexion. Cette fois-ci l’unanimité pouvait se faire plus aisément sur la question et l’Angleterre, favorable à une telle formule, allait arrêter sa campagne [6].
L’annexion supposait, sur le plan juridique, la conjonction de trois accords : celle du roi des Belges, celle du gouvernement belge et celle du roi-souverain du Congo. La première et la dernière adhésion étaient celles d’un même individu : Léopold II Celui-ci n’en continua pas moins à rejeter cette idée d’annexion qu’il estimait prématurée. C’est en décembre 1906 qu’il changea d’avis suite à une circonstance extérieure exceptionnelle. En effet, au cours de ce mois, le roi se rendit compte que l’Angleterre préparait une nouvelle offensive : la convocation d’une conférence internationale, une « nouvelle Conférence de Berlin » qui se déroulerait en Angleterre, pour vérifier si les grands principes arrêtés à Berlin étaient respectés ou non, et tirer les conséquences de cette nouvelle enquête. Cette perspective avait de quoi effrayer car elle risquait de décider d’ôter l’EIC à Léopold II, pour la confier à l’une des puissances signataires. Léopold II eut la confirmation que non seulement l’Angleterre et la France adhéraient à cette idée, mais que le Président Th. Roosevelt des USA était lui aussi disposé à envisager la chose. Léopold II se retrouva coupé de ses arrières et se rendit à l’évidence : le Congo allait être annexé à la Belgique. Cependant, l’acte juridique n’intervint que deux ans plus tard, suite à la dernière lutte que le roi entreprit pour maintenir à son compte la Fondation de la Couronne et au délai nécessaire à l’élaboration de la Charte coloniale.
Le passage du premier ordre colonial au second supposait une réorganisation générale, un partage des pouvoirs qui reposaient jusque-là sur la seule personne du roi. Cette réorganisation suscita d’âpres discussions. Le seul point sur lequel tout le monde s’accordait était celui du principe de la séparation du budget de la colonie d’avec celui de la mère patrie. On craignait que la métropole ait à combler les déficits toujours possibles de la colonie et qu’elle ne coure le risque de la banqueroute à cause de l’aventure coloniale. En réalité, une telle perspective n’inquiétait plus la colonie étant donné la prospérité qu’elle venait de connaître grâce au caoutchouc, relayé plus tard par les produits miniers. Le principe de la séparation de gestion fut sanctionné par la Charte coloniale dès son article premier.
Pour le reste, on réalisa le partage des compétences. Le pouvoir législatif fut confié au roi, qui devait en user sous forme de décrets rendus sur la proposition du ministre des Colonies ; le pouvoir exécutif fut confié au ministre des Colonies (résidant en Belgique) et au gouverneur général (résidant au Congo) assisté des gouverneurs provinciaux ; quant au pouvoir judiciaire, il devait être exercé par des tribunaux hiérarchisés et par des tribunaux indigènes.
Le premier âge colonial arrivait à terme. Quelques constatations essentielles s’en dégagent. Du point de vue formel, il faut noter qu’en deux décennies, une réalité politique nouvelle s’est créée, un Etat de type colonial, avec ses frontières définies, une capitale, une administration, des centres commerciaux, des postes missionnaires, une armée, une infrastructure avec le chemin de fer, des bâtiments de toutes sortes.
C’est vers 1896 que le Congo révéla pour la première fois son identité de pays potentiellement riche par la commercialisation systématique du caoutchouc. Cela confirmait les promesses tant de fois faites par Stanley. La richesse est d’ordre agricole. L’identité minière ne fait pas encore recette. D’ailleurs, le leadership commercial est loin d’être détenu par le Katanga, encore pratiquement inconnu. Ce leadership fut détenu bien avant les voyages de Stanley par la zone côtière et un peu plus tard par la région du Bas-Congo actuel dans laquelle on nota la plus grande concentration de districts, de missions et de factoreries. Vers les années 90, la présence économique et sociale remonta le cours du fleuve et alla camper dans le haut- fleuve. C’était là le grand domaine de collecte d’ivoire et de cueillette de caoutchouc. C’était le pays où l’approvisionnement des caravanes était plus aisé et où le recrutement des soldats-ouvriers était le plus intéressant. Déjà Stanley avait fait miroiter les « richesses » de la région du haut-fleuve par rapport au pays du bas-fleuve, la nature y était plus exubérante et les populations plus nombreuses et plus vigoureuses (Stanley H., 1886 : 158,169, 173-174). Dans le sens horizontal, l’ouest du pays confirmait son hégémonie, supplantant l’est. La révolte dite de Luluabourg et celle des colonies du baron Dhanis avaient semé la méfiance à l’égard des éléments de l’ancienne zone arabisée.
Texte : Que faisons-nous au Congo ?
La préface de L. Franck, Ministre des colonies de 1918 à 1924, aux 3e et 4e éditions du Rufast (Recueil à l’Usage des Fonctionnaires et des Agents du Service territorial) a répondu à la question. Le Congolais y découvre combien toutes les initiatives, y compris celles qui paraissaient les plus désintéressées, n’étaient qu’au service de l’idéal colonial. Tout se tenait.
« Que faisons-nous au Congo ?
Nous y poursuivons un double but : répandre la civilisation, développer les débouchés et l’action économique de la Belgique.
Ces deux buts sont inséparables.
Sans une population indigène plus portée au travail, mieux protégée contre les maladies, plus nombreuse, mieux outillée, de capacité technique plus grande, mieux vêtue, mieux nourrie, mieux logée, de conceptions morales plus élevées, nous n’arriverons pas à dégager de notre empire africain sa magnifique puissance de richesse. C’est avec les noirs et par les noirs que nous y parviendrons, pour leur plus grand bien comme pour le nôtre.
C’est dire que le souci que nous avons des populations est à la base de notre politique indigène.
Mais cette fin essentielle de notre activité est, à son tour, étroitement associée aux progrès du commerce, de l’industrie, des plantations européennes, de l’agriculture indigène, au développement des moyens de transport, de l’outillage et à la mise en valeur du domaine minier. Peu pénétrables à nos idées abstraites, les primitifs subissent profondément et rapidement l’action des facteurs économiques ; pour eux, également, le bien-être et le travail sont à la longue des agents très puissants de civilisation.
La colonisation ainsi entendue rationnellement a toujours été un titre de gloire et une source d’avantages considérables pour le pays colonisateur. Dans cette œuvre si belle et si intéressante, le fonctionnaire territorial a un rôle capital : il est l’agent actif et direct de la colonisation ; tant vaut le service territorial, tant vaut la Colonie ; aucun office n’est plus important que le sien.
Il en découle de grandes responsabilités, mais aussi de grandes satisfactions.
Ce que le Gouvernement attend avant tout de ses fonctionnaires chargés de l’administration indigène, c’est qu’ils soient actifs et dévoués ; qu’ils agissent avec bon sens et en hommes justes et droits. Nous ne leur demandons pas de ne jamais se tromper. S’ils le font de bonne foi et en agissant au mieux, ils peuvent compter sur la bienveillance de l’autorité supérieure.
Les magistrats et les missionnaires prêtent un concours précieux à la colonisation.
Le fonctionnaire territorial s’efforcera d’entretenir avec les uns et les autres les meilleurs rapports : les divergences et les conflits nuisent à notre action et au prestige du Blanc.
Plusieurs passages de ce recueil appellent l’attention de nos agents sur la nécessité impérieuse de maintenir, en toutes circonstances, ce prestige, essentiel à notre action civilisatrice. Ce prestige peut être atteint non seulement dans la personne du fonctionnaire, mais aussi par les rapports de celui-ci avec les autres Blancs vivant en Afrique, comme par leur conduite aux uns et aux autres. Les indigènes sont très observateurs ; ils ne manquent ni de discerner les divergences et les conflits entre Blancs, ni d’essayer d’en tirer parti. Plus d’une fois, le langage imprudent tenu devant des serviteurs a été la source de graves difficultés.
Dans le même ordre d’idées, l’expérience coloniale doit recommander à nos agents de ne pas céder à la tentation très naturelle de modifier parfois brusquement les directives et la ligne de conduite suivie par leurs prédécesseurs. Faire et défaire n’est pas travailler. Ce n’est jamais qu’avec prudence qu’il faut toucher à ce qui a été réalisé avant nous. Si la nécessité en existe impérieusement, il convient de le faire avec beaucoup de tact et par une lente gradation qui ne heurte pas les sentiments très traditionnels des noirs.
□
Le commerçant, l’industriel, le planteur sont la force d’une colonie. Sans eux, sans leur initiative et leur travail, sans le rendement de leur effort, aucun pays au monde ne pourrait s’imposer les charges considérables de la colonisation. L’État ne peut tenter lui-même la mise en valeur économique de nos vastes domaines. Aussi, la politique du gouvernement est-elle d’industrialiser la Colonie en donnant à ses propres services économiques une organisation commerciale et autonome et en encourageant partout les entreprises privées.
Jamais les fonctionnaires n’ont réussi à développer seuls les pays nouveaux. Les colons et les sociétés commerciales sont nos collaborateurs directs et obligés. Le service territorial les aidera et les soutiendra. Rien ne serait plus contraire aux intentions du gouvernement qu’une attitude de supériorité ou de dédain ou simplement d’indifférence à ce sujet.
□
Ce n’est pas un des moindres attraits de la carrière d’Afrique que d’observer avec intelligence la vie indigène, d’apprendre à connaître les coutumes, l’organisation de la famille, du clan, de la tribu, les croyances et les mœurs.
Bien des institutions congolaises qui, à première vue, peuvent paraître bizarres ou étranges, tels le matriarcat, le mariage par l’achat, la compensation pécuniaire à titre de pénalité, la solidarité matérielle des membres d’une même famille, correspondent à des formes et à des pratiques qui ont existé chez nos ancêtres et n’ont disparu qu’après une longue évolution.
Rien ne serait périlleux comme de brusquer cette transformation ou de détruire des règles traditionnelles, qui bien souvent sont des forces moralisantes ; moins nobles que les nôtres, elles sont efficaces dans le milieu indigène où elles agissent depuis des siècles. L’infériorité morale que l’on observe souvent quand on compare le noir vivant dans son village, aux déracinés, vivant près des grands centres, constitue un exemple frappant du mal que peut causer la désorganisation de la vie et des institutions indigènes. Il ne peut s’agir d’exposer l’ensemble des populations à d’aussi périlleuses et brusques expériences. Comme la vie animale, la vie sociale ne procède pas par bonds.
C’est pourquoi, rien ne préoccupera davantage le fonctionnaire territorial que la tâche si profondément intéressante d’adapter notre effort d’expansion économique, d’ordre et de justice, au milieu indigène et à son organisation, sans les bouleverser et les détruire. C’est une œuvre de choix qui veut beaucoup de bon sens, de tact, de bonté et une sympathie sincère pour nos sujets noirs.
Les rapports avec les chefs sont un élément capital de cette politique. Leur autorité est devenue une part de notre autorité et de nos moyens d’action. Ne l’ébranlez pas : c’est une force perdue. Le chef doit être traité avec égards, de façon à le faire respecter et à le distinguer. Les instructions détaillées qu’on trouvera dans ce guide aideront à préciser cette partie des devoirs du service territorial.
La pratique de diviser les grandes chefferies est contraire à la politique du gouvernement. Il en est de même de la multiplication des sous-chefs.
Non contents de soutenir l’autorité traditionnelle fondée sur la coutume, nous entendons développer la participation des indigènes à notre administration. Des instructions nouvelles ont rappelé la nécessité de former et d’employer plus de clercs noirs. Pour remédier à l’émiettement de l’autorité, il importe de réunir les chefs par secteurs, de jeter les bases de tribunaux indigènes et d’une administration noire subordonnée, là où les grandes chefferies n’y suppléent pas.
Le besoin de justice est vivement ressenti par les noirs de toutes les tribus.
Déjà juge naturel des palabres, l’administrateur s’est vu récemment attribuer une compétence beaucoup plus étendue comme juge de police. Il ne saurait consacrer trop de soins et d’application à ces nouvelles fonctions : son autorité morale s’en trouvera agrandie, le juge calme et impartial, juste mais paternel, est une noble figure chez tous les peuples, mais il domine de toute sa supériorité morale l’esprit simple des primitifs.
C’est une erreur parfois commise de voir dans la récolte de l’impôt un acte indifférent à la politique indigène. C’est oublier que de leur temps immémorial, le tribut a été pour nos populations le signe direct de la souveraineté.
Le service territorial ne saurait s’en désintéresser. Mais il lui appartient, par l’usage intelligent d’auxiliaires noirs, de faciliter le recensement, de simplifier et d’intensifier les opérations matérielles, sans néanmoins, en principe, laisser opérer l’encaissement par eux : les abus ne tarderaient pas à se développer.
L’étude soigneuse des langues indigènes est vivement recommandée à nos fonctionnaires et agents. Ces langues sont intéressantes en elles-mêmes. Celui qui les parle mal et les entend imparfaitement perd de son autorité sur les noirs, très observateurs, et s’expose à être induit en erreur par son interprète.
Etre fonctionnaire colonial n’est pas un métier : c’est un honneur et une mission.
Celui qui, en Afrique, au service de la Colonie, ne recherche que le gain matériel, s’est trompé de carrière : il n’a pas l’esprit colonial, et il ne trouvera jamais en lui- même ces satisfactions profondes de la conscience, qui sont la joie et la force de la vie pour les plus humbles comme pour les plus grands.
Sans renoncer à la justice, récompense de son travail, il faut avant tout voir dans la Colonie une grande œuvre collective à laquelle on est fier de collaborer. Cet idéalisme a inspiré les plus beaux dévouements ».
Le Ministre des Colonies, (S) Louis Franck. 22 novembre 1920.
[1] Depuis lors cette banque a fusionné avec la Banque de Bruxelles pour devenir la Banque » Bruxelles- Lambert » (BBL). Au Congo, la » Banque Lambert » a pris une acception particulière : elle qualifie le prêt à usure.
[2] Les chiffres indiqués pour cette période sont exprimés en franc-or. qui équivaut environ à 130 francs belges actuels.
[3] Dans une étude plus ancienne (1981 : 495-509), cet auteur démontre qu’à la veille de la Conférence de Berlin, les Hollandais constituaient le groupe de commerçants le plus important au Congo. La première société hollandaise à s’installer à Banana n’est pas la NAHV, mais plutôt la société Kerdijk & Pincoffs et ce, dès après 1857.
[4] Voir chapitre 3 (4e partie).
[5] Sont qualifiés de « belgicains », les congolais en séjour en Belgique.
[6] Il faut nuancer l’effet de ses campagnes dans l’amélioration des conditions des Congolais. Partant du cas de l’ABIR, Robert Harms (1975 : 73-88) démontre que c’est davantage l’épuisement des sources de caoutchouc plutôt qu’autre chose qui justifia le déclin de ladite société au début du XXe siècle.



