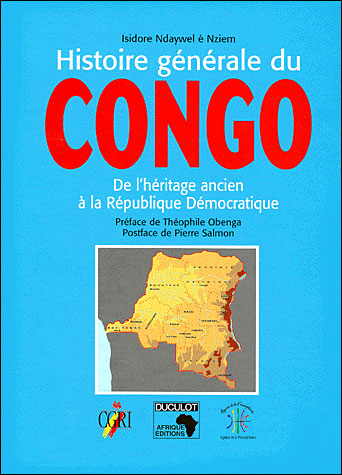
Partie 7 - Chapitre 2 : L’invention de la société congolaise contemporaine
Isidore Ndaywel è Nziem
Dans Histoire générale du Congo (Afrique Éditions)
Chapitre 2
L’invention de la société congolaise contemporaine
En cette fin de la première décennie des indépendances africaines, il était certain que la période mouvementée de la décolonisation était parvenue à son terme, et que le pays tendait à acquérir un statut beaucoup plus stable, engagé plus que jamais dans une évolution qui, sans exclure d’éventuelles turbulences, relevait désormais plus spécifiquement de l’initiative de ses ressortissants. En effet, les problèmes issus du spectacle anomique de la décolonisation avaient été, l’un après l’autre, éliminés. Après la réduction des sécessions et des rébellions, la société zaïroise [1] se félicitait à présent de la disparition des dernières oppositions armées, du regroupement des provinces et de la dépolitisation du territoire. On s’autorisait à parler plus ouvertement de la relance agricole. En effet, le slogan : « retrousser les manches », avait fait place en 68 à « Salongo » (travail), chacun étant invité à remplir correctement la tâche qui était la sienne (moto na moto abongisa). [2]
En réalité, le peuple était las des oppositions internes et le coup d’Etat militaire lui permit de vivre une accalmie, à l’ombre d’un pouvoir « énergique ». Comme ce fut le cas en 1960, le phénomène n’était pas isolé. A l’époque, des coups d’État militaires s’imposèrent ailleurs en Afrique comme solutions à des crises politiques internes, pendant que des partis uniques étaient instaurés partout et interprétés comme les solutions inespérées aux excès de la démocratie d’origine occidentale. Ainsi, après les événements du Congo, les politiciens furent mis au pas par les militaires en République Centrafricaine (décembre 65) ; de même en 1966, successivement au Nigéria (janvier puis juillet) et en Haute-Volta (du moins pour une première tentative). Au Ghana, le prestigieux Nkrumah fut renversé (février) et au Burundi le régime fut aboli par l’éviction du jeune roi Ntare V (novembre). Le mouvement se poursuivit en 1967 (Togo, Mali, Sierra-Léone) et, au cours des années suivantes, il s’étendit notamment au Congo/Brazza (1968), à la Somalie et au Soudan (1969), à l’Ouganda (1971) et à d’autres pays encore, y compris le Rwanda (1973).
Le Congo avec le Togo avait fait office de novateur. L’opinion nationale politicienne s’accorda pour mettre fin aux discours et se ranger derrière les solutions préconisées par l’armée. Le destin semblait lui aussi enclin à apporter son concours au respect de cet intermède. En effet, peu après, les plus grands acteurs de cette époque antérieure à 65 disparurent un à un : Mulele fut exécuté le 9 octobre 68 ; Kasa-Vubu, réfugié au Mayumbe, fut vite mis en disgrâce par le nouveau pouvoir ; accusé d’avoir boudé le référendum de juin 67, il s’éteignit le 22 avril 69. [3] Tshombe, ancien antagoniste, ne fut pas plus chanceux : il mourut le 30 juin de cette même année 69, dans sa prison d’Alger.
Ceux qui survécurent furent réduits au silence. Les anciens leaders révolutionnaires (Gbenye, Soumialot) préférèrent s’exiler. Ceux du « groupe de Binza » furent peu à peu mis à l’écart. A la fin de la décennie, Nendaka comme Bomboko se retrouvèrent dans des ambassades à l’étranger, de même l’ancien Premier ministre Mulamba. Cette sélection était trop parfaite pour être le seul fait du hasard. Autour du président Mobutu, une nouvelle élite politique revendiqua sa place au soleil, elle s’enrichissait d’éléments nouveaux, et elle imposa aux anciens une reconversion totale, pour prix de leur intégration. Plus qu’une Deuxième République, un ordre nouveau se mettait en place. En effet, la Deuxième République née virtuellement le 24 novembre 65 démarra de manière effective le 24 juin 1967 pour s’estomper en 1990 avec l’amorce de l’ère récente, qui se réclame de la démocratie pluraliste. Pendant ces 25 ans, le pays connut une stabilité institutionnelle qui tranchait, de manière remarquable, avec la période précédente. Un « pouvoir fort » – revendiqué au cours des années précédentes – marqua cette période, avec ses servitudes et ses grandeurs, au terme d’un premier mandat présidentiel de 5 ans (1965-70), complété par un triple mandat de sept ans (1970-77), (1978-84), (1985-1991). En raison de cette stabilité, une vision thématique continue sera ici nécessaire, pour saisir dans leurs nuances les différentes implications du nouvel ordre national.
Précisons d’abord que l’évolution globale nous permet d’établir trois périodes particulières dans le temps : la première, qui va de 1968 à 1975, marque la période euphorique où la promesse d’un décollage économique autorisa l’élaboration de projets audacieux et la construction d’un nouveau projet de société. De 1976 à 1981, le pays vécut une autre période où les effets de la crise économique devinrent manifestes. L’opposition, jusque-là en veilleuse, récupéra son droit à l’initiative et les conflits armés réapparurent. La troisième commence vers 1982, alors que le pays passe pour être plus que jamais en quête de recettes nouvelles susceptibles de mettre un terme au « mal zaïrois ». Chacune de ces trois phases a ses particularités propres, que nous nous attacherons à décrire dans le détail.
1 LE NOUVEL ORDRE NATIONAL
Situons d’abord l’avènement de ce nouvel ordre national qui se manifesta entre 1967 et 71. Il fut significatif surtout par la création d’un parti unique, la formulation d’une philosophie politique, le Recours à l’Authenticité ; ces faits méritent un examen plus approfondi.
1.1 De la dépolitisation à la création d’un Mouvement Populaire de la Révolution
La première création d’envergure du Nouveau Régime fut incontestablement la constitution d’un parti politique. En un certain sens, cet acte était paradoxal, car l’activité des partis avait été suspendue pour cinq ans. Mais le pouvoir se rendit vite compte qu’il avait besoin d’un instrument politique efficace pour construire l’unanimisme politique qu’il entendait instaurer, et galvaniser l’opinion par un tel idéal. Pour ne pas se contredire, Mobutu pensa d’abord à un « Corps des Volontaires de la République » (CVR), se défendant d’en être le fondateur, même s’il fut le premier à s’y inscrire en tant que membre. Les fondateurs officiels étaient en effet Gaston Nsengi- Biembe (président) et Paul-Henri Kabayidi (secrétaire général). Le mouvement se prétendit apolitique, et se donna pour devise : « Conscience, Vigilance, Reconstruction » (CVR) en harmonie avec son blason. Pourtant son premier séminaire national (3-21 décembre 66) aboutit à des décisions curieusement avant-gardistes, au regard de ce qui allait être statué tant dans la nouvelle Constitution que dans le Manifeste du futur MPR. En effet, sur le plan idéologique, ce congrès prôna le nationalisme ; le choix économique préconisé était la « socialisation des principaux secteurs de la vie économique » ; en matière politique, il se prononça pour la nécessité d’une organisation des masses forte et unique, un « parti d’avant-garde ». Le séminaire proclama J.D. Mobutu « Second Héros National » après Lumumba, en sa qualité de « Champion du nationalisme » ; il préconisa la réalisation de l’unité syndicale et celle des organismes de la jeunesse. Tous les éléments étaient en place. Il est donc évident que, dès la constitution du MPR, cet organisme précurseur était appelé à disparaître et à proclamer l’adhésion en bloc de ses membres au parti présidentiel. Cette décision ferait l’objet de l’assemblée générale d’avril 1967 (Congo 1966 :37-83).
Entre-temps, le vide politique qui s’était instauré depuis le coup d’arrêt de novembre 65 devait être comblé. Le MNC/L, fort de la proclamation solennelle de son fondateur comme « héros national », jugea bon d’en prendre l’initiative. Son président A. Kiwewa profita des cérémonies commémorant l’anniversaire de la mort de Lumumba (17 janvier 67) pour poser la candidature de son parti, précisément en tant qu’unique instance politique susceptible de s’occuper valablement de l’encadrement des masses populaires, en cette période de vacance politique. Cette déclaration fut prononcée en présence du président de la République, et est à coup sûr la preuve que Mobutu était à tout le moins prévenu de cette intention et qu’il en autorisa la diffusion, sans doute pour observer les réactions de l’opinion. La réaction populaire ne se fit pas attendre ; elle était plutôt négative. Elle s’exprima surtout par l’entremise du CVR, qui s’inscrivit en faux contre ce projet. Visiblement le MNC/L avait été trop ambitieux ; le président lui-même, comme on devait s’y attendre, précisa que ce parti ne pouvait prétendre à un tel privilège, pour avoir été lui-même à l’origine de désordres et de guerres civiles. Il devint alors évident que l’héritage lumumbiste n’avait pas été exalté pour lui-même, mais bien pour servir d’instrument de promotion du nouveau pouvoir.
Comment combler le vide politique ? Par un grand parti des masses ? L’idée n’était pas neuve. En 1956, le groupe « Conscience Africaine », dans son élan nationaliste, comme on l’a vu, y avait déjà songé. Lumumba caressant ce rêve avait voulu donner à son MNC cette même envergure mais il n’y parvint pas complètement. En annonçant à Mbandaka en avril 67 son intention de créer un parti, c’est précisément un projet similaire de grand parti de masse que l’ancien secrétaire d’État à la présidence du Conseil entendait concrétiser mais sous un sigle nouveau, sous peine de perdre le bénéfice d’en être le fondateur. On comprend que le nouveau parti soit un « mouvement » à l’instar du « Mouvement » National Congolais. Les témoins qui firent la randonnée fluviale en compagnie du Président rapportent qu’au premier jet, il était question d’un « Mouvement Populaire Révolutionnaire » ou encore d’un « Mouvement Révolutionnaire du Peuple », puis on s’en tint à l’appellation de « Mouvement Populaire de la Révolution ».
Mais pourquoi ce choix inattendu des concepts de « populaire » et de « révolution » ? Le fait demeurait quelque peu inexplicable en 1967. [4] Il a fallu que soient publiés les Mémoires de la compagne de maquis de Mulele, Léonie Abo, pour trouver une explication à cette inspiration soudaine. Celle-ci serait née en effet de la révolution muleliste. Lors de leur progression vers le nord du Kwilu pour traverser le Kasaï et établir une jonction avec le maquis de l’Est, Léonie rapporte que Mulele et Bengila se sont livrés à une activité « livresque » intense. Elle se risqua à interroger son mari pour savoir ce qui le préoccupait tant. Mulele lui-même lui répondit, un paquet de feuilles à la main : « Quand nous rencontrerons les combattants de l’Est, nous formerons ensemble un Mouvement Populaire de la Révolution. Les textes ont déjà été rédigés. Jadis, si tu parlais de la révolution, on te tuait. Maintenant le nom de la révolution est devenu très populaire parmi les masses. Nous allons regrouper tous ceux qui refusent l’esclavage et l’oppression étrangère. Nous devons avoir avec nous les ouvriers et les paysans mais aussi les commerçants et les intellectuels, les chefs coutumiers et même les simples soldats. Le Mouvement Populaire de la Révolution mettra les affaires du Congo entre les mains des enfants du Congo ». Léonie Abo poursuit son récit en rapportant cet autre incident. … « Il y a quelques semaines, lors d’une fuite devant l’armée, aux environs d’Eyene, Mulele a perdu ses manuscrits (sur la création d’un MPR). Pourvu que l’armée ne les ait pas récupérés. Mulele s’occupe fiévreusement à reconstituer ses documents » … (Martens L. 1991 :202-203). Bien après, lorsque le MPR sera créé par Mobutu et que les partisans désorientés questionneront leur chef pour savoir quelle conduite adopter, celui- ci sera obligé de leur tenir le langage de la franchise. « Moi-même (Mulele) j’avais rédigé au maquis, dans les environs d’Eyene, des documents pour créer le Mouvement Populaire de la Révolution. Les militaires s’en sont emparés… Maintenant Mobutu qui a toujours combattu la révolution et le peuple, et qui continuera à le faire, copie nos idées et nos mots d’ordre pour vous désorienter » ! (Martens L. 1991 :221).
Pourtant le projet muléliste aurait connu un début de réalisation comme l’atteste ce projet de protocole d’accord, établi le 7 février 1967 par les représentants des Fronts de l’Ouest (T. Mukwidi) et de l’Est (C. Kibwe et E.W. Kabasu-Babo), trois mois avant la proclamation de Nsele, et dix mois avant la création du PRP de L.D. Kabila.
Nous, soussignés, Constantin KIBWE. Emmanuel-Willem KABASU-BABO et Thomas MUKWIDI, respectivement des Fronts de l’Est et de l’Ouest, réunis du 31 janvier au 7 février 1967, pour analyser la situation générale de la Révolution Congolaise et étudier des perspectives de réorganisation de la révolution sur les bases nouvelles.
– Attendu que les revers actuels de la Révolution Congolaise trouvent leur origine fondamentale :
a) dans le manque d’une direction politiquement et idéologiquement convaincue, juste et éclairée, composée des éléments conscients, intègres, sérieux et honnêtes, totalement dévoués à la cause de libération de notre peuple, sachant lier la théorie révolutionnaire à la pratique et les paroles aux actes ;
b) dans l’inexistence d’un Parti d’avant-garde, ayant une base idéologique et un programme clair et précis, traduisant fidèlement des aspirations profondes de notre peuple et la réalité objective de notre pays ;
c) dans le manque de mobilisation et d’organisation politique et idéologique des masses populaires ;
d) dans l’absence des cadres authentiquement révolutionnaires et profondément attachés aux intérêts de la révolution ;
e) dans le fait que plusieurs dirigeants de la révolution se sont réfugiés à l’étranger et refusent d’aller combattre à côté du peuple, s’écartant ainsi de toute réalité de la situation révolutionnaire.
– Résolument convaincus que les vicissitudes du moment ne sont que passagères et que la situation tant nationale qu’internationale est extrêmement favorable au développement et à l’essor vigoureux de la lutte libératrice de notre peuple qui obtiendra à coup sûr la victoire finale ;
– Prenant en considération l’appel lancé par le camarade MULELE dans son message du 3 août 1966 à toutes les forces révolutionnaires congolaises les invitant à fonder un Parti d’avant-garde de la Révolution Congolaise, seule condition indispensable de la réussite victorieuse de notre lutte révolutionnaire ;
– Vu que la direction actuelle du Conseil Suprême de la Révolution Congolaise (C.S.R.) par son manque de programme d’action concrète, de contrôle sur les activités révolutionnaires à l’intérieur, est devenue une direction bureaucratique, impopulaire et incapable de conduire les masses congolaises jusqu’à la victoire finale, parce que détachée de ces masses et de la réalité objective de notre pays :
Décidons :
1) de créer, à l’intérieur du pays, un Parti d’avant-garde, ayant comme base le « MARXISME-LENINISME », en dehors des Partis politiques déjà existants, dont l’appellation sera déterminée ultérieurement ;
2) de constituer aux fronts de l’Est et de l’Ouest un noyau d’avant- garde, chargé de regrouper, d’organiser les combattants se trouvant encore à l’extérieur et de les faire regagner l’intérieur du pays ;
3) de créer à l’intérieur du pays, sous la direction du noyau, les conditions propices pour la convocation d’une Conférence réunissant les délégués de ce Parti d’avant-garde ;
4) d’appliquer, dans les deux fronts, les mêmes principes et méthodes sur les plans politique, idéologique et organisationnel, et d’échanger régulièrement des expériences et des informations sur le développement de l’action révolutionnaire dans chacun des fronts, jusqu’à la constitution d’un organisme directeur et coordinateur de toutes les activités révolutionnaires dans les deux fronts ;
5) de demander à tous les amis de la Révolution Congolaise de nous apporter leur appui moral, politique, diplomatique et autre pour nous permettre d’accomplir jusqu’au bout la mission libératrice de notre peuple.
Fait, le 7 février 1967 POUR LE FRONT DE L’EST POUR LE FRONT DE L’OUEST C. KIBWE et E. W KABASU-BABO
Th. MUKWIDI
Toujours est-il que le MPR, qui allait s’imposer comme parti unique, naquit officiellement le 20 mai 1967, par proclamation de son manifeste près de la rivière N’sele, à l’endroit même où Mobutu avait l’habitude de se retirer avec son état- major d’universitaires pour discuter de la politique d’indépendance de ses premières années. [5] Ce « Manifeste du MPR » – qualifié plus couramment de Man if este de la N’sele – fut présenté alors par l’ancien syndicaliste Kithima. Ce texte aurait-il été rédigé d’après le contenu des manuscrits perdus de Mulele ? Ces documents avaient- ils été effectivement transmis par les militaires au Commandant en chef de l’armée devenu chef de l’État ? On ne peut l’attester mais le fait est vraisemblable et constitue la seule explication plausible de cette coïncidence terminologique. Si l’origine « muleliste » du MPR était attestée, cela renforcerait paradoxalement l’importance historique de ce document, qui constitue une synthèse des aspirations de l’ensemble du peuple congolais en cette fin de la décennie 60. Le Manifeste était une sorte de pacte national où furent énoncés les grands principes indispensables au développement national. D’entrée de jeu, il proclama que le MPR avait pour but « … de libérer les Congolais et les Congolaises de toutes les servitudes et d’assurer leur progrès en édifiant une république vraiment sociale et vraiment démocratique ». Ses options fondamentales ? Elles sont précises et multiples : l’indépendance économique, le respect et la protection des libertés fondamentales, la révolution dans la gestion des biens et des hommes, y compris dans la famille, « la cellule-mère de la nation ». Dans cette optique, une place de choix doit être réservée à l’émancipation de la femme, à l’éducation et à la formation de la jeunesse. La promotion de la science et des arts est à encourager ; les conditions générales d’hygiène seront améliorées et l’homme congolais prolongera son épanouissement dans l’utilisation rationnelle de ses loisirs grâce à l’extension sociale des œuvres sociales. En politique africaine, le Manifeste prôna le soutien d’une politique de regroupements africains, la libération des pays encore sous dépendance politique, la promotion des échanges commerciaux et culturels. Sur le plan international, il s’engagea à soutenir des organismes internationaux ; face à l’existence des Blocs, il opta… « pour une politique de neutralisme positif ». « Le pays ne doit pas être entraîné par le jeu d’alliances ou de pactes dans l’un ou l’autre des camps qui divisent le monde ». [6]
Le programme était généreux et ambitieux, il restait à le mettre en pratique. C’est là que les problèmes allaient survenir. Pour l’heure, il consolidait la crédibilité du nouveau parti. Comment les populations réagirent-elles ? Plusieurs instances clamèrent haut et fort leur adhésion à ce projet. Tel fut le cas du CVR, comme celui de l’UFVR (l’Union des Femmes Volontaires de la République).
Le MNCA- de Kiwewa, enclin à faire de l’excès de zèle, posa à nouveau sa candidature pour se constituer parti d’opposition et être admis en tant que deuxième parti autorisé à avoir droit de cité. Cette tentative se solda à nouveau par un échec. Kiwewa s’entendit en effet répondre qu’il ne pouvait y avoir deux organisations différentes soutenant la même révolution. Le président lui-même précisa que « le second parti prévu devait être le mouvement de ceux qui ne partagent pas notre façon de concevoir les choses et de tous ceux qui ne sont pas d’accord avec notre manière de gérer la chose publique et de tous ceux qui ont un autre programme, nettement opposé au nôtre » (Congo 1967 :100). Le MNC/L de Kiwewa pouvait-il prendre le risque d’incarner ce contre-idéal ? Qui oserait se déclarer l’adversaire d’un militaire en armes ? Kiwewa dut s’incliner et proclamer l’adhésion des siens au MPR. Le MNC/L fut ainsi exclu des candidats susceptibles d’occuper le siège du parti de l’opposition. D’autres partis se présentèrent, mais sans succès. Il s’agit notamment du Rassemblement Démocratique du Congo (RDC) dont les promoteurs ne se firent pas connaître et du Parti Républicain (PR) d’Isaak-Josué Kamba qui n’eut qu’une existence éphémère. La tentative la plus élaborée vint de l’UNARCO (Union des Nationalistes de l’Afrique Révolutionnaire du Congo), le parti qui s’efforça de regrouper en son sein les anciennes formations politiques, dont le droit à l’existence était menacé depuis le coup d’Etat. Il s’agissait d’un rassemblement hétéroclite qui regroupait aussi bien l’Abako, la Puna, la Luka, le PRA que le MNC, le PSA, le CEREA et le Balubakat, auxquels s’ajoutaient le Rapelu, l’Unerga, l’Alco, l’Unibat etc. Mais ce « mariage de raison » n’était pas assez cohérent pour se muer en une force d’opposition. De plus, le pouvoir ne le reconnut pas vraiment, car il l’accusait d’être le messager de certaines ambassades. Ainsi, il fut pratiquement impossible de créer un second parti tel que le prévoyait la Constitution.
Tout se clarifia quand on précisa que, si la Constitution prévoyait qu’il ne pouvait y avoir plus de deux partis, cela ne signifiait nullement qu’un second parti devait nécessairement voir le jour. On s’achemina alors vers un monopartisme « de fait », tandis que la Constitution prônait un multipartisme à deux. Ainsi, après l’échec du projet du MNC/L de Kiwewa, le rejet des autres formations politiques désireuses d’accéder au statut de parti d’opposition, le MPR naissant, renforcé par l’adhésion inconditionnelle et unanime du CVR, s’arrogea le monopole de fait de la vie politique. Il fut légitimé en tant que parti unique, ce à quoi il était destiné depuis sa création (Mulumba L. 1972 :323-338).
Dans cette logique d’unification des structures disparates préexistantes, on préconisa l’unification des mouvements de jeunesse et des syndicats. On savait que le grand combat pour briser les dernières résistances politiques se situerait dans le secteur de la jeunesse universitaire où le pouvoir cherchait visiblement à apprivoiser l’UGEC qu’il admirait tout en la craignant. Celle-ci fut l’objet d’une opération de charme au cours des premiers mois qui suivirent le coup d’Etat. Nkanza-Ndolumingu et son état-major, bien que prudents dans leurs entrevues avec le le général Mobutu, furent souvent consultés. Lors de la proclamation de Lumumba héros national, le président de l’UGEC fut invité à prendre la parole devant une foule nombreuse, face au « monument de l’indépendance ». L’UGEC fut consultée et utilisée tant pour la création du CVR que pour la mise en place du MPR dont l’avènement fut préparé, comme on l’a souligné, par une résolution de son 3e congrès.
Mais le pouvoir ne pouvait s’accommoder trop longtemps d’un groupe si encombrant, qui osait se proclamer officiellement marxiste-léniniste et qui affichait un comportement hautain et condescendant à l’égard de certaines de ses initiatives. La situation devint ainsi trop délicate en 1967, quand on enregistra une succession de grèves dans les universités et instituts supérieurs. [7] L’UGEC était trop heureuse de l’audience qu’elle avait auprès des pouvoirs publics pour être consciente du danger qui la guettait. Elle ne cessait en effet de tenir des propos téméraires, convaincue qu’elle allait s’imposer comme unique association estudiantine du pays, comme elle l’avait réclamé dans l’une de ses résolutions du 3e congrès. Dans sa naïveté, elle avait fourni au régime des armes dont certaines allaient se retourner contre elle. La rupture fut consacrée en janvier 1968 quand l’UGEC – Lovanium, croyant bien faire, organisa une manifestation hostile à la visite à Kinshasa du vice-président des USA, H. Humphrey. La manifestation se tint devant le mémorial de Lumumba, où l’illustre visiteur devait déposer une gerbe de fleurs. En un tour de main, l’entente qui s’était tissée entre le pouvoir en place et les étudiants se dissipa. Il y eut d’abord des arrestations, suivies de la dissolution pure et simple de l’UGEC. L’occasion était en effet trop belle pour donner du crédit à la JMPR récemment créée, et qui était méprisée par les étudiants. C’est ainsi que Godefroid Sampassa, l’ancien leader estudiantin de l’UOC, devenu secrétaire national de la JMPR, revendiqua l’intégration pure et simple de l’UGEC dans la JMPR (Congo 1977 :156).
L’UGEC résista, refusant de déclarer son adhésion en bloc à l’organisation de la Jeunesse du Parti. Pour faire admettre la JMPR dans les milieux universitaires, le pouvoir déploya alors une autre stratégie ; il fit appel à un ancien grand leader de la jeunesse universitaire, Hubert Makanda qui, en tant que président de l’AGEL, avait mené avec succès la grande grève universitaire de 1964. Il jouissait d’un grand prestige auprès des étudiants. A son retour des USA où il était allé parfaire sa formation en sciences politiques, le futur Makanda Kabobi se retrouvait curieusement sans emploi, Lovanium ayant refusé de courir le risque, vu son prestige, de l’intégrer à son personnel académique. En faisant de lui le secrétaire général de la JMPR, on prodiguait à cette organisation un plus grand crédit auprès des lettrés et des étudiants.
L’unification de la jeunesse non universitaire était moins problématique. Le Haut- Commissariat à la jeunesse soutint dans un premier temps la primauté de deux centrales préexistantes : le Conseil national de la Jeunesse (CNJ) et la Jeunesse pionnière nationale (JPN). Il fut entendu qu’aucune initiative ne pouvait se concevoir dans le secteur de la jeunesse sans être sous la bannière de l’une ou l’autre de ces deux formations. A partir de là, l’abolition des mouvements de jeunesse au profit d’un seul et unique procédait de la fusion de ces deux structures de regroupement. Ce fut chose faite en juillet 1967. Les directoires furent en effet fusionnés en un seul Comité de la jeunesse qui fut le seul habilité à diriger les jeunes sur toute l’étendue du territoire.
L’unité syndicale se réalisa encore plus rapidement car cette exigence de regroupement préexistait chez elle à l’avènement du Nouveau Régime ; les milieux syndicaux avaient en effet toujours ressenti un besoin de regroupement bien qu’ils n’aient jamais pu le traduire dans les faits, tant les rivalités personnelles et l’inféodation aux syndicats métropolitains rendaient une telle perspective irréalisable. Le premier impératif dans la voie de l’unité se présenta en 1962 lorsque naquit à Dakar la Confédération syndicale africaine (CSA). L’adhésion des syndicats du Congo à ce forum impliquait leur regroupement car les statuts du CSA ne prévoyaient pas l’existence d’une pluralité de syndicats au sein d’un seul pays. Mais malgré la création à cette époque d’une intersyndicale, l’unité ne put se traduire dans les faits à cause de controverses qui éclatèrent dans le pays avec le retour de Tshombe et les options que prit son gouvernement. Toutefois le processus était entamé. L’intersyndicale, qui survécut à ces dissensions, symbolisa par son existence une volonté de concertation entre syndicats.
En 1966, le problème fut brutalement remis i l’ordre du jour avec la résolution du séminaire du CVR réclamant la création d’un syndicat unique. Les principales formations existantes étaient particulières quant à leurs origines, à leurs idéologies et donc, à leurs histoires. L’UTC (Union des travailleurs congolais) dirigée par A. Bo- Boliko était issue de la confédération des Syndicats chrétiens de Belgique. Elle constituait le syndicat le plus important et le plus influent. La FGTK (Fédération générale des Travailleurs Kongolais) avait ses origines lointaines dans l’existence d’une « Fédération générale des travailleurs de Belgique » (FGTB). En 1960, trois personnages émergèrent de cette formation syndicale de tendance socialiste : C. Adoula, R. Bintou et A. Kiwewa. Quant à la CSLC de Roger Kithima, la « Confédération des syndicats libres du Congo », elle fut créée en 1961 comme expression de la fusion des deux premières, fusion qui ne se réalisa pas et qui donna naissance à une troisième formation distincte des deux premières. Elle fonctionnait avec le soutien des syndicats américains. La pression exercée pour aboutir à une fusion des trois syndicats suscita quelques résistances, se fondant sur l’argument selon lequel un tel processus ne devait pas venir d’en haut, à moins que le but visé soit de discréditer le fait syndical lui-même. Mais cette opinion fut elle-même combattue, en étant présentée comme une preuve d’inféodation aux syndicats métropolitains qui se traduisait dans les faits par la revendication à l’autonomie. Finalement, l’unification fut décidée au cours du congrès qui réunit du 21 au 23 juin 67 les représentants des organisations intéressées. Le congrès donna naissance au syndicat unique, l’UNTC (qui deviendrait par la suite l’UNTZA). Bo-Boliko fut élu secrétaire général, assisté de trois adjoints : Booka, Beleke et Bintou. Une autre histoire syndicale allait voir le jour.
1.2 Du nationalisme authentique au recours à l’authenticité
L’innovation du Deuxième Régime et, donc, du MPR ce fut sa prétention de forger une idéologie. Le fait même d’amorcer un tel débat constituait une nouveauté car la Première République n’en avait fait aucun cas. C’est le courant universitaire animé par l’UGEC qui – comme nous l’avons souligné – prit le régime en charge dans la phase de sa genèse et fit ressentir cette nécessité. Marqués par les leçons magistrales, les étudiants rappelèrent que la matérialisation d’un projet de société était nécessairement fonction de l’idéologie qui le sous-tendait. Mais quelle idéologie invoquer ? Le fait même d’en parler était un choix virtuel car le capitalisme ne se dit pas porteur d’idéologie. En affirmant le choix socialiste voire marxiste, l’UGEC entendait indiquer l’option qu’elle considérait comme appropriée pour le pays. Mobutu lui-même n’était pas insensible à ce choix. Les leçons politiques anticolonialistes apprises naguère en compagnie de Lumumba, la fréquentation des anciens leaders de l’UGEC avaient créé autour de lui un environnement favorable. Il était séduit et fasciné par la technique d’organisation des masses des pays socialistes. L’opportunité politique imposait cette vision, pour se démarquer de Tshombe dont la politique fut décriée de tous, parce que trop accommodante à l’égard du capitalisme international. Mais cet élan spontané fut contrebalancé par un raisonnement froid. Le pays ne pouvait se permettre de rêver au marxisme-léninisme, fût-il de type estudiantin. La morphologie générale du pays – les alliances issues depuis la période coloniale, et l’expérience malheureuse avec les pays « progressistes » d’Afrique – ne l’autorisait pas à s’aventurer plus avant. On s’en tint à une vision plutôt révisionniste. Il fallait, à tout le moins, restaurer l’autorité de l’État, et reconstruire le pays. En cela, on renouait avec Lumumba – ce qui représentait le grand atout du moment – et on chanta l’hymne du nationalisme, qui avait connu un véritable martyre pendant les cinq premières années.
Le nationalisme ! Le CVR l’avait brandi dès 1966 comme une option idéologique. Le « Manifeste de la N’sele » confirma et prôna, pour éviter toute confusion, un nationalisme qui se défendait d’avoir des accointances avec des « idées toutes faites d’origine externe ». Ce « nationalisme authentique » qui marquait la volonté de se démarquer des idéologies importées, particulièrement le socialisme scientifique, entendait se définir comme la préoccupation d’élaborer des solutions originales pour résoudre les équations de la société, loin des pièges d’une extraversion facile.
L’idée fit son chemin. La sémantique aussi, à tel point que du « nationalisme congolais authentique », on finit par ne plus retenir que le dernier terme, le qualificatif mais surtout le substantif qui en découlait, « l’authenticité ». Cette évolution avait l’avantage de brouiller les traces originelles – le nationalisme rappelant trop Lumumba – et de faire du président Mobutu le père de l’innovation idéologique. Il y mit effectivement du sien, surtout à partir de 1970 quand la construction idéologique connut son envol. A Dakar (14 février 1971) face aux membres de l’Union Progressiste Sénégalaise (UPS), ces propos retentissants furent tenus :
« Tout le sens de notre quête, tout le sens de notre effort, tout le sens de notre pèlerinage sur cette terre d’Afrique, c’est que nous sommes à la recherche de notre authenticité et que nous la trouverons parce que nous voulons, par chacune des fibres de notre être profond, la découvrir ; et la découvrir chaque jour davantage. En un mot, nous voulons, nous autres Zaïrois, être des Zaïrois authentiques… Qui peut comprendre, mieux que vous (…) l’importance que nous Zaïrois, attachons à cette recherche de notre authenticité, à cette découverte de notre vrai visage d’Africains, tel que l’ont façonné, jour après jour, les ancêtres à qui nous devons le noble héritage de notre grande patrie africaine ». [8]
Le concept d’authenticité allait connaître tout une carrière, défini tour à tour comme une « philosophie » (Kinshasa, décembre 1971) et comme « antidote à toute forme d’aliénation » (Pékin, janvier 1973). Finalement, c’est le 15 août 1974, à l’occasion de l’ouverture de l’Institut Makanda Kabobi [9] qu’un schéma conceptuel complet fut établi, schéma qui devait par la suite faire l’objet d’un enseignement systématique. La doctrine du MPR était le Nationalisme Zaïrois Authentique ; son idéologie, l’Authenticité, sa démarche, le Recours à l’Authenticité. L’ensemble de ce schéma constituait le mobutisme, défini comme étant l’enseignement, la pensée et l’action du président-fondateur. Peu après, du haut de la tribune des Nations- Unies (4 octobre 1974), Mobutu précisera encore sa pensée : « L’authenticité est une prise de conscience du peuple zaïrois de recourir à ses sources propres, de rechercher les valeurs de ses ancêtres, afin d’en apprécier celles qui contribuent à son développement harmonieux et naturel. C’est le refus du peuple zaïrois d’épouser aveuglément les idéologies importées. C’est l’affirmation de l’homme tout court, là où il est, tel qu’il est, avec ses structures mentales et sociales propres ». On ne pouvait être plus clair et personne n’osa critiquer une réflexion aussi rationnelle et aussi pertinente.
C’est sur le plan pratique que ce projet suscita de sérieux problèmes. Le projet idéologique était en effet à la base d’une transformation du pays, dont le point culminant fut la métamorphose décrétée le 27 octobre 1971 et qui, dans la symbolique, marquait l’installation de l’ordre nouveau. En effet, à l’issue d’une réunion conjointe du Bureau politique du Parti et du gouvernement, la population entendit Madrandele Prosper, porte-parole du Bureau politique lire ce communiqué : [10]
… Dans la recherche de notre Authenticité, fidèles aux options fondamentales de notre révolution amorcée le 24 novembre 1965, dans le but de nous débarrasser des séquelles d’un passé révolu et afin d’éviter une fois pour toutes toute confusion, les membres du Bureau Politique et du gouvernement ont décidé ce qui suit :
- le majestueux fleuve qui traverse notre pays reprend son nom d’origine et s’appelle « Zaïre » ;
- Notre pays s’appelle « la République du Zaïre » ;
- La Province Orientale devient la » Province du Haut-Zaïre » ;
- La Province du Kongo Central devient « la Province du Bas-Zaïre » ;
- Le drapeau national change ;
- L’hymne national change
Les grands changements proclamés devaient s’effectuer. Le « vert », drapeau du Parti, devint celui de la République et remplaça le « bleu » à l’étoile d’or de l’AIA dont la dernière version remaniée par la Constitution de Luluabourg servait jusque-là de couleur nationale. La « Zaïroise », œuvre de l’historien Lutumba et du Jésuite Boka, prit la place du « Debout Congolais » que ces mêmes auteurs avaient donné au pays en 1960. Le nouvel hymne national fut chanté pour la première fois le 9 décembre à Mbuji-Maji, par le président de la République lui-même.
La révolution terminologique décrétée alla plus loin car, suite au changement de nom du pays, toutes les entreprises devaient changer de sigles : Air-Congo se transforma en Air-Zaïre, OTRACO en ONATRA (Office National de Transport), la récente GECOMIN (Générale Congolaise des Minerais) en GECAMINES (Générale des Carrières et des Mines). De même les villes, les rues et places publiques devaient à tout prix être rebaptisées. Le mouvement avait déjà été amorcé au temps d’Adoula et même plus tôt. Entre 1960 et 1966, en effet, les noms de la capitale et de ses artères principales furent changés. Le boulevard Albert devint le boulevard du 30 juin 1960 ; l’avenue prince Baudouin devint Kasa-Vubu et l’avenue Princesse Joséphine-Charlotte avenue Lumumba (transformée en « Victimes de la Rébellion » puis en « 24 novembre »). Le second mouvement fut radical et, en guise de prélude, en mai 1966, les chef-lieux de provinces furent invités à faire peau neuve : Mbandaka (au lieu de Coquilhatville), Kisangani (au lieu de Stanleyville), Isiro (au lieu de Paulis), Bandundu (au lieu de Banningville), Lubumbashi (au lieu d’Elisabethville), à l’exception de Bukavu qui avait cessé d’être « Costermansville » depuis la fin de la période coloniale. A partir du 31 décembre, le mot d’ordre officiel fut de débaptiser les rues, avenues et places publiques dans toute la République. Les monuments du roi Albert Ier, sur le boulevard du 30 juin et du roi Léopold II devant le Parlement furent déboulonnés de même que celui de Stanley qui trônait au mont Stanley devenu mont Ngaliema.
Les exigences de l’Authenticité allèrent plus loin encore ; une loi promulguée le 5 janvier 1972 exigea des Congolais mulâtres de prendre à tout prix des noms africains. Certains hauts cadres de l’État étaient touchés par cette mesure : Mario Cardoso devint Mario Losembe, Léon Lobitch, Léon Kengo wa Dondo etc.
L’abandon des prénoms d’origine chrétienne, qui allait être l’objet d’une violente controverse entre l’Eglise et l’État, semble être né en réaction à une provocation. A la suite de la Loi du 5 janvier, le quotidien catholique belge La Libre Belgique, pour se moquer de l’initiative zaïroise, se demanda pourquoi Mobutu, qui se disait « authentique », conservait encore ses prénoms chrétiens de « Joseph-Désiré ».
La réaction ne se fit pas attendre.
Je ne demande pas mieux, déclara Mobutu, en ce qui me concerne, que ces deux prénoms disparaissent aujourd’hui, tout de suite. Mais je reste chrétien et catholique, tout simplement pour respecter la religion de mes parents. Pour l’ensemble du pays cependant, le problème est posé : que la Libre Belgique se tranquillise donc : nous lui répondrons dans quatre mois, c’est-à-dire au prochain congrès du Parti. C’est alors que l’Occident saura si les 22 millions de Zaïrois devront garder leurs prénoms actuels, ou opter simplement pour les noms de leurs ancêtres….
On ne patienta pas jusqu’au délai annoncé pour répondre à ce défi. Le 12 janvier, les Zaïrois apprirent que leur président s’appelerait désormais Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga. Peu après (16 janvier) cette démarche leur fut imposée à tous.
L’Eglise catholique, inquiète, se proposa de réagir. Ce faisant, elle apportait la preuve qu’elle constituait encore la seule force capable de contester le président. Cependant, le pouvoir ne rata pas l’occasion de la faire taire, elle aussi. Tout partit de l’éditorial du journal kinois Afrique Chrétienne qui crut bon d’apporter quelques nuances à la vague de changements qui déferlait sur le pays. On y publia la réflexion suivante : (n° 3 – XIIe année, janvier 1972 :3) :
Stanley et Léopold II ont disparu du paysage de notre capitale. Seuls les touristes le regrettent, provisoirement d’ailleurs, en attendant que nos architectes et nos artistes réaménagent ces sites. Nous voulons être chez nous, entre nous et résoudre ensemble nos problèmes selon ce que nous en penserons et déciderons. Nous voulons être authentiquement nous-mêmes et non plus nous laisser emporter dans une remorque conduite par d’autres. Dès lors, nous nous sommes engagés dans une aventure très importante pour notre avenir. Il s’agit de bien plus désormais que de réclamer et conquérir l’indépendance politique et la libre disposition de nos richesses. Nous nous sommes engagés sur la voie du développement philosophique et culturel. Nous avons en effet estimé que notre progrès économique et l’amélioration de notre vie sociale devaient être basés sur un développement culturel authentiquement africain.
De ce fait, nous avons mis le doigt sur la question fondamentale, d’où se jouent en vérité notre grandeur et notre dignité de peuple libre. Mais cette entreprise est bien plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Allons- nous exhumer de la nuit du passé une « philosophie africaine originelle » qui n’a pu être, si du moins elle a un jour existé, que l’expression d’une situation et d’une vie sociale à jamais périmées ? C’est dire que la découverte d’une telle conception de la vie ne saurait encore résoudre notre problème actuel ni nous aider à vivre dans le monde moderne. Notre monde n’étant plus celui de nos ancêtres, leur conception de la vie ne saurait non plus être la nôtre. Il est important que nous sachions cela clairement pour que nous ne perdions pas notre temps à bavarder d’une «négritude» un peu dépassée. Le mouvement de la négritude a été une revendication de dignité humaine. Ses protagonistes ont cherché à se faire d’ailleurs par les Blancs un Certificat d’Authenticité humaine. Il ont réussi d’ailleurs à nous faire reconnaître comme peuple libre. Mais il faut bien se rendre compte que cette problématique est dépassée. Il ne s’agit plus aujourd’hui de nous procurer l’éphémère satisfaction de réclamer à grands cris qu’on reconnaisse notre droit d’être nous-mêmes et de nous amuser à saccager notre passé de colonisés.
L’enjeu n’est plus pour nous d’obtenir la reconnaissance d’un droit mais bien d’exercer ce droit. Il faut passer aux actes et imposer par des réalisations de tous les ordres notre dignité d’hommes africains. La question n’est- elle pas de mettre en œuvre, aux yeux du monde, cette originalité et ces valeurs. Nous ne le ferons que si nous sommes autant sensibles à nos lacunes, à nos faiblesses, à nos insuffisances, qu’à nos richesses et à nos possibilités. Il faut que nous mobilisions toutes nos énergies pour corriger les faiblesses qui freinent notre marche vers l’avenir. Nous ne réussirons pas cela en déterrant les vieilles conceptions de la vie qui ont fait la faiblesse de nos ancêtres devant la colonisation. Ce n’est pas en ressuscitant une philosophie que nos déroutes passées ont condamnée que nous gagnerons ces batailles du monde moderne. C’est au contraire en cherchant une nouvelle force de vie pour notre monde de demain. L’enjeu est grave, il mérite l’effort de réflexion et l’engagement profond dans la vie de tous ceux qui nous guident.
Le texte avait la profondeur de l’Eglise catholique qui, ici, vivait en réalité cette quête d’africanité depuis des décennies, et la critique était pertinente. Mais le ton était polémique en dépit de la finesse du style qui en atténuait la rigueur. On comprend qu’en un premier temps, le président ait applaudi. Mais peu après, une campagne d’une rare violence fut lancée par la radio nationale contre le cardinal Malula, auteur présumé du texte. [11] La décision d’imposer à tous les Zaïrois des prénoms d’origine locale (16 février 1972), sans attendre le prochain Congrès du MPR, ne fit qu’accroître la tension. De grands séminaires refusant l’implantation de la JMPR en leur sein furent fermés. Tel fut précisément le cas du grand séminaire Jean XXIII de la province ecclésiastique de Kinshasa, fondé par Malula. Face à un tel malaise, le peuple chrétien marqua sa résistance et sa contestation dans son choix des nouveaux noms. En effet, certains « postnoms » – terme consacré à l’époque pour désigner ces éléments supplémentaires d’identification – dissimulaient à peine la protestation qu’ils comportaient. [12]
On se trouvait en réalité en présence d’un malentendu plutôt que d’un conflit. Déjà dans la période antérieure à Mobutu, on avait noté une tendance à abandonner des prénoms d’origine externe, notamment dans le milieu des universitaires de culture luba. Ainsi Auguste Kalanda était devenu Mabika – Kalanda ; André Rodolphe Ilunga, Ilunga-Kabongo, etc. L’innovation portait ici uniquement sur le caractère obligatoire du choix d’un nom africain. Toutes les micro-cultures n’étaient plus capables en effet de réaliser encore une telle performance.
Le contexte général et surtout l’influence extérieure trouvaient de quoi alimenter une polémique qui s’avérait de plus en plus dénuée de fondement. On s’en rendit compte de part et d’autre. C’est pourquoi le cardinal, dont les biens avaient été spoliés, reçut des dédommagements de la part de l’État. La Conférence épiscopale, quant à elle, admit le principe des comités de parti dans les séminaires. En bref, l’Eglise catholique rejetait la campagne politique mais fondamentalement elle ne s’inscrivait pas en faux contre la quête de l’authenticité. A la même époque d’ailleurs, elle posait les conditions de l’inculturation du christianisme pratiquement dans les mêmes termes : « Le Zaïre ne sera pas chrétien tant qu’il ne pourra pas le penser et l’exprimer en langage africain c’est-à-dire en langage authentiquement zaïrois », proclamaient ses évêques. [13]
Il a donc fallu du temps pour que l’argument de l’authenticité transparaisse d’une manière pertinente et soit reconnu comme étant, en principe, une option qui pouvait mener le Zaïre à son développement. Il était en effet évident que le devenir d’une société donnée était fonction de l’intérêt de ceux qui la constituaient. Mais cela n’était pas forcément évident pour tous, et encore moins pour ceux qui, à cause de la colonisation, avaient trop minimisé le contenu de leur héritage propre au profit de celui de leur civilisation d’emprunt. Ce n’est que dix ans plus tard, en 1980, que les hommes de science et de culture, d’abord méfiants à cause de la propagande politique, ont pu reconnaître au cours d’un colloque international à Kinshasa, que f authenticité pouvait avoir un contenu théorique dans le processus de modernisation dans lequel était engagé le pays, et qu’elle pouvait être posée comme une idée- force capable de générer une pratique sociale nouvelle. [14]
On serait en droit de s’interroger de nos jours : comment cette idée de l’authenticité a-t-elle pu être envisagée au Congo ? Pourquoi l’a-t-elle été au terme de la première décennie de l’indépendance ? Cela peut s’expliquer par un concours de circonstances, la conjonction de deux facteurs majeurs : le profil du Congo des années 70 et le charisme particulier de Mobutu.
L’itinéraire précolonial des populations congolaises, qui fit l’objet des premiers chapitres de cette étude, a révélé que le pays disposait d’un héritage culturel extraordinaire. Le système colonial belge, en confinant les autochtones dans leurs coutumes, a eu le mérite, en définitive, d’être peu iconoclaste. Le Congolais a donc accédé à la modernité, tout en restant fort d’un patrimoine riche et précieux. La créativité moderne disposait donc des matériaux d’appoint pour s’exprimer. La nécessité de s’y référer pour élaborer son devenir – le recours et non le retour à la tradition – était déjà prônée dès les années 63 par un courant intellectualiste dont le chef de file, Mabika Kalanda, avait publié à l’époque un ouvrage fort significatif : « La remise en question, base de toute décolonisation mentale ». Avec ce courant de contestation de l’extraversion, on recourait déjà à une certaine pratique de l’authenticité avant la lettre.
Mobutu fut celui qui trouva le mot juste pour qualifier ce courant préexistant, mais il était bien placé pour ce faire. Il suffit de parcourir son curriculum vitae pour se rendre compte qu’il fut le témoin privilégié de toute l’évolution postcoloniale ; il passait pour être l’un de ceux qui assumaient le mieux cette expérience. Grâce à son charisme personnel, qui le prédisposait à assimiler rapidement toute nouvelle réalité rencontrée, il constituait un authentique agent de la modernité.
A l’armée, il avait fait, avant 1960, l’expérience des brassages ethniques. Il avait vu du pays en allant de Coquilhatville à Léopoldville, et de là à Luluabourg, pour revenir ensuite à Léopoldville. Sa qualité de journaliste le mit en contact avec la politique coloniale qu’il combattit. Puis, il fit la connaissance de Lumumba à son retour d’Accra. Il assimila cette nouvelle réalité avec d’autant plus de facilité qu’il se retrouva à Bruxelles, à la faveur d’un stage en Belgique, dans les coulisses de la table ronde où il tenait le rôle privilégié de conseiller du futur Premier ministre. Il tira visiblement profit de sa fonction d’indicateur de la Sécurité belge puis de la CIA, à l’époque (Chôme J. 1974 :69). C’est ainsi qu’en 1960, en tant que commandant en chef, il disposait déjà d’un avion personnel (JDN) qui le rendait plus mobile que le président de la République et que son Premier ministre. A l’écoute des étudiants et de l’UGEC, il apprit à avoir des ambitions intellectuelles. Il sut se servir de ce nouvel atout. La création du MPR et l’implantation de l’authenticité s’effectuèrent d’autant plus aisément quelles bénéficièrent de l’imposition d’ordre militaire ; elles eurent pour effet de le propulser davantage au-devant de la scène.
Manipulant habilement ce courant intellectualiste qui préexistait à son avènement, Mobutu parvint à s’accorder un pouvoir illimité en sa qualité de « président- fondateur du MPR, président de la République ». Ce principe fut consacré par les réformes constitutionnelles de 1970 et de 1974 dont il sera question plus loin. Le parti se confondant avec la nation, cette situation lui conférait en effet un pouvoir double ; d’abord celui d’être le premier « penseur » de la société (président du MPR) ensuite celui d’être le premier « gestionnaire » de la société (président de la République). Le premier rôle, qui lui incombait, était capital car il se trouvait renforcé par sa qualité de fondateur du parti, avantage dont aucun de ses successeurs à la tête du parti ne pourrait en principe bénéficier. Il constituait en lui-même le premier organe du parti et donc, de la République. Dans cette logique, Mobutu était donc le garant de la pérennité de la nation ; tant qu’il était vivant, il ne pouvait logiquement être écarté du pouvoir, sauf en cas de folie (le déviationnisme 1). Cette mystification politique constituait un élément important de la stratégie d’ensemble. Le président- fondateur pouvait donc se lancer, en toute liberté de pensée, dans des conceptions « révolutionnaires » de la société, sans que sa perception des choses n’ait à souffrir d’une confrontation avec une idée autre, ni qu’elle soit ramenée à des positions « révisionnistes ». Le président avait donc la latitude de s’engager dans n’importe quelle démarche politique, même impopulaire ou de nature à susciter des réactions négatives, pourvu qu’il considère agir ainsi pour le bien du pays. Le MPR était décidément un phénomène complexe. Un juriste zaïrois, s’efforçant à l’époque de justifier sa démarche, n’a pas hésité à le qualifier de « phénomène politique envahissant et omniprésent destiné à la promotion globale de la société à partir de ses valeurs propres » (Kitete K.O. 1983 :459).
La nouvelle société zaïroise devait donc inventer des traditions, établir ses assises et créer un comportement pour ses citoyens. Il serait intéressant de situer les sources d’inspiration que se choisit pour la circonstance le peuple zaïrois, et en particulier, Mobutu, le père de l’innovation nationale, en cette période d’émergence de la nouvelle société. Elles sont au nombre de quatre : la tradition zaïroise, les recettes coloniales, l’Eglise catholique et son enseignement et enfin le monde asiatique.
De la tradition, on tira quelques artifices qui vinrent soutenir le pouvoir. C’est de là que le pouvoir sans partage tira sa légitimation, en rappelant que le pouvoir traditionnel, semble-t-il, s’exerçait naguère sans partage (on ne peut s’asseoir à deux sur la même peau de léopard !). L’absence d’une opposition organisée fut mise en avant pour justifier le bien-fondé du parti unique au sein duquel les composantes de la société vivaient davantage une relation de juxtaposition qu’une relation conflictuelle. Le président s’en inspira pour adopter quelques symboles propres à son pouvoir moderne : la canne, le couvre-chef, la symbolique du léopard (roi des animaux), le cérémonial du toast qui devint une goutte de vin jetée au sol (à défaut, dans un cendrier) en l’honneur des ancêtres, etc.
L’autre source d’inspiration qui intervint dans l’élaboration de la modernité zaïroise authentique fut le domaine colonial. Ce recours était inévitable, l’expérience coloniale étant celle que le président maîtrisait le mieux dès le départ. Aussi la centralisation administrative qu’il préconisa était-elle évocatrice de la centralisation coloniale, à l’époque où le pays était géré comme un seul ensemble cohérent. Les provinces furent regroupées par 6, à l’exception du cas particulier du Kasaï, éclaté en deux régions autonomes et de l’ancienne province de Léopoldville à laquelle un regroupement risquait de donner trop d’envergure par rapport aux autres entités. C’est ainsi qu’on aboutit à un total de 8 provinces, auxquelles s’ajoutait la ville de Kinshasa. La terminologie nouvelle se référa au registre colonial ; ainsi le concept de « Zone » rappelait l’EIC, et celui de « commissaire d’État » sortait tout droit de la « Loi Fondamentale ». La personnalité même du président fut calquée sur le modèle de la royauté belge. Dans un écrit, on ne pouvait faire référence au président qu’en utilisant la lettre majuscule ; en discours direct, on s’adressait à lui à la troisième personne. Le président se dota de sa « maison militaire » et « civile », à l’image du roi des Belges. Plus important encore, Mobutu nourrissait visiblement l’ambition de bâtir un empire à l’instar de Léopold II, et créa comme lui les distinctions honorifiques de cet empire. [15] Le président n’hésita pas à imiter pour une partie le comportement de ce personnage historique. Il dut certainement, conseillé en cela par des Belges proches de la famille royale, étudier ses attitudes pour y parvenir. Ainsi à l’instar de Léopold II, on le vit se servir d’une canne, construire une pagode chinoise (à défaut d’une tour japonaise) et s’offrir un yacht présidentiel, comme le fit le monarque vieillissant, pour les réceptions et les grandes audiences. Il imita encore le grand roi pour ses ambitions immobilières, qu’il qualifia de « politique de grands travaux » (barrage d’Inga, lignes à haute tension Inga – Shaba, tour de la Voix du Zaïre, Centre du Commerce International au Zaïre), tandis que la naissance de l’empire mobutien se manifestait par le changement de nom du pays.
Le catholicisme et son organisation constituèrent un autre champ d’inspiration qui fut mis à contribution pour construire le parti. Certaines déclarations officielles cachèrent mal cette référence évidente à l’Eglise. Ainsi, en décembre 70, au retour d’une tournée en province, le président fut accueilli au stade par le gouverneur de la ville. Ce dernier, les bras levés, chanta sur l’air de « Dominus vobis cum » la formule d’accueil, « le Seigneur soit avec vous ». La création du parti, dans le discours présidentiel de la création de l’école du parti (1974), fut présentée comme l’élaboration d’une Eglise. Les fondateurs de l’une ou l’autre réalités étaient le Christ et Mobutu ; les garants des idéologies mises en place étaient dans un cas les « Pères de l’Eglise » et dans l’autre les « commissaires politiques » ; les enseignements respectifs de ces deux entités étaient appelés « christianisme » et « mobutisme ». Au demeurant, la devise du MPR était tout simplement une citation biblique – Servir et non se servir – (« Le Fils de l’homme est venu non pour être servi mais pour servir… » Marc 10 :45). Celle du maréchalat en était une variante : « toujours servir ! ». Le mobutisme eut droit à son « catéchisme » et à son « bréviaire » du militant. Dans son code de conduite interne, la révolution mobutienne estima utile d’évoquer un sens de la hiérarchie, tel qu’il prévaut au sein de l’Eglise. L’autorité de l’évêque, l’infaillibilité du pape qui ne pouvait souffrir aucune contestation, l’ordonnancement de la liturgie qui obéissait à un code strict, tout cela semble avoir exercé une réelle fascination. La chanson Djalelo (tirée du folklore impérial luba) fut appelée à jouer le rôle du « Sacerdos et Pontifex» ou du «Tu es Petrus» [16]. Son exécution supposait nécessairement la présence physique du président. « L’hymne au maréchal », qui fut introduit plus tard, était ajouté lorsque le président portait sa grande tenue de Maréchal [17]. En son absence, il était strictement interdit d’exécuter ces deux mélodies. Dans la grande salle du Congrès à N’sele qui servait de « temple du parti », il existait à côté de la table d’honneur (autel) une sorte de siège « épiscopal » réservé au seul président. Au demeurant, l’arrivée du président lors d’une cérémonie obéissait à toute une liturgie. Il ne pénétrait dans le lieu où il se tenait que précédé d’une double rangée de protocole et de sécurité, ainsi que de ses conseillers. On eût dit le début d’une grand- messe pontificale, où le célébrant était entouré d’un monde religieux costumé.
L’Extrême-Orient, en particulier la Chine, semble également avoir fasciné le président du moins au début de son règne. Dès qu’il créa le MPR, il lui attribua une symbolique précise dans le domaine de la couleur. De même que le rouge symbolisait la révolution maoïste, de la même façon le vert devint le signe de sa révolution zaïroise authentique. Le drapeau du parti fut le vert flanqué d’une main portant un flambeau allumé. Puisque l’authenticité fut perçue comme une révolution culturelle, à l’instar du père de la révolution culturelle chinoise Mao-Tsé-Toung, Mobutu poussa l’analogie jusqu’à publier le petit livre vert (citations du président Mobutu) en référence au petit livre rouge (citations du Président Mao-Tsé-Toung). Comme en Chine, la couleur du parti (vert) finit par évincer celle de la nation (bleu) : le drapeau « bleu à l’étoile d’or » fut remplacé par celui du MPR. Plus tard, quand Mobutu put visiter la Chine maoïste et la Corée de Kim II Sung, il rapporta de ces tournées un vocabulaire politique nouveau qui renforçait le culte de sa personne. A l’instar de Mao et surtout de Kim II Sung, il fut en effet qualifié de « timonier », de « guide », de « père de la Nation ». Le terme le plus courant fut celui de « chef », lequel, sans autre précision, désignait toujours le président-fondateur, ou, plus familièrement, le P.F. Ce code présidentiel eut pour effet de renforcer l’identité charismatique de Mobutu.
Le nouvel ordre n’aurait jamais pu se déployer réellement dans le pays sans le concours de l’armée ; c’est pourquoi elle fit l’objet d’une préoccupation particulière. Qu’en était-il de l’évolution de l’organisation militaire dans le pays ? En cinq ans, de 1960 à 1965, sous la direction du commandant en chef Mobutu, l’ANC avait fait du chemin. Non seulement elle s’était aguerrie, gonflée d’effectifs d’origine sécessionniste, mais elle s’était également modernisée, avec l’acquisition d’un matériel nouveau et la formation d’une élite à l’étranger. En 1965, sa physionomie se renouvela plus particulièrement au niveau des effectifs, notamment par la création du Centre d’Entraînement de Kitona (CEKI) et du Centre d’Instruction des Parachutistes (CIP) qui deviendrait plus tard le Centre d’Entraînement des Troupes Aéroportées (CETA). Le premier bataillon de parachutistes était déjà en place, de même qu’une ébauche de la future armée de l’air du Zaire (FAZA), connue alors sous le nom de « Force Aérienne Congolaise » (FAC).
Pour garantir une certaine pérennité du régime, il était indispensable de renforcer l’organisation de l’armée, d’augmenter sa force de frappe, d’élargir son importance numérique et surtout de la restructurer en fonction des impératifs nouveaux, en renforçant son unité de commandement. Cette évolution fut réalisée entre 1970 et 1978. En 1970, la garde côtière, fluviale et lacustre fut transformée en « Force Navale ». La justice militaire fut restructurée tandis que les forces de police, soupçonnées d’être perméables aux caprices des politiciens, furent reconverties en une gendarmerie nationale, intégrée à l’armée comme une de ses branches spécialisées (1972). A la faveur de ces changements, l’ANC elle-même avait fait peau neuve, avec la réforme terminologique du 27 octobre 1971, pour se muer en Forces Armées Zaïroises (FAZ).
Un grand moment de cette évolution prodigieuse fut la formation de troupes fraîches de 12 000 hommes, qui reçurent le nom de Division Kamanyola. Réparties en 5 divisions (logistique, transmission, génie, artillerie anti-aérienne, aviation légère) et en 4 brigades, les troupes Kamanyola furent présentées pour la première fois à la population le 24 novembre 1975, au dixième anniversaire du Nouveau Régime. Leur avènement marquait également un tournant dans le renforcement de la politisation de l’armée qui reçut pour mission particulière d’assurer la protection du Guide et du MPR [18].
Mais le point culminant de cette réorganisation militaire ne fut atteint qu’au lendemain de la « guerre de 80 jours », lorsqu’on promulgua la loi du 1er juillet 1977 relative à l’organisation générale de la Défense et des Forces Armées Zaïroises. Cette loi qui détermine les compétences en matière militaire renforça la double autorité de Mobutu sur les armées, à la fois en tant que président de la République à qui incombe la charge de la politique de la défense, et en tant que commandant suprême, chargé de la haute direction des actions de la Défense. En outre pendant 25 ans, il exercerait les fonctions de commissaire d’Etat (ou de ministre) de la Défense et de la Sécurité du territoire.
Sur un plan général, le pays fut considéré comme doté de 4 armées : Force terrestre, Force navale, Force aérienne et Gendarmerie nationale, qui constituaient ensemble les Forces Armées Zaïroises (FAZ). Celles-ci étaient réparties en « Régions militaires » et en « Circonscriptions ». [19] Elles étaient régies par un système hiérarchique strict structuré comme suit : le Commandant suprême ; le Conseil supérieur de la Défense ; l’Etat-major général, les Etats-majors des forces, de la base logistique et de la gendarmerie nationale ; suivaient enfin, les Etats-majors des régions et circonscriptions militaires. Les impératifs de l’ordre furent renforcés ensuite par la création d’autres unités : le CADER (Corps des Activistes pour la Défense de la Révolution) qui fut créé au sein de la JMPR et enfin la Garde Civile (28 août 1984) considérée comme un corps d’élite au service de la sécurité publique, qui renforcerait la gendarmerie nationale. Les FAZ comportaient aussi un Service d’Action et de Renseignements Militaires (SARM), une Maison militaire du chef de l’État et un Auditorat général coiffant les différents auditorats militaires et une Division Spéciale Présidentielle (DSP). Un Corps des éducateurs politiques fut institué en 1975 pour assurer l’éducation civique et l’encadrement politique des Forces Armées.
La surêté nationale connut une évolution semblable dans le sens d’une meilleure répartition des compétences. En 1965, lors du coup d’Etat, ce service était géré par le futur général Alexandre Singa Boyenge Musambay ; il devint un Centre National de Documentation (CND). Vers la fin des années 70, avec l’extension de ses réseaux, le perfectionnement de ses méthodes et surtout l’arrivée d’universitaires, le service fut scindé en trois parties distinctes : l’Agence Nationale de Documentation (AND) qui s’occupa du réseau intérieur, le Service National d’Intelligence (SNI) qui eut la charge du réseau extérieur et enfin le Conseil National de Sécurité (CNS) dirigé par le conseiller spécial du chef de l’État et qui assura la coordination des deux autres instances. Cet impressionnant appareil militaire et de sécurité fut jugé nécessaire pour assurer la paix, autoriser Mobutu à donner libre cours à sa créativité politique, économique, sociale et culturelle.
Tableau 24 — Les commandants en chef de l’armée (1886-1997)
| Institutions | Noms | Grades | Durée |
| Force Publique | 1.L. Roget | Commandant | août 1886 -août 1888 |
| 2. H.Avaert | Commandant | août 1888 – octobre 1889 | |
| 3. L. Van de Putte | Commandant | juillet 1890 – juin 1891 | |
| 4. L. Fourdin | Commandant | octobre 1891 – juin 1893 | |
| 5. G. Dielman | Commandant | juin 1893 – juin 1895 | |
| 6. J. Van Dorpe | Commandant | mars 1895 – juin 1898 | |
| 7. G. Dielman | Commandant | mars 1899 – mai 1900 | |
| 8. E.Tonglet | Commandant | mai 1900-nov. 1902 | |
| 9. G. Seghers | Commandant | juin 1903-déc. 1903 | |
| 10. E.Warnant | Lieutenant-Colonel | mai 1904-avril 1906 | |
| Force Publique | 11. J. Gomins | Colonel | avril 1906 – mai 1907 |
| 12. J. Paternoster | Colonel | mai 1907-déc. 1907 | |
| 13. J. Gomins | Colonel | mai 1908 – mai 1909 | |
| 14. A. Bruneel | Colonel | mai 1909-mars 1911 | |
| 15. A. Marchant | Lieut.-Col./Colonel | mars 1911 -janv. 1916 | |
| 16. G. Tombeur | Général Major | janv. 1916-mai 1918 | |
| 17. P.Molitor | Général Major | juin 1918-avril 1920 | |
| 18. F. Olsen | Lieut.-Col./Colonel | oct. 1920-août 1924 | |
| 19. P. Ermens | Colonel/Générai major | nov. 1925-juillet 1930 | |
| 20. L. De Koninck | Général Major | juillet 1930-juillet 1932 | |
| 21. Servais | Colonel | août 1932-nov. 1933 | |
| 22. Hennequin | Colonel/Générai Major | avril 1935 – nov. 1939 | |
| 23. A. Gilliaert | Lieut. Colonel/Colonel | nov. 1939-déc. 1940 | |
| 24. P. Ermens | Lieut. – Général | déc. 1940-août 1944 | |
| 25. A. Gilliaert | Général Major/Lieut. Génér. | août 1944 -1954 | |
| 26.E.Janssens | Général Major | 1954-juil. 1960 | |
| Armée Nationale Congolaise (ANC) |
27. Lundula Victor | Général | juil-sept. 1960 |
| 28. Mobutu Joseph Désiré | Col./Général Major | sept 1960 – nov. 1965 | |
| 29. Bobozo Louis de G. | Général Maj./Lt. Général | nov. 1965-juil. 1972 | |
| Forces armées zairoises (FAZ) | 30. Bumba Maoso D. | Général de Corps d’armée | juillet 1972-1977 |
| 31. Babia Zanghi Malobia | Général de Corps d’armée | sept. 1978-1981 | |
| 32. Singa Boyenge Mosambay | Général d’armée | 1981-1985 | |
| 33. Eluki MongaAundu | Général de Division | 1985-oct. 1987 | |
| 34. Lomponda wa Botende | Amiral | oct. 1987 – 1989 | |
| 35. Mazembe ma Ebanga | Général d’armée | 1989-1991 | |
| 36. Mahele Lieko Bokungu | Général de Corps d’armée | 1991-1993 | |
| 37. Eluki MongaAundu | Général de Corps d’armée | 1993- 1996 | |
| 38. Mahele Lieko Bokungu | Général de corps d’armée | 1996 -mai 1997 |
(Sources : F.B. 1952:518; informations arabes)
2 LA SOCIÉTÉ ZAÏROISE AUTHENTIQUE
Au début des années 70, l’ère mobutienne était établie, symbolisée sur le plan terminologique par le règne des 3 Z (Zaïre le pays, Zaïre la monnaie, Zaïre le fleuve). De longues années de stabilité allaient se succéder, l’ombre de la décolonisation s’étant enfin dissipée. La logique de la centralisation allait s’imposer comme une réaction aux tendances centrifuges propres aux premières années d’indépendance. La créativité nationale fut soumise à rude épreuve, tant il fallait innover, aussi bien à cause des contraintes imposées par le pouvoir militaire que sous son impulsion. Tous ces éléments allaient contribuer à déterminer l’identité contemporaine du Congo. Cette nouvelle société congolaise fera ici l’objet d’une analyse dans ses différents efforts de production politique, culturelle et économique. L’évolution dans chacun de ces domaines sera saisie essentiellement au travers des structures mais aussi des hommes qui furent porteurs de ces innovations.
2.1 Evolution politique et administrative
De la fin des années 60 à celle des années 80, soit pendant un peu moins d’un quart de siècle, le paysage politique du Zaïre, sous le signe du MPR, eut à subir plusieurs transformations, bien que le président Mobutu dût reprendre à son compte le mot du Premier ministre Tshombe, qui avait prétendu naguère qu’il n’y avait pas de problèmes politiques en vue mais uniquement des problèmes socio-économiques. Ces transformations étaient manifestes tant dans l’évolution de la gestion du Parti que dans les révisions constitutionnelles et l’évolution de la politique étrangère.
L’itinéraire du MPR, après sa genèse, vu du dedans, aurait connu deux étapes successives, celle de l’implantation puis celle de son affirmation. Dans la première phase, on tenta de résoudre des questions structurelles et de mettre un terme au conflit latent entre le réseau administratif de l’État et celui du Parti. Ce dualisme fut enrayé par cinq ans de pratique monopartiste, de 1967 à 1972. Le Bureau politique entama en effet ce processus en 1967, par la suppression du bicéphalisme en régions, en décrétant l’accumulation des fonctions de gouverneur et de président régional du MPR. Cela fut concrétisé au cours du premier Congrès extraordinaire (21 – 23 Mai 70), et lors du premier Congrès ordinaire (21 – 23 Mai 1972) qui décrétèrent que le MPR constituait l’instance suprême du pays, les autres structures nationales devant fonctionner sous son contrôle. Ainsi les comités du MPR s’élargi- rent-ils jusqu’à l’intégration des corps constitués tels la magistrature, l’armée, la police, le syndicat. Au plus haut niveau, les deux exécutifs, soit le Comité exécutif du Parti et le gouvernement, fusionnèrent suite à une décision du bureau politique, pour constituer le Conseil exécutif national (août 1972), plus couramment désigné sous sa forme abrégée de Conseil exécutif. C’est à cette époque, dans un souci d’uniformisation des appellations politiques, que le Zaïre multiplia les titres de commissaires : il y avait des commissaires politiques (membres du Bureau politique du MPR), des commissaires d’Etat (ministres), des commissaires de région (gouverneur), des Commissaires sous-régionaux et des Commissaires de zone, sans oublier les Commissaires du peuple (les députés).
De là, le MPR cessa d’être un fait privé pour devenir véritablement la doublure de l’État. La formule consacrée le qualifia de nation zaïroise organisée politiquement. Ses membres ne constituaient plus une catégorie à part, recrutée sur base de critères précis et en fonction d’idéaux définis. Désormais, suivant les nouvelles normes, tout Zaïrois était par définition membre du MPR, qu’il le veuille ou non. [21] Une fois son implantation effectuée, le MPR travailla à l’élaboration de ses institutions et à l’approfondissement de ses options idéologiques, s’efforçant d’innover, au gré des influences subies ou des idées en présence. Parmi ses innovations les plus importantes, citons, outre la zaïrianisation, dont il sera question plus loin, la création d’une école du Parti, l’Institut MAKANDA KABOBI (27 juin 1974) du nom de l’ancien leader estudiantin décédé inopinément quelques mois plus tôt. Inauguré en grande pompe, cet Institut qui se transformerait plus tard en Secrétariat général à la formation des cadres (FORCAD) dispensait une formation sous forme de séminaires et sessions d’études par catégories d’auditeurs.
L’avènement de la « guerre de 80 jours », qui fit une brèche importante dans la stabilité acquise, imposa la nécessité d’une certaine libéralisation politique. Le deuxième Congrès ordinaire du MPR (23 – 27 novembre 1977), qui se tint après l’important discours du 1er juillet, décida d’un certain nombre de dispositions à prendre en vue de permettre au peuple de s’exprimer plus démocratiquement. Aussi la plénitude de l’exercice du pouvoir politique cessa-t-elle en principe d’appartenir au seul président-fondateur, car les pouvoirs judiciaires et législatifs furent réhabilités dans leur autonomie et les commissaires politiques, la plus haute aristocratie du Parti, furent déclarés éligibles.
Au seuil des années 80, le Parti subit quelques autres réformes, notamment avec la création d’un organe nouveau, le Comité central (août 1980). Cette instance s’intercala, sur le plan hiérarchique, entre le Congrès et le Bureau Politique qu’il finit par absorber. Organe dit de conception, d’inspiration, d’orientation du Parti, le Comité central se divisait en quatre Commissions (politique, administrative et judiciaire ; économico-financière ; socio-culturelle, en plus de la Commission spéciale de discipline) ; il avait son réseau d’action, représenté par « les Branches spécialisées » du Parti, sortes de ministères dotés de compétences de type gouvernemental pour certains secteurs de la vie nationale : Mobilisation, propagande et animation politique (MOPAP) ; Formation des cadres (FORCAD) ; Jeunesse du Mouvement populaire de la révolution (JMPR) ; Condition féminine et famille (CONDIFA). Le Corps des Educateurs politiques des Forces armées zaïroises et l’Union des Travailleurs du Zaïre (UNTZA) lui furent annexés. Plus tard, viendrait encore s’y ajouter un Secrétariat général chargé des relations avec les partis frères et amis. [22]
Le Comité central tint plusieurs sessions ordinaires et extraordinaires, légiférant à sa manière par Décisions d’État dont l’exécution était en principe acquise de la part du Conseil exécutif. En réalité, il n’y avait pas forcément de relation de cause à effet de l’un à l’autre, le Conseil exécutif ayant dû remettre à plus tard, voire reporter aux calendes grecques l’application de certaines décisions d’État. C’est l’une de ces dispositions de la haute hiérarchie du Parti qui introduisit le concept de Parti- État, à l’issue d’un voyage du président en Roumanie, pour sanctionner cette réalité politique qui, au départ, se défendait de ne pas être un parti, mais se considérait plutôt comme un mouvement. C’est que le MPR, au terme de 20 ans d’évolution, était devenu une réalité bien différente de ce qu’il était à son point départ, tant son organisation et sa conception furent l’objet de réaménagements multiples.
Quel était le statut de la constitution zaïroise au cours de ces décennies de gestion monopartiste ? Soulignons que la Constitution qui fut promulguée le 24 juin 1967 suite à un référendum organisé du 4 au 24 juin, était orientée dès le départ vers une conception excessive de la concentration du pouvoir. Prônant un régime unitaire, monocaméral, la constitution de 67 fut en effet présidentialiste au propre comme au figuré à tel point qu’elle accorda au chef de l’État des prérogatives supplémentaires, jusque-là inconnues de tous, y compris d’autres régimes négro- africains francophones. En effet, contrairement aux codes de conduite qui prévalaient dans d’autres pays pratiquant de tels types de régimes, le président disposa ici de droits lui permettant de présenter directement des projets de loi à l’Assemblée nationale, d’exercer dans certaines circonstances particulières le pouvoir législatif, de recourir directement à l’arbitrage du peuple par l’organisation du référendum, et de s’octroyer provisoirement des crédits nécessaires, sans l’accord de l’Assemblée nationale. C’est dire que, dès son avènement, le chef de l’État fut investi constitutionnellement de pouvoirs très étendus.
La Constitution fut ensuite soumise à une série de révisions qui, dans l’ensemble, consistèrent à légaliser les décisions qui se prenaient au niveau du Parti. Entre juin 1967 et février 1980, on compta pas moins de dix révisions.
Après la première d’entre elles, intervenue le 17 avril 1970 (Ordonnance-Loi n° 70/025) pour revoir les délais dans lesquels devaient avoir lieu les élections législatives et présidentielles, s’imposa celle du 23 décembre 1970, qui consacra de droit la position de parti unique dont bénéficiait le MPR depuis sa naissance officielle. L’artifice du bipartisme fut aboli. Le processus de sublimation du MPR était donc entamé. La Loi constitutionnelle du 29 octobre 1971 (Ordonnance-Loi n°071/ 006) vint consacrer la révolution terminologique décrétée deux jours plus tôt et consacra l’usage des termes de « Zaïre et de Zaïrois » en lieu et place de « Congo » et de « Congolais ». Les désignations provinciales de « Kongo Central » et de « Haut- Congo » devinrent respectivement « Bas-Zaïre » et « Haut-Zaïre ». Le changement d’emblème fit l’objet d’une révision constitutionnelle particulière le 19 novembre 1971 (Ordonnance-Loi n° 71/007). En décembre de la même année, pour donner à la loi Bakajika des assises solides, un article fut inséré dans le texte de la Constitution, dans lequel l’État confirmait sa propriété du sol et du sous-sol ainsi que des produits naturels. Enfin pour clore ce chapitre relatif aux réajustements terminologiques et à la révision de détails, la loi constitutionnelle du 5 janvier 1973 (Ordonnance-Loi n° 73/003) consacra la substitution du terme « Katanga » à celui de « Shaba », tandis que celle du 5 janvier 1973 consacrait l’emploi de dénominations dites révolutionnaires telles que « Conseil législatif national », « Commissaire du peuple », « Conseil exécutif national », « Département », « Commissaire d’État », « Commissaire de région » en lieu et place, respectivement de « Assemblée Nationale », « Député », « Gouvernement », « Ministère », « Ministre », « Gouverneur » (Ordonnance- Loi n° 73/014). [23]
Deux autres lois constitutionnelles de ce même mois de janvier 1973 (Ordonnance-Loi nos 73/015 et 73/016) amorcèrent une réorganisation du pays suivant les principes de l’ordre nouveau tout en complétant la révision terminologique. En effet, ces lois reconsidéraient l’organisation territoriale et administrative de la République tout en consacrant l’usage de termes comme « Sous-Région », « Zone » et « Collectivité » au lieu de « District », « Territoire » et « Secteur » « Chefferie » et « Centre ».
La révision constitutionnelle du 15 août 1974 (Ordonnance-Loi n° 74/020) innova. En consacrant l’institutionnalisation du Parti, le régime zaïrois devint moniste au sens propre du terme car tous les pouvoirs de l’État furent monopolisés par le MPR qui s’identifia complètement à l’État. L’article 29 de cette nouvelle Loi constitutionnelle précisa que le MPR était « la nation zaïroise organisée politiquement ». Le fait qu’un changement aussi important soit intervenu sans qu’il y ait eu nécessité de recourir au référendum montre que le régime avait atteint la phase dictatoriale, après avoir réduit à néant toute velléité de contestation.
Mais les révisions constitutionnelles ne cessèrent pas pour autant. Celle qui suivit était relative à la réaction née de la forte concentration de pouvoirs décrétée en 1974. Il s’agit de la révision constitutionnelle du 15 février 1978, qui décida de la libéralisation du système (Ordonnance-Loi n° 78/010). C’était là un moyen de couler dans un moule juridique l’ensemble des mesures arrêtées par le discours présidentiel du 1er juillet 1977. L’innovation était de taille. Elle atténua, du moins au niveau des documents, les pouvoirs du chef de l’État, à qui fut retirée « la plénitude de l’exercice du pouvoir » (article 74). La nouvelle formulation était moins choquante : « le pouvoir émane du peuple qui l’exerce par le président du MPR qui est de droit président de la République… » (article 9). L’exécutif redevint bicéphale par la reconduction d’un « Premier Commissaire d’Etat ». Le Conseil législatif redevint législateur ordinaire et les élections au suffrage universel direct furent instaurées pour les commissaires politiques. Cette loi constitutionnelle reprenait également l’innovation de la création d’un Conseil judiciaire, déjà fonctionnel à partir du 28 décembre 1977.
Une autre révision constitutionnelle intervint le 18 février 1980 (Ordonnance- Loi n° 80/007) et impliqua une remise en question de certaines dispositions arrêtées en 1978. Ainsi l’élection des commissaires politiques fut supprimée et le Conseil judiciaire fut modifié par rapport à son statut du 28 décembre 1977. Le fait marquant de cette révision consistait en la suppression des dispositions spéciales relatives au Président-Fondateur, considéré jusque-là comme étant situé au-dessus de la Constitution. En revanche le droit de dissoudre le Conseil législatif lui fut à nouveau reconnu.
Avant la fin de l’année, la onzième et dernière révision constitutionnelle de la décennie 70, intervint (Ordonnance-Loi n° 80/012 du 15 novembre 1980). Elle réaffirmait la primauté du MPR dans la vie politique par le réaménagement de la hiérarchie définie en son sein selon l’ordre suivant : le président du MPR, le Congrès, le Comité central, le Comité exécutif. Cette dernière structure, chargée de la coordination des branches spécialisées du parti, ne tarda pas à entrer en conflit avec le Conseil exécutif. Le Comité central décida finalement de la supprimer (Décision d’Etat n° 31/CC/82 du 15 février 1982). Ce qui constitua matière à une douzième révision constitutionnelle, qui intervint le 31 décembre 1982 (Ordonnance-Loi n° 82/ 004). Cette réforme s’attacha à statuer sur le cas d’une vacance éventuelle du poste de président du MPR, président de la République. Il fut décidé qu’en ce cas, les fonctions du président seraient provisoirement assumées par le Comité central, qui les exercerait par l’entremise du plus âgé de ses membres.
Tel fut l’itinéraire de cette Constitution de 1967, dont la dernière révision n’interviendrait qu’en 1990, en vue de doter la République d’une disposition transitoire dans l’attente de l’avènement de la Troisième République.
Signalons que l’appareil du MPR façonna en quelque sorte la classe politique du Zaïre. Celle-ci fut grossie par la vieille garde politicienne de la Première République d’une part, et par l’intégration de jeunes éléments universitaires, de simples techniciens au départ, qui finirent par rejoindre la classe politique. Les nombreuses structures mises en place permirent d’accueillir ce beau monde et de lui offrir l’occasion de diversifier les expériences, par un mécanisme de permutations. Les multiples disponibilités dégagées ou créées facilitèrent l’exécution de ce projet. Il existait en effet plusieurs instances dont les membres étaient soumis à une mise en place fréquente : le Comité central, le Bureau politique, le Conseil exécutif, les branches spécialisées du Parti, les Régions, les Entreprises. Il y avait ainsi pas moins de 400 places à pourvoir. Mobutu choisissait invariablement les nouveaux cadres parmi les anciens des états-majors. Les représentants du groupe de Binza (Ndele, Bomboko, Ileo, Kamitatu, Nendaka) se retrouvèrent ainsi aux côtés des rejetons du camp des nationalistes (Mungul-Diaka, Kiwewa, etc.) et du groupe du Katanga (Munongo, Sapwe, Kibwe, etc.) comme de celui du Sud-Kasaï (Tshisekedi, Mukamba, etc.), les anciens commissaires généraux ayant déjà rejoint les anciennes classes politiques.
Tableau 25 — Equipes gouvernementales (1965 -1990)
| Durée | Premier Ministre (Commissaire d’État) |
Principaux Ministres (Commissaires d’État) | Référence | ||
| Intérieur | Aff. Etrangères | Finances | |||
| 1. 28 nov. 65 -13 sept. 66 | Col. L. Mulamba | E.Tshisekedi | J. Bomboko | J. Litho | Ordon. n° 2 du 28 nov. 65 |
| 2. 14 sept. -16 déc. 66 | Col. L. Mulamba | E.Tshisekedi | J. Bomboko | J. Litho | Ordon. n° 66/505 |
| 3. 17 déc. 66-4 oct. 67 | E.Tshisekedi | J. Bomboko | J. Litho | Ordon. n° 66/639 | |
| 4. 5 Oct.. 67-17 août 68 | E.Tshisekedi | J. Bomboko | P. Mushiete | Ordon. n° 67/449 | |
| 5. 17 août 68 – 4 mars 69 | J. Nsinga | J. Bomboko | V. Nendaka | Modif. Ordon précitée | |
| 6. 5 mars-31 juillet 69 | J. Nsinga | J. Bomboko | V. Nendaka | Ordon. n° 69/071 | |
| 7. 1er août 69-15 déc. 70 | J. Nsinga | C.Adoula | L. Namwisi | Ordon. n° 69/148 | |
| 8. 15 sept. -6 déc. 70 | D. Sakombi | C. Adoula | A. Ndele | Modif. Ordon. précitée | |
| 9. 7 déc. 70-2 juil. 71 | E. Bulundwe | M. Cardozo | L. Namwisi | Ordon. n° 70/327 | |
| 10. 3 juil. 71-20 fév. 72 | E. Bulundwe | M. Cardozo | L. Namwisi | Modif. Ordon. précitée | |
| 11. 21 fév.-7 juil. 72 | Bulundwe K.P. | Nguz a Karl i Bond | Baruti wa Ndwali | Ordon. n° 72/018 Modif. | |
| 12. 7 juil.-17 oct. 72 | Bulundwe K.P. | Nguz a Karl i Bond | Baruti wa Ndwali | Ordon. précitée | |
| 13. 18 oct. 72-7 mars 74 | Kithima Bin R. | Nguz a Karl i Bond | Baruti wa Ndwali | Ordon. n° 72/412 | |
| 14. 8 mars 74 – 6 janv. 75 | Engulu Baanga Mpongo B.L. | Umba di Lutete | Baruti wa Ndwali | Ordon. n° 74/1047 | |
| 15. 7 janv. – 2 mai 75 | Engulu Baanga Mpongo B.L. | Mandungu Bula Nyati | Bofossa W’Amba | Ordon. n° 75/006 | |
| 16. 2 mai 75-4 fév. 76 | Engulu Baanga Mpongo B.L. | Mandungu Bula Nyati | Bofossa W’Amba | Ordon. n° 75/139 | |
| 17. 4 fév. 76 – 22 fév. 77 | Engulu Baanga Mpongo B.L. | Nguz a Karl i Bond | Bofossa W’Amba | Ordon. n° 76/010 | |
| 18. 23 fév. – 7 juil. 77 | Engulu Baanga Mpongo B.L. | Nguz a Karl i Bond | Bofossa W’Amba | Ordon. n° 77/195 | |
| 19. 8 juil.-19 août 77 | Mpinga Kasenda | Engulu Baanga Mpongo B.L. | Nguz a Karl i Bond | Bofossa W’Amba | Ordon. n° 77/195 |
| 20. 20 août-12 déc. 77 | Mpinga Kasenda | Engulu Baanga Mpngo B.L. | Umba-di-Lutete | Kiakwama kia K. | Modif. Ordon. précitée |
| 21. 3 déc. 77 – 5 janv. 79 | Mpinga Kasenda | Engulu Baanga Mpongo B.L. | Umba-dl Lutete | Emony Mondanga | Ordon. n° 79/007 |
| 23. 6 mars 79 -18 janv. 80 | Bo-Boliko Lokonga | Materna Nga’N. | Nguz a Karl i Bond | Bofossa W’Amba | Ordon. n° 79/050 |
| 24. 19 janv. 80-26 août 80 | Bo-Boliko Lokonga | Mafema Nga’Nzeng | Nguz a Karl i Bond | Namwisi ma Nkoy | Ordon. n° 80/009 |
| 25. 27 août 80-18 fév. 81 | Nguz a Karl I Bond | Duga Kugbe T. | Inonga Lolonga L. | Namwisi ma Nkoy | Ordon. n° 80/204 |
| 26. 18 fév.-23 avril 81 | Nguz a Karl I Bond | Duga Kugbe T. | Bomboko Lokumba (vice -Premier Commissaire d’État) |
Namwisi ma Nkoy | Ordon. n° 81/026 |
| 27. 23 avril – 9 oct. 81 | Nsinga Udjuu | Duga Kugbe T. | Bomboko Lokumba (vice -Premier Commissaire d’État) |
Namwisi ma Nkoy | Ordon. n » 81/059 |
| 28. 9 oct. 81-7 mai 82 | Nsinga Udjuu | Vunduawe te Pemako (Vice-Premier Commissaire d’État |
Yoka Mangono | Namwisi ma Nkoy | Ordon. n° 81/186 |
| 29. 7 mai 82-5 nov. 82 | Nsinga Udjuu | Vunduawe te Pemako (V. P. C.) |
Yoka Mangono | Namwisi ma Nkoy | Ordon. n° 82/055 |
| 30. 5 nov. 82-18 mars 83 | Kengo wa Dondo | Munongo M. | Kamanda wa K. | Namwisi ma Nkoy | Ordon. n° 82/173 |
| 31. 18 mars-1er nov. 83 | Kengo wa Dondo | Munongo M. | Kamanda wa K. | Ngole lliki | Ordon. n° 83/081 |
| 32. 1er nov. 83 — 3 fév. 84 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Umba-di-Lutete | Namwisi ma Nkoy | Ordon. n° 83/187 |
| 33. 3 fév.-3 mai 84 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Umba-di-Lutete | Kiakwama Kia K. | Ordon. n° 84/029 |
| 34. 3 mai — 2 juil. 84 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Umba-di-Lutete | Kiakwama Kia K. | Ordon. n° 84/113 |
| 35. 2 juil.-6 déc. 84 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Umba-di-Lutete | Kiakwama Kia K. | Ordon. n° 84/143 |
| 36. 6 déc. 84-1er fév. 85 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Umba-di-Lutete | Kiakwama Kia K. | Ordon. n° 84/241 |
| 37. 1er fév.-12 avr. 85 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Mokolo wa Pombo | Tshishimbi | Ordon. n° 85/056 |
| 38. 12 avr.-5 juil. 85 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Mokolo wa Pombo | Djamboleka 0. | Ordon. n° 85/096 |
| 39. 5 juil. 85-18 avr. 86 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Mokolo wa Pombo | Djamboleka 0. | Ordon. n° 85/176 |
| 40. 18 avr.-31 oct. 86 | Kengo wa Dondo | Mwando Nsimba | Mandungu Bula Nyati | Djamboleka 0. | Ordon. n° 86/119 |
| 41. 31 oct. 86-22 janv. 87 | Kengo wa Dondo | Vunduawe te P. | Mandungu Bula Nyati | Mabi Mulumba | Ordon. n° 86/264 |
| 42. 22 janv. – 29 juil. 87 | Mabi Mulumba | Duga Kugbe T. | Ekila Liyonda | Nyembo Shabani | Ordon. n° 87/019 |
| 43. 29 juil. 87-7 mars 88 | Mabi Mulumba | Duga Kugde T. | Ekila Liyonda | Kinzonzi M.N. | Ordon. n° 87/244 |
| 44. 7 mars – 28 juil. 88 | Sambwa Pida Mbagui | Mandungu Bula Nyati | Nguz a Karl I Bond | Kamitatu Masamba | Ordon. n° 88/024 |
| 45. 28juil.-12oct.88 | Sambwa Pida Mbagui | Mandungu Bula Nyati | Nguz a Karl I Bond | Kamitatu Masamba | Ordon. n° 88/125 |
| 46. 12 oct. – 26 nov. 88 | Sambwa Pida Mbagui | Mandungu Bula Nyati | Nguz a Karl i Bond | Katanga ya M. | Ordon. n° 88/165 et 166 |
| 47. 26 nov. – 8 déc. 88 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Nguz a Karl i Bond | Katanga ya M. | Ordon. n° 88/200 |
| 48. 8 déc. 88-12 mai 89 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Nguz a Karl i Bond | Katanga ya M. | Ordon. n° 88/215 |
| 49. 12 mai-20 juil. 89 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka(V.P.M.) | Nguz a Karl i Bond | Katanga ya M. | – |
| 50. 20 juil. 89-11 jan 90 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka(V.P.M.) | Nguz a Karl i Bond | Katanga ya M. | Ordon. n° 89/160 |
| 51. 11 janv. – 4 mai 90 | Kengo wa Dondo | Mozagba Ngbuka | Nguz a Karl i Bond | Ordon. n° 90/001 | |
L’innovation spécifique à l’ère du MPR résida dans l’apparition d’éléments nouveaux : ainsi, les syndicalistes devinrent des politiciens actifs (Kithima, Bo-Boliko, Bintou). Les premiers professeurs d’université nationaux qui firent allégeance au MPR furent aussitôt nommés : ainsi Mpinga Kasenda, Gambembo Fumu wa Utadi et Kazadi Nduba. En 1971, ils publièrent ensemble une plaquette sur l’option politique du MPR ; le document suscita l’attention générale, non pas tant pour son contenu, qui n’était qu’assemblage de généralités mais plutôt en tant que profession de foi. Les réactions ne se firent pas attendre : Mpinga fut nommé directeur de l’Institut Makanda Kabobi et ne devait quitter ce poste que pour devenir Premier commissaire d’Etat, cédant ainsi son siège d’idéologie à Gambembo. Dans les universités et Instituts supérieurs, un recrutement politique systématique fut instauré. Etaient enrôlés d’office, à la fois ceux qui collaboraient aux services de renseignements et ceux qui contestaient le système. Parmi les premiers, deux étudiants de Lovanium furent promis dès les années 68 – 69 à un brillant avenir : Jean Seti (Yale) et Edouard Mokolo (wa Pombo). Parmi les seconds, tous les anciens leaders estudiantins étaient appelés à connaître un avenir politique, qu’il s’agisse de H. Takizala (Luyan M.M.), de J. Nsinga (Udju 0. O.), de G. Kamanda (wa Kamanda), de H. Makanda (Kabobi), de G. Sampassa (Kaweta Milombe) ou de M. Nzanda-Bwana (Kalemba). [24]
Des permutations intervenaient indifféremment dans les structures du Parti, comme dans celles de l’État. Dans le seul cadre gouvernemental, une cinquantaine d’équipes se succédèrent de 1965 à 1990, avec la période particulière allant de 66 à 77, où le président exerçait en plus les fonctions de Premier ministre. L’analyse de la composition de ces équipes démontre que certains commis de l’État, malgré le principe de permutation fréquente, ont marqué de leur personnalité certains secteurs de la vie nationale. Ainsi Tshisekedi, Engulu, Duga, Mozagba à ! Administration du territoire ; Bomboko, Umba di Lutete, Nguz a Karl i Bond, aux Affaires étrangères ; Litho, Namwisi, Bofossa aux Finances.
Vers 1975, il devint possible de déceler de grandes tendances parmi ces hauts cadres du MPR, au-delà des regroupements de type régional.
Le groupe de Binza, malgré ses revers, constituait une réalité politique bien vivante ; il était rival du groupe de Righini, qui rassemblait des universitaires ayant quitté leurs chaires (Mpinga, Gambembo, Kazadi. Mabi, etc.). Sur un plan régional, le groupe leader était celui de l’Equateur, en particulier celui des ngbandi. Une distinction subtile démarquait les ngbandi mulâtres (Seti Yale, Kengo wa Dondo, Bemba Saolona) des autres frères ethniques, surtout ceux qui se réclamaient de l’héritage de Litho Moboti (Vundwawe te Pemako, Ndolela Siki Konde, etc). Chaque région constituait un groupement politique, doté de ramifications internes calquées sur des ensembles macro-ethniques déjà identifiés avec leurs groupes dominants et leurs minorités. Sur le plan général, deux fronts macro-ethniques se constituèrent, distinguant les populations dites de l’Ouest (anciennes provinces de l’Equateur et de Léopoldville) de celles de l’Est, qui ressentaient l’expansion du lingala comme une agression : car elles parlaient le ciluba et le swahili. La politicaillerie, qui avait cessé de se compromettre dans des manipulations de partis politiques, trouva à s’occuper en gérant ces multiples différences. Les nominations politiques constituaient elles- mêmes des chefs-d’œuvre de dosage de cette multitude de réalités.
L’option politique de l’ère mobutienne se traduisit par le désir de jouer un rôle important à l’extérieur, compte tenu de la dimension et du poids du pays, à présent stable. Dès 1965, le Congo opta d’emblée pour une politique d’influence et une politique d’indépendance, la première en Afrique, plus particulièrement en Afrique Centrale, la seconde à l’égard de ses partenaires traditionnels du monde occidental notamment la Belgique, la France et les USA. Avec la crise économique, cette option se muerait en une opération de charme, pour des raisons de sécurité.
Dès 1966, le Congo se fit entreprenant sur le plan africain, se proposant d’être l’initiateur d’un vaste regroupement des pays d’Afrique Centrale. L’UDEAC (l’Union Douanière des Etats d’Afrique Centrale) s’était constituée sans lui, en décembre 1964 et regroupait les anciens pays de l’AEF mais cet ensemble sous-régional connaissait des problèmes, puisque la tension était pratiquement permanente entre les pays de l’arrière-continent (Tchad, Centrafrique), dépourvus d’accès à la mer, et les pays côtiers (Congo/Brazza, Gabon). Mobutu préconisa une réorganisation de l’Afrique Centrale, en annonçant en février 1968, la création des « États-Unis d’Afrique Centrale » avec la RCA et le Tchad, et en comptant sur l’adhésion du Rwanda, du Burundi, du Congo et du Gabon. Le projet compromettait l’existence de l’UDEAC, parce qu’il lui retirait deux de ses membres, et proposait à l’ensemble de ceux-ci de la quitter au profit de ce nouveau regroupement. Cette démarche provoqua des tensions et des conflits. A l’époque, la rumeur y voyait un conflit entre la France et les USA ; le général de Gaulle favorisait, par le renforcement de l’UDEAC, la création d’un bloc francophone capable de contrebalancer le Nigéria, tandis que les USA, par l’UEAC, cherchaient à s’introduire dans l’ancien empire français par le Congo/Kinshasa, en tirant habilement parti de l’ambition de Mobutu de s’imposer comme un grand leader africain.
Malgré le peu d’enthousiasme suscité par ce projet et la méfiance qui s’exprima à l’égard de sa viabilité économique, les productions tchadienne et centrafricaine devant désormais être acheminées par le port de Matadi, la Charte de la nouvelle organisation fut signée à Ndjamena (alors Fort-Lamy) le 2 avril 1968 ; on avait en définitive abandonné cette appellation d’« États-Unis d’Afrique Centrale » pour calmer les esprits. L’UEAC (Union des États d’Afrique Centrale) instituait donc un marché commun et une coopération à tous les niveaux, y compris celui de la sécurité. Son premier président était le général Mobutu. Son secrétariat comprenait un secrétaire général (à désigner par le Tchad), deux secrétaires généraux adjoints (à désigner par la RCA et le Congo). Le siège de l’Union était fixé à Bangui, capitale de la RCA.
Après l’accord de création de l’institution, les premières décisions de coopération furent prises par les trois fondateurs à Kinshasa (9 avril) : création d’un « Fonds de démarrage » de l’UEAC, mise en commun des moyens de transport ; création de la première société de transport, une compagnie aérienne dénommée « Air-Afrique Centrale ».
Mais l’UEAC, pour être rentable, devait nécessairement s’allier avec les autres pays de la région, notamment le Gabon et le Congo. Elle l’avait compris dès le départ en insistant sur le fait que « l’Union était ouverte à d’autres Etats ». Mais les mésententes du début rendaient une telle perspective irréalisable ; non seulement l’UDEAC se trouvait supplantée sur son propre terrain, mais de plus la France du général de Gaulle restait étrangère à cette affaire. Cela n’empêcha pas, le 21 avril à Bangui, la pose de la première pierre de l’immeuble de l’UEAC. Peu après Bokassa fit faux bond et annonça, le 9 décembre de la même année, le retrait de son pays de l’UEAC. Il réintégra l’UDEAC, laissant les deux autres partenaires, le Zaïre et le Tchad, dénués de frontières communes. La solidarité née du régime colonial était la plus forte et avait voué cette tentative à l’échec. Le Tchad réintégra à son tour l’UDEAC, mais bien après la mort de Tombalbaye, et contre la volonté du général Malloum, désireux de relancer la coopération avec le Zaïre. En effet, pris dans le tourbillon de la guerre civile, ce pays eût été plus en sécurité en demeurant dans la zone C.F.A. En tant qu’observateur aux réunions de l’UDEAC depuis 1979, le Tchad demanda sa réintégration à cette organisation en décembre 1981. Le projet UEAC avait vécu.
Il ne resta plus au Zaïre qu’à chercher lui aussi du côté de la solidarité née de la colonisation ; c’est ainsi qu’il avait fondé en 1976, avec le Rwanda et le Burundi, la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) dont le siège se situait à Gisenyi, au Rwanda. [25] Mais le Zaïre n’avait pas abandonné son rêve de doter l’Afrique Centrale d’une structure de concertation plus importante. Il lança à nouveau en 1977 un appel pour la création d’une nouvelle organisation appelée « Communauté économique des pays de l’Afrique Centrale », regroupant des membres de l’UDEAC et de la CEPGL, mais en vain. Le Gabon reprit ce projet à son compte, tout en le rendant plus ambitieux puisqu’il pensa y intégrer les anciens territoires portugais de la région, à savoir l’Angola, Sâo Tome et Principe, et la Guinée Equatoriale. L’accord pour la création de la CEEAC fut donc signé, sur initiative de la Commission économique des Nations unies pour 1 Afrique à Libreville, le 18 octobre 1983 (Demba C., 1994).
L’initiative du Zaïre avait échoué une fois encore, non seulement à cause de la fragilité de l’union dont il s’était fait l’artisan, mais aussi à cause de l’opposition et de la réticence manifestées par les autres pays, y compris la France. Elle eut tout au plus pour avantage d’avoir permis au Zaïre de vivre une expérience concrète, déterminante pour la manière dont il concevait et mènerait des projets futurs.
Contrairement au cas de l’UEAC, l’affaire angolaise, qui se solda également par un échec, eut des conséquences inattendues, menant la crise zaïroise à son paroxysme. [26] Pourtant l’Angola est proche du Congo, spécialement au Katanga, au Bandundu, au Bas-Congo et dans la capitale, où ses ressortissants sont désignés non pas d’après leur nationalité, mais d’après leur référence ethnique, ce qui souligne davantage le rapprochement existant entre ces deux communautés. C’est depuis la fin de la période coloniale que le Congo et l’Angola se retrouvaient sur une voie de libération commune. A la conférence des peuples d’Afrique que Kwame N’krumah organisa en 1958 pour promouvoir la libération du continent, Lumumba, qui y prit part, se retrouva aux côtés de l’Angolais Joseph Gilmore, plus connu sous le pseudonyme de Holden Roberto.
Devenu indépendant, le Congo ne pouvait oublier l’Angola ; Lumumba le premier décida, en 1960, de fournir une aide substantielle au mouvement de libération de l’Angola en lui procurant des assises territoriales et en prêtant main-forte à ses dirigeants exilés. A l’époque, Agostinho Neto était un médecin réputé de Kinshasa. Mais le devoir de solidarité avait ses servitudes. Les Angolais étaient loin de s’entendre entre eux. Du MPLA (Mouvement populaire de Libération de l’Angola) était né, en 1961, l’UPA (Union des Populations de l’Angola), une dissidence de Holden Roberto. Le gouvernement Adoula tenta de réconcilier les deux groupes, mais en vain. L’installation d’un gouvernement socialiste à Brazzaville, avec Massamba- Débat, accentua ce clivage ; les socialisants angolais choisirent de traverser le fleuve. De son côté, H. Roberto resta sur place et constitua un gouvernement angolais en exil (GRAE), dont il prit la tête en tant que président. C’est la situation que connut le régime de Mobutu lors de son instauration. L’avenir des relations entre l’Angola et le Zaïre ne causait pas d’inquiétudes. D’abord, le colonialisme portugais passait toujours pour être foncièrement opposé à toute velléité d’indépendance. Au cas où il le deviendrait, le Zaïre miserait logiquement sur « l’homme fort » de la décolonisation qu’était Holden, l’adversaire de Neto, personnage parfaitement intégré au Zaïre, faisant presque corps avec le groupe de Binza. Au demeurant, l’UPA avait fini par créer avec quelques autres petites formations politiques, un mouvement plus important, le Front National de Libération de l’Angola (FNLA) sous la présidence du même H. Roberto.
C’est suite aux premières secousses économiques qu’il connut que le Zaïre réalisa l’importance que l’Angola pouvait avoir pour lui. En effet, l’évacuation du cuivre du Katanga – qui constituait l’épine dorsale de l’économie nationale – se réalisait pour 40 % par la voie ferrée, allant de ce coin du pays jusqu’au port de Lobito. Cette voie était plus directe que celle de l’Afrique Orientale, qui aboutissait à Maputo. L’accès des bateaux au port maritime de Matadi exigeait également, au niveau de l’embouchure, un transit par les eaux territoriales angolaises. On se rappelera qu’en 1960, alors que Lumumba condamnait ouvertement le colonialisme portugais, le Portugal de Salazar avait déjà menacé de couper cette voie maritime en y faisant couler de vieux bateaux.
Avec la « Révolution des Oeillets » à Lisbonne, le 25 avril 1974, tout changea : ce qui passait jusque-là pour être sûr, ne le fut plus. L’indépendance de l’Angola risquait de se faire au détriment de l’allié du Zaïre. Le colonisateur était passé à gauche et, puisqu’il tenait le langage de la décolonisation, il tendrait à favoriser la faction appartenant à la même obédience que la sienne, à savoir le MPLA de Neto. L’enjeu était trop important. Le Zaïre alors occupé à effectuer son virage à gauche par sa « révolution dans la révolution », la fraternisation avec la Chine et la Corée du Nord et la rupture des relations diplomatiques avec Israël, dut revenir à ses anciennes alliances et trouver une issue satisfaisante au problème.
L’enjeu consistait à mettre en place à Luanda un gouvernement adapté à cette situation. Les impératifs de sécurité et d’ordre économique l’exigeaient. La frontière entre le Zaïre et l’Angola était longue, et trop perméable aux éventuelles invasions ennemies surtout qu’il était connu que les anciens gendarmes katangais avaient élu domicile en Angola. L’inquiétude grandissait encore à la perspective qu’un Angola socialiste, pouvait toujours compter sur le Congo de Marien Ngouabi, socialiste lui aussi. Sur le plan économique, l’Angola, comble de l’ironie, disposait de tout ce qui manquait au Zaïre pour sortir de la crise : les ports maritimes, le pétrole. Le problème était aussi d’ordre sentimental : depuis 1960, le Congo puis le Zaïre avait trop « investi » dans l’Angola pour pouvoir perdre du jour au lendemain tout le bénéfice de son action d’hospitalité et d’aide aux mouvements de libération sans amertume. Dans la guerre qui opposa le MPLA au FNLA, à l’approche de l’indépendance, comme au lendemain de l’indépendance, le Zaïre prêta main-forte à ce dernier, aidé par les Occidentaux et la Chine, tandis que l’URSS soutenait le MPLA, par l’entremise des Cubains. Mais, hélas pour le Zaïre, la coalition du FNLA et de l’UNITA ne l’emporta pas sur le MPLA qui avait déjà donné au pays le nom de « République Populaire ». Le soutien apporté au FLEC (Front de Libération de l’Enclave de Cabinda) pour obtenir ne serait-ce que le droit à l’autodétermination, contrairement à l’opinion du MPLA qui le considérait comme faisant partie intégrante de l’Angola, n’aboutit guère à un résultat concret, lui non plus.
Le régime de Mobutu s’était trop investi dans cette cause désespérée. Le pays allait payer un lourd tribut pour cette erreur d’appréciation. Non seulement il perdit le bénéfice de ses efforts constants d’aide à la décolonisation de l’Angola, mais il fut en plus ruiné par cette guerre gratuite, et perdit le droit, dont il disposait pourtant depuis l’époque coloniale, d’opérer des transactions commerciales à partir des ports maritimes de l’Angola.
Désormais, l’insécurité était permanente sur cette frontière de part et d’autre de laquelle la mobilité de la population ne pouvait être soumise à un contrôle rigoureux, du fait qu’elle appartenait à une seule et même ethnie.
La diplomatie zaïroise tenta de remédier à cette situation. L’Angola de Neto, ruiné par la guerre, ne pouvait pas davantage rester sur ses positions. Marien Ngouabi mit à profit les intentions pacifiques émises par les deux présidents après la guerre pour les réconcilier. Ils se rencontrèrent pour la première fois à Brazzaville le 28 février 1976 et mirent au point une commission mixte chargée de favoriser la coopération entre les deux pays. Moins d’un an plus tard, le 6 janvier 1977, le Zaïre reconnaissait formellement la République populaire d’Angola. L’expérience avait été lourde de conséquences pour l’économie, entraînant le pays dans une crise sans précédent.
Une autre du même genre, à la base des futures équations inextricables, a été la trop grande ouverture du Zaïre de Mobutu à l’immigration rwandaise et burundaise, dans le cadre de la solidarité de l’ancienne Afrique belge. Une initiative qui allait compromettre ses relations saines avec la communauté nationale, particulièrement au Kivu. Depuis l’indépendance, chaque crise politique au Rwanda comme au Burundi, se traduisait, pour le Congo, en une nouvelle vague des réfugiés. Par définition, il s’agissait des adversaires des pouvoirs en place, adversaires d’autant plus indésirables que les espaces d’habitation étaient exigus et que les conflits politiques empruntaient le langage de l’ethnicité (Reyntjens F., 1994 ; Harroy J.P., 1984, Chrétien J.P., 1993).
Le mouvement de déplacement du surplus démographique, de l’est vers l’ouest, qui avait reçu le renfort du pouvoir colonial, s’était accéléré sous la pression des événements de la postcolonie. A partir du coup d’envoi de la « Toussaint rwandaise » en 1959 qui avait conduit à l’abolition de la royauté, suivant le mot d’ordre du Parmehutu, le parti de Grégoire Kayibanda, le futur président de la république (Hubert J.R., 1965 ; Willame J.C., 1995). La longue marche des Tutsi rwandais avait commencé. Par dizaines de milliers, entre 1959 et 1966, ils avaient été contraints à l’exil, vers le Burundi (où le pouvoir est resté entre les mains des Tutsi), l’Ouganda, mais surtout vers le Congo. Leur attaque en 1963, pour tenter de reprendre possession de leurs terres, n’avait rien arrangé ; elle avait offert, au contraire, le prétexte pour de nouvelles représailles. Tant d’événements avaient produit, dès cette époque, la conscience et la nécessité non seulement de « venger » les victimes, mais aussi de « corriger » cette situation de fait [27].
Au Burundi, les années 60 avaient présenté le même spectacle d’exclusion, mais en sens inverse. C’est le groupe hutu qui se retrouvait victime des excès du pouvoir tutsi. Au cours des toutes premières années de l’indépendance, de 1962 à 1966, les deux premiers Hutu à s’asseoir sur le siège de Premier ministre, avaient péri assassinés (Ndarubagiye L., 1995). Après la défenestration du jeune Ntare V, qui avait lui-même ravi le trône à son père, le premier chef d’État républicain, Michel Michombero avait fait exécuter, en 1969, des intellectuels et officiers hutu, au motif qu’ils se trouvaient à la base d’un conflit ethnico-politique. Essayant de venger leurs morts, les Hutu avaient suscité une répression violente de l’armée (Ndarubagiye L. 1995). Presque en réplique à ces événements malheureux, au Rwanda, une nouvelle vague de persécution des Tutsi s’était organisée en 1973 ouvrant curieusement la voie au coup d’Etat du 5 juillet du général Juvénal Habyarimana [28] (Shyirambere J.B., 1988).
A combien se chiffraient ces immigrants « postcoloniaux » ? Selon le Haut Commissariat aux Réfugiés, ils avaient été 50 à 60.000 à déferler du Rwanda au Congo rien qu’entre 1959 et 1961. Entre 1961 et 1966, on en avait comptabilisé 25.000 de plus et, en 1973, 23.000 (Willame J.C., 1997 : 46). Tous étaient donc venus grossir au Congo les rangs des « Rwandais » [29], Rwandophones et Burundophones d’avant la colonisation, et Rwandais sédentarisés au Kivu par le régime colonial. Au vécu, la distinction rigide entre autochtones rwandophones, immigrants et réfugiés rwandais passait pour trop subtile. Elle n’était donc pas courante. Le clivage pertinent était celui qui démarquait les autochtones (Hunde, Nande, Nianga) des « allochtones » (Hutu et Tutsi), quelle que soit leur condition. Et chaque groupe avait ses dissensions internes, comme celle qui, parmi ces derniers, démarquait les Hutu des Tutsi.
Seule la Belgique coloniale aurait pu apporter une contribution déterminante pour atténuer durablement l’ampleur de ces dérives futures, si elle avait pu, lors de la négociation du virage de l’indépendance de « son » Afrique, tenir compte explicitement de l’équation posée par la question de nationalité. Tel ne fut pas le cas. Faut- il mettre cela au compte de la précipitation ou avait-elle estimé que la distinction entre Congolais, Rwandais et Burundais allait de soi ? En tout cas, la Loi Fondamentale fut curieusement muette sur la définition de la nationalité congolaise. Seule la loi relative aux élections législatives du 23 mars 1960 avait précisé que « les ressortissants du Rwanda-Urundi, résidant au Congo depuis 10 ans au moins étaient admis à voter ». De là, on peut conclure que la Belgique coloniale avait timidement admis le principe suivant lequel la nationalité congolaise était automatiquement acquise aux ressortissants du Rwanda-Urundi installés au Congo depuis 1950 au plus tard.
La solution au problème de la nationalité, à l’âge postcolonial, était d’autant plus épineuse, qu’il fallait y intégrer un héritage constitutionnel d’origine coloniale, qui compliquait davantage la gestion du dossier. En effet, en conformité avec la pratique belge, la nationalité congolaise était, par essence même, « une et exclusive ». Aucune concession n’était donc envisageable pour faire prévaloir légalement le statut de « zaïrwandais », à cheval entre deux nationalités. D’où, pour se sécuriser, tout allochtone n’avait pas d’autres choix que de prétendre à l’autochtonie et donc, se déclarer congolais « de fait ».
C’est dès le seuil des années 60 qu’on avait noté les premières grandes tensions entre « originaires » et « non originaires », par la position dominante occupée par ces derniers dans le commerce, la politique et l’administration, tant ils représentaient une quantité non négligeable de la population active. Dans le Masisi, ils étaient même majoritaires [30]. Une véritable bourgeoisie locale émergea dans ces milieux [31]. Elle contrôlait l’administration provinciale, la représentation de la région au niveau des instances de la capitale ainsi que les réseaux des exportations en fraude du café du Nord-Kivu, de l’huile de palme du Maniema et du quinquina du Sud-Kivu vers les pays de l’Afrique de l’Est. De plus, dès la décolonisation, cette communauté « zaïrwandaise » s’était illustrée par des prises de position excentriques par rapport au reste de la population. Si ces membres adhérèrent massivement au CEREA (qui, symptomatiquement, prônait le regroupement « africain »), alors que les « originaires » se ruèrent vers des partis de type tribal, c’est qu’ils craignaient de ne pas y trouver leur compte.
Lors de la régionalisation des provinces coloniales en « provincettes », on les vit s’illustrer encore, à l’envers du reste de la population, par leur opposition au démembrement du Kivu, particulièrement à la constitution d’une province du Nord-Kivu autonome. Cette position apparemment curieuse était justifiée. Fonctionnant déjà comme une diaspora organisée, avec ramifications dans les cabinets ministériels à Kinshasa, dans les entreprises au Katanga, dans le Haut-Congo, son fonctionnement était plus aisé dans un Kivu unifié administrativement que dans trois provinces autonomes (Tableau 23) [32]. De plus, dans le cadre de la rivalité entre eux et les Nande pour le contrôle de l’espace politique et commercial au Nord-Kivu, ils craignaient que l’autonomie de la partie septentrionale du Kivu ne se transformât en chasse gardée des Nande. Cette obstruction se matérialisa surtout dans la fixation du statut de Rutshuru et de Goma, qui finalement furent promis au référendum. L’opposition entre partisans du rattachement de ces territoires au Nord-Kivu ou au Kivu central avait fini par donner lieu à des oppositions ouvertes dont la dernière – la révolte Kanyarwanda (fils du Rwanda) – fut déjà interprétée, à l’époque, comme une tentative rwandaise de créer un « Hutuland » [33]. On comprend que les rédacteurs de la Constitution de 1964, à Luluabourg, se soient sentis interpellés par ces velléités et qu’ils se soient efforcés d’être aussi précis que possible dans la définition de la nationalité [34].
Les choix politiques de Mobutu vinrent exacerber ces tensions sociales, en les portant à leur paroxysme. En offrant massivement des promotions politiques et économiques aux « barons » rwandophones, ils leur offrirent la possibilité de chercher à « sauver » l’ensemble des membres de la communauté, y compris les immigrants illégaux. Paradoxalement, l’option du régime vint donc compromettre encore davantage les chances du rapprochement entre autochtones et allochtones au Kivu. Sa stratégie de confier les responsabilités politiques de préférence aux représentants des groupes marginaux du fait de leur faiblesse numérique ou de leur nationalité douteuse conduisit à la nomination d’un membre de la communauté des immigrants, Barthélémy Bisengimana Rwema [35], au poste de directeur du Bureau du Président-Fondateur du MPR, Président de la République. De mai 1969 à février 1977, ce « munyarwanda » joua le rôle de tout premier plan dans la gestion des affaires de l’Etat, cumulant nombre de fonctions agglutinées à la personne du Président de la république [36]. C’est lui qui géra les années folles du mobutisme, particulièrement le secteur économique où il s’était fait le grand inspirateur des projets d’industrialisation somptuaires initiés par les sociétés d’ingénierie américaines, françaises, italiennes, japonaises et belges (Willame ; J.C. 1997 : 53). Grand parrain de ceux qui partageaient sa condition, il initia en 1972 une loi mettant fin au statut incertain de Banyarwanda. Aux termes de l’art. 15 de cette loi, « les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960 ». Par rapport aux dispositions précédentes, coloniales et postcoloniales, l’innovation portait particulièrement sur l’intégration des « transplantés » de la période coloniale [37]. La mesure eut entre autres pour conséquence le fait que Masisi changea littéralement de « propriétaire », puisqu’il se trouva habité majoritairement par des « Zaïrois d’origine rwandaise ».
Sur le terrain, on ne put éviter la recrudescence des tensions car la loi avait une lecture économique. Cette intégration avait, en effet, été décrétée à la période de la zaïrianisation. Les « Zaïrwandais », puisqu’ils contrôlaient la haute hiérarchie de l’Etat, s’attribuèrent non seulement des terres expropriées des « chefs coutumiers » mais aussi les entreprises agro-industrielles et commerciales de la région. Croyant bien faire, on s’éloigna plutôt plus résolument d’une pédagogie d’intégration des populations d’origine diversifiée au Kivu. Aussitôt, la contestation de la nationalité congolaise se trouva relancée de plus belle au Kivu, comme conséquence des impositions de Kinshasa et comme stratégie d’autosécurisation de la part des couches dominées. C’est ainsi qu’en juin 1978 (après le départ de Bisengimana de la présidence de la République), le Conseil législatif décida d’envisager la possibilité de la révision de l’art.15 de la loi de 1972. Rien qu’une telle éventualité suscita émoi et branle-bas et provoqua tout un débat fait de mémorandums et de pétitions, relayés ensuite par les délibérations du Comité Central. Dans ce débat, les Hutu décidèrent, à la fin de 1980, de jouer la carte de la démarcation avec les Tutsi. Ils se réclamèrent d’être d’authentiques zaïrois… « comme leurs frères Banande, Bashi, Bahunde et Nyanga » et s’insurgèrent contre « la surreprésentation » des Tutsi qui ne représentaient même pas les 5 % de la population » (Willame ; J.C., 1997: 56) [38].
Finalement, le 29 juin 1981, le Conseil législatif vota l’annulation de l’art.15 de la loi de 1972. La nouvelle loi (81-002 du 29 juin 1981) était encore plus restrictive que la Constitution de 1964. Elle stipulait que n’étaient zaïroises que les personnes dont l’un des ascendants était sur place à la date du 1er août 1885, au lieu du 18 octobre 1908. La nationalité zaïroise ne pouvait être accordée aux « étrangers » que sur base d’une demande expresse et individuelle. Deux possibilités étaient offertes, celle de la petite comme de la grande [39] naturalisation. Pour avoir voulu aller trop vite et trop loin, le régime avait réussi à faire perdre aux concernés les avantages déjà acquis du fait des dispositions antérieures [40]. De plus, la conflictualité du Kivu avait connu un plus grand développement, sclérosée, de manière plus nette, entre trois groupes plus que jamais distincts : d’une part, les Hutu qui s’estimaient une ethnie congolaise, installée dans le pays depuis des temps reculés bien qu’il faille y inclure les immigrés des années 30 à 50, d’autre part, les Tutsi arrivés suite aux progroms de 1959 à 1973 au Rwanda ; il y avait enfin les natifs congolais qui, se sentant étrangers ou minorisés sur leur propre terroir, continuèrent à rejeter les uns et les autres. Il fallait désormais compter avec ces clivages, devenus presque institutionnalisés.
D’une manière générale, la politique d’influence du Zaïre, avec ses initiatives et ses maladresses, découlait de la politique d’indépendance qu’il avait tenté de pratiquer, sur le plan international, au cours des dix premières années du nouveau régime, se rapprochant à grands pas des pays du bloc de l’Est. La proclamation du nouvel ordre politique, en 1968, fut accompagnée d’un certain nombre de dispositions qui, blessantes à l’égard des Occidentaux, accréditaient le Zaïre en tant que pays influent au sein du groupe des non alignés, et comme véritable leader du Tiers- Monde. Un an après que le pays eut changé de nom, le président renonça à ses alliances avec la Chine nationaliste pour se rapprocher de l’Asie socialiste. La Chine maoïste qui, pendant les années 60, avait soutenu les mouvements révolutionnaires au Congo, entre autres celui de Mulele, l’accueillit du 10 au 12 janvier 1972 et s’engagea dans une coopération « exemplaire ». L’aide chinoise intervint dans des domaines aussi variés que la riziculture, la construction d’un « Palais du peuple », l’équipement et la mise sur pied d’une division spéciale au sein de l’armée (la division Kamanyola). La Corée du Nord, visitée par le président lors du second voyage en Chine (du 6 au 22 décembre) confirma cette coopération avec l’Asie socialiste. L’apport le plus important de celle-ci se situa au niveau idéologique, les pays visités constituant une source d’inspiration nouvelle. On prôna la mobilisation générale du peuple pour le développement, de même l’étatisation de l’enseignement et la socialisation de l’économie. La personne du président fut l’objet d’un culte véritable avec la généralisation des danses dites d’animation politique. On pensa à « changer » la société et l’on dénonça les maux (les dix fléaux) qui rongent la société. On s’était promis d’engager la lutte contre l’injustice sociale, l’inflation, le chômage, la crise agricole. La « Zaïrianisation », l’expropriation du petit commerce au profit des nationaux, se situait dans ce contexte. Dans le même discours rendant hommage à la coopération chinoise (prononcé les 4 octobre 1973 à l’ONU), le président condamna les régimes racistes de l’Afrique du Sud et annonça la rupture des relations diplomatiques avec Israël « pays ami », par solidarité avec l’Egypte « pays frère ».
Pourtant la crise économique, encore aggravée par la guerre de l’Angola, allait ramener cette ouverture au monde dans le giron du monde capitaliste. A la fin de l’année 1977 après la « guerre de 80 jours », le Zaïre revint à ses alliances traditionnelles avec les États capitalistes d’Europe et d’Amérique du Nord. Le moment était particulier, car il faisait suite à une période au cours de laquelle la politique d’indépendance avait mené le pays à accéder à d’autres types de difficultés pour son développement. Il en resta toutefois quelque chose ; la fréquentation des pays socialistes se poursuivit sans toutefois provoquer une rupture de la collaboration avec les pays d’économie capitaliste. Aussi fut-on ami avec la Roumanie, la Chine, la Corée du Nord et l’Allemagne de l’Est, etc. La formule politique en vigueur disait que « le Zaïre n’était ni à gauche, ni à droite… pas même au centre ». Il était tout cela à la fois.
C’est dans le domaine culturel, au sens large du terme, que l’ère mobutienne allait briller de mille feux car elle eut l’ambition de faire renaître la société. Par sa durée, sa volonté d’indépendance et sa quête de l’inédit, cette période fut en effet propice à l’explosion des arts et au développement des ressources humaines nationales. Nous nous en tiendrons pour cet exposé à une analyse du « vécu » de l’authenticité, dans sa vie quotidienne comme dans l’expression des arts, sans omettre pour autant la production des institutions qui eurent pour mission de gérer ce patrimoine culturel et de soutenir la créativité nationale. [41]
2.3.1 Vie quotidienne
L’idéologie de l’authenticité eut l’ambition de contribuer à libérer le Zaïrois de la vision « européocentrique » qu’il avait si bien assimilée pendant la colonisation, au point de ressentir un certain mépris à l’égard des réalités locales, au profit des réalités extérieures. Le discours officiel vint réhabiliter les réalités du terroir. Il dut parfois même faire violence à la population, l’obligeant à abandonner des comportements qu’elle avait déjà bien assimilés. C’est ainsi qu’au cours des années 70 s’imposa le réaménagement du quotidien, moins par application des décrets que par l’imposition par voie de fait des créations des uns et des autres. Ces nouveaux comportements ont continué à dominer la vie quotidienne zaïroise, au point d’être reconnus, sur le plan international, comme caractéristiques de cette communauté nationale.
Au niveau de l’habillement, le costume officiel masculin devint l’abacos assorti éventuellement du foulard et de la pochette. [42] La tenue présidentielle impliquait en outre le port d’une toque en peau de léopard et l’usage de la canne. Quant aux dames, tenues d’abandonner le port des robes, des jupes et des pantalons, elles purent découvrir au fil des ans que le pagne avait des vertus insoupçonnées. Ce textile était importé de l’étranger, particulièrement de Hollande, ou provenait d’usines locales implantées à Kinshasa (Utexafrica, CPA), à Lubumbashi (Solbena) ou à Kisangani (Sotexki). Puisqu’il existait des distinctions subtiles entre les pagnes, suivant la qualité du tissu et la couleur et le type de ses décorations, chaque genre portait un nom précis ; il en allait même des différentes coutures. L’univers vestimentaire féminin connut ainsi des courants, des modes et des différences internes. [43] Il en fut de même des coiffures, nécessairement « authentiques », puisque l’usage de postiches ou d’autres accessoires était proscrit. [44]
La cuisine zaïroise acquit elle aussi son droit de cité lors des banquets officiels, cessant d’être considérée dans son pays d’origine comme une nourriture exotique. L’étalage culinaire courant, fait de viande ou de poisson (frais, fumé, salé) garni de riz, de plantain, de manioc et de haricots, n’excluait pas le recours pour les grandes circonstances, à certaines spécialités régionales : gibier, buffle, éléphant, hippopotame, crocodile, tortue, serpent, chenilles et certaines variétés d’insectes (grillons, fourmis ailées, termites, etc.). Le dîner zaïrois « authentique » consiste à se servir soi- même en faisant son choix parmi un assortiment de plats de poisson, de viande, de légumes, de riz, de plantain et de manioc (Chikwangue ou fufu). Le toast suppose que l’on verse en hommage aux ancêtres, suivant la tradition, une goutte de boisson, de préférence sur le sol ou à défaut dans un cendrier.
Dans le souci supposé de faire prévaloir l’esprit patriotique, il fut décidé que tous les Zaïrois étaient des « citoyens » et non des messieurs, dames ou demoiselles. Ces dernières, indépendamment de toute référence à leur âge ou à leur état civil, étaient appelées « marna », par respect pour leur féminité. Ce terme ou celui de citoyenne étaient utilisés l’un et l’autre, indistinctement. [45]
La désignation des personnes, après la suppression des prénoms chrétiens, s’effectua par le biais du nom de famille suivi d’autres noms caractérisant l’individu. S’il arrivait que des familles fassent encore usage des prénoms, ou autres dénominations étrangers, ceux-ci ne valaient plus qu’en tant que surnoms, indépendamment de toute identification officielle. [46] La plupart de ces noms nouveaux tiraient leur origine d’histoires familiales. C’est ainsi qu’ils désignent généralement soit un parent ou un ancêtre, soit encore le village d’origine ou le clan dont on est issu. Si certains « postnoms » sont d’origine noble et désignent des aristocraties politiques réelles ou présumées, d’autres sont simplement tirés des maximes populaires ; d’autres encore sont des correctifs des noms que les héritiers portent encore suite aux impositions coloniales. [47]
Signalons que dans la pratique de l’authenticité, la ville de Kinshasa fut surtout le cadre de rencontres et de brassages de plusieurs traditions d’origines diverses. Celles-ci furent bien souvent uniformisées pour être, dans le flux des contacts interethniques, redistribuées dans les centres urbains de l’arrière-pays où des permutations administratives avaient accentué les besoins de communication interethnique. Ainsi le cérémonial de mariage et de deuil connaît-il de nos jours un code pratiquement uniformisé. Le mariage pseudo-traditionnel qui se célèbre dans les villes comprend deux parties ; le kanga lopango constitue la première cérémonie au cours de laquelle, comme son nom l’indique, on procède à la « fermeture de la concession ». Désormais la jeune fille promise à un homme, doit s’abstenir de « sortir ». Pour ce faire, le futur époux verse une prédot en guise de gage. La seconde cérémonie est celle de la dot proprement dite qui peut intervenir soit le jour même soit des mois ou des années plus tard. Mais une fois que la prédot est versée, l’élue peut rejoindre la demeure de son mari et commencer sa vie conjugale.
Le cérémonial de deuil répond lui aussi à des consignes précises. Un deuil dans une rue ou un quartier est signalé par la présence de palmes (lindalala). L’enterrement est précédé d’une veillée de pleurs, de danses et de prières (matanga). Au retour du cimetière, les amis venus participer au deuil se dispersent. Seuls les intimes continueront à veiller auprès de la famille endeuillée, et ce pendant quarante jours. C’est au quarantième jour de deuil que les amis et connaissances rejoignent à nouveau la famille éprouvée pour célébrer la fin du deuil. Lors de cette cérémonie, la famille endeuillée quitte l’habit de deuil pour renouer avec la vie active au milieu de chants et de danses.
Sur le plan national, le calendrier des fêtes officielles fut complètement revu à la suite du conflit de l’État avec l’Eglise catholique en 1971. Proclamant sa laïcité et donc son indépendance à l’égard de toute confession, l’État zaïrois préféra ne pas reprendre à son compte, dans la nomenclature des jours fériés, les fêtes religieuses, notamment : le jeudi de l’Ascension, le lundi de la Pentecôte et l’Assomption (15 août). Par contre d’autres fêtes furent instaurées : l’anniversaire de la création du Parti (20 Mai) ; la fête du poisson (24 juin) ; l’anniversaire de l’indépendance (30 juin) consacré à la méditation ; la fête des parents (1er août) ; la fête de la jeunesse (14 octobre) ; la fête de l’authenticité (27 octobre) ; la journée des Forces Armées zaïroises (17 novembre), sans oublier la grande fête d’anniversaire de la deuxième République (24 novembre).
Cette laïcité de l’État n’a jamais été considérée comme incompatible avec l’esprit religieux du Zaïrois. En effet, les vingt dernières années de l’évolution nationale se sont caractérisées, entre autres, par une grande effervescence religieuse qui n’est pas tout à fait indépendante, comme nous le verrons plus loin, de la crise économique. Mais la crise seule n’explique pas ce phénomène. L’engouement religieux provient également d’efforts plus efficaces pour décrypter le message religieux et l’insérer dans le champ culturel local. Ce qui passait jusque-là pour être hermétique devint accessible.
L’Eglise catholique, la plus stricte de toutes au niveau du respect de son code de conduite, alla jusqu’à produire un rituel zaïrois de la messe. Ce projet est le fruit de plusieurs intuitions, nées dans des contextes différents. D’abord, vers 1963-64, un moine belge, professeur de théologie, le Père Luyckx, désireux de bâtir un monastère africain non loin de l’université, procéda à une première tentative d’adaptation du rituel romain de la messe [48]. Le cardinal Malula également qui, jeune prêtre, composait des chants religieux en lingala, aidé par son ami, monseigneur E. Moke, fit école et inspira plusieurs jeunes prêtres dont le noyau dynamique se recruta parmi les anciens du grand séminaire Jean XXIII. Parmi ceux-ci, il y eut notamment l’abbé Kinzanza du diocèse de Kikwit ainsi que B. Binia, J. Yakime et I. Lufwaël du diocèse d’Idiofa. Leurs chansons permirent aux chrétiens catholiques de prier dans les différentes langues nationales du pays. De nos jours, la « messe zaïroise », reconnue officiellement par Rome depuis 1988, ouvre des perspectives nouvelles [49]. Elle galvanise autour d’elle toutes les inspirations locales, qu elles proviennent du clergé ou des laïcs. Des rythmes populaires sont appelés en renfort pour soutenir les inspirations religieuses, les mêmes mélodies circulant de l’église au temple et vice- versa, à travers des confessions religieuses différentes. Le résultat est d’une originalité prodigieuse malgré son ambiguïté. On dirait que le christianisme, pour avoir si bien façonné le citoyen zaïrois, est à nouveau façonné par lui. La musique religieuse est devenue populaire, au point qu’elle s’exécute même dans des contextes apparemment profanes, pour accompagner les veillées de deuil et assurer l’animation des fêtes familiales.
Cette situation qui prévaut de nos jours est le résultat de tout un cheminement. Vers les années 70, on s’interrogeait encore sur l’ambiguïté du message chrétien qui passait pour être lié à l’acculturation que l’on dénonçait par ailleurs. Un chanteur zaïrois, Kiamwangana Mateta (Verkys), a traduit cet état dame :
Je me demande souvent
Oh Dieu ! je me demande si souvent
La peau noire d’où est-elle venue Notre premier ancêtre qui est-il ? Puisque Jésus le fils de Dieu est Blanc Adam et Eve sont aussi des Blancs Tous les saints sont aussi des Blancs Pourquoi, Seigneur, tu as fait ainsi ?
Je me demande souvent
Oh Dieu ! Je me demande si souvent
Dans les livres sacrés, nous constatons
Que les images des anges
Que les images des saints sont celles des Blancs…
Lorsqu’il s’agit du diable
On lui donne une tête de Nègre, une tête toute noire
D’où vient cette injustice ?
Les couplets suivants traduisent davantage la révolte et le souci de ne plus se laisser abuser.
Je me demande souvent
Oh Dieu ! Je me demande souvent
La peau noire d’où vient-elle
Les « oncles » (les colonialistes) nous ont donc trompés
Les statuettes de nos ancêtres, ils les rejettent
Mais que voyons-nous à l’Eglise ?
Nous prions le chapelet à la main
Les statues ornent l’ensemble de l’Eglise
Mais ces statues représentent des Blancs
Pourquoi Seigneur ?
Je me demande souvent
Oh Dieu ! Je me demande si souvent
Les prophètes à eux les Blancs nous acceptons
Lorsqu’il s’agit d’un Nègre, ils n’y croient pas
Pourquoi Seigneur nous as-tu créés ainsi
Notre ancêtre à nous les Nègres où serait-il ?
L’Afrique a maintenant les yeux éveillés
L’Afrique ne fera pas marche arrière. [50]
Ces paroles sont symptomatiques du degré d’intériorisation de l’authenticité dans le peuple ; elles expriment une interrogation profonde, dont une tentative de réponse n’a pu se dessiner qu’après des années, grâce à la prise de conscience de la nécessité de l’inculturation. De nos jours, en effet, le peuple s’est approprié la Bible et n’hésite pas à l’utiliser hors du cadre dans lequel le missionnaire qui l’avait apportée lui avait conseillé de le faire.
2.3.2 Langues et littérature
Dans le domaine de la langue, écrite ou parlée, la volonté de faire renaître la société ne semble pas avoir eu d’incidence. En fait, c’est l’ambiguïté de la politique coloniale qui justifia la réticence à la poursuivre. A l’époque, en effet, l’instruction en langues locales était une façon d’étouffer la formation des élites, l’accès au français étant une faveur réservée à quelques-uns. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est le législateur congolais et non l’autorité coloniale belge qui décréta la généralisation de l’instruction en français ; le multilinguisme que le réseau d’enseignement élémentaire et primaire s’efforce d’assumer de nos jours en est le résultat. [51]
En pratique, la promotion des langues locales s’est limitée, sur le plan officiel, à la proclamation des « quatre langues nationales » (lingala, swahili, kikongo, ciluba) à côté de la « langue officielle ». La politique de l’authenticité se traduisit dans ce domaine par une révision des noms des organes de presse qui devinrent pour la plupart d’origine locale. [52] Pourtant le contenu demeura en grande partie en français, et la radio et la télévision nationales continuèrent à réserver la part du lion, dans leurs programmes, au français. Malgré tout, au-delà du contexte officiel, les quatre langues nationales connurent une plus grande extension, à cause des permutations administratives qui imposèrent dans les faits à tout Zaïrois moyen l’usage d’au moins deux des quatre langues nationales. [53]
Malgré tout, l’usage du français a servi de base à l’affirmation d’une littérature qui a la particularité de cerner de près les réalités sociales du pays. Elle prit racine dès la période coloniale, grâce aux « cercles d’Evolués ». Certains grands succès de ces derniers se sont prolongés jusqu’aux années 65/66 : Badibanga, P. Lomami – Tshibamba. A.R. Bolamba, A. Mongita, sans oublier les essais politiques de Th. Kanza et de P.E. Lumumba. Entre 1966 et la fin des années 80, on assista à une véritable éclosion de cette littérature. Il serait impossible d’établir ici l’inventaire exhaustif de cette production. Limitons-nous à en citer les grandes tendances et les oeuvres les plus significatives. Trois périodes peuvent y être distinguées : les années 66-71, qui furent celles de la première politique culturelle du pays, correspondirent à l’éclatement des structures culturelles. La quête d’une écriture nouvelle fut essentiellement d’origine universitaire. Les années 71-80 se caractérisèrent par l’apparition de grandes productions littéraires, dont la diffusion fut confiée à des maisons d’édition étrangères. Certaines d’entre elles furent même produites à l’extérieur. La dernière décennie allant de 1980 à 1990 vit l’avènement d’une littérature en mutation, en quête de nouvelles voies et dont la maîtrise n’est pas insensible aux effets de la crise économique.
La première période fut inaugurée par un essai fameux : la Remise en question (Kinshasa 1967) de Mabika – Kalanda fut pour un temps le livre de chevet des lettrés du pays. Mais cette période fut surtout dominée par les écrits poétiques des frères et soeurs Nzuji. L’aînée, Clémentine Nzuji (devenue par la suite Faïk – Nzuji) se fit connaître par ses Murmures (Kinshasa 1967) mais surtout par son recueil Kasala et autres poèmes (Kinshasa 1969) ; elle poursuivit son oeuvre avec le Temps des amants (Kinshasa 1969), Lianes (Kinshasa 1971), etc. Dieudonné Kadima- Nzuji Mukala utilisa le même style poétique pour évoquer ses souvenirs des guerres fratricides du Kasaï, qu’il dut quitter brutalement (Ressacs, Kinshasa 1969). Son talent poétique se manifesta encore avec la parution des Préludes à la terre (Kinshasa 1971) et de Redire les mots anciens (Saint-Germain-des Prés 1977). [54] Caroline Nzuji se spécialisa dans l’écriture de contes. Cette première période connut d’autres productions valables parmi lesquelles Aux flancs de l’Equateur (Kinshasa 1966) et Réveil dans un nid de flammes (Seghers 1969) de Matala Mukadi Tshiaka- Tumba, qui précéda de peu Somme première (Kinshasa 1968), le premier recueil de poèmes de P. Masegabio Nzanzu, l’une des plus belles poésies du pays. [55]
La deuxième période fut plus significative sur le plan social ; elle se caractérisa par une certaine distance par rapport à la poésie, ce qui rendit possible la production des meilleures oeuvres romanesques et théâtrales du pays. Mudimbe Vumbi Yoka (Valentin – Yves) entama sa carrière littéraire avec une poésie hermétique (Déchirures, Kinshasa 1971 ; Entrailles, précédé de Fulgurances d’une lézarde, Paris 1973, les Fuseaux parfois, Paris 1974). Son message eut un impact beaucoup plus important lorsqu’il passa à la publication de romans. Entre les eaux : Dieu, un prêtre, la révolution (Présence Africaine 1973 ; Nathan 1986). Cette première oeuvre du genre, née de la plume d’un Zaïrois, fut reconnue d’emblée comme un grand roman. Il reçut en effet le Grand Prix catholique de Littérature. La toile de fond de ce récit était la période de la révolution muléliste. Un prêtre du pays (Pierre Landu) y vit une crise de conscience, tiraillé entre ses engagements religieux (héritage occidental) et son souci de participer à la transformation de la société (tradition africaine). Mudimbe publia en outre, coup sur coup, le Bel immonde (PA 1976), qui décrit le déploiement d’une passion zaïroise puis l’Ecart (PA 1979), qui dresse le tableau d’une conscience africaine divisée et déprimée. [56] Une autre variante de cette nouvelle écriture congolaise fut le fait de Ngal Mbwil a Mpang avec Giambatista Viko ou le viol du discours africain (Lubumbashi 1975). [57]
Mais le romancier le plus populaire d’entre tous est sans conteste Zamenga Batukezanga. S’il se distingue des deux premiers, c’est parce que son oeuvre, loin d’être élitiste, s’adresse au grand public et se met à sa portée, et plus particulièrement encore au niveau de l’immense public scolaire. Les thèmes de ses ouvrages sont tirés du quotidien, du vécu et du réel. On comprend dès lors que la plupart s’y retrouvent aisément. Fort heureusement, l’auteur est très fécond, en 1970, il écrit Les hauts et les bas, puis Souvenirs de village (1971), Terre des ancêtres, Carte Postale (1974) ; Mille kilomètres à pied, Homme comme toi (1979). Un Croco à Luozi (1982), Bandoki, Sept frères et une sœur (1983). [58]
Le théâtre congolais venait de bien plus bas, au moment où prenait forme la nouvelle société zaïroise. Ses palmes remontaient encore à Mongita où le jeu scénique demeurait limité à la représentation immédiate. Les promesses d’un renouveau se jouèrent sur trois registres : la création en 1967 d’un Conservatoire national de musique et d’art dramatique, qui devint en 1973 l’Institut national des arts (INA) avec pour objectif entre autres la formation de techniciens des arts dramatiques (théâtre et danse) ; d’autre part, la naissance du Théâtre de la colline (1968) créé par le jeune recteur de l’Université, Mgr Tshibangu. Avec sa représentation de la « Tragédie du roi Christophe » d’A. Césaire, ce théâtre fit une entrée remarquée dans le monde des arts ; enfin, le passage à Kinshasa de la tournée du Théâtre des petits nègres, mené par celui qui n’est encore que le Frère Norbert Mikanza, tout cela annonçait un courant théâtral nouveau, plus élitiste et donc plus complémentaire des saynètes et sketches radiophoniques dans lesquels excellaient et continueraient à exceller un certain nombre de talents confirmés (Maboké, Mufwankolo, etc.). Mikanza, devenu fonctionnaire du Ministère de la Culture à peine créé, marqua la fondation du Théâtre National par une création inédite : Pas de feu pour les antilopes (Kinshasa, 1970). Cette pièce annonça à la fois le début de l’institution théâtrale nationale et celui de la carrière de dramaturge et de metteur en scène de N. Mikanza Mobyem. Plusieurs oeuvres remarquables, inscrites dans la mémoire collective du Zaïrois, jalonnent cet itinéraire : Mundele-Ndombe (Blanc à peau noire), Allô ! Mangembo Keba ! (1972), La bataille de Kamanyola (1975), Procès à Makala (1977) et plusieurs autres, créées uniquement sous forme de spectacles (Monnaie d’échange, Moni-Mambu notamment). [59]
A la même époque, le public découvrait un autre dramaturge, le Jésuite Charles Ngenzhi (Lonta Mwene Malamba). La fille du forgeron (Kinshasa 1969), un drame de conscience au confluent de la tradition et de la modernité, fut choisi pour être présenté lors du deuxième Festival des arts négro-africains (Lagos 1977). Dans la même veine, Ngenzhi produira deux autres pièces, dont les personnages principaux sont féminins : La tentation de Sœur Hélène (Kinshasa, 1976) et Njinji ou une fille de Ngola sauvera le peuple Ngola (Kinshasa 1966).
A côté de ces oeuvres majeures, on dénombre bien d’autres créateurs. Ainsi, la poésie populaire trouva son défenseur dans la poésie « concrétiste » (opposée à celle dite « hermétique ») de Tito Yisuku. Parmi ses oeuvres, citons Cœur enflammé (1973), Tams-Tams crépitants (Kinshasa 1974), Excuse sublime (Kinshasa 1977). Dans la même veine, il faudrait mentionner aussi les écrits d’Elebe Lisembe : du théâtre historique (Simon Kimbangu ou le messie noir, Oswald 1972) mais surtout de la poésie (Uhuru, Mélodie Africaine, Paris, 1970 ; Orphée rebelle, Paris, 1972 ; Souvenirs d’enfance, Paris, 1975 ; La Joconde d’ébène, Paris, 1977).
La troisième période a ceci de particulier qu’elle est le cadre de l’éclosion d’une littérature diversifiée quant à la thématique et aux auteurs, localisés aussi bien au Zaïre qu’à l’étranger. La thématique reste liée au quotidien du Zaïre, du moins aux événements qui ont marqué l’itinéraire des auteurs. Les auteurs les plus célèbres sont pour la plupart en Europe : Kama Kamanda, si peu connu au Congo malgré ses oeuvres remarquables : Contes des veillées africaines (Lutry 1985), Chants de brumes (Liège 1986), Les résignations (Liège 1986), Eclipse d’étoiles (Paris, 1987) et ses nombreux prix littéraires [60] ; mais surtout P. Ngandu-Nkashama, dramaturge, romancier et critique littéraire. C’est sans conteste l’auteur le plus fécond de cette génération : La délivrance d’Ilunga (l’Harmattan 1977), Le Fils de la tribu (NEA, 1983), La malédiction (Silex 1983), Le pacte de sang (Harmattan 1984), Les étoiles écrasées (Publi-Sud, 1988). [61] La mort faite homme (l’Harmattan, 1986) est le récit (romancé) des arrestations des étudiants qui se produisirent au Zaïre lors des événements malheureux que nous avons évoqués plus haut. Djungu Simba est connu pour son roman Cité 15 (l’Harmattan 1988), mais il fut beaucoup plus productif dans le domaine des contes : Autour du jeu (1984), La petite histoire de Nené (1985), Les belles aux dents taillées (1988), Les aventures de Kandolo (1987) furent tous publiés à Kinshasa.
Les écrivains de l’arrière-pays ont manifesté, au cours de cette période, le même engouement pour la création littéraire. Le cas du Katanga est révélateur à cet égard. Tshisungu wa Tshisungu s’exprime aussi bien en poésie (Sémences, Lubumbashi, 1982) qu’en prose (Le croissant des larmes, l’Harmattan, 1989). Tshibanda Wamuela s’est lancé dès le départ dans le récit, qu’il maîtrise avec doigté. Il a déjà écrit : De Kolwezi à Kasaji (1980), Je ne suis pas un sorcier (1981), Londala ou le cercueil volant (1984) tous publiés à Kinshasa. Plus récemment, il publiait Femmes libres, femmes enchaînées (1985), Au clair de la lune (1986), Train de malheurs (1990).
L’inventaire est loin d’être exhaustif, tant le Zaïre est riche en écrivains. Ceux-ci se regroupent en « salons littéraires », généralement affiliés à « l’Union des écrivains du Zaïre » (UEZA). Mais la littérature comme mode d’expression a ses limites, en particulier elle est peu accessible au peuple congolais. Non seulement celui-ci est peu porté à la lecture, car à peine sorti de la civilisation orale ; mais de plus les difficultés de diffusion du livre, alliées à l’obstacle que constitue le recours à la langue française, limitent à priori le niveau d’audience du message écrit.
2.3.3 Musique et arts du spectacle
Le genre le plus prisé s’avère provenir des arts du spectacle, à savoir la musique et la danse, le théâtre et le ballet. Ces deux premières expressions restent les formes les plus utilisées, encouragées en cela tant par les supports disponibles (radio, télévision, cabarets) que par les opportunités de la vie (fêtes familiales et nationales). Cette évolution se fit sur deux registres différents. La musique et la danse traditionnelles – qu’on se plaît à qualifier ici de folkloriques – toujours vivantes dans les campagnes, firent une entrée remarquée dans les centres urbains, en tant qu’ex- pressions de la diversité des identités ethniques. Cet éveil de la conscience ethnique en milieu urbain est attesté par l’existence d’un millier d’orchestres de musique traditionnelle dans la seule ville de Kinshasa, qui ont pour mission d’occuper les loisirs des communautés ethniques et d’assurer l’animation des cérémonies qu’elles pourraient organiser. [62] La musique et la danse dites modernes, créations spécifiquement urbaines, poursuivirent leur expansion grâce aux mêmes supports et aux sollicitations d’un public toujours friand de créations nouvelles. Trois variables caractérisent cette nouvelle époque : l’apparition d’un nouveau réseau d’orchestres, l’éclosion de nouvelles danses et la maturation de la chanson féminine.
En matière d’orchestres, le Congo indépendant hérita, nous l’avons expliqué, de deux grands orchestres – OK JAZZ et AFRICAN JAZZ – qui firent à la fois office d’écoles de danse et de musique, et même de présence politique. [63] Chaque formation en fonda d’autres, qui continuèrent à égrener des airs semblables. A la fin des années 60, apparut un orchestre des jeunes qui introduisit aussitôt une chorégraphie plus entraînante et qui fit moins usage des bois et des cuivres dans l’orchestration, pour laisser la place aux battements des mains et au martèlement des pieds. Ainsi, Zaïko Langa-Langa fut la figure de proue d’un troisième type d’orchestre au Congo ; il fonda l’orchestre Grand Zaïko de Manuaku Waku. Il y eut ensuite Viva la Musica de Papa Wemba puis Langa Langa Stars d’Evoloko, Choc Stars de Ben Nyamabo et Anti-Choc de Bozi Boziana. Cela continua avec Victoria Eleison (Emeneya Jokester) et Quartier Latin (Koffi Olomide). Zaïko Langa Langa, tenant toujours l’affiche aux côtés de ses créations, se subdivisa à son tour en 1988 en Zaïko Langa Langa – Familia dei et Zaïko Langa Langa – Nkolo Mboka. Entretemps, une nouvelle « famille » musicale avait pris forme avec la naissance, dans des milieux scolaires de Kinshasa, de la formation Wenge Musica de J.B. Mpiana. Cet ensemble d’orchestres s’ajouta ainsi à ceux qui étaient issus des lignées de OK JAZZ et de l’AFRICAN JAZZ. Le nombre de chansons sur le marché fut décuplé, de même que les nouvelles danses : Cavacha, Griffe Dindon, Caneton, Silauka, etc. (tableau 20).
C’est dans ce cadre que la chanson féminine acheva de gagner ses lettres de noblesse. Précisons d’abord que le fait qu’une femme apparaisse dans la chanson moderne zaïroise n’était pas nouveau pour l’époque. Depuis la fin de la période coloniale, quelques voix féminines s’étaient fait entendre, comme celle de Lucie Eyenga. Mais le phénomène était plutôt rare ; de même pendant les années 60, malgré l’existence d’Etisomba. C’est au sein même des orchestres qu’on découvrit celles qui allaient être les grandes chanteuses du Congo contemporain : Abêti Masikini d’abord, Mpongo Loue ensuite. Elles étaient danseuses au départ. Toutes deux donnèrent leurs premiers grands spectacles lors du deuxième festival panafricain des Arts et Culture à Lagos (1977). Ensuite une danseuse de Mpongo Love, Tshala Mwana, rejoignit le groupe, en se spécialisant dans une danse originaire du Kasaï, sa région natale (le mutwashi). Vonga Age, handicapée comme Mpongo Love et encouragée par son exemple, se lança elle aussi dans la chanson mais connut un succès éphémère. Mbilia Bel, formée par Tabu Ley, avant Faga Tess, devint à partir de 1985 la figure de proue de cette chanson féminine zaïroise en plein expansion.
Mais la grande particularité de la culture musicale de la nouvelle société zaïroise fut à coup sûr la naissance de ce qu’il est convenu d’appeler l’animation, une création inédite. Il s’agissait d’un ballet à grand spectacle regroupant garçons et filles en uniforme, chantant, dansant et scandant des slogans politiques. Les ballets, dont l’objectif politique était de créer une opinion patriotique ou du moins favorable au régime, étaient présentés lors des grands rendez-vous politiques : arrivée ou départ du chef d’État ou de ses hôtes, fêtes politiques, ouverture et clôture de grandes manifestations, etc. L’organisation de ces programmes pseudo-culturels était prise en charge au plus haut niveau du MPR, par une structure appropriée, à savoir la MOPAP (Mobilisation, Propagande et Animation Politique). Chaque échelon administratif et chaque institution publique disposait ainsi de son « groupe d’animation ». [64] Le phénomène était spontané et adapté aux circonstances entre 1967 et 1969, inspiré par des expériences chinoises et coréennes de mobilisation des foules, et agrémenté de danses et airs musicaux d’origine locale. Il fut institutionnalisé à partir de 1970, soit trois ans après la création du MPR. Le point culminant de cette activité fut marqué en 1973 par un « festival national d’animation », mettant en compétition les ballets de différentes régions, chacune ayant son répertoire de chansons, de danses et de slogans. Les chansons « révolutionnaires » avaient des visées politiques bien précises et elles étaient souvent plus explicites que les discours et déclarations officiels, tenus de se cantonner dans des euphémismes pour éviter de sortir du contexte protocolaire. Une des chansons de la première décennie de la Deuxième République était intitulée « Cent ans à Mobutu ».
Nous avons accordé cinq ans à Mobutu
Nous avons ajouté sept ans à Mobutu
Finalement nous disons cent ans à Mobutu
Mobutu eee Mobutu, nous te souhaitons cent ans
Ils peuvent parler, nous te souhaitons cent ans
Ils peuvent tout faire, nous te souhaitons cent ans
A bas les crocos, nous te souhaitons cent ans
A bas les méchants, nous te souhaitons cent ans
A bas les vendus, nous te souhaitons cent ans.
Les slogans avaient tous le même sens du réalisme ; ils constituaient bien souvent une reprise en choeur d’une citation du président et vulgarisaient avec succès les enseignements du Parti et ceux de son président. Le slogan ci-dessous, extrait du répertoire du groupe d’animation du Shaba, a synthétisé ce que le MPR entendait instaurer comme valeurs cardinales ; amour du Guide, unité nationale dans la diversité, libération totale de l’homme zaïrois ; devoir de vigilance.
Responsable : Nous sommes zaïrois !
Animateurs : Zaïrois dans l’âme
Zaïrois dans la conscience
Zaïrois en langage.
(…)
Nous chanterons et danserons
Pour honorer notre Guide
Et lui exprimer notre amour.
R. L’Authenticité!
A. L’Authenticité est notre philosophie politique
Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons.
R. Notre objectif !
A. L’unité dans la diversité
Région oui, régionalisme non
Tribu oui, tribalisme non
Clan oui, clanisme non
R. Indépendance nominale
A. Non
R. Indépendance totale
A. Oui
R. Aliénation mentale
A. Fini
R. Notre souci prioritaire
A. Le recouvrement de notre personnalité
R. Mobutu Sese Seko
A. Notre seul Guide
R. Mobutu Sese Seko
A. Notre seul espoir
R. Mobutu Sese Seko
A. Notre Salut
R. Pour la vigilance
A. Toujours prêt
R. Pour la révolution
A. Nous mourrons.
Le théâtre populaire connut un itinéraire tout aussi retentissant. Déjà avant 1967, les sketches radiophoniques avaient leurs grands maîtres déjà cités : Mongita, Mufwankolo, Maboke, Mulangi ya Pembe. Ils allaient être plus nombreux encore et créer une véritable école grâce à la magie de la télévision. Les saynètes les plus élaborées sont celles de Tshitenge Sana, fournissant de la matière aux grands talents du Théâtre de chez nous (théâtre Salongo) comme Ebale Mondial, Kwedy, Mupepe, Bomengo et Masumu.
Le théâtre classique connut lui aussi son envol et fit connaître une poignée de grands dramaturges déjà cités : Mikanza, Mutombo Bwitshi, Mwamb’a Musas Mangol, Buabua wa Kayembe, Yoka Lye Mudaba. L’originalité à ce moment résidait dans le fait que ce théâtre était bien souvent une oeuvre commune du metteur en scène et des acteurs. Le texte était réduit au minimum au profit des gestes, de la musique et de la danse. On aboutissait ainsi à un théâtre proche du ballet. Les créations les plus importantes et les plus significatives ne dissimulaient pas leur dépendance thématique à l’égard des courants idéologiques du moment qui prônaient l’exaltation de la personnalité du Chef. L’opportunisme politique imposait une sorte de surenchère. Ainsi donc, qu’il s’agisse de Lianja, de Muzang – épopée empruntée au patrimoine culturel Kanyok – ou encore de la Bataille de Kamanyola, on retrouvait le même langage si bien rendu par le Théâtre national, créateur à son niveau de deux autres spectacles bien significatifs : Et la lumière vint… et Le Zaïre en trois étapes. Mais la décennie 80 amena un changement de ton et afficha des titres de plus en plus critiques tels Voyage au bout de la misère (Mambambu I.M.), Scandale (Tambwe K. et Mutombo B.), Les animaux malades de la faim (Yoka lye Mudaba) puis Notre sang (Mikanza Mobiem) et éron noir (Wembo Ossako). La dénonciation des injustices conduisit à la contestation politique.
Quant au septième art, il disposait lui aussi d’une certaine antériorité avec le cinéma colonial, fort de ses maisons de production : Lulua-Film (Kasaï), Africa-Film (Kivu), Murumbu-Film (Katanga), Edisco-Film (Léopoldville). Après l’indépendance, la reprise en main de ce secteur de production culturelle ne put démarrer qu’en 1966, quand l’Extension Universitaire, dispensait un enseignement sur le tas. On réalisa alors un court-métrage intitulé La Kinoise. Peu après, en 1969,
Luntadila réalisa un autre court-métrage, Le petit cireur. La création, en 1968, de Télé-Star (qui deviendra plus tard la RENAPEC – Régie nationale de production éducative et culturelle) fut une structure qui permit l’éclosion de cet art. Ainsi, en 1972, le jeune cinéaste Kwamy Mambu Nzinga, fraîchement diplômé en Belgique, obtint, pour son film Moleska , le prix de l’authenticité africaine au festival Panafricain de Ouagadougou [65]. En 1978, tous les jeunes cinéastes zaïrois décidèrent de s’organiser en association pour promouvoir la culture par le cinéma. Mais cet élan fut freiné par les effets de la crise économique.
2.3.4 Les Beaux-arts
Les arts plastiques, on l’a vu, disposaient d’assises solides dès la fin de la période coloniale. Ils connurent une évolution normale, malgré les turbulences de la décolonisation. Au cours de cette période, la céramique, restée jusque-là en retrait par rapport à la peinture et à la sculpture, acquit le plus grand renom. Les céramistes zaïrois. Bamba, Manteto et Lenda obtinrent, en 1965, des diplômes d’honneur lors de l’exposition internationale de la céramique à Genève. Les Beaux-arts zaïrois, dans ces trois disciplines – sculpture, peinture, céramique – purent ainsi participer activement au Premier festival mondial des Arts Nègres (Dakar 1966).
L’ère mobutienne apporta une nouvelle impulsion aux beaux-arts, d’abord grâce au climat qu’elle instaura, qui fut favorable à la production artistique, ensuite et surtout par le mécénat présidentiel, qui rendit possible des réalisations importantes qu’on retrouva d’ailleurs sur des sites officiels : paillote présidentielle, Cité de l’OUA, Bureau du président-fondateur, Palais de marbre, Résidence présidentielle (Ngaliema), Ministère des Affaires étrangères (Gombe), Foire internationale de Kinshasa (Lemba), Aéroport international de N’djili, Kinkole et Cité de la N’sele, Motel Nzekele et Résidence présidentielle (Gbadolite). La décoration des églises fut également un prétexte à l’émergence d’un art religieux zaïrois qui se voulait spécifique. [66] La production plastique, sur le plan national, dépendait toujours de deux grands foyers : Kinshasa et Lubumbashi. Deux « écoles » artistiques particulières issues de ces deux « académies » des beaux-Arts.
Kinshasa continua à s’affirmer comme l’institution de formation la plus importante du pays. En 1968, un « Institut supérieur des Arts plastiques » (ISAP) fut créé au sein de l’académie ; lors de la création de l’Université nationale du Zaïre, cet établissement y fut intégré, sous l’appellation de « Académie des Beaux-Arts » (1972). La formation artistique était élevée au plus haut niveau. Quelles furent les grandes tendances de cet art d’académie ? En s’efforçant de ramener cette diversité à quelques constantes, il est possible de retenir trois innovations particulières qui furent le fait successivement, des artistes du « groupe d’avant-garde », des artistes « sabléistes » et de ceux de la « nouvelle génération ».
Le groupe avant-gardiste est né au lendemain du troisième congrès extraordinaire de l’AICA (Association internationale des critiques d’art) à Kinshasa (septembre 1973), à la suite d’une critique impitoyable, selon laquelle l’art zaïrois moderne était « en retard de cinquante ans » par rapport à celui de l’Europe. C’est ainsi qu’une dizaine de plasticiens zaïrois décidèrent de relever ce défi ; il s’agit des sculpteurs Liyolo et Tamba, des peintres Mavinga, Ndamvu, Lema, Kamba, Mayemba et Nkutu a Zowa, et des céramistes Makengo et Bamba. Dans leur manifeste rendu au public en février 1975, les « avant-gardistes » faisaient la profession de foi suivante. « Nous artistes zaïrois plasticiens modernes, ne pouvons nullement négliger les valeurs inestimables de notre patrimoine ancestral qui doit nous servir non seulement de soubassement solide mais aussi de source inspiratrice féconde. (…) Nous voudrions que notre art recouvre totalement son autonomie retrouvée et sa personnalité intrinsèque grâce au dépouillement, fût-il brutal, de toutes les formules stéréotypées d’origine lointaine. Nous pensons… que la philosophie de l’authenticité sera le phare qui éclaire les artistes, partant l’adjuvant qui les encouragera dans la mission combien exaltante qui est la leur, c’est-à-dire : « animer les coeurs et les esprits des idéaux de l’humanisme zaïrois, grâce à leur génie créateur » (Bamba N. et Musangi N. 1987 :20- 21). La proclamation est nettement révélatrice de cette volonté de réenfantement de la société chère au régime. Manifestement, elle pouvait intervenir dans l’effort de recherche esthétique.
Liyolo Limbe Mpuanga, fils d’un ivoirien de Bolobo, formé à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, réalisa par son oeuvre une synthèse harmonieuse de la stylisation occidentale et de l’inspiration zaïroise. Il choisit de célébrer essentiellement la femme, la maternité, le couple. Parmi ses plus belles réalisations, citons L’œil de Dieu, L’Entente, La Penseuse, Symphonie, L’Envol, La Nymphe. Ses dernières créations évoquent le contexte « riverain » de son enfance : Mirage du fleuve, Fille Lokele. Liyolo fréquente également les sites officiels avec Le Militant (N’sele) Le Bouclier de la Révolution (mont Ngaliema) et Mains d’artiste au quartier populaire de Matonge.
Tomba Ndenabe, issu de la colonie scolaire de Borna, mania le bois et non le métal battu comme le précédent. Présent dans plusieurs places publiques grâce à ses œuvres monumentales (Place du Zaïre à Kinkole, Cité du Parti à N’sele. Immeuble des Affaires étrangères), il s’est lui aussi exprimé en produisant des sculptures de « Mère et enfant ». C’est un artiste d’élite, passionné par la recherche de formes inédites, à en devenir parfois hermétique et inaccessible au grand public. Les artistes-sculpteurs s’illustrèrent aussi par la construction de nouveaux monuments de Kinshasa, après la destruction de ceux d’origine coloniale. Mention spéciale doit être faite ici aux oeuvres de Lufwa Mawidi (le « Batteur de Tam-Tam » à l’entrée de la FIKIN, les « Léopards » à l’entrée principale des jardins présidentiels au mont Ngaliema), de Liyolo (le « Bouclier de la Révolution » au mont Ngaliem, le « Militant » à Nsele, le « Monument des Artistes » à la Place Victoire) et du jeune Meko Disengomoka (monument « Paix et Liberté » dédié à Nelson Mandela, monument de la Réconciliation devant le Palais du Peuple).
Les peintres se firent également remarquer, qu’il s’agisse de Mavinga et de son disciple Mayemba ou de Ndamuu, de Lema Kusa et de Nkutu a Zowa. Depuis leur Bas-Zaïre natal, ils n’ont pas eu de peine à rejoindre Kinshasa pour bénéficier d’une formation à l’Académie des Beaux-Arts. Leurs oeuvres ornent les murs des grandes résidences du pays.
L’innovation «sabléiste» était d’ordre technique. Ce nouveau langage, né en 1977, est le fait d’un noyau d’étudiants de l’Académie manquant de matériaux nécessaires pour peindre. Pour compenser cette carence, ils ont utilisé du sable coloré qu’ils ont collé sur la toile. Le résultat obtenu aboutit à la création d’un nouveau mode de peinture, dominant dans l’œuvre de quelques grands artistes : Mukalenge. Lenda, Bavedila, Kubongo et Mukalayi.
Une autre innovation est née à l’initiative du peintre Kamba Luesa ; elle constitue un effort de dépassement de la part des jeunes artistes du groupe « d’avant-garde ». Dépassement sur le plan esthétique mais aussi sur le plan social pour cette génération nouvelle, plus jeune que la précédente, qui revendiquait son droit de cité. Le seul résultat tangible de ce mouvement demeure, du moins jusqu’ici, l’oeuvre de Kamba Luesa lui-même, qui s’est distingué par une production précoce. Originaire du Kasaï, il a passé son enfance à Lubumbashi, avant de découvrir Kinshasa où il fit toutes ses études à l’Académie des Beaux-Arts. Son oeuvre est au confluent des tendances rupestres et surréalistes, appliquées à une matière première d’essence locale et d’une inspiration locale.
Tous ces courants modernes, loin de supplanter les « grands maîtres » d’hier, vinrent plutôt enrichir, à leurs côtés, la production diversifiée de l’art congolais moderne. En effet, certains grands plasticiens déjà célèbres lors de la période coloniale, par exemple Nkusu Felelo, Lufwa Mawidi et Konde Bila, continuèrent à briller dans le firmament de l’art zaïrois, soutenus plus que jamais dans leur inspiration par le retour à l’authenticité prôné par le régime.
« L’école de Lubumbashi », connut un engouement similaire. Les PiliPili et Mwenze continuèrent à tenir l’affiche, avec nombre d’autres d’artistes travaillant le cuivre et la malachite. En peinture, il faut retenir un grand nom, celui de Chenge Baruti. Originaire de Kalemie, il commença ses études à Lubumbashi avant de venir s’initier à l’art à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa où l’avait précédé son frère. Avec ce dernier, il s’installa à Lubumbashi, où ils firent bâtir un complexe comprenant des ateliers de peinture, de sculpture et de céramique. Ce grand artiste est passé maître dans l’art de produire des scènes grandioses, envoûtantes, représentant entre autres le Rassemblement des guerriers, les Danseurs, la Chasse. A lui seul, il constitue une « école » car plusieurs de ses disciples – Sadi Matamba, Safi et Shabani – sont déjà des artistes de renom.
L’art zaïrois se distingua également pour son art populaire et sa peinture naïve. La période était favorable à l’éclosion de cette expression artistique qui avait résolument choisi de rendre compte de la vie du peuple : scènes de danse, de chasse, de pêche ; maximes et proverbes visualisés ; portraits en tous genres. Un thème était privilégié : la vie politique d’hier comme d’aujourd’hui. Deux grands noms émergèrent : Moke et Chéri Samba. Moke, venant de Bandundu, est arrivé à Kinshasa en 1960 à l’âge de dix ans. Condamné à vivre dans la misère et le vagabondage, il eut une inspiration soudaine en visitant le marché touristique de la « place Braconnier », se souvenant qu’il était bon dessinateur quand il fréquentait encore l’école. Sa carrière avait commencé. Il est devenu l’un des peintres naïfs les plus célèbres et les plus productifs. Vivant au cœur même du peuple, il n’eut aucune peine à restituer des scènes de la vie quotidienne, peignant avec humour infidélité, disputes, réjouissances. Samba wa Mbimba Nzinga (alias Chéri Samba) a suivi un itinéraire assez semblable. Rescapé d’une enfance misérable dans le Bas-Congo, il ne put terminer ses études secondaires et vint à Kinshasa où il fut attiré par un étalage de peinture situé avenue du 24 novembre. Engagé comme apprenti artiste, il changea d’employeur à deux reprises avant d’ouvrir son propre atelier en octobre 1975, avenue Kasa-Vubu, dans la Zone de Ngiri-Ngiri. C’était un artiste confirmé. On l’invita au Congo, au Gabon, en RFA, en France et dans d’autres pays encore. L’originalité de cet artiste résidait dans sa peinture des scènes de la vie, éloquentes et expressives dont le message était renforcé par des textes. Ses oeuvres les plus caractéristiques sont : Femme infidèle, Amoureux châtié, Séduction, Affaire mbanda, Kin Kiese, Les Riches et les pauvres…
Telle est l’image de la production artistique zaïroise, dont les meilleures pièces sont vendues à l’étranger où elles sont reconnues et appréciées. En fait, les rencontres internationales firent office de tribunes publicitaires pour l’art congolais. En effet, plusieurs rencontres de ce genre contribuèrent à le faire rayonner, depuis le premier festival mondial des Arts Nègres (Dakar 1966) jusqu’à la semaine culturelle zaïroise (Kigali 1988), en passant par les expositions de Montréal (1967), de Bâle (1968), de Bruxelles (1970), de Lausanne (1974), de Paris puis celles de Lagos (1977), de Dakar, et celle de Rio de Janeiro lors des semaines culturelles zaïroises (1987).
2.3.5 Les institutions culturelles
Pendant la première décennie de l’indépendance, le Congo ne perçut le fait culturel national qu’au travers de l’éducation et de l’instruction. C’est ainsi que ces deux réalités ne furent confiées qu’à un seul ministère « de l’Education nationale et des beaux-arts » complété, il est vrai, par le Ministère de l’Information qui gérait une certaine culture audiovisuelle.
L’enseignement primaire et secondaire a vécu l’indépendance par l’application d’une réforme, qui intervint en juillet 1961, déterminant la structure générale de cette filière : six ans d’études primaires, un cycle d’orientation commun aux deux premières années de l’enseignement secondaire et enfin quatre années de spécialisation à orientation commerciale, littéraire, physique-mathématique, bio-chimique, technique et pédagogique générale. Des « Instituts Supérieurs Pédagogiques » (ISP) furent créés à partir d’une institution pilote (IPN à Binza) dans toutes les régions pour soutenir cette réforme. [67] Ce programme était valable tant pour le réseau « officiel » de l’enseignement que pour les réseaux confessionnels (catholique, protestant, kimbanguiste). Le clivage entre réseaux officiel et privé fut aboli en 1974 quand l’État procéda à la nationalisation de l’enseignement par la suppression des réseaux confessionnels, l’abolition des cours de religion et le retrait des facultés de théologie des universités.
La nationalisation de l’enseignement universitaire était intervenue trois ans plus tôt. Le prétexte était tout trouvé, avec le développement de la contestation estudiantine. Les troubles à l’Université Lovanium le 4 juin 1969 provoquèrent la mort de quelques étudiants. Les manifestations qui se déroulèrent pour l’anniversaire de cet incident entraînèrent l’enrôlement dans l’armée de tous les étudiants de Lovanium et de quelques-uns de l’UOC. Les trois universités furent fermées. Une commission du Bureau politique fut constituée le 6 juin pour préparer la réforme de l’enseignement supérieur. Ses conclusions établissaient les grandes étapes de la nationalisation qui allait être imposée au pays. Au mois de juillet, les professeurs d’université nationaux furent réunis en congrès à N’sele pour statuer sur la finalité, les méthodes et les programmes de cet enseignement, qui pourraient faire transparaître la volonté politique du « Recours à l’Authenticité ». Le résultat de cette double consultation ne se fit pas attendre : l’université nouvelle fut d’abord créée sous l’appellation d’« Université nationale du Congo » (6 août 1971), avant de devenir en octobre de la même année l’« Université nationale du Zaïre » (Hull S. Galen 1974).
La nouvelle organisation voulait se présenter comme une superstructure regroupant, sous une même autorité, les différentes universités et instituts préexistants. Elle compta donc trois campus universitaires (Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi), et un grand nombre d’instituts supérieurs : les instituts pédagogiques déjà évoqués mais aussi les instituts techniques : l’IBTP (Institut du Bâtiment et des Travaux publics) en place depuis 1962, PISTA (Institut supérieur des Techniques appliquées), l’ISTI (Institut supérieur des Sciences et Techniques de l’Information), l’ISTM (Institut Supérieur des Techniques médicales) ainsi que l’ISC (Institut Supérieur du Commerce). Furent également intégrés dans le réseau des instituts techniques : les Instituts supérieurs d’Arts (l’Académie des Beaux-Arts, l’Institut Supérieur des Arts et Métiers, l’Institut national des Arts) ainsi que ceux du développement (ISDR, Institut Supérieur de Développement Rural ; ISEA, Institut Supérieur d’Etudes Agronomiques). [68]
La politique de l’authenticité eut un effet bénéfique sur l’adaptation des programmes d’enseignement et la formation du personnel enseignant local. Entre 1967 et 1971, des assistants furent envoyés en Europe et en Amérique du Nord pour rédiger des thèses de doctorat. Localement, un Office national de la recherche scientifique (ONRD) fut créé le 10 août 1967 pour promouvoir la recherche scientifique nationale. [69] Le déroulement en 1978 de la 4e session du Congrès des africanistes (devenu Congrès international des Etudes africaines) sur le thème significatif de « La dépendance de l’Afrique et les moyens d’y remédier » marqua le point culminant de cette entreprise.
Tableau 26 — Evolution des diplômés au Congo (1967-1985)
| ANNEES | DIPLOMES D’ETAT |
DIPLOMES UNIVERSITES |
DIPLOMES IST |
DIPLOMES ISP |
Total des Diplômés sup. |
| 1967-68 | 2.272 | 314 | 7 | 142 | 463 |
| 1968-69 | 3.300 | 383 | 23 | 183 | 589 |
| 1969-70 | 3.722 | 523 | 22 | 288 | 833 |
| 1970-71 | 5.151 | 690 | 28 | 393 | 1.111 |
| 1971-72 | 7.025 | 915 | 209 | 421 | 1.545 |
| 1972-73 | 7.974 | 1.161 | 329 | 620 | 2.110 |
| 1973-74 | 7.747 | 1.166 | 423 | 698 | 2.287 |
| 1974-75 | 8.594 | 1.191 | 622 | 966 | 2.779 |
| 1975-76 | 12.263 | 1.306 | 667 | 982 | 2.965 |
| 1976-77 | 18.581 | 2.044 | 471 | 1.309 | 3.820 |
| 1977-78 | 17.064 | 897 | 457 | 2.275 | 3.629 |
| 1978-79 | 7.235 | 1.547 | 289 | 1.358 | 3.194 |
| 1979-80 | 17.736 | — | 304 | 969 | 1.273 |
| 1980-81 | 20.701 | — | 826 | 1.030 | 1.856 |
| 1981-82 | 24.102 | 1.226 | 1.377 | 994 | 3.597 |
| 1982-83 | 20.530 | 1.116 | 1.950 | 1.462 | 4.522 |
| 1983-84 | 26.026 | 1.057 | 2.273 | 1.386 | 4.716 |
| 1984-85 | 34.650 | 920 | 2.283 | 1.454 | 4.657 |
| 1985-86 | 38.137 | 1.067 | 1.736 | 1.160 | 3.263 |
| Total général | 282.889 | 17.841 | 14.296 | 18.090 | 50.227 |
Sources : Cf. Conseils d’Administration des universités, des Instituts supérieurs techniques (IST) et des Instituts supérieurs pédagogiques (ISP) ; Panorama… pp. 459,461.
Dans le même esprit, on organisa quelques années plus tard, en 1986, le Symposium international sur l’Afrique et son avenir, en marge des commémorations du centenaire de la Conférence de Berlin.
Le déploiement des institutions spécifiquement culturelles se fit entre 1967 et 1978, après l’instauration en septembre 1966 d’un ministère autonome de la Culture et des Arts. Les premières organisations culturelles virent le jour rapidement. La création du Conservatoire national (1967) fut suivie en 1969 par celles d’un organisme de protection des oeuvres de l’esprit, la « Société nationale des Editeurs, Compositeurs et Auteurs » (SONECA) et d’une maison d’édition littéraire, les Editions Lokole dont le pendant scientifique était les Presses universitaires du Zaïre, relevant du rectorat de l’UNAZA. Le support des arts plastiques fut organisé en 1970 par la création d’un Institut des Musées nationaux du Zaïre (IMNZ). On effectua une collecte systématique des œuvres d’art dans les villages et des mécanismes institutionnels furent mis en place pour réglementer l’exportation des œuvres d’art. Le Président alla plus loin. Il profita de la tribune de l’ONU de 1973 pour demander aux puissances riches détentrices d’œuvres d’art originaires des pays pauvres, de leur en restituer une partie, afin que ces pays puissent montrer des exemples de leurs histoires nationales aux nouvelles générations. [70]
Au chapitre de la culture, mentionnons les dispositions prises par la nouvelle société mobutienne en faveur de la femme. Elle avait déjà droit à des égards ; la société ancienne ne l’avait pas totalement méconnue, comme en attestent l’importance qui fut toujours accordée à la maternité et le rôle politique que la femme a eu à jouer dans les sociétés matrilinéaires du sud. Mais la colonisation, en privilégiant l’instruction des hommes, avait accentué le clivage homme-femme à un point tel qu’à l’époque postcoloniale, il fallait envisager la nécessité d’une libération de la femme. Mobutu eut raison d’en faire son cheval de bataille. L’intégration de la femme dans l’armée, en particulier comme parachutiste, eut valeur de symbole. La reconnaissance du droit de vote féminin en 1967 et avant cela, l’avènement d’une première femme ministre en octobre 1966 finirent par convaincre les plus sceptiques. [71] L’année internationale de la femme (1975) au Zaïre prit la forme d’un vaste dialogue avec les différentes communautés féminines du pays ; elle donna une impulsion décisive à l’effort d’insertion des femmes dans les multiples circuits décisionnels du pays. En février 1980, on créa un Secrétariat permanent de la la Condition féminine au sein du Bureau politique. Cette structure, devenue par la suite le « Secrétariat exécutif à la Condition féminine » s’est muée en un ministère de la « Condition féminine et Famille ».
L’action féminine, sur le plan national, se concrétisa essentiellement dans des domaines tels que la promotion du commerce et celle des activités sociales. Ainsi les femmes commerçantes se multiplièrent et créèrent une puissante association féminine des femmes commerçantes, qui contrôlait surtout les différents réseaux du commerce informel. Dans le secteur social, la femme zaïroise se spécialisa, à l’initiative de Sophie Lihau-Kanza, dans le soutien des handicapés physiques et l’aide à l’enfance défavorisée, surtout féminine. Dès 1968, un Institut Marna Mobutu pour Aveugles (IMMA) fut créé, suivi en 1969 d’un Centre féminin Marna Mobutu Sese Seko (CFMMSS). Des personnalités féminines s’affirmèrent dans plusieurs domaines : des chanteuses de talent, mais aussi des politiciennes commis de l’État (Lihau- Kanza, Lessendjina Kiaba-Lema, Ekila Liyonda, Nlandu Kandi, Mayuma Kala, etc.), de grandes couturières et commerçantes, des gestionnaires de l’action sociale (Mpinga Mwakana, Nimy-Lenoir) sans oublier de grandes responsables de maisons religieuses. L’apothéose de l’exaltation de la Zaïroise se situe à coup sûr dans la béatification par le Pape Jean-Paul II, le 15 août 1985 à Kinshasa, de Anouarite Nengapeta, une jeune religieuse qui mourut le 1er décembre 1964 à Isiro pendant la révolution de l’Est, victime de son idéal de virginité. [72]
Cependant dans le Zaïre authentique, la situation était loin d’être idéale. L’ère mobutienne avait ses contradictions, quelle avait engendrées d’elle-même étique et que l’on baptiserait mal zaïrois. Son talon d’Achille était l’économie, secteur au sein duquel une crise sans précédent dans l’histoire nationale se déclara. Pour mieux en comprendre l’origine, commençons par situer les grandes lignes de la vie économique à la période mobutienne.
Avant 1965, la situation économique, comme on le sait, n’était guère brillante. Le pays bénéficiait cependant encore d’un tissu économique de bonne facture, inégalé en Afrique noire ; c’était le legs de la colonisation belge. [73] La deuxième République décida de réorganiser cet appareil économique hérité de l’État colonial afin de le rendre plus rentable et plus performant dans la mise en valeur des ressources du pays en vue de son développement. Elle s’efforça d’accroître les infrastructures du pays et de les diversifier. Ce sont précisément ces actions qui, mal conçues, conduisirent à la destruction du tissu économique préexistant. Cette initiative supprima les organisations en place, mais sans les remplacer dans des proportions requises par des institutions nouvelles. La conjoncture internationale, tantôt favorable, tantôt défavorable fit le reste, précipitant cette dégradation par les faux espoirs de croissance qu’elle apportait. Cet échec retentissant explique les comportements irrationnels qui allaient être déplorés puis dénoncés pendant plus d’une décennie.
Ce souci de « réinventer » l’économie zaïroise apparut lors de la renégociation du contentieux belgo-congolais, qui permit de prendre possession des participations ayant appartenu à l’État colonial. Cette politique fut soutenue par deux facteurs externes : la hausse du cours du cuivre, qui fut constante entre 1965-69, et 1 aide financière et technique des USA. Elle fut payante car elle se traduisit par un redressement économique spectaculaire. Sans prendre le temps de consolider ces acquis, le pays se hâtera de passer à la vitesse supérieure en décrétant les nationalisations et en se lançant dans la politique des grands travaux publics. La fragile prospérité serait ainsi étouffée dans l’œuf, contraignant l’ensemble du secteur économique à se contenter d’un profit peu élevé. Voici pour la synthèse de cette évolution très contrastée qui peut, d’une manière plus nuancée, être lue en plusieurs épisodes faits de hauts et de bas. La croissance du départ (1967-70) connut un ralentissement brusque (1971), et finit par devenir négative en moyenne (1975-1983) pour connaître ensuite, après les signes d’une certaine reprise (1983), un ralentissement presque général (1986 et suivantes). Ce dernier allait créer un climat propice à une mutation profonde.
Tableau 27 — Evolution de la production nationale (1959-1980) (en milliers de tonnes, sauf spécification particulière)
|
1959 |
1963 |
1967 |
1973 |
1975 |
1980 |
|
|
Riz |
165 |
60 |
60 |
120 |
135 |
230 |
|
Maïs |
333 |
232 |
260 |
150 |
126 |
500 |
|
Café |
61 |
66 |
60 |
67 |
59 |
79 |
|
Coton |
60 |
16 |
9 |
20 |
16 |
17 |
|
Caoutchouc |
40 |
38 |
30 |
45 |
29 |
20 |
|
Huile de palme (y compris palmiste) |
245 |
178 |
179 |
140 |
145 |
180 |
|
Cuivre |
282 |
271 |
321 |
489 |
496 |
426 |
|
Zinc concentré |
112 |
152 |
183 |
156 |
142 |
44 |
|
Cobalt |
8 |
8 |
10 |
15 |
14 |
15 |
|
Etain |
13 |
8 |
8 |
8 |
6 |
4 |
|
Manganèse |
193 |
135 |
114 |
334 |
340 |
0 |
|
Or (en kilos) |
10,087 |
6,674 |
4,758 |
4,157 |
3,120 |
2,270 (1979) |
|
Diamant (millions de carats) |
15 |
15 |
13 |
13 |
13 |
8 (1979) |
Source : Young C. et Turner T. 1985 :281
Pendant les premières années du régime, l’économie zaïroise avait fourni des preuves sérieuses d’une santé économique en train de se refaire : la réforme monétaire opérée en 1967 avec l’aide du FMI et la promulgation en juin 69 d’un nouveau code d’investissement de loin plus libéral que celui de 1965 conduisirent à un succès réel. Du reste on put mesurer l’impact positif de cette politique à l’importance de la vague d’investisseurs étrangers venus nombreux participer à la première Foire internationale de Kinshasa, tenue en 1969, aux dates fort significatives, du 30 juin au 21 juillet. [74] Avec l’amélioration de la production commença à se poser le problème de la recherche de partenaires commerciaux, de préférence diversifiés. Le projet de la création des Etats-Unis d’Afrique Centrale était une initiative dans ce sens. Hors du territoire africain, le président fit le tour, en mars et avril 1970, des partenaires potentiels, la France, les USA, le Japon et la Chine nationaliste. Réélu président de la République, il présenta dans son discours de prestation de serment du 5 décembre, un véritable programme d’action pour les dix années à venir (1970 à 1980). Les objectifs assignés à cette période (Objectifs 80) étaient les suivants : renforcer l’esprit civique, promouvoir la paix sociale pour un développement harmonieux restaurer et moderniser l’infrastructure et l’équipement de transport intensifier effort de production agricole, diversifier la production minière et réaliser une programmation rationnelle d’aménagement des villes et des régions.
L’option économique prônait également la réalisation d’un certain nombre de grands travaux notamment celle du vieux projet colonial de construction du barrage d’Inga, extension de Banana pour en faire un port de mer pour grands tonnages, la construction du chemin de fer Matadi-Banana et d’une aciérie à Maluku pour rentabiliser l’électricité à bon marché d’Inga. La construction d’une ligne à haute tension Inga-Shaba était également au programme, pour renforcer la production minière du Shaba. Les entreprises zaïro-japonaises ayant créé une Société de Développement Industriel et Minier du Zaïre (SODIMIZA) s’attelèrent à l’exploitation de la mine de cuivre de Musoshi. Une autre société, la S.M.T.F. (Société Minière de Tenke-Fungurume), fut fondée en 1970 à la suite de la découverte d’importantes couches de cuivre dans le secteur de ces villes. Par ces opérations, l’État manifestait son souci d’internationaliser le capital d’investissement, essentiellement belge au départ, de manière à s’assurer une marge d’autonomie à l’égard de l’ancien colonisateur. Ce faisant, il se préoccupait de renforcer sa propre position en tant que négociateur face à l’ensemble du capital étranger.
La deuxième période (1971-1974) fut marquée par la zaïrianisation. En effet, c’est dès le départ que la politique économique s’était caractérisée par une volonté de nationalisation de toute une série de secteurs de production importants. Dès 1966, il fut décidé que les entreprises opérant dans le pays devaient avoir leur siège au Zaïre même. La loi Bakajika (7 juin 1966) consista ni plus ni moins en une nationalisation pure et simple des droits fonciers et miniers. L’Union Minière, qui s’était sentie visée par ces dispositions, fut nationalisée (31 décembre 1966) (Gé- rard-Libois J. 1967 : 24 ; Chômé J. 1973-1979). On ressortit le dossier du contentieux belgo-congolais. En 1970, le bilan de cette quête d’indépendance s’exprimait en ces termes : « L’économie nationale, contrôlée à 80 % par I étranger au moment de l’indépendance l’était à présent à 75% et il valait mieux être pauvre dans la dignité plutôt que riche dans la servitude ». Cette tendance fut 1 objet de tout un débat politique qui se fit plus explicite et plus présent à partir de 1971, quand on accéda véritablement à l’ère de l’authenticité, et que ce mouvement, a partir de 1973, devint socialisant.
C’est le 30 novembre 1973, après le succès retentissant du discours du 4 octobre à New York où l’Authenticité acquit son « droit de cité », que la « zaïrianisation » fut décrétée : on proposait de faire quelques pas de plus dans la conquête de l’indépendance économique. [75] Les préambules de ce discours étaient clairs à ce propos.
Si nous faisons une analyse approfondie de la situation de notre pays, déclara le président, nous pouvons affirmer que pratiquement nous sommes un peuple libre, que culturellement nous le devenons mais qu’économiquement nous ne sommes pas encore totalement maîtres de notre économie (…) Il est inadmissible et même scandaleux que le Zaïre, à l’époque colonie de la Belgique, ait fait l’effort de guerre en faveur de sa métropole jusqu’à la date de l’indépendance en 1960 et que, de 1960 jusqu’à ce jour, il continue à faire un effort d’après-guerre toujours en faveur de son ancienne métropole [76].
Les mesures arrêtées étaient une manière de mettre fin à l’état d’injustice dénoncé, en tirant les conséquences de la « Loi Bakajika » qui estimait que la terre ne pouvait appartenir qu’aux seuls Zaïrois. Aussi les entreprises liées au domaine foncier (plantations, élevages, fermes, pêcheries, carrières) furent-elles nationalisées. Par extension, il fut décidé que l’ensemble du petit commerce ne pouvait plus être exploité désormais que par les seuls autochtones. Par cette politique, on espérait créer de toute pièce une bourgeoisie nationale, une « classe moyenne » selon les propres termes de Mobutu, reprenant en cela le discours colonial, censée entraîner l’ensemble du pays au développement (Braeckman C. 1991 : 157). En principe, cette première vague de nationalisation aurait été suivie d’autres si elle avait pu réussir. Mais hélas ! La zaïrianisation, saluée avec tant d’éloges par des pays socialistes, posait problème dans son application.
En effet, l’improvisation, l’absence d’une classe économique aguerrie à la gestion des affaires, l’impossibilité d’assurer un encadrement rationnel à l’exécution d’une telle mesure prise brusquement, transformèrent l’opération en un désordre généralisé. Tout au plus avait-elle offert aux classes dirigeantes l’opportunité de s’adonner à une consommation facile de fortunes qu’elles n’avaient pas amassées. [77] Certains anciens propriétaires expropriés choisirent de réagir à cette politique de confiscation des biens en adoptant la tactique de la « terre brûlée » Le désordre était à son comble, l’approvisionnement en denrées alimentaires devenait pénible. L’autorité gouvernementale se fit hésitante. Que faire pour corriger le tir ? On opta pour la fuite en avant, en procédant à l’étatisation des entreprises nationalisées. Cela s’appela la « radicalisation » de la révolution (30 décembre 1974). Suivant cette nouvelle disposition, l’État se faisait représenter à la tête de chaque entreprise par un « délégué général ». Il n’est pas impossible que cette mesure ait été dictée par le souci de décourager la concurrence de la bourgeoisie économique naissante. Mais cette politique ne fut guère plus heureuse. Les délégués généraux n’étaient pas meilleurs que les « acquéreurs ». Dans bien des cas, il s’agissait des mêmes personnages, peu désireux de travailler pour le bien de la nation, et s’empressant d’appliquer la devise du parti à l’envers, « se servir et non servir ». Un observateur averti fait, dans ses analyses, ce constat malheureux : « Nous ne connaissons pas de cas où un acquéreur ou un délégué général ait pu permettre à l’État d’indemniser, (comme c’était promis) l’ancien propriétaire. Au contraire, on peut citer plusieurs noms de firmes qui ne parvinrent même plus à payer leurs travailleurs, tant les caisses étaient abusivement vidées, si bien que l’État a dû intervenir par des subventions spéciales » (Kikassa M. : 276b : 250).
Il ne restait plus qu’à tirer courageusement un trait sur un tel échec en procédant à la « rétrocession », c’est-à-dire à la remise des entreprises à leurs anciens propriétaires, à qui l’on demanderait de s’associer désormais aux autochtones. Mais la crise n’était pas pour autant terminée, parce que les anciens propriétaires, devenus méfiants, n’importèrent plus qu’au compte-gouttes ; de plus, ils ne se gênèrent plus pour transférer à l’étranger leur moindre bénéfice dans la crainte qu’une nouvelle nationalisation les prenne de court et les ruine pour de bon. [78]
L’opération de zaïrianisation eut surtout l’effet désastreux de chasser les petits commerçants – Portugais, Pakistanais, Grecs et autres – des campagnes zaïroises, et donc de démanteler les sources d’approvisionnement des populations. Avec l’échec de la politique agricole du Nouveau Régime, la crise économique qui se déclarait, annonçait un impact direct sur le panier de la ménagère ; elle prendrait de ce fait une forme existentielle. [79] A cela s’ajoutèrent la crise du dollar en 1971 et la montée vertigineuse des prix du pétrole, imposée par les pays de l’OPEP en 1973. L’avenir était sombre. Mais pour l’heure, l’évolution globale demeurait encore plus ou moins satisfaisante, bien que le taux de croissance ait chu de 9 % (1967-70) à 4,6 % (1971-74) (Panorama… 1990 : 151). La misère sociale n’en était qu’à ses débuts.
La troisième période qui démarra en 1975 mena l’économie zaïroise à la ruine. Les cours du cuivre qui avaient atteint en 1974 des sommets encore inégalés, connurent, pour la première fois depuis 1967, une chute catastrophique. Le marché international prenait-il sa revanche sur l’épreuve de force que le Zaïre avait déclenchée unilatéralement ? Cette situation était d’autant plus dramatique que le cuivre intervenait pour 70 % dans le revenu en devises de l’Etat. Depuis 1960, le secteur minier n’avait fait que gagner de l’importance, à tel point qu’il représentait en 1974 plus de la moitié du secteur commercial.
Avec cette dépression, toute l’économie allait sombrer dans la pénurie. L’inflation galopante et la chute de la production eurent pour conséquence l’apparition de fluctuations importantes au niveau du produit intérieur brut qui enregistra, de 1975 à 1983, une baisse annuelle globale de l’ordre de 2 %, tandis que la dépression par habitant était d’environ 5 % par an. La consommation des ménages ne fit que décroître, les prix ne cessant de monter. En effet, en 1974, les prix n’avaient fait que doubler ; ils furent à peu près multipliés par six de 1974 à 1983, ce qui se traduisit par une dévaluation considérable du zaïre-monnaie (Panorama… 152-159). Le Zaïre, en principe divisible en 100 Makuta et 10 000 Sengi, devint l’unité monétaire par voie de fait, les monnaies qui le composaient ayant disparu du marché.
Il faut préciser qu’entre 1983 et 1986, on parvint à maîtriser partiellement l’inflation, grâce aux multiples programmes de stabilisation mis en œuvre avec la collaboration de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des pays amis du Zaïre. Mais on obtint cette amélioration au prix du sacrifice de la vie sociale et sa rentabilité au niveau de la croissance fut très limitée. La crise reprit donc en 1986, ce qui n’étonna personne.
Que la production nationale ait fait problème pendant plus de dix ans paraît relever davantage des mauvais choix opérés dès l’instauration du régime. Le fait de miser sur le secteur minier, comme à l’époque coloniale, avait eu pour conséquence la négligence du secteur agricole, malgré les slogans utilisés pour accréditer la bonne foi des dirigeants. La construction des « éléphants blancs », comme on le verra plus loin, contribua à augmenter les dettes sans que ces crédits puissent améliorer la santé économique globale ou avoir un effet positif sur les différents secteurs de production. Enfin, les comportements irrationnels inhérents à la crise vécue assurèrent par ailleurs sa permanence, étouffant à la base toute idée nouvelle susceptible d’aboutir à une solution.
Le plus grand acquis de cette décennie réside vraisemblablement dans la mise en place de structures nationales de gestion économique, la première du genre dans le Zaïre indépendant et qui définit l’identité qu’on lui reconnaît de nos jours. Au niveau de la gestion globale des entreprises, on créa dès 1972 une Association nationale des entreprises du Zaïre (ANEZA) à partir de la fusion des unions professionnelles patronales existantes. A la fois Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Mines et organisation patronale, cet organisme s’imposa comme une instance de promotion et de protection des intérêts des entreprises de tous les secteurs. De ce fait, il fut doté non seulement d’organes nationaux et régionaux mais aussi de regroupements sectoriels que sont les comités professionnels.
Le secteur agricole fut doté de son cadre institutionnel, comprenant entre autres : les Offices de production et de commercialisation dont les plus en vue demeurent l’Office zaïrois du café (OZACAF), la Caisse de stabilisation cotonnière (C.S.Co) et l’Office national d’élevage (ONDE) ; les sociétés d’exploitation forestière parmi lesquelles figurent SIFORZAL et AGRIFOR et plusieurs autres structures de transformation des produits agricoles, contrôlées pour la qualité de leur production par l’OZAC (Office zaïrois de contrôle). L’industrie de transformation agricole fut diversifiée, allant des minoteries à la fabrication du sucre en passant par l’industrie laitière. On fabriqua le sucre zaïrois dans trois complexes agro-industriels : la sucrière de Kwilu-Ngongo (Bas-Congo), opérationnelle depuis 1926, la sucrière de Kiliba (SUCRAF) implantée au Kivu depuis 1956 et enfin celle de Lotokila (Haut-Zaïre), une création récente de 1984. Les minoteries étaient encore plus nombreuses, installées principalement dans le Bas-Zaïre et au Shaba. Les plus importantes dans ces deux régions sont respectivement la MIDEMA et la MINOKA.
Quant à l’industrie minière, elle continua à reposer essentiellement sur la GECAMINES, laquelle fut organisée en holding à partir de 1986, avec trois divisions : Gécamines-Exploitations, Gécamines-Commercial, Gécamines-Développement. Mais cette tripartition fut à nouveau supprimée au cours des années 90. L’exploitation du diamant du Kasaï continua d’être assurée par la MIBA (Minière de Bakwanga) tandis que l’or de Kilo-Moto restait l’affaire de l’OKJMO (Office de Kilo-Moto). Au chapitre des transformations des produits miniers, il faut noter l’existence de quelques entreprises de fabrication de produits semi-finis et finis en cuivre, notamment la Câblerie et métallurgie zaïroise (CAMEZA). Les autres activités du genre furent confiées à l’Office des petites et moyennes entreprises (OPEZ) qui assurait la promotion des PME.
Le secteur énergétique a fait l’objet d’une réorganisation systématique. Une Société nationale d’Electricité (SNEL), fonctionnelle depuis 1970, remplaça les multiples sociétés qui se chargeaient de la distribution de l’énergie électrique dans les différentes régions du pays. La puissance disponible passa de 675,33 MW en 1967 à 2 600 MW en 1986 – soit une augmentation de 285 % – grâce à la mise en exploitation des centrales d’Inga I (350 MW) en 1974 et Inga II (1.460 MW) en 1982. [80] La distribution de l’eau, qui dépendait également de plusieurs sociétés, devint l’apanage de la REGIDESO, enfin déchargée de ses prétentions à la commercialisation de l’électricité par la création de la SNEL, pour s’en tenir uniquement et exclusivement à la distribution d’eau. Pour l’approvisionnement et la distribution des produits pétroliers, une restructuration intervint également. Comme on le sait, la demande zaïroise en produits pétroliers portait sur l’essence, le kérosène, le gas oil, l’essence pour l’aviation, le fuel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Dans un premier temps, le Zaïre accorda le monopole d’importation de ces produits à une société nationale, Petro-Zaire (1974), laquelle était seule habilitée à revendre le pétrole auprès des sociétés commerciales (Zaïre-Mobil-Oil, Zaïre-Shell. Zaïre-Texaco). Mais ces dispositions purent l’allure d’un blocage, à tel point qu’il fut nécessaire de réhabiliter les autres sociétés de commercialisation également importatrices de pétrole dans leur rôle. Petro-Zaïre devint la société d’État chargée exclusivement de la commercialisation du pétrole (1978). La collaboration entre cette entreprise d’État et les sociétés privées conduisit à la création de ZAIRE-SEP (Service des entreprises pétrolières), l’instance qui assume depuis la distribution (transport et entreposage) des produits pétroliers. Le Zaïre compta ainsi cinq sociétés pétrolières.
Tableau 28 — Principales entreprises industrielles du Zaïre
(suivant le chiffre d’affaires en millions de zaïres)
| RAISON SOCIALE | ACTIVITES | C. A. 1985 | C. A. 1986 | C. A. 1987 |
| 1. Gécamines | Cuivre, cobalt, zinc | 47.380 | 52.299 | 110.760 |
| 2. Zaïre-Gulf | Activités pétrolières | 10.962 | 6.006 | 14.102 |
| 3. Gr.-Damseaux | Elevages, Transp. rail, fleuve | 4.729 | 7.155 | 12.648 |
| 4. S.N.C.Z. | Transport rail | 7.235 | 8.427 | 11.755 |
| 5. S.N.E.L. | Electricité | 2.803 | 4.199 | 8.710 |
| 6. ONATRA | Transport fluvial | 5.010 | 5.216 | 8.275 |
| 7. BRALIMA | Bière, boissons gazeuses | 2.887 | 3.965 | 8.021 |
| 8. MIBA | Extraction diamants | 2.865 | 4.235 | 7.958 |
| 9. UNIBRA | Bière, boissons gazeuses | 2.492 | 4.273 | 7.466 |
| 10. PETRO-ZAIRE | Activités pétrolières | 6.229 | 3.219 | 5.800 |
| 11. TABAZAIRE | Tabac, cigarettes | 2.291 | 3.101 | 5.621 |
| 12. ZAIRE-SEP | Transport carburant | 3.199 | 4.668 | 5.443 |
| 13. CMZ | Transport maritime | 1.769 | 2.539 | 5.271 |
| 14. HASSON&FR. | Confection, commerce | 1.889 | 2.904 | 5.228 |
| 15. MIDEMA | Farine, froment | 1.991 | 2.221 | 4.422 |
| 16. SODIMIZA | Concentré cuivre | 1.867 | 1.620 | 4.377 |
| 17. ZAIREP | Extraction pétrole | 2.477 | 1.860 | 4.307 |
| 18. BRAUMA | Bière, boissons gazeuses | 1.507 | 2.242 | 4.039 |
| 19. MARSAVCO | Produits alimentaires | 1.445 | 1.983 | 4.000 |
| 20. AIR-ZAIRE | Aviation | 2.093 | 3.496 | 3.718 |
| 21. REGIDESO | Eau distributions | 1.942 | 2.782 | 3.661 |
| 22. B.A.T.-ZAÏRE | Tabac, cigarettes | 1.171 | 1.778 | 3.556 |
| 23. P.LZ. | Huile palme, café, cacao | 1.972 | 1.895 | 3.011 |
| 24. SCIBE-ZAIRE | Café, or, commerce | — | 2.681 | 2.835 |
| 25. CHANIMETAL | Construction navale | 1.071 | 1.504 | 2.758 |
| 26. SCIBE-AIRUFT | Aviation | 669 | 1.517 | 2.551 |
| 27. SOTEXKI | Tissage, impressions | 1.014 | 1.347 | 2.479 |
| 28. S.B.K. | Bière, boissons gazeuses | 680 | 1.131 | 2.199 |
| 29. Cie SUCRIERE | Sucre | 1.588 | 2.340 | 2.100 |
| 30. GOOD-YEAR | Pneumatiques | 675 | 901 | 1.944 |
| 31. SOMINKI | Cassitérite | 1.300 | 1.018 | 1.865 |
| 32. QUOVADIS | Pain, farine | 518 | 700 | 1.855 |
| 33. C.I.B. | Boissons gazeuses | 601 | 1.004 | 1.798 |
| 34. SIFORZAL | Bois | 605 | 950 | 1.781 |
| 35. SOLBENA | Confection, commerce | 1.568 | 2.344 | 1.769 |
| 36. C.P.A | Impression de tissus | 779 | 1.019 | 1.674 |
| 37. AUXELTRA | Constructions | 703 | 1.167 | 1.659 |
| 38. CIZA | Ciment | 844 | 898 | 1.500 |
| 39. AMATO&Cie | Minoterie, savon | 748 | 895 | 1.296 |
| 40. DAIPN | Elevage avic, port | 444 | 691 | 1.294 |
| 41. UTEXAFRICA | Tissage, impression, confect. | — | 860 | 1.270 |
| 42. SAFRICAS | Constructions | 453 | 661 | 1.244 |
| 43. G.C.M. Dévelop. | Minoterie, Culture maïs | 1.169 | 1.253 | 1.200 |
| 44. CINAT | Ciment | 537 | 687 | 1.197 |
| 45. G.M.- ZAÏRE | Véhicules automobiles | 584 | 626 | 1.185 |
| 46. SORGERI | Savon, huile, beurre | 282 | 544 | 1.110 |
| 47. Sté CULTURES | Huile de palme, caoutchouc | 529 | 692 | 1.071 |
| 48. J.V.L. | Elevage, huile de palme | 401 | 499 | 1.061 |
| 49. SOZIR | Raffinage pétrole | 544 | 839 | 1.045 |
| 50. UPAK | Pain | 560 | 531 | 933 |
(Source : Cornevin R. 1989 :479-480)
Le secteur des transports et de la communication était sans nul doute celui qui était le plus en mal de réorganisation. L’entretien du réseau routier fut assigné à un Office des routes (1971) tandis que le transport en commun urbain avait été confié, un an plus tôt, à l’Office des transports en commun du Zaïre (OTCZ). La Société nationale des chemins de fer zaïrois ((SNCZ) fut créée en 1974 à partir de la fusion des anciens réseaux ferroviaires : KDL (Kinshasa, Dilolo, Lubumbashi), C.V.C. (Chemin de fer vicinaux du Congo), CFMK (Compagnie des chemins de fer des Grands Lacs). En matière de transports fluviaux, maritimes et lacustres, on fit appel aux établissements ci-après : La Régie des voies fluviales (RVF) et la Régie des voies maritimes (RVM), créées toutes deux en janvier 1971 pour gérer les réseaux fluviaux et maritimes du pays. L’ONATRA (Office national des transports) qui succéda à l’OTRACO (1971) restait la société de transport fluvial la plus importante ; il fut complété en 1974 par une Compagnie maritime zaïroise (CMZ) qui reprit à la CMB (Compagnie maritime belge) le privilège d’organisation du transport maritime au compte du pays avec dès le départ une flotte autonome.
La défense des intérêts des chargeurs auprès des compagnies de transport fut confiée à une entreprise particulière : L’Office zaïrois de gestion du fret maritime (OGEFREM). Le transport aérien disposait d’établissements qui lui étaient propres : Air-Zaïre créée déjà en 1961 sous le nom d’« Air-Congo » et la Régie des voies aériennes (RVA), opérationnelle depuis 1972. S’y ajoutèrent des sociétés privées : Scibe-Airlift de Bemba Saolona, ACS, Shabair et quelques autres.
En vue de pouvoir disposer des structures nécessaires au bon fonctionnement des postes et télécommunications ainsi que de la radiodiffusion, on créa l’ONPTZ (Office National des Postes et Télécommunications), l’OZRT (Office Zaïrois de Radio-Télévision) et le REZATELSAT (Réseau Zaïrois de Télécommunications par Satellite).
Les institutions financières se multiplièrent, et disséminèrent leurs agences à travers le pays. Entre 1965 et 1990, le nombre d’institutions bancaires zaïroises passa du simple au double. En effet jusqu’en 1965, le pays ne disposait que d’une demi-douzaine de banques, qui étaient déjà en fonction pendant la période coloniale : il s’agissait de la « Banque du Congo belge » (1909) devenue Banque Commerciale Zaïroise (BCZ), de la « Banque Belge d’Afrique » (1929) actuellement Union Zaïroise de Banques (UZB), de la « SOCOBANQUE » (1947) devenue « Banque du Peuple » puis Banque Zaïroise de Commerce Extérieur (BZCE), de la « Banque Centrale du Congo belge et Rwanda-Urundi » (1951), de nos jours Banque du Zaïre, du « Crédit Congolais » (1952) actuellement Bardais Bank et enfin de la Banque de Paris et des Pays-Bas (1954). Depuis lors, on a assisté à l’implantation de nouvelles banques, depuis la « Banque de Kinshasa » (1969) actuellement Nouvelle Banque de Kinshasa (NBK) jusqu’à la Banque de Placements du Zaïre (BPZ) opérationnelle depuis 1988, en passant par la BIAZ (1970) Banque Internationale pour l’Afrique au Zaïre, la Citibank (1971), la Grindlay’s Bank (1973), la BCA (1982) Banque de Crédit Agricole et la BACAZ (1984) Banque Continentale Africaine au Zaïre. Le nombre des institutions financières non bancaires était près de la vingtaine avant que certaines soient supprimées suite à la crise. Parmi les plus importantes qui subsistent, citons entre autres, la Société Financière de
Développement (SOFIDE), la Caisse Générale d’Epargne du Zaïre (CADEZA), l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS), la Société Nationale d’Assurance (SONAS) ainsi que les différents Fonds, Agricole, de Contrepartie, des Conventions de Développement et de Promotion de l’Industrie et du Tourisme. Les finances publiques, pour être alimentées, furent reliées à des institutions spécialisées telles que l’OFIDA (Office de Douanes et Accises), la Direction Générale des Contributions (DGC) et d’autres structures de ce genre. Un Office de Gestion de la Dette Publique (OGEDEP) fut créé en 1976, avec pour mission d’élaborer la politique nationale de l’endettement, y compris l’identification de meilleures sources de financement.
Il est clair que l’endettement a été à l’origine de l’anéantissement de tout effort de développement économique. En effet, s’il faut louer l’effort consenti pour la mise en place des instruments de gestion d’une économie véritablement nationale, il faut reconnaître que celui-ci ne porta pas ses fruits du fait de la structure extravertie de cette même économie. La vie nationale restait trop tributaire des multiples fluctuations du commerce extérieur. Le dérapage de la politique d’indépendance économique de l’ère mobutienne trouve là son origine. Vers 1966, le Congo eut le réflexe qui lui permit d’échapper au premier piège que lui tendait sa propre structure commerciale extravertie. 11 rejeta sur la Belgique le passif des engagements que celle-ci avait contractés sur le compte de sa propre colonie. Les conclusions du contentieux belgo-congolais de 1966 se réduisirent à un effacement des dettes et à la confiscation des instruments de production qui échappaient jusque-là aux pouvoirs publics. Mais hélas, le Congo indépendant, dans sa vision du développement, ne put échapper au deuxième piège tendu par l’environnement économique préexistant. En effet, il reprit à son compte les erreurs de la politique économique coloniale et s’employa même à les multiplier. Il suffit, pour s’en convaincre, d’étudier les choix économiques qui furent opérés et les investissements qui les concrétisèrent.
Le Zaïre limita presque exclusivement son commerce extérieur aux seuls produits miniers. Alors qu’en 1950, ces produits représentaient 51,2 % des exportations contre 48,8 % pour les produits agricoles, la disproportion s’accentua de manière inquiétante. En 1969 et 1970, les produits miniers couvraient à eux seuls 84,9 % et 83,5 % des exportations. Pire, l’exportation agricole fut à un moment donné limitée au seul café, de même que l’exportation minière se réduisit pratiquement au cuivre et au cobalt, tous deux dépendant de la seule Gécamines. [81]
L’autre faiblesse de l’économie nationale, qui fut traitée à la légère par le Zaïre nouveau, réside dans les investissements réalisés. Que la dette contractée de 1965 à 1989 soit de l’ordre de 11 308 milliards de dollars américains, restait supportable, au regard des ressources du pays. [82] Ce qui le fut moins, c’est le fait que cet argent fut affecté à des investissements peu rentables à court terme, liés aux impératifs de la politique « des grands travaux ». Ainsi, ces fonds furent affectés pour la plupart à la construction du pont Maréchal Mobutu à Matadi (215 millions de dollars), à celle de la Cité de la Voix du Zaïre (158,6 millions de dollars), à celle des aéroports de Goma et de Kisangani (135,5 millions de dollars). Une partie fut également affectée à l’équipement fluvial (ONATRA), maritime (CMZ) et ferroviaire (SNCZ). Une autre et non des moindres, au secteur énergétique : 478,4 millions de dollars servirent à la production de l’électricité (barrages d’Inga et de Mobayi-Mbongo), 771,4 à sa distribution (ligne à haute-tension Inga-Shaba). Une autre enfin servit à la mise en place de la sidérurgie de Maluku et à la construction du Centre de Commerce International du Zaïre (CCIZ). Ces choix « politiques » semblent effectivement être douteux sur le plan économique. Mobutu fut le premier à le reconnaître, une fois la brève euphorie économique des années 69-70 dissipée. [83]
On aurait pu penser que, pour réparer de telles erreurs, il suffisait de contracter d’autres dettes, et d’investir ces fonds dans des secteurs productifs. La situation n’était pas aussi simple. L’ampleur de l’endettement, encore accentuée par des taux d’intérêts dus aux rééchelonnements, restreignit d’office l’éventualité de nouveaux emprunts. Les nouveaux engagements étaient donc moins évidents, car ils étaient dépendants de nouvelles contraintes. Il est d’ailleurs utile de se pencher sur la nature de l’endettement zaïrois, afin de pouvoir évaluer l’importance de la contrainte à laquelle la communauté nationale est soumise. Une grande partie de la dette a été contractée par l’intermédiaire de deux types de banques commerciales créancières, le Club de Londres mais surtout le Club de Paris, institution créée en 1956 pour régler les difficultés de l’Argentine, qui ne parvenait pas à respecter ses échéances de paiement de la dette, et fit ensuite de même pour d’autres pays. Les créances du Club de Londres, qui représentaient 10 % de l’ensemble de la dette en 1983, sont constituées de prêts consentis par des banques consortiales privées. Celles du Club de Paris qui totalisaient la même année 63 % des engagements existants proviennent des organismes officiels d’Allemagne Fédérale (Kredietanstalt FW), de France (CCCE), du Canada (ACD1), des USA (USAID), de Belgique (Ducroire) et d’autres pays comme le Royaume-Uni, l’Arabie Saoudite, le Japon, la Suède, l’Italie, les Pays-Bas. Outre ces créances, il y avait celles qui provenaient des institutions multilatérales (Banque Mondiale, FMI, BAD, CEE, OPEP, etc), représentant la même année les 13 % de ce qui était dû. Le reste revenait à d’autres créanciers publics et privés.
Le principe de remboursement auprès de ces différentes instances financières était assorti de conditions strictes et finalement laborieuses, de sorte que les accords de rééchelonnement ou de consolidation des dettes non apurées dans les délais entraînaient une capitalisation des arriérés à des taux d’intérêts élevés. Ceci vaut surtout pour le Club de Paris, où les rééchelonnements en série créèrent un effet de boule de neige et vinrent ainsi s’ajouter à la dette non consolidée. Au 1er janvier 1989, ses créances représentaient 67,4% des engagements initiaux et 72 % du total de l’encours. De 1976 à 1989, le Zaïre dut malheureusement conclure avec ce Club 9 accords de rééchelonnement de sa dette extérieure (16 juin 1976, 6 novembre 1977, 11 décembre 1979, 9 juillet 1981, 19 décembre 1983, 18 mai 1985, 15 mai 1986, 18 mai 1987, 23 mai 1989) créant chaque fois une nouvelle dette. Ainsi, rien que pour la période allant de 1973 à 1983, le Zaïre aura payé 2,9 milliards de dollars américains au compte du remboursement des dettes et du paiement des intérêts ; cette opération, réalisée au prix de mille sacrifices, ne constituait pourtant pas encore une avancée significative dans le domaine de l’apuration totale de sa dette publique. En 1985, en effet, la dette extérieure zaïroise fut évaluée à 836 millions de dollars, ce qui représentait la totalité des recettes budgétaires de l’État. Le dernier accord de rééchelonnement signé en juin 1989 concernait des engagements de remboursement allant jusqu’en 2003 (France) voire en 2014 (Belgique, USA, Pays-Bas, Suède). Le plus curieux, comme le note L. de Saint Moulin, est que ces mêmes pays, qui « aident » le Zaïre, sont ceux qui rémunèrent si mal les activités d’exportation dans lesquelles ils lui demandent pourtant de continuer à investir l’essentiel de ses ressources (1987 : 31).
On comprend que les pays du Sud se préoccupent d’identifier de nouvelles « voies » pour sortir de ce cercle vicieux qui, visiblement ne vise qu’à pérenniser cette situation de dépendance. [84] Condamné à effectuer de tels transferts pendant des années, le Zaïre ne peut plus disposer de ce qui est nécessaire à la mise en oeuvre des programmes d’investissements pour soutenir la relance économique. Ce n’est pas par hasard qu’un Sommet de l’OUA (novembre – décembre 1987) ait décidé de prendre publiquement position à propos de cette question qui concerne pratiquement toute l’Afrique. Les stratégies nouvelles actuellement envisagées concernent entre autres la révision des conditions de rééchelonnement ainsi que des demandes d’effacement des dettes ou du moins leur réduction. C’est ainsi qu’en 1987, la Belgique avait décidé de commuer ces crédits d’État à État en don. Ceux-ci portaient sur un montant global de 4 892 milliards de francs belges. Ces actes de solidarité, également posés par le Canada, la Suède, la Suisse, la France à l’égard des « pays pauvres » du Sud sont louables mais limités. Ils allègent le fardeau sans le supprimer Les causes structurelles qui sont à la base du processus d’endettement et de la situation d’insolvabilité des pays du Sud demeurent « présentes » malgré cela. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il ne serait guère surprenant que les dettes effacées soient remplacées par de nouvelles, toujours impossibles à rembourser. Seules des mesures énergiques comme le rapatriement des capitaux zaïrois enfuis à l’étranger pourrait permettre au pays de disposer d’argent frais, exempt de taux d’intérêt exorbitants et de relancer l’économie par des investissements rentables. La détérioration constante des termes de l’échange est un autre fléau à combattre si l’on veut obtenir un juste prix pour les matières premières importées. En l’absence de telles transformations pourtant possibles, la crise économique risque fort de se prolonger. C’est effectivement ce qui se passe dans le Zaïre authentique.
On pourrait mettre sur le compte du droit à l’erreur les options de la politique économique qui furent arrêtées dans l’euphorie d’un succès économique, qui s’avérait précaire. Ce qui prévaut ici est l’attitude de la population zaïroise qui, confrontée à un problème aussi grave, a pu s’y adapter. Pour qu’il y ait eu une conscience si vive de la crise, il a fallu que celle-ci ait des conséquences néfastes sur la vie nationale. Une chanson de Mbuta Miyalu du début de la décennie 80 rappelle cette misère envahissante et inextricable. Un père de douze enfants les perdit tous, l’un après l’autre ; chacun de ces décès constitue en lui-même l’évocation de tout un chapitre de misère sociale : pauvreté, inadaptation sociale, maladie, désorganisation de la société, banditisme, etc.
Mon premier enfant décédé fut ingénieur à la Gécamines. Le deuxième a coulé dans une pirogue : il était trafiquant. Le troisième enfant décédé mourut du tétanos.
La quatrième, une ndumba, obtint un fétiche pour attirer plus d’hommes. A cause de cela, elle fut empoisonnée par jalousie, par ses amies.
Le cinquième enfant mourut de kwashiorkor. Le sixième, un «viveur», provoqua une bagarre dans un bar, on lui lança une bouteille de Primus sur la tête qui eut raison de lui.
(…)
Le septième enfant excellait en vagabondages la nuit, il fut pris par des bandits. Parce que sans argent, on lui lança un canif…
Le huitième enfant mourut à Songololo. En coupant les régimes de palme, il tomba du palmier.
Le neuvième se brûla au feu de désespoir, sa femme l’avait quitté.
Le dixième enfant, un chauffeur, alla vers Bandundu. A son retour, il tomba à la rivière Mayi-Ndombe.
Le onzième enfant était serviteur à la Sozacom. Il tomba du haut de l’immeuble pris de vertige.
Le douzième enfin mourut en gardienne
L’instituteur lui lança une latte…
On le tua pour rien, en gardienne…
Effectivement, la pénurie donna lieu à une augmentation instantanée de la corruption, qu’il s’agisse d’obtenir une faveur ou tout simplement de faire reconnaître un droit. Pour ceux qui étaient dans le besoin, ce comportement était la seule possibilité de trouver des solutions à leurs problèmes. 11 n’était pas rare de voir un gendarme arrêtant un automobiliste dont les papiers étaient en ordre, lui demandant d’autres documents, jusqu’à ce qu’il parvienne à le prendre en défaut et que ce dernier soit obligé de lui tendre un pourboire pour être quitte. Cette chasse au pourboire était pour certains une condition nécessaire à la survie quotidienne de la famille. On l’appelait madeso ya bana (le haricot des enfants).
Dans cette situation de sauve-qui-peut, la fidélité au parti, le militantisme devint la modalité de survie la plus sûre, même s’il ne correspondait pas à un véritable esprit patriotique ou à une préoccupation de servir la société. C’est ainsi que l’Etat devint prisonnier d’une classe de profiteurs, dont il ne parviendrait pas à se défaire facilement, malgré des exercices d’autocritique, effectués sans doute davantage par calcul politique que par une volonté réelle de se mettre en cause. [85] Cette situation inextricable – le mal zaïrois – était volontiers mise sur le compte des bourgeoisies montantes, les « Cadres » pourtant soumis à plusieurs sessions de formation idéologique de la FORCAD. En fait, forte des leçons de la période léopoldienne, l’aristocratie politique était appelée à être intégrée à la bourgeoisie économique. A quelques exceptions près, les hommes d’affaires zaïrois étaient des anciens lieutenants du président qui avaient eu à le servir au sein du parti, dans le gouvernement ou dans l’armée. Ceux qu’on appelait les « Cadres » étaient donc à la fois les officiers supérieurs, anciens et nouveaux, les hommes politiques encore au pouvoir ou retranchés dans la gestion commerciale, les universitaires parvenus à des postes enviables dans la hiérarchie politique et par conséquent, économique. Ce groupe connaissait, comme on l’a souligné plus haut, des clivages internes, qui s’ajoutaient à des rivalités personnelles, inévitables dans un tel climat de compétition. L’enjeu était de taille car la promotion politique était une condition suffisante à la survie économique. De l’argent et des biens, il fallait en amasser le plus possible, entre autres pour survivre à des périodes de disgrâce, et pour reconquérir le pouvoir dans des délais raisonnables.
A cause des lendemains incertains, les cadres eux-mêmes vivaient donc un étrange nivellement, tant ils étaient tous préoccupés de leur survie politique. Que le régime ait eu à déplorer leur « manque d’engagement » (le militantisme tiède), cela n’était pas seulement dû à la nécessité de sacrifier, de manière régulière, quelques boucs émissaires. Il y avait plus. Pour nombre d’entre eux, en effet, les hautes fonctions qu ils occupaient, constituaient essentiellement un gagne-pain, sans plus. On applaudissait et brandissait le slogan du MPR lorsque c’était nécessaire. On s’occupait de l’application de réformes dont on contestait la pertinence, convaincu à tort ou à raison que les avis que l’on aurait voulu émettre ne seraient jamais écoutés ; ils serviraient seulement à introduire un doute auprès des instances supérieures, quant au degré de loyauté que l’on témoignait au régime. Ainsi le mal zaïrois put-il se prolonger alors qu’il était dénoncé, voire combattu.
Il est juste de rendre compte des multiples efforts qui furent déployés pour venir à bout de cette crise. Le combat le plus significatif fut mené non seulement par les pouvoirs publics mais aussi par le peuple.
3.2.1 Le combat des pouvoirs publics
L’offensive gouvernementale fut à la fois politique et économique. Au lendemain de la décolonisation de l’Angola, on l’a vu, le Zaïre décida courageusement de se défaire de la compromission qui le liait au FNLA (Holden Roberto) vaincu, pour coopérer avec le vrai maître de l’Angola, le MPLA (A. Neto). Cette volte-face était indispensable pour ne pas compromettre l’approvisionnement du pays, qui transitait par les ports angolais et l’insécurité que cette immense frontière sur laquelle planait l’ombre des anciens gendarmes Katangais pouvait évoquer. Les premiers contacts furent prometteurs et les deux pays se reconnurent des intérêts communs. Ils se mirent d’accord pour le respect de la sécurité le long de la frontière commune, le retour des réfugiés dans leurs pays d’origine respectifs et la remise en état des voies de communication (chemin de fer de Benguela et bief maritime du fleuve Congo). Mais un tel consensus eût été trop beau, il fallait encore que les deux parties en finissent avec le contentieux de la guerre d’indépendance dans laquelle le Congo avait été impliqué en tant qu’allié du FNLA. Le Zaïre eut beau reconnaître officiellement la République populaire d’Angola le 6 janvier 1977. il ne put empêcher qu’une colonne armée, venue d’Angola, l’attaque le 8 mars pour faire la guerre au régime du MPR. La « guerre de 80 jours » fut ainsi déclenchée ; l’opération de charme n’avait pu l’empêcher. Le désastre de la guerre s’ajouta encore aux malheurs d’une population zaïroise déjà accablée par la crise.
Fort heureusement, il existait un front économique qui combattait lui aussi la crise pour sortir le pays du marasme. Des actions concrètes avaient été envisagées en ce sens au lendemain de l’effondrement de l’économie zaïroise en 1975. L’appel à l’expansion économique supposait au préalable la relance de la production, avant tout autre choix économique, sauf lorsque celui-ci s’imposait comme préalable à cette relance. Deux initiatives s’inscrivirent dans cet esprit : l’instauration d’un programme de stabilisation (1976) et la mise au point d’un plan de relance qualifié de plan Mobutu (1977). La « stabilisation » avait été l’objet de préoccupations pendant plus de cinq ans, soit de 1976 en 1981. C’est dans les derniers mois de 1976. en effet, qu’un « Comité de Stabilisation » fut institué ayant pour mission l’application de la nouvelle politique économique du pays définie dans le discours présidentiel du dixième anniversaire du régime, le 25 novembre 1975. Elle prônait 1 ajustement du taux de change, une politique plus restrictive des importations, la réduction des dépenses publiques, la limitation de l’expansion des crédits, le réaménagement de la dette extérieure et l’ajustement des salaires et des prix. Dans 1 immédiat, on opta pour le maintien des acquis de la période révolutionnaire avec une association plus large du secteur privé étranger. C’est dans ce contexte qu intervint la « rétrocession », opération au cours de laquelle furent remis 40 puis 60 % des actions ou parts aux propriétaires d’entreprises nationalisées. Il fut question d’une relance de l’économie qui se réalisa avec l’aide d’institutions internationales (la CEE, le FMI et la BIRD) et de pays amis (les USA, le Canada, la Belgique, la France, la RFA, l’Italie, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Japon) qui se réunirent à plusieurs reprises à Bruxelles et à Paris pour débattre de la question. Le FMI fut chargé de mettre au point un programme de stabilisation et la Banque Mondiale, un programme d’investissement. Le programme de stabilisation commença le 12mars 1976, avec le détachement du Zaïre-monnaie de la parité avec le dollar, et son rattachement au DTS. Sur le plan local, on insista plutôt sur la remise en ordre de l’appareil de production, pour atténuer les déficits alimentaires.
Mais les priorités définies du « dehors » et du « dedans » en vue de la stabilisation ne concordaient pas rigoureusement. En effet, les dispositions préconisées au niveau du FMI « ne tenaient pas compte en certains points des possibilités du pays et imposaient en certains autres points de cruels sacrifices à la population » (Kikassa M. 1977à : 144). De plus, le correctif d’origine interne n’était pas toujours réaliste. Les prévisions de relance de la production surestimaient l’état de l’appareil de production devenu défectueux, après l’opération de zaïrianisation et des guerres du Shaba, de même qu’elles minimisaient l’ampleur de la corruption et de la défection morale des fonctionnaires économiques.
Il faudra attendre 1980 pour voir apparaître les signes d’une reprise économique : le taux d’inflation fut ramené à 50 % alors qu’il était de 110 % en 1979 ; le taux de croissance du PIB commercialisé, constamment négatif depuis 1975, redevint positif : + 1,8 %. La production minière, qui avait fluctué depuis 1975, se stabilisa à la hausse. La balance des paiements, en déficit depuis 1974, présenta un excédent de 48,5 millions de Zaïres. Les réserves d’échange avaient augmenté, même si leur solde demeurait négatif comme les années précédentes ; il avait été ramené de – 310 288 millions de Zaïres en 1979 à – 261 824 millions. Il fallait que cette tendance à la croissance ou du moins à la stabilisation se maintienne, ce à quoi s’employaient les pouvoirs politiques sous la férule de Kengo wa Dondo, Premier Commissaire d’Etat, malgré les aléas de la conjoncture.
Entre-temps, le Plan Mobutu, auquel les événements avaient fait subir des modifications diverses depuis 1977, pouvait enfin entrer en application, après que sa période d’exécution – triennale dans les prévisions – eut été postposée à plusieurs reprises. Tel qu’il était défini le 25 novembre 1977, dans le discours d’ouverture du deuxième Congrès ordinaire du Parti, le plan portait sur les éléments ci-après : la réorganisation des transports, le développement de l’agriculture, le retour de la production minière à son niveau optimum, la décentralisation de la gestion de l’économie au profit des régions, la rigueur et l’efficacité dans la gestion des affaires nationales.
En principe, on s’attendait à une reprise ferme de l’activité économique du pays en 1985 mais le plan triennal n’atteignit pas ses objectifs. La dette extérieure pesait déjà trop lourdement sur le budget de l’État ; au 1er janvier 1980, cette dette était de 4 604 018.400 dollars ; il s’agissait là des engagements initiaux, l’encours étant de 3 235 948.500 dollars. La dette consolidée s’élevait, quant à elle, à 364 871 500 dollars. [86] Mais tous les espoirs étaient encore permis, grâce à la diversité des richesses disponibles et à l’importance stratégique du pays, dont la situation polarisait l’attention des institutions internationales les plus prestigieuses. Tout n’était pas encore joué. En 1979, un nouveau Code d’Investissement avait été promulgué, élargissant la gamme d’avantages fiscaux aux investissements extérieurs. L’année suivante, un Programme agricole minimum (PAM) préconisa la relance de la production agricole vivrière à très court terme. Pour attirer les investisseurs potentiels, la commercialisation de l’or et des diamants fut libéralisée (Ordonnance n° 82/ 039). Cette mesure fut critiquée par l’opinion publique parce qu’elle paraissait cautionner la fraude. En réalité, l’État venait par là contrôler ce trafic et le soumettre aux taxes en vigueur. Mais le résultat sur le plan économique fut minime et l’implication sociale, comme nous le verrons, catastrophique.
Entre 1983 et 1986, d’autres projets virent le jour. Le Zaïre signa avec le Fonds monétaire international des accords des programmes d’ajustement structurel avec pour objectifs principaux la libre convertibilité de la monnaie, le renforcement de la discipline budgétaire, la poursuite de l’assainissement des entreprises publiques, la libéralisation progressive de l’économie et surtout, le respect des échéances de paiement de la dette. Le mot d’ordre était « politique de la rigueur » et en tant qu’élève modèle du FMI, le Zaïre obtint en 1986 le rééchelonnement du remboursement de sa dette qui fut porté sur une période de dix ans avec un délai de grâce de quatre ans. Il y eut également, au cours de cette période, un Programme intérimaire de Réhabilitation économique, le PRINT (1983-85), qui prévoyait la relance de l’économie par des investissements publics. Mais celui-ci ne put aboutir qu’à des résultats précaires, étant donné l’insuffisance budgétaire.
Malgré tout, on prit d’autres initiatives. Dans son discours d’investiture du 5 décembre 1984, le président avait décidé de se passer désormais de simples programmes de stabilisation et d’investissement. Il fallait se lancer dans une action globale intégrant tous les projets et impliquant tous les partenaires dans le financement : l’État, les entreprises publiques, le secteur privé et la population. C’est ainsi que fut lancé, en mars 1986, le Premier Plan quinquennal de développement économique et social (1986-1990). Les objectifs demeuraient fondamentalement les mêmes avec quelques explicitations sur le plan pratique : réhabilitation des infrastructures, promotion des secteurs privés, amélioration de la gestion administrative et économique, croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 4 % en moyenne par an. Quelques stratégies furent dégagées à cet effet, à savoir la décentralisation régionale, une politique financière et fiscale adéquate, des politiques appropriées en matière de gestion des ressources humaines, de l’emploi, des revenus et des salaires. Entretemps un nouveau Code d’investissement fut publié en avril 1986.
Mais le plan quinquennal ne put être mis en application. Son point vulnérable était son financement, estimé globalement à 262.0614 milliards de zaïres (1985), soit 167,0614 milliards pour les investissements du secteur public (Etat, entreprises publiques, régions et financement extérieur) et 95 milliards pour ceux du secteur privé. Déjà les investissements du secteur public avaient posé problème. Les organismes internationaux acceptèrent d’intervenir pour 55.49 % ; le solde devait être compensé par des sources de financement internes (l’État, les régions, les entreprises publiques). Cette situation était en elle-même insoluble car depuis 1985, les dépenses courantes dépassant les recettes, il n’était plus possible de financer le budget d’investissement à partir des sources internes. Cet état de choses entraînait un important recours au financement monétaire, donc au renforcement du processus inflationniste.
Par ailleurs en 1986, la tension sociale atteignit son paroxysme, au terme de tant d’années de privations imposées à la population. La douzième session du Comité central (septembre 1986) fut obligée de se démarquer à l’égard de la politique d’austérité symbolisée par le premier commissaire d’État Kengo wa Dondo. Menacé d’éclatement, le Zaïre se décida à renoncer à son identité d’élève modèle du FMI car, suivant le mot du président, « la rigueur ne se mangeait pas ». Dans cette nouvelle optique, le plan quinquennal devint pratiquement irréalisable puisque son financement était hypothétique. Le plan lui-même fut révisé de manière à restreindre ses ambitions et à les faire dépendre essentiellement des ressources internes de financement. Avec l’éclatement du conflit belgo-congolais, il devenait évident que le soutien économique des partenaires occidentaux était loin d’être imminent. La crise économique atteignait des proportions telles qu’on s’attendait à ce qu’un changement politique important se produise.
On constatera que les pouvoirs publics ne se sont pas découragés au cours de ces quinze ans de crise profonde. Les initiatives prises ont chaque fois eu pour défaut principal de ne pas impliquer le peuple. Tout se jouait entre les pouvoirs publics et les organismes internationaux comme si ces instances entendaient bâtir le bonheur du peuple zaïrois malgré lui et sans lui. Témoins de réalités tout autres, les populations locales apportèrent à leur niveau leurs propres solutions à la crise pour pouvoir survivre envers et contre tout. Certaines de ces solutions, nous allons le voir, étaient vraiment ingénieuses. D’autres, même si elles étaient compréhensibles, ont compromis l’avenir et ont freiné les efforts entrepris par les pouvoirs publics, lorsqu’ils ne les neutralisaient pas. Le malentendu résidait dans le fait que les initiatives gouvernementales se traduisaient dans l’immédiat pour le peuple par une pénurie plus grande et une misère plus profonde ; elles créaient de nouvelles occasions de tension. L’avènement du DTS par exemple (que des esprits malins traduisaient par « Destruction Totale et Systématique) fut impopulaire, à cause des mesures d’encadrement qu’il prit, qui furent mal appliquées. En décembre 1979, après une concertation avec « les pays amis » et les institutions internationales à Bruxelles, on lança l’opération dite de démonétisation dans l’intention de ruiner les spéculateurs. Les anciennes coupures de 5 et 10 zaïres devaient être changées dans un délai bref, au terme duquel ces billets n’étaient plus valables. Cette décision, impopulaire et contestable, n’eut qu’un seul effet : elle ruina davantage les paysans et les personnes à revenu modeste qui n’eurent guère le temps de changer leur argent. A cause de cette mesure, l’institution bancaire perdit une partie du capital de confiance que les Zaïrois avaient placé en elle. Les petits commerçants se mirent à gérer eux-mêmes leurs revenus monétaires, afin de l’avoir à portée de main en cas de nécessité, sans avoir à subir les effets d’autres restrictions gouvernementales.
3.2.2 Le combat du peuple
C’est donc essentiellement grâce à son propre dynamisme que le peuple parvint à se prémunir contre les effets de la crise. Les recettes les plus efficaces consistèrent à développer une économie informelle, à déployer le mysticisme et enfin, à mettre les campagnes en valeur par des actions de promotions de l’agriculture et de l’élevage. Nous reviendrons par la suite à ces points de repère qui constituent, aujourd’hui encore, des phénomènes collectifs.
Auparavant, la lutte contre la misère se caractérisait par le règne de la débrouillardise, appelée libanga [87]. Dans sa forme la plus rudimentaire, il se traduisait d’abord par le déploiement d’un savoir-faire populaire qui s’exprimait dans tous les domaines : mécanique, artisanat, construction, etc. Des métiers nouveaux firent leur apparition tels que celui du Kadhafi (vendeur de carburant en fraude), du chargeur (préposé à la recherche de la clientèle pour le taxi), du commissionnaire (chargé de l’identification de la clientèle immobilière) du mukala (chargé de la quête des partenaires sexuels). Le chômeur américain était un autre concept du genre : il qualifia le trafiquant qui, sans avoir un métier précis, menait un train de vie supérieur à la moyenne ; la Londonienne était une prostituée spécialisée dans la clientèle européenne tandis que les moineaux désignaient des enfants abandonnés qui, pour survivre, se mettaient au service des étudiants pour des tâches domestiques. [88] Toutes ces formes de survie firent recette, bien qu’elles fussent dénoncées par la conscience sociale. Ainsi le phénomène Mario – immortalisé par une chanson de Franco Lwambo Makiadi – qui évoque le cas de jeunes gens qui, pour subsister, deviennent les amants de grandes dames riches : en retour, celles-ci prennent leur entretien en charge.
Une autre variation du libanga consistait à s’organiser pour opérer des détournements de fonds sans se faire prendre, pour résoudre des problèmes de subsistance. Certaines de ces opérations constituaient des actes d’héroïsme. En l’absence de tout système officiel de crédit bancaire, des pères de famille prenaient de grands risques de « s’accorder des crédits » pour assurer l’avenir de leurs enfants, quitte à finir leurs jours en prison. On comprend que les détenus libérés étaient généralement fêtés par leur famille. Dans cette optique, la logique recommandait de rechercher des postes de gestion, parce qu’ils permettaient aux individus de « s’organiser » en vue d’assurer leur propre survie ainsi que celle des leurs. Un autre forme de libanga consistait à voyager à l’étranger, en Afrique ou de préférence en Europe – appelée en argot Miguel – pour signer une inscription scolaire, trouver un emploi même temporaire ou pour se faire déclarer « réfugié ». Le Congolais, confiné depuis la période coloniale à l’intérieur de ses frontières, découvrit les avantages du voyage. [89]
Mais le vrai libanga, dans l’acceptation première du terme, fut celui que le Zaïrois apprit des Ouest-Africains ; il consistait à se lancer dans la production artisanale du diamant pour le vendre aux courtiers étrangers. [90] Une étude de ce phénomène au Kasaï démontre qu’il a pris forme dès 1960, au lendemain des déplacements des populations luba vers Bakwanga (Kambayi B. et Mudinga M. 1991). Face à la misère qui les guettait, les immigrants reçurent de leurs leaders le mot d’ordre suivant : « Débrouillez-vous ; vous êtes chez vous ! ». [91] Les consignes se firent plus précises. « Creusez les grillons (diamants) mais évitez de pénétrer dans la zone de la Miba » (nkonga umbulayi mintuntu, kadi nuamanya kunubwedi mu buloba bwa Miba). Cette activité prit de l’ampleur et se structura : il y eut des spécialistes dans l’art de trouver des marchés et des courtiers. Une bonne partie des diamants fut ainsi écoulée frauduleusement. Rien qu’en 1983, en trois mois, à la seule porte de sortie de Brazzaville, auraient été écoulés 1 513 000 carats ; 245 000 en août, 500 000 en septembre, et 768 000 en octobre (Kambayi B. et Mudinga M., 1991 : 85). Une classe particulière de parvenus naquit, caractérisée par l’ostentation, l’arrogance et le goût du lucre. On les appela les Citanci c’est-à-dire, littéralement des personnes qui ont « grossi » au delà du seuil acceptable. Trop riches, généralement peu instruits, ces nouveaux maîtres se distinguèrent par leur sens de la démesure, ignorant l’épargne, la prévision et la planification. La découverte de nouveaux gisements dans le Kwango méridional et le Haut-Congo a donné une plus grande extension à ce phénomène entraînant l’abandon du travail agricole au profit de l’exploitation minière, et la démobilisation scolaire.
Dans cette « lutte pour soi », une autre stratégie payante était l’élaboration sinon la mise à l’honneur de structures de solidarité pour se prémunir contre la crise. Les associations « familiales » ou « tribales », en dépit de leur morphologie, ont presque toujours eu pour but essentiel « l’entraide ». Celle-ci était également recherchée au niveau professionnel ou entre amis. Les associations de likelemba se généralisèrent. Leurs membres mettaient en commun chaque mois une partie de leurs revenus qui constituait un fonds mis à la disposition de chacun des membres, à tour de rôle. En l’absence d’un système de crédit bancaire, ce fonds servait d’appoint pour autoriser à tour de rôle un achat important qui n’aurait pu être envisagé avec un seul revenu individuel.
Le retour au mysticisme se généralisa également. Il s’exprima d’abord par une pratique religieuse accrue dans les Eglises reconnues : « l’Eglise de Jésus-Christ sur la terre grâce au Prophète Simon Kimbangu », « l’Eglise du Christ au Zaïre » (regroupement des Eglises protestantes) et l’Eglise catholique. Depuis la période révolutionnaire, cette dernière avait acquis une vigueur nouvelle. La suppression des mouvements chrétiens avait favorisé une plus grande prise en charge des structures formelles : la paroisse, subdivisée en CEB (Communautés Ecclésiales de base) dépendant de responsables laïcs (Bakambi). Les vocations religieuses se firent plus nombreuses, témoignant d’une vitalité nouvelle.
L’Eglise kimbanguiste et l’Eglise du Christ au Zaïre, tout en connaissant le même phénomène, disposaient d’un atout supplémentaire parce qu’elles étaient plus ouvertes et plus tolérantes à l’égard des Eglises nouvelles (les sectes) qui se multipliaient, entraînant dans le mysticisme une bonne partie de ceux qui affichaient un certain scepticisme à l’égard des Eglises officielles. Le Bas-Congo et le Kasaï constituaient les deux grandes « terres saintes », d’où provenaient les prophètes qui propageaient des enseignements. La quête du peuple était ici plus claire : si on invoquait toujours Dieu par les ancêtres, on estimait que la prière devait être « rentable » dans le cadre d’un objectif précis, souvent porté à la connaissance de toute la communauté : une guérison, la recherche d’un emploi, la réussite d’un projet, l’arrangement d’un conflit, etc. L’Esprit-Saint (Mpeve ya Longo), qui venait s’exprimer par l’entremise d’un membre en transe, apportait bien souvent une réponse orale au problème, indiquant ce qu’il y avait à faire. La prière « utilitaire » pratiquée au cours de séances charismatiques était aussi bien le fait des catholiques que des protestants.
Les lettrés du pays, peu enclins à composer avec ces différentes structures, soit à cause de leur anticléricalisme soit à cause de leur rupture avec la base, trouvaient volontiers d’autres références pour assouvir ce même besoin qu’ils ressentaient visiblement eux aussi. C’est ainsi que les recettes ésotériques ou mystiques, diffusées au départ de l’Europe ou de l’Amérique, remportaient un grand succès, qu’il s’agisse des sectes millénaristes (Témoins de Jéhovah, Adventistes du 7e jour. Mormons), guérisseuses (Pentecôtisme), occultistes (astrologie) ou scientistes (Scientologie. Théo- sophie, Rose-Croix, Franc-maçonnerie). Les mystiques les plus populaires étaient orientalistes (Bahai, Sakai Mahikari, Bunmei Kyodan. Graal. Moonisme, etc).
Au sein de ces mystiques d’origine locale ou externe, le Zaïrois, qu’il fût de la bourgeoisie ou du peuple, cherchait à assouvir les mêmes besoins fondamentaux, accentués par la crise économique. Il entendait réagir, sur le plan personnel ou communautaire, à la crise morale et sociale par la quête d’un certain ascétisme. Si les « voies » nouvelles, ouvertes par les sectes, passaient pour être plus appropriées, c’est essentiellement parce qu’elles étaient plus exigeantes que les Eglises classiques. Presque toutes interdisaient la consommation d’alcool et imposaient la continence sexuelle. L’interdiction portait soit sur l’un de ces éléments soit sur les deux à la fois. Ceci explique qu’un nombre de plus en plus élevé de Zaïrois ait cessé à 1 époque de consommer de l’alcool et des cigarettes. En outre, les sectes étaient des lieux où se résolvaient, par le recours à la prière, les problèmes concrets des membres ; c’était du moins ce qu’elles prétendaient. Or chacun avait des problèmes. Si, pour les hauts cadres, les recettes religieuses permettaient de conserver le poste occupé, ou d’assurer la promotion à laquelle on aspirait depuis longtemps, pour les gens du peuple, elles autorisaient l’espoir de trouver un emploi, d’obtenir la sortie de prison d’un membre de la famille, d’anéantir la stérilité qui frappait une épouse ou de profiter d’un avantage financier quelconque. Par-dessus tout, fait symptomatique, toutes les sectes et toutes les Eglises guérissaient des maladies. On y recourait de plus en plus, dans une conjoncture où l’accès aux hôpitaux était devenu un privilège qui n’était plus à la portée de tous. Un dernier avantage lié à ce courant : l’individu se trouvait automatiquement introduit dans un réseau précis et concret de solidarité. Même si l’on ne trouvait pas de solution à un problème, l’adhésion à une secte intégrait l’individu dans une communauté qui le prenait en charge moralement et parfois même matériellement. L’entraide recherchée se réalisait bien souvent dans ce contexte. Les « groupes religieux » non seulement s’efforçaient de survivre et de prospérer mais tentaient également de se hisser, grâce à leurs membres, à un niveau social élevé ; ce faisant, on procurait une promotion à chacun. Dans cette logique, on recrutait des adeptes de préférence parmi les personnes les mieux placées dans la hiérarchie du pouvoir ; dès qu’un « frère en Christ » accédait à un poste, il ne manquait pas de recruter ses collaborateurs parmi les autres « frères en Christ », pour des raisons de sécurité et de partage.
On revenait de la sorte à l’importance de la solidarité dans la société congolaise d’aujourd’hui. La quête du succès ou d’une promotion sociale passait nécessairement par l’appartenance à un réseau précis d’ordre ethnique, religieux ou philosophique, sinon par une combinaison heureuse, et personnelle, de cet enchevêtrement de solidarités. En tout cas, loin d’être une « fuite » de la réalité concrète, la prolifération des sectes au Congo passait pour être une manière réaliste de limiter les effets de la crise et de connaître un certain bien-être, qui ne transparaissait certes pas dans les statistiques alarmantes des économies classiques.
Une autre panacée populaire contre la crise économique résidait dans l’engouement évident pour l’activité commerciale. La généralisation de cette activité était liée à l’insuffisance du revenu salarial qui ne permettait qu’à une infime minorité de se suffire à elle-même. L’activité commerciale était avant tout le fait de la femme, mariée ou célibataire, ayant un emploi ou non, parce quelle était plus préoccupée que l’homme de la survie de la famille, qu’elle soit biparentale ou monoparentale. Même si les hommes se situaient à l’arrière-plan de telles entreprises, celles-ci n’en étaient pas moins le fait des femmes. Un fonctionnaire, s’adonnant à une telle activité secondaire, aurait craint de compromettre son métier en s’affichant par ailleurs comme commerçant. Une telle polyvalence était non seulement interdite, mais elle laissait supposer aussi que le fonctionnaire était susceptible de détourner les fonds publics qu’il était censé manipuler en tant que fonctionnaire, pour alimenter son commerce. D’aucuns se sont laissé tenter par une telle combinaison, surtout lors de la zaïrianisation ; voilà pourquoi l’activité commerciale avait fini par être interdite aux grands commis de l’État, ce qui accrut le nombre de femmes versées dans le commerce. Il n’est guère étonnant que les meilleurs analyses du budget ménager des communautés urbaines du pays aient toutes abouti au constat que les ménages zaïrois dépensaient toujours plus que ne leur permettait leur revenu salarial. Le déficit était compensé entre autres par le travail de la femme ou par d’autres activités « informelles ». [92]
Ce commerce portait essentiellement sur deux secteurs : l’alimentation et l’habillement féminin. Dans le premier cas, les femmes du peuple vendaient de la bière, du pain, des beignets, de la chikwangue, de la farine ou du riz. Les dames de la haute société intervenaient à un niveau plus élevé, dans les circuits de distribution, en s’octroyant des quotas des denrées alimentaires ou autres, revendues plus chères aux détaillants. Par rapport au secteur alimentaire, celui de l’habillement était davantage réservé à la classe des fonctionnaires et une savante distribution des rôles s’était instaurée. Un premier groupe de femmes, notamment les épouses et les parents d’hommes politiques ainsi que les hôtesses d’Air-Zaïre se chargeaient de ramener au pays bijoux, pagnes et blouses à la mode. Ces produits passaient chez des détaillantes pour être revendus. Cette pratique provoqua finalement une grande circulation des « femmes zaïroises », reconnues désormais dans les villes africaines et européennes. En fait, une véritable « classe » de femmes commerçantes était à présent créée, exerçant le métier avec rigueur et disposant de partenaires commerciaux précis en Europe et dans les grandes villes d’Afrique. Dans le pays, elles s’organisèrent en associations, dont la plus puissante était l’AFECOZA (Association des femmes commerçantes du Zaïre).
Mais le revenu commercial n’était pas le seul élément d’appoint ; une autre ressource demeurait le partage imposé par le système familial en place. Ce partage demeurait de rigueur non seulement par solidarité familiale mais aussi et surtout par la nécessité, pour le bourgeois, de ne pas s’attirer les malédictions des aînés (oncles, pères, tantes et mères), ce qui aurait fait perdre l’espoir d’une promotion, ruiné une carrière, ou coûté la vie. Cet impérialisme de la famille, accentué par la crise, constituait une sorte de contestation du clivage en classes sociales qui se généralisait rapidement au Zaïre. La « solidarité familiale », d’après laquelle on était censé se préoccuper des parents se trouvant généralement au loin dans l’arrière-pays, se doubla alors d’un autre partage « à courte distance » imposé dans les milieux urbains. Au sein d’une même ville, le bourgeois était tenu de vivre un régime de promiscuité dans le cadre de la parenté urbaine, cette communauté regroupant les ressortissants de la même ethnie ou sous-ethnie sans tenir compte des liens réels qui unissaient ses membres. Sous peine d’être sanctionné, en étant rejeté de ce réseau de solidarité, finalement plus existentiel que la relation avec les parents réels mais restés au village, le bourgeois était obligé de se faire pardonner sa condition en apportant toujours une quote-part « digne de son rang » à l’occasion des deuils, des fêtes ou d’autres rencontres du groupe. Il était obligé de sortir constamment de son confort en recevant chez lui des visiteurs qui n’étaient pas de sa classe, et de partager avec eux ce confort.
Mais ce n’est pas tout, l’inévitable frivolité masculine, et le besoin de défoulement des uns et des autres amenèrent ces mêmes cadres à vivre cette autre forme de partage que constitue l’entretien d’épouses subsidiaires appelées « bureaux ». La bureaugamie, cette forme de polygamie urbaine, assurait de la sorte à une pluralité de femmes appelées «deuxièmes bureaux» une part de revenu, qui servait d’appoint à leur revenu propre pour assurer la subsistance de leurs familles monoparentales. Dès lors les partages se multiplièrent dans les centres urbains, en particulier à Kinshasa, qui compte des femmes en surnombre, par l’attrait de la ville mais aussi par les « rébellions » et autres guerres civiles qui, en décimant essentiellement la population masculine, provoquèrent une pénurie d’hommes. Les femmes émigrèrent vers les centres urbains, en quête de soutien. Parmi ces femmes promises à la « bureaugamie », on notait quelques différences dues aux distinctions existant entre traditions ethniques. Les femmes des régions septentrionales (Equateur, Haut-Congo), étaient moins prisonnières de la tradition que celles des régions méridionales (Bas-Congo, Bandundu, Kasaï) davantage contraintes, il y a quelques années encore, à n’épouser que des hommes de même ethnie. Les femmes du Nord, notamment les riveraines du Haut-Congo, jouissaient en revanche d’une longue tradition d’indépendance, nécessitée par l’expansion commerciale du XIXe siècle où, seules dans des pirogues, elles partaient pour des villages éloignés ; il leur arrivait même d’y demeurer et de se marier là-bas. Le calme acquis depuis la fin de la décennie 60 les autorisa à étendre cette zone de circulation ; elles émigrèrent volontiers vers les autres villes du pays, surtout à Kinshasa où elles constituaient, de par leur condition sociale et ethnique, des « deuxièmes bureaux » tout indiquées. En tout cas, ces formes diverses de partage spontanées atténuaient les effets de la crise, puisqu’elles visaient toutes à rendre l’individu plus autonome par rapport à son revenu strict.
L’espace de débrouillardise des hommes se situait généralement au loin. La route des pierres précieuses, on l’a vu, était connue. Elle menait d’abord vers les sites traditionnels de la Miba et de Kilo-Moto d’où l’on revenait transformé en « chômeur américain ». D’autres fortunes étaient bâties à partir des activités informelles des frontières. Le déploiement de la fraude tout au long des milliers de kilomètres de la frontière nationale et les fluctuations de la monnaie ont accumulé en ces lieux les conditions nécessaires à un enrichissement facile. Chaque frontière a développé un réseau spécialisé dans l’échange des biens et des monnaies avec le pays limitrophe. Avec le Congo/Brazza, la zone d’échange fut localisée à Kinshasa, au beach Ngobila et à Luozi. L’échange portait aussi bien sur les produits vivriers que sur les articles manufacturés revendiqués réciproquement par les deux populations, congolaise et zaïroise. Avec le Centrafrique, on notait une activité similaire au départ de l’Ubangi. L’huile de palme zaïroise était particulièrement recherchée en raison de son bas prix et 1 acquisition du CFA constituait en retour un gain important s’il était échangé au taux parallèle en zaïres. A la frontière méridionale, la fraude vers l’Angola, longtemps freinée à cause des guerres, connaissait un essor prometteur. Vers la Zambie, les commerçants de Lubumbashi, surtout ceux venus des zones de Katuba et du Kenya, se sont spécialisés dans la diffusion des produits zaïrois les plus prisés en Zambie. Ils ramenaient en retour des articles recherchés au Shaba : sucre, savon, produits pharmaceutiques, bunga (farine de maïs), tissus, etc. Mais le trafic le plus important se situait aux frontières de l’Ituri et du Nord-Kivu où s’était installé un véritable système de troc, pour contourner les difficultés d’échange de monnaies.
A la frontière avec le Soudan, au centre commercial appelé Base, à proximité du village Kengeri, le café et le thé sont échangés contre des postes de télévision, des radios, des pièces de rechange, voire des autos (Willame J.C. 1992 : 112-113).
Ce nouveau commerce à longue distance connaissait, comme au XVIIIe siècle, l’existence de ces populations marchandes. A l’instar des Luba au Kasaï, les Nande au Nord-Kivu ont acquis une position dominante, s’octroyant pratiquement le monopole du trafic de l’or et du café. Les centres de Béni et de Butembo abritaient ensemble pas moins de trois cents commerçants-entrepreneurs nande spécialisés dans ce trafic (Willame J.C. 1992 : 113). Tant d’initiatives, privées et collectives, contribuaient beaucoup à atténuer les effets de la crise ; elles visaient toutes à augmenter le revenu des salariés ou tout simplement à l’assurer, quand il faisait défaut.
Il existait une dernière stratégie populaire de mobilisation générale contre la crise ; elle était constituée par la somme des efforts extragouvernementaux menés par les ONG en faveur des marginalisés de l’économie capitaliste que sont les paysans. Au départ, cette action partit presque exclusivement des Eglises kimbanguistes, protestantes et catholiques, avec le soutien des organismes de charité : Caritas, Misereor international, Oxfam allemand, etc. Les évêques du pays firent de cette tendance une option de leur pastorale, instaurant au niveau de leur secrétariat, une commission épiscopale du développement. Cette commission se chargeait d’apporter un concours pastoral, matériel et technique, aux actions ponctuelles menées à travers les provinces ecclésiastiques et les diocèses. On soutenait les paysans dans leur effort pour relancer l’agriculture et pour vivre de leur travail. En ce sens, l’action d’éducation était importante pour démontrer au paysan l’importance du regroupement sous forme de coopératives ou d’autres communautés paysannes. L’éducation sanitaire fut également au programme, notamment à partir de l’expérience du docteur Courtejoie à Kangu et du matériel didactique produit par son équipe. [93] A Kananga, l’équipe de Mgr Bakole se consacra surtout à la culture du soja, cette céréale porteuse de protéines, dont la farine fut difficilement admise comme nourriture valable par le paysan. Mais l’expérience la plus typique, parce que la plus complète tant dans ses ambitions que dans ses réalisations, demeure le « Développement Progrès populaire » (DPP) d’Idiofa. Elle est née au lendemain de la rébellion de Mulele, quand les paysans firent le constat que la « deuxième indépendance » (la rébellion) n’avait pas été plus concluante que la « première » et qu ils étaient en fin de compte les grands perdants de l’aventure des hommes politiques. Le « Progrès Populaire » s’est investi dans la remise en état des infrastructures, dans 1 introduction de l’élevage du grand bétail, chose inconnue jusque-là dans cette région, dans 1 amélioration de l’agriculture par des cultures nouvelles. Vingt ans plus tard, le résultat obtenu était inespéré : la production du riz d Idiofa arrivait à point, pour suppléer à une carence alimentaire imprévue à Kinshasa et dans les autres centres urbains du Kasaï-Occidental (Tshikapa et Kananga).
L’efficacité des petits projets s’est avérée d’un concours précieux, d’autant que l’effet des grands projets se faisait attendre, aggravant la misère préexistante ; de plus, ils étaient essentiellement destinés à résoudre les pénuries existant au sein des régions à fortes concentrations humaines : Kinshasa et les zones minières du Shaba- Kasaï. C’était le cas du grand projet CEPSE (Centre d’Exécution des Programmes sociaux et économiques), lancé en 1974 en collaboration avec la Gécamines qui aurait dû rendre cette région du Shaba autosuffisante sur le plan alimentaire. Le gigantesque projet de Kaniama-Kasese financé par la Belgique, et les rizicultures établies par les Chinois n’avaient pas encore pleinement abouti. Visiblement, la solution alimentaire du Zaïre ne proviendrait pas, à court terme, des grands projets. C’est peut-être cette redécouverte de l’importance des petites et moyennes entreprises qui conduisit le Président à revoir son projet initial de création d’une ferme privée pilote à N’sele pour la transformer en un vaste Domaine agricole et industriel présidentiel de la N’sele (DAIPN). Ce domaine devait nourrir en poulets et en oeufs l’ensemble de la ville de Kinshasa et une partie de l’arrière-pays.
C’est la mobilisation de tous ces efforts qui permet au pays de subsister envers et contre tout.
La crise portait en elle les germes d’une explosion politique. Malgré l’énormité de ses ressources, nous l’avons dit, la mise en valeur de ce potentiel demeurait modeste. En 1980, le PIB global avait à peu près retrouvé le niveau qu’il avait atteint la veille de l’indépendance, mais avec une population doublée. [94] Dans de telles circonstances, aucune politique sociale digne de ce nom n’aurait pu se développer. La production nationale, à peine suffisante pour satisfaire tous les besoins, servit davantage à sécuriser les plus nantis et leur clientèle familiale et sociale. Cette richesse, étalée ostensiblement, joua le rôle d’un détonateur, dont les effets ne seraient réellement visibles sur le plan politique que quinze ans après le déclenchement de la crise.
4.1 De la contestation à l’opposition
Tout recommença avec les contestations estudiantines, qui réapparurent dès que se dissipa l’euphorie populaire qui saluait le changement du régime. De 1968 à 1971, comme on l’a vu, les manifestations se succédèrent et aboutirent à la nationalisation de l’Université. A l’effervescence estudiantine répondirent une succession de manifestations de mécontentement dans l’armée. Le complot dit du Kasaï-Occidental (1968) fut le premier d’une longue série, parmi lesquels il faut signaler celui qui fut ourdi contre la sûreté de l’État, quand en 1971 le général Bangala. Bomboko et Nendaka tombèrent en disgrâce. Il fut suivi en 1974 de la tentative de coup d’État réelle ou présumée de J. Kudiakubanza qui fut exhibé au stade, obligé à faire lui- même la lecture d’un document qui le déclarait coupable. En 1976, eut lieu le « coup monté et manqué » qui impliqua 41 militaires, dont des officiers supérieurs Tetela-Kusu (Otshudi, Kantshuva, Fallu, Omba). D’après le président, le complot aurait été monté avec la complicité de la CIA et impliquait également deux hommes politiques : Ndele et Tshomba, respectivement anciens ministres des Finances et des PTT. En 1978, il fut question d’un autre complot militaire mené par le major Kalume : quatre-vingt-onze personnes furent inculpées et 19 furent condamnées à mort : 13 d’entre elles furent passées effectivement par les armes. Les dénonciations de complots servirent chaque fois de prétextes à une épuration dans l’armée. Elle s’effectuait sous plusieurs autres formes, entre autres par des mises à la retraite anticipées. Les plus touchés étaient de jeunes officiers issus des Académies militaires étrangères. [95]
L’Eglise catholique, réduite provisoirement au silence lors de la période « révolutionnaire », revint à une attitude critique à l’égard du pouvoir. La première initiative vint de Kananga, où l’ancien vice-recteur de l’université Lovanium, devenu archevêque, diffusa un écrit critique au titre significatif : Chemin de libération (1978) [96]. Auparavant, l’archevêque de Lubumbashi. Mgr Kabanga, avait publié une lettre pastorale célèbre, intitulée Je suis un homme (1976) qui dénonça publiquement l’injustice sociale. A partir de là, les déclarations de l’Assemblée des évêques conservèrent ce ton. [97] Au sein même du parti, la contestation n’était pas exclue, à en juger par les changements fréquents et les mouvements inattendus. Le président lui- même ne se lassait pas d’adopter un ton critique, par tactique, pour banaliser le contre discours et conférer à sa politique une doublure démocratique. Le 24 novembre 1977, dans son allocution du 12e anniversaire du Nouveau Régime, il dénonça le « mal zaïrois », néologisme inspiré de l’exemple du « mal français » d’Alain Peyrefitte.
La contestation interne fut soutenue par l’apparition d’une littérature d’un genre nouveau originaire d’outre-mer, et qui rendit démodé le genre épique dont Lumumba était l’acteur principal et qui faisait recette jusque-là. Cette littérature fut inaugurée par le Fleurs du Congo de G. Althabe (1972) mais surtout par la célèbre Grande mystification du Congo – Kinshasa de C. Kamitatu Massamba (1971), dont le sous-titre était « les crimes de Mobutu ». [98] Vinrent ensuite les dénonciations de Jules Chômé, de l’ancien gouverneur Monguya Mbenge, sans oublier les écrits de Kalonga Kibwe et de Bwana Kabwe. [99] A l’époque, la situation zaïroise fournit à Gérard de Villiers le thème d’un roman policier dont le titre – Panique au Zaïre – en disait long.
Au-delà de la littérature, c’est une réelle opposition qui commença à prendre corps à l’étranger, particulièrement en France et en Belgique. Après la défaite du CNL en 1964-65, mouvement qui avait contrôlé une bonne partie du pays au départ de Kisangani en 1963, quelques-uns des militants se réfugièrent à l’étranger et restèrent insensibles aux différentes amnisties décrétées à Kinshasa. La suppression de l’UGEC en 1972, organisme qui comptait également des sections outre-mer, avait fait naître un mouvement parmi certains étudiants en Belgique, qui refusèrent d’être annexés à la JMPR. Ils s’organisèrent en un Mouvement National de Libération du Congo (MNLC). Ce regroupement des « étudiants congolais progressistes » éditait un organe d’information : Congo -Libération. Entre-temps, un nombre de plus en plus important de mécontents, contestant le régime en place, venait grossir les rangs de l’opposition. Les mouvements qui se déclaraient en lutte contre le régime se multiplièrent et se diversifièrent, bien que les anciens partis d’opposition qui existaient lors de la première législature estimaient toujours leur action clandestine. C’était le cas du PALU (Parti lumumbiste unifié) et du CNL (Conseil national de Libération).
Cette opposition s’était tue aussi longtemps qu’elle était désarmée politiquement par la croissance des années 70 et les initiatives fort tactiques du président, qui avait rallié l’Asie socialiste à sa cause. C’est en 1974, au moment où se manifestaient les premiers signes de la crise, que plusieurs groupes d’opposition se formèrent et commencèrent à agir en Europe. Cette action eut des retombées dans le pays. Le PRP, Parti de la Révolution Populaire, naquit, comme on l’a vu, des cendres du mouvement insurrectionnel du Haut-Congo de 1964. Laurent-Désiré Kabila réussit à implanter son mouvement dans le triangle Fizi-Baraka-Uvira, dans le Sud-Kivu, mais sans connaître un plus grand rayonnement, bien que par deux fois il parvînt à inquiéter le régime par les guerres de Moba, la première comme la seconde. Le MARC, Mouvement d’Action pour la Résurrection du Congo fut créé en 1974, à partir d’une dissidence de la JMPR/Belgique ; il parvint à rallier à sa cause certains anciens fonctionnaires, notamment l’ancien gouverneur Monguya. Le mouvement connut une dissidence interne qui aboutit en 1977 à la création de la CODESO, Convention des démocrates Socialistes. Puis ces mouvements d’opposition se démultiplièrent, à la manière des formations musicales de Kinshasa, de sorte qu’il était difficile d’établir un inventaire. [100] Cette multiplicité constituait déjà par elle-même une preuve de l’inefficacité de cette opposition et peut-être aussi de son manque d’attachement à la vraie cause du peuple (C.K. Lumuna Sando, 1980). Une critique peu complaisante estima que ces chefs d’opposition « ne souhaitaient pas voir le peuple arracher le pouvoir par sa propre force. Ce serait trop dangereux pour eux, ils risqueraient de ne pas y trouver leur place. Et que deviendraient leurs rêves de tenir un jour le levier de commande du pays ?… Le pouvoir, ils le voulaient sans partage, à tout prix… C’est pourquoi, il ne fallait pas effaroucher les gens avec lesquels ils pouvaient justement trouver un terrain d’entente : l’Occident, l’Amérique, les grandes multinationales ». [101]
Un groupe fit pourtant preuve d’une grande combativité ; il s’agit du FLNC (Front de Libération Nationale du Congo), mouvement politique qui fit son apparition en 1975, à l’issue d’une fusion entre le mouvement des réfugiés politiques de la deuxième République et le groupe des réfugiés katangais, une fois la sécession terminée. Comme on le sait, il existait des réfugiés militaires en Angola depuis 1963, des ex-gendarmes katangais. Ceux d’entre eux qui avaient refusé de réintégrer l’ANC, pour peu qu’ils n’aient pas trouvé d’emploi dans les mines de l’UMHK. s étaient volontiers exilés en Angola. C’était en quelque sorte une manière de trouver refuge chez d’autres frères Lunda et Cokwe. Le pouvoir colonial portugais leur fournit les armes nécessaires pour mener la contre-guérilla contre les mouvements nationalistes angolais en tant que troupes auxiliaires, tâche qui les maintenait dans les faits d’armes. On les appelait là-bas les « Flèches Noires ». Ce groupe fut grossi, plus tard, en 66-67, par le renfort de ces « gendarmes katangais » qui avaient choisi de rentrer au pays à l’appel de Tshombe, alors Premier ministre, et qui furent par la suite victimes des exactions de J.F. Manzikala, celui-là même qui fit régner une véritable terreur au Katanga, après la révocation de Munongo en décembre 1966 en tant que gouverneur. Ce gouverneur antikatangais était fui non seulement par les anciens membres de la « gendarmerie », mais aussi par des civils qui se sentaient persécutés. Nathanaël Bumba, président d’une « Amicale de Lunda », ancien commissaire de police à Kolwezi, démis de ses fonctions, puis emprisonné par le gouverneur Manzikala, préféra s’exiler en Angola après son évasion. [102]
A l’annonce de la guerre civile pour l’indépendance de l’Angola, les « Flèches Noires », sur le conseil des Portugais devenus socialistes, firent alliance avec le MPLA d’Agostinho Neto ; ils n’avaient aucun intérêt, en effet, à voir s’installer à Luanda un régime pro-zaïrois. L’alliance avec le MPLA eut un effet double : il conduisit ce parti plus sûrement à la victoire et, en retour, encouragea la « politisation » des réfugiés, déterminés désormais à combattre l’impérialisme et à le poursuivre même au-delà de la frontière angolaise au Zaïre.
Dans la nouvelle conscientisation politique, les partisans du groupe firent remonter la naissance de leur organisation, le « Front de Libération Nationale du Congo », au mois de juin 1968, voire en janvier 1963, soit à la fin de la sécession katangaise, bien qu’il n’ait été opérationnel qu’à partir de 1975. Nathanaël Bumba, le plus haut gradé parmi les exilés, qui avait pu bénéficier d’une formation militaire complémentaire à Lisbonne, à l’époque de la lutte contre la guérilla, en était le chef incontesté. Il était bien introduit auprès des milieux du MPLA, d’autant qu’il était l’un des principaux artisans de la victoire qui avait mené ce parti au pouvoir.
Venues des camps situés dans le nord-est de l’Angola, les colonnes des forces armées du FLNC, soutenues par les Cubains et les éléments des FAPLA (armée du MPLA), pénétrèrent au Shaba en 1977 par deux axes : le premier suivit la voie ferrée Lobito-Lubumbashi dans la direction est, le second partit de Kapanga vers le nord, en direction de Kaniama. Opposés à une armée mal encadrée suite à des épurations nombreuses, mal équipée, et soutenus par des complicités locales, les attaquants emportèrent assez aisément la victoire. Kasaji fut occupée le 13 mars, Mutshatsha, le 25. Il faudrait l’intervention des unités marocaines, appuyées par une logistique française, belge et américaine pour repousser les envahisseurs. La reprise de Kapanga, le 28 mai, marque la fin de cette première guerre du Shaba, la guerre de 80 jours, qui, malgré l’intervention marocaine, n’était que partie remise.
Un an plus tard éclata, en effet, la guerre du Shaba. Le samedi 14 mai à l’aube, le FNLC pénétra à nouveau au Katanga, cette fois par la Zambie alors qu’on ne surveillait que la frontière angolaise. Décidé à se venger de l’échec antérieur, il envahit la ville minière de Kolwezi, et endommagea les installations de la Gécamines, principale source de revenus du pays. [103]
Une fois de plus, l’Occident vola au secours du régime, en larguant des parachutistes français et belges à Kolwezi. [104] La veille de cette intervention, le 18 mai, le commandant en chef des FAZ ordonna le repli de ses troupes. Plus tard, Français et Belges furent remplacés sur le terrain par une « force interafricaine » composée de contingents marocains, sénégalais et togolais. Jamais l’opposition n’avait été si près du but. Seulement elle avait commis une grave erreur : aucune action extérieure n’avait jusque-là réussi à renverser à elle seule un régime politique en Afrique. Quand bien même elle y serait parvenue, elle n’aurait pas été cohérente dans son action, étant donné que le FLNC, trop sûr de la victoire, avait rejeté les offres d’alliance des autres mouvements d’opposition. Le FLNC lui-même parvint à peine à survivre à la guerre puisque sur le plan politique, il se scinda en deux tendances : les « modérés » et les « durs », tandis que sur le plan militaire, il ne subsista que par petits groupes, dont certains se rallièrent à l’UNITA, après la réconciliation de l’Angola avec le Zaïre, pour combattre le pouvoir angolais de Luanda. Le temps du FLNC était passé. Vint ensuite celui du PRP. Kabila refit, en effet, surface en novembre 1984, décidé à entamer sa « guerre de libération ». Avec ses commandos venus de la Tanzanie, il investit Moba pendant trois jours. Sur le plan tactique, le projet tenait. Si Moba était occupé, Kalemie, pris à revers, ne pouvait résister longtemps, coincé qu’il serait entre Hewa Bora et Moba. Et une fois installé sur les cimes de l’ensemble des monts Mitumba, Kabila ne pouvait en être délogé facilement. A partir de ce fief du Nord-Katanga, il irait, avec ses troupes, à la conquête des villes du sud : Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, etc. Mais le projet tourna court. Tous, ils furent obligés de se replier. On revint sur le métier en 1985. A partir d’Hewa Bora, une nouvelle attaque fut lancée sur Moba. Mais, une fois de plus, les guérilleros furent mis en déroute. La première tentative de déclenchement de la « guerre de libération » avait échoué. Kabila, contraint à l’errance en Tanzanie, allait attendre un moment plus favorable pour réapparaître.
Conscient du danger que représentait ce foyer de tension, l’Occident entreprit d’aider le Zaïre à se réconcilier avec l’Angola, à partir de juin 1978, ce qui correspondait aux désirs de l’Angola, confronté à des problèmes de reconstruction du pays et ruiné par la guerre civile. Nous l’avons vu, des accords furent conclus dès juillet 78 qui assuraient la sécurité à la frontière sous l’autorité de l’OUA, et l’établissement d’une coopération dans le domaine des transports commerciaux et de la culture ainsi que le rapatriement des réfugiés avec l’aide de l’ONU. Les exportations zaïroises reprirent par la voie angolaise en 1981.
Cette guerre eut un impact politique. En juillet 77, après la » guerre de 80 jours », le régime politique se prêta volontiers à l’autocritique, désireux de faire peau neuve. Le poste de « premier commissaire d’État » (Premier ministre), supprimé depuis 1966, fut établi, de même que le principe d’élection au suffrage universel direct et secret pour les choix des commissaires du peuple et des commissaires politiques. Un des théoriciens du régime, professeur de sciences administratives et ancien directeur de l’Institut Makanda Kabobi, Mpinga Kasenda, fut nommé premier commissaire d’État ; il sera remplacé quelques années plus tard à la tête du gouvernement par l’ancien syndicaliste Bo-Boliko Lokonga. Nguz a karl i Bond, commissaire d’État aux Affaires étrangères au moment de la première guerre du Shaba, fut condamné à mort en 1977 pour complicité avec le FNLC ; puis, libéré en 1979 après que sa peine eut été commuée en détention à perpétuité. Il accédera à ce même poste en août 1980 et le quittera peu après, à l’occasion d’un voyage privé en Belgique, pour rejoindre les rangs de l’opposition.
Quant aux commissaires du peuple, issus de la nouvelle démocratie de 1977, ils se distinguèrent par leur esprit critique, ayant été autorisés à exercer un droit de contrôle sur le Conseil exécutif et le Conseil judiciaire. Ce pouvoir, ils l’exercèrent consciencieusement, en procédant à des interpellations des membres de l’Exécutif national. La séance du 27 décembre 1979 fut le cadre d’une sorte de procès public du régime, qui fut retransmis en direct à la radio et à la télévision. On y dénonça les erreurs de gestion et la corruption sous ses différentes formes. Le pouvoir dut réprimer cette tendance, exagérée à son goût, en précisant que les dossiers d’interpellation devraient désormais être préalablement soumis à l’accord explicite du chef de l’État. Le pouvoir parvint de la sorte à éviter de justesse ce qu’il considérait comme étant un débordement par la gauche. Mais la brèche était faite, et ne cessait de s’agrandir.
La gauche parlementaire, muselée au niveau du Conseil législatif trouva un nouveau moyen de se faire entendre. Une « lettre ouverte » signée par treize de ses membres fut envoyée au maréchal pour dénoncer l’inadéquation entre le « Manifeste de la N’sele » et la situation concrète du pays, et pour revendiquer des réformes importantes dans la gestion du pays. Tout le programme futur y était déjà présenté y compris la précitée « Conférence nationale ». [105]
Le Zaïre appartient aux 25 millions de Zaïrois. Les millions de personnes que nous croyons représenter légitimement ou qui sympathisent avec nous, sont d’avis qu’un changement profond et immédiat doit s’opérer dans notre société, avant qu’il ne soit trop tard. Le changement implique la refonte complète des structures du pays, la jouissance effective de toutes les libertés politiques et démocratiques, principalement la liberté d’association et la liberté de presse. Pour être valables et durables, ces réformes ne peuvent intervenir qu’à l’issue d’un débat national réunissant autour d’une même table, non seulement les élus du Peuple mais aussi les représentants es différentes opinions politiques, où qu’ils se trouvent, désignés librement par les groupes qui les délèguent.
Cette initiative fut mal accueillie. Les auteurs de la lettre furent déchus de leurs privilèges parlementaires et arrêtés. Libérés sous la pression des organismes internationaux des droits de l’Homme, certains furent séduits par les charmes du pouvoir tandis que d’autres, parmi lesquels Tshisekedi, choisirent de rester fidèles à leur opinion première.
Une initiative nouvelle vint s’inscrire dans cette optique : le 15 janvier 1982.
Tshisekedi et ses amis fondèrent un parti politique, «Union pour la Démocratie et le Progrès social » (UDPS). Le mouvement de contestation, prenant une expression politique précise, se mua dès lors en une opposition réelle, même si jusqu’en 1990 elle serait clandestine parce que réprimée par les pouvoirs publics.
Un coup dur fut porté au régime du MPR avec le transfuge de [ancien premier commissaire d’État Nguz a Karl i Bond. Il persuada l’opinion internationale que Mobutu, le dénonciateur du « mal zairois », en était lui-même «!incarnation »(1982). Le témoignage de l’ancien héraut du MPR, bien connu dans les capitales occidentales où il s’était tissé un puissant réseau d amis alors qu’il détenait le portefeuille des Affaires Etrangères, passait pour être crédible. D autres témoignages allèrent dans le même sens, notamment les « révélations » sur le mode de gestion des finances publiques faites par E. Blumenthal, fonctionnaire du Fonds monétaire international. au terme de sa mission à Kinshasa auprès de la Banque Nationale [106]. Les informations sur la fortune de Mobutu à l’étranger [107]. ses investissements immobiliers, les prélèvements scandaleux opérés sur la réserve des devises [108]. autant d’accusations fondées ou non, qui entamèrent sérieusement la crédibilité du Président.
Un autre mal rongeait de l’intérieur le régime mobutien: le mysticisme. La vie politique nationale subissait quotidiennement l’impérialisme des sorciers et des marabouts. On savait, depuis la période coloniale, qu’en dépit de la christianisation tous azimuts, le peuple congolais n avait jamais oublié ses recettes magico-religieuses traditionnelles qui l’aidaient à se prémunir contre les assauts de l’adversité. Ces recettes avaient été mises simplement en veilleuse. Dans la guerre révolutionnaire des années 60, on a vu combien les militants y recouraient, n’ayant pratiquement rien d’autre à opposer à l’offensive gouvernementale. Avec la radicalisation de la crise économique, l’instabilité gouvernementale permanente et la quête effrénée de la nomination politique, il devint habituel de recourir à cette forme de sécurisation. Les grosses cylindrées qui, pendant la journée, faisaient la fierté des plus grandes artères de la capitale, se retrouvaient volontiers le soir dans les quartiers obscurs de la périphérie urbaine. Les hauts fonctionnaires y étaient en consultation auprès de leurs protecteurs. La veille des remaniements ministériels, il n’était pas rare de trouver des ministres en veillée dans les taudis de la ville, en extase dans les cimetières ou chez eux, dans des positions étranges, exécutant à la lettre les « prescriptions » des sorciers. Les plus fortunés parmi ces quémandeurs de nomination politique n’hésitaient pas à recourir aux sciences occultes extérieures, qu’elles soient occidentales, orientales ou simplement africaines. L’intervention extérieure la plus courante était celle des marabouts ouest-africains qui y trouvèrent l’occasion d’accroître leur commerce illicite des pierres précieuses. L’or et le diamant devinrent la monnaie la plus courante dans le règlement des notes de consultation des marabouts.
A la fin de la décennie 80, suite à la radicalisation de la crise économique, une évolution se fit jour dans la gestion du mysticisme zaïrois. L’échec du maraboutage et de la sorcellerie suscita un engouement nouveau pour les christianismes, vécus particulièrement en groupes de prière », dans les multiples Eglises du pays, nouvelles et anciennes, d’origine locale ou étrangère. Le phénomène touchait aussi bien le bas peuple que les cadres supérieurs. Les anciens lieutenants du président, « convertis à Jésus» – notamment Bofossa W Ambea et Sakombi Inongo – ne se gênèrent pas pour dénoncer auprès de leurs « frères et sœurs en Christ », les égarements passés. Grâce à ces confidences, l’opinion prit conscience de l’ampleur du phénomène qui, visiblement, avait miné de l’intérieur, depuis des années, l’ère mobutienne. L’ancien gouverneur de la Banque du Zaïre, Bofossa, qui connut une carrière fulgurante au cours de cette période, explique combien il devint prisonnier de la magie et du maraboutage au point d’être réduit à une vie mécanique et asphyxiante :
J’ai pratiquement visité tous les cimetières de Kinshasa pour chercher la puissance auprès des Morts( .. .) Dieu seul sait ce que j’ai enduré au titre de sacrifice par-ci, par-là, parce que, quand vous entrez dans cette vie-là, curieusement vous cherchez le bonheur, mais vous menez une vie sans repos parce qu’à 8 heures il faut faire cela, à 21 heures il faut être à tel cimetière, à 23 heures à tel autre, à 3 heures du matin dans la brousse pour parler avec les Esprits. Dieu seul sait combien de têtes de chèvres j’ai enterrées chez moi à la maison, en brousse, dans certains lieux stratégiques de la ville de Kinshasa et même dans certaines villes du pays pour que l’on tremble, partout où l’on entendait le nom de Bofossa.
Mobutu lui-même ressentit ce besoin général d’être sécurisé dans le domaine supranaturel. Plus que tout autre cadre politique, il avait besoin de protection contre les ennemis et les adversaires visibles et invisibles, les brebis galeuses dissimulées dans son entourage, les opposants réels ou présumés ; il avait besoin d’être guidé, dans son comportement et ses initiatives, pour accroître son succès auprès du peuple et son rayonnement international, recruter les collaborateurs les plus efficients etc. Dès le début de son régime, il fut préoccupé par l’idée de faire converger vers sa personne l’ensemble des multiples savoirs mystiques des ethnies congolaises. Il se fit donc introniser chef coutumier où il put et s’octroya le plus grand nombre d’attributs traditionnels d’origines diverses : cannes, anneaux, couvre-chefs etc. On était encore dans la fièvre de l’authenticité. Il fallait jouer le jeu à fond.
Dans la suite, sans doute devant la persistance de l’insécurité politique et sociale, Mobutu chercha visiblement à récupérer, dans chaque ordre mystique. la part de force supranaturelle qu’il pouvait lui apporter. A l’égard du catholicisme, il tint à soigner son apparence de chrétien modèle, non sans une certaine dose de sincérité, tout en évacuant la mauvaise conscience qui pouvait résulter de ce comportement ambigu où la pratique chrétienne coexistait avec l’utilisation de recettes magiques. L’Eglise catholique même se fit quelque peu complice de cette confusion, puisque les messes solennelles présidentielles alternaient avec des séances incantatoires des marabouts. Cependant, l’ampleur toujours grandissante de la crise devait amener Mobutu, au cours de la décennie 80, à faire aveu d’impuissance, sans doute mêlée de désespoir, à recourir davantage au savoir-faire des marabouts, sans doute sur le conseil de chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest. Cette pratique éclectique se transforma peu à peu en passion puis en esclavage. Qu’ils s’appellent Kebe. Doucouré. Cissé ou Kaké, ces marabouts sénégalais et guinéens savaient qu’ils disposaient d’un pouvoir terrible sur le président. Ils pouvaient lui arracher n’importe quelle décision et bâtir les fortunes les plus colossales en un tour de main.
Un ancien agent des services secrets, Emmanuel Dungia (1992 :46-48). a fourni des détails révélateurs sur le comportement « irrationnel » du président Mobutu, complètement désemparé suite à la nouvelle de la victoire du socialiste F. Mitterand aux élections présidentielles de 1981. Il fallait à tout prix « travailler » le successeur de Valéry Giscard d’Estaing, l’apprivoiser, l’envoûter afin que la France continue à être favorable à la cause du Zaïre. Cette mission, d’intérêt national, fut confiée à quatre marabouts (le chiffre avait son importance) parmi lesquels les Sénégalais Kebe et Cissé. Les séquences de l’envoûtement furent structurées en fonction de la première rencontre de Mobutu avec Mitterand, qui devait avoir lieu à Paris le 3 novembre 1981, lors du sommet franco-africain. Deux semaines plus tôt commencèrent les préparatifs magiques prescrits par les marabouts. Le jour de l’audience, tout se passa à merveille. Le président Mitterand fut enfin apprivoisé. Le coût de la victoire fut salé pour les caisses de la République : 4 millions de dollars, en plus des lingots d’or.
Vers 1985, le Zaïre donna l’impression d’être dans l’impasse. Chacun cherchait à résoudre ses propres problèmes de subsistance, parfois même au détriment de l’intérêt collectif : sans le savoir, chacun devenait ainsi l’artisan de son propre malheur. L’État zaïrois passait pour être une réalité abandonnée de tous, sauf lorsqu’elle servait d’« instrument » nécessaire pour aboutir à des fins personnelles. En effet, au niveau des pouvoirs publics, certaines structures politiques et économiques n’étaient créées que pour faire plaisir à des individus, ou encore pour liquider des règlements de comptes ; d’autres permettaient à certains privilégiés de résoudre leurs problèmes personnels. Aucune norme n’était acquise de manière absolue. La sagesse populaire élabora ainsi un certain nombre de principes dénonçant cet État fictif. Le fonctionnaire ne devait jamais trop s’adonner au travail car « le travail de l’État ne se terminait jamais » (mosala ya leta esilaka te). Au don Quichotte qui aurait contredit ce propos, on rappelait que le relèvement du Zaïre était bien éloigné dans le temps ! « Celui qui doit redresser cette société n’est pas encore né » (moto akobongisa mboka oyo, naino abotami te !). [109]
La situation sociale était devenue explosive. Les ambitions sociales du régime de 1965 avait échoué. Le maréchal Mobutu avait prétendu mettre l’homme au centre de sa révolution ; prisonnier de la mafia qui s’était formée autour de lui, il dut s’avouer impuissant et reconnaître son échec en qualifiant son troisième mandat (1984-91) de « septennat du social ». Le programme qu’il présentait alignait les bonnes résolutions. Mais que pouvait-on faire en pleine crise économique, dès lors que « les vaches grasses » avaient été investies dans tout autre chose que la réhabilitation socio-économique du citoyen ? C’est au cours de cette dépression qu’apparurent les signes avant-coureurs d’un changement. Ils se manifestèrent à différents niveaux.
En 1986, se tint le 4e Congrès ordinaire du MPR. Ce Congrès se distingua particulièrement par son appel pathétique au changement. Le mot d’ordre à l’honneur était : « tout doit changer, tout va changer ! ». Et le président d’ajouter que la crise vécue était essentiellement une question d’hommes, donc de mentalité. Il fallait que le cadre fasse preuve de dépassement de soi, qu’il se sente responsable du bonheur et du mieux-être du peuple. Les structures politiques subirent une fois de plus des transformations dans l’espoir d’éviter des dérapages et d’assurer un contrôle strict de l’ensemble de la vie nationale. Le changement ne survint pas pour autant. Il fallait plus qu’une simple réforme et qu’une déclaration de bonnes intentions pour faire sortir le régime du carcan dont il s’était fait lui-même le prisonnier.
Un autre signe avant-coureur émana des milieux intellectuels, soucieux d’engager une réflexion active sur les racines profondes de la crise. En novembre 1985, le deuxième Colloque de l’AMOZA (Association des Moralistes Zaïrois) préféra s’interroger sur la « crise morale, vie économique au Zaïre ». Cette réflexion incita les chercheurs de l’université de Kinshasa à entrevoir la possibilité d’organiser en mars 1987 un colloque national sur le thème de «la crise de l’économie zaïroise et la recherche de nouvelles bases pour le développement national ». On espérait trouver ainsi des réponses à trois questions fondamentales : la nature de la crise zaïroise, ses causes profondes, et les possibilités d’y remédier. Cette analyse fut profonde, et la critique fondée, de sorte que cette démarche inquiéta les pouvoirs publics. Le maréchal Mobutu jugea nécessaire de réunir tous les participants à N’sele à l’issue des travaux, pour leur donner à son tour son opinion sur ce débat. Son argumentation aboutissait à la conclusion que l’universitaire avait été lui aussi un agent de la crise, que pour cette raison, il ne pouvait être aussi sévère dans son analyse de la pratique sociale zaïroise. C’était là une manière de contester la pertinence de l’analyse qui avait été faite, et dont les résultats rejoignaient cependant ceux d’autres études menées ailleurs. [110]
La XXVIe Assemblée plénière de l’épiscopat du Zaïre (septembre 1988) fut consacrée au thème général « Le chrétien et le développement de la nation ». Cette Assemblée procéda à une analyse générale de la situation. On y évoqua une fois de plus la nécessité d’une transformation radicale. « Le temps n’est-il pas venu pour que tous ceux qui jouissent d’une parcelle d’autorité acceptent de clarifier leur conduite et leur attitude vis-à-vis de cette crise tragique et persistante que connaît notre pays ! (…) Nous sommes convaincus que la droiture des mœurs tant morales et politiques qu’intellectuelles est la condition de santé de la société. Il nous faut donc œuvrer à la fois à la conversion des mœurs et à l’amélioration des structures qui souvent freinent le progrès. On devrait affecter à cette tâche des hommes bien formés intellectuellement et moralement, et non des flatteurs en mal de pouvoir qui croient que le fait de paraître « bon militant » et de bien parler suffit pour mériter d’être promu et maintenu à la tête des institutions publiques (…). Nous demandons aux dirigeants du pays de restituer aux institutions nationales leur autonomie et leur pouvoir de décision et de rétablir le sens de l’autorité responsable conçue non pas comme source d’enrichissement ou comme moyen de brimade ou d’exploitation du peuple, mais comme service ». [111]
Un autre signe de l’appel au changement se manifesta comme noté plus haut, par une plus grande participation du comportement social général ou courant religieux. L’engouement constaté dès le début de la crise s’était encore accentué, et plutôt dans les « Eglises nouvelles » d’origine locale ou étrangère, plus dynamiques que les Eglises traditionnelles. C’est dans ces circonstances que les courants scientistes et philosophiques cédèrent peu à peu le pas devant la Bible. Le phénomène s’afficha ouvertement partout ; des slogans se retrouvaient sur des autocollants appliqués sur les voitures, les tables de travail, des attachés-cases, etc. Les médias officiels diffusèrent des messages publicitaires pour des croisades et des campagnes d’évangélisation. Prophètes et pasteurs se multiplièrent à travers le pays. Le peuple zaïrois se mit de plus en plus à pratiquer l’ascétisme ; de même les séances de prière se généralisèrent, s’organisant même dans le cadre d’édifices prestigieux, tels le « Palais du Peuple », l’Hôtel Intercontinental, la FIKIN ou la Cité de la N’sele. Ces prières publiques étaient émaillées de « témoignages » de conversions spectaculaires, même des « officiers » et des cadres importants du pays y participaient. D’aucuns annonçaient que la fin des temps était proche, et qu’elle se manifesterait par l’apparition du sida et la persistance de la misère.
Le discours général était donc au diapason du spectacle par la situation sociale. On espérait une mutation profonde. Les « derniers jours » de la période mobutienne étaient effectivement arrivés. Seul manquait le déclic qui provoquerait ce bouleversement. Il vint finalement de l’Europe de l’Est où la fin de l’empire soviétique, baptisé « perestroïka », provoqua des transformations profondes et imprévues jusqu’au Zaïre.
Le maréchal Mobutu eut tort, dans un premier temps, de déclarer hâtivement, à la fin de l’année 1989, que le Zaïre n’était nullement concerné par ces événements. Il se ravisa bien vite et, le 14 janvier 1990, annonça pompeusement qu’il allait procéder à des consultations populaires pour connaître la « volonté du peuple » quant à l’organisation générale du pays. Sans doute espérait-il des changements sur mesure, susceptibles d’enrayer des transformations incontrôlées qui risqueraient d’intervenir. Toujours est-il que le mouvement connut un succès inattendu mais révélateur de l’importance des attentes zaïroises : 6 128 formulaires furent dénombrés en réponse à la requête présidentielle, avec des critiques sévères et des propositions de solutions impitoyables à l’égard du régime. Le discours le plus intraitable émanait curieusement des fonctionnaires de l’État, ces auxiliaires de la politique qui, pendant des décennies, avaient été réduits au silence. Dans leurs suggestions, ils alignèrent des propositions audacieuses : dissolution de la Constitution, suppression du MPR et de ses organes, reconnaissance du multipartisme, convocation d’une Conférence nationale, mise en place d’un gouvernement provisoire, rédaction d’une nouvelle Constitution et son adoption par voie de référendum sous l’égide de l’ONU et de l’OUA, organisation des élections présidentielles, législatives et locales.
Au président lui-même, on proposa ceci : « …après avoir réussi la pacification et l’unification du pays durant 25 ans de pouvoir sans partage, de faire comme Jésus qui après une mission de 33 ans sur terre a dit en levant la tête : Père tout est accompli ». [112]
Mobutu répondit à ces réclamations le 24 avril 1990. Cette date avait été choisie pour la symbolique du chiffre 4, considéré par le président comme un porte-bonheur. [113] Il annonça dans son discours qu’une série de mesures avaient été prises parmi lesquelles le suppression de la Constitution, le renvoi du gouvernement (Kengo) en place, la réhabilitation du multipartisme mais à trois, le « congé » du président par rapport au MPR, la libération vestimentaire. Peu après, à la suite de pressions, certaines mesures furent revues et renforcées : le multipartisme n’était plus limité à trois mais intégral (6 octobre 1990) ; la conférence nationale souveraine, réclamée pendant de longs mois, fut enfin promise. Mais entre le 24 avril 1990 et cette échéance, la transition fut laborieuse. Elle connut des dérapages et fit des martyrs, entre autres à Lubumbashi (les étudiants de l’université) et à Mbuji-Mayi (les militants de l’UDPS).
Pourtant, l’idée du changement semblait se préciser. Il passait par une reconversion des mentalités, la mise en place d’une nouvelle constitution et l’organisation d’élections libres et démocratiques. Le déblocage de la situation socio-économique supposait en effet la libération de la créativité populaire et l’élaboration d’un plan de développement qui soit une rentabilité efficiente des ressources du pays, au service de ses habitants. Le peuple zaïrois était-il prêt à le réaliser ? L’avenir le dirait. Pour l’heure, le renouveau national, préfigurant l’avènement de la 3e République, se manifestait, notamment dans le domaine de la presse et surtout dans celui des partis politiques. Dès le 25 avril, une série d’organes de la presse écrite avaient vu le jour. D’emblée, la terminologie des nouveaux titres choisis frappe. A l’exception de quelques cas (Umoja, Nzadi, Nzoi, Ekeseni), et d’anciens journaux qui préexistaient (Salongo, Elima, Mambenga, Taifa, Mwanga, Jua, Boyoma, etc), la presse de la Troisième République semble avoir choisi de tirer ses appelations du registre francophone, en réaction sans doute aux excès de la politique de l’authenticité. Ainsi naquirent, au lendemain du changement, les hebdomadaires La Semaine, le Phare, le Potentiel, le Soft de Finance, l’Evénement, l’Opinion, la Conscience et d’autres organes bimensuels, mensuels et trimestriels : L’analyste, Demain le Congo, la Différence, la Nouvelle Lanterne, la Référence, la Relève, la Vérité, Lumière, Présence, le Grognon pour ne citer que ceux-là. Plus que les titres, le discours brille d’un éclat nouveau, critique, voire pédant. Peu d’entre eux sont liés, de manière explicite, à des partis politiques et quelques-uns dissimulent à peine leur obédience gouvernementale (Salongo, Nzadi, Mambenga) mais la plupart se rallient à une optique critique (le Phare, le Potentiel, la Semaine) et parfois hypercritique (Umoja, le Grognon).
L’évolution des partis politiques est plus complexe. Ils se multiplièrent dès l’instant où il fut permis de dépasser le multipartisme à trois. Plus de trois cents partis politiques furent créés. On peut les classer de différentes manières. L’une d’entre elles distingue les partis de la « vraie opposition » de ceux qui ne seraient que des annexes du MPR, forgés de toutes pièces par le pouvoir pour faire diversion et noyauter l’opposition par une majorité numérique faite d’opportunistes. Ceux-ci furent qualifiés de « partis alimentaires » puisqu’ils furent créés en vue de faire fortune.
Tableau 29 — Aperçu des premiers partis politiques agréés
| N° | DENOMINATION | SIGLE | PRESIDENT | N »ARRETE MINISTÉRIEL |
| 1 | Mouvement Populaire de la Révolution | MPR | (N’singa Udju) Mobutu Sese Seko |
91-024 |
| 2 | Union des fédéralistes et des Républicains Indépendants | UFERI | Nguz-a-Karl I Bond | 91-025 |
| 3 | Front Commun des Nationalistes | FCN | Mandungu Bula N. / Ka- manda wa Kamanda | 91-026 |
| 4 | Convention Nationale des Démocrates pour un Ordre Nouveau | CONDOR | Kabaidi wa Kabaidi | 91-027 |
| 5 | Alliance des Démocrates pour le Développement National et la Défense des Libertés |
ADDL | Kawata B. | 91-028 |
| 6 | Parti Démocratique pour le Développement Communautaire | PADDECOM | Mwana-Nteba | 91-029 |
| 7 | Parti Démocratique | PD | Ukoko Upikadio | 91-030 |
| 8 | Convention Démocratique pour le Développement | CDD | Nyindu Kilenge | 91-031 |
| 9 | Union Sociétaire pour le Développement INtégral | USDI | Binda Phumu M. | 91-032 |
| 10 | Centre d’échange et de Regroupement Africain | CEREA | Weregemere Na-N | 91-033 |
| 11 | Parti pour la Solidarité des Indépendants et des Paysans | PSIP | Ndangiankasa | 91-034 |
| 12 | Alliance Nationale des Démocrates pour la Reconstruction | ANADER | Kumbu Ki-Lutete | 91-035 |
| 13 | Alliance des Bâtisseurs du Zaïre | ABAZi | MayambaTashar | 91-045 |
| 14 | Parti du Peuple Uni | PPU | Matunda Lumina | 91-046 |
| 15 | Parti des Nationalistes Fédéralistes | PNF | Kisimba Ngoy | 91-048 |
| 16 | Union pour la Démocratie et le Progrès Social | UDPS | Kibassa Maliba | 91-049 |
| 17 | Mouvement National Lumumba | MNL | Gbenye | 91-050 |
| 18 | Rassemblement Démocratique pour la République | RDR | Mungul-Diaka | 91-051 |
| 19 | Parti Démocratique et Social Chrétien | PDSC | lleo Songo-Amba | 91-053 |
| 20 | Rassemblement des Libéraux pour le Progrès | RLP | Tala-Ngai Elima | 91-087 |
| 21 | Parti National pour le Développement Rural | PANADERU | Kanda-a-Mukor | 91-088 |
| 22 | Parti Social Africain | PSA | Jibi Ngoy | 91-089 |
| 23 | Démocratie Chrétienne Fédéraliste | DCF | Ngoma Ngabu | 91-090 |
| 24 | Union Démocratique Africaine | UDA | Kalala Mukinay | 91-091 |
| 25 | Front National pour le Salut de la République | FNSR | Kashasa Mwenda | 91-093 |
| 27 | Parti Social Démocrate | PSD | Mokede | 91-094 |
| 28 | Jeunesse Républicaine du Zaïre | JR | Munga Mukayi | 91-102 |
| 29 | Eveil National pour le Redressement et le Développement | ENRD | Tshiamanga Katshi | 91-103 |
| 30 | Front de Libération Nationale du Zaïre | FLNZ | MakindaWata-Wata | 91-104 |
| 31 | Mouvement de Solidarité pour le Développement | MSD | Mutuza Kabe | 91-105 |
| 32 | Parti Progressiste pour l’Intégration de la Jeunesse Montante | PIJM | Namumba Lenghe | 91-106 |
| 33 | Parti Libéral pour le Développement | PLD | Lumbu-Lumbu | 91-107 |
| 34 | Parti Libéral Chrétien | PLC | Hamaweja M. | 91-108 |
| 35 | Forum National pour la Démocratie | FND | Massamba ma M. | 91-109 |
| 36 | Mouvement National de la Communauté Lumumbiste | MNC/L | Ngoy Nduba K. | 91-110 |
| 37 | Parti National Africain | PNA | Mutuza Bravabame | 91-111 |
| 38 | Alliance des Sociaux Démocrates | ASOD | Tshobo-i-Ngoma | 91-112 |
| 39 | Mouvement National des Compatriotes Rénovés | MNCR | Nepa B.M. | 91-113 |
| 40 | Mouvement d’Action pour le Réveil de la Conscience | MARC | Kanyonga B.L | 91-114 |
| 41 | Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le Développement Intégral | RPDI | Mukenge Ndibu | 91-115 |
| 42 | Union Nationale Progressiste de la Jeunesse | UNPJ | Kinzonzi D. | 91-116 |
| 43 | Alliance de Base pour l’Action Commune | ABACO | Mabanda S. | 91-117 |
| 44 | Parti Néo-Chrétien Démocratique | PNCD | – | 91-118 |
| 45 | Parti Démocrate Nouvelle Génération Politique | PDN | Mwinyi Hanza B. | 91-119 |
| 46 | Parti National du Renouveau pour le Développement | PNRD | Kutubisa B.K. | 91-120 |
| 47 | Alliance Démocratique Fédérale et Sociale | ADF | Nlandu Ndo-E | 91-121 |
| 48 | Parti National du Développement Communautaire | PNDC | Musawo Mbayo | 91-122 |
| 49 | Mouvement Nationaliste Démocrate | MND | Kitete Kekumba | 91-123 |
| 50 | Alliance Nationale pour la République | ANR | Kikila Kikomula | 91-124 |
| 51 | Rassemblement Démocratique pour le Développement | RDD | Namegabe M. | 91-125 |
| 52 | Mouvement Populaire Africain | MPA | Mwema Nsingi | 91-126 |
| 53 | Union Républicaine pour le Développement du Zaïre | URDZ | Futa Mudiambula | 91-127 |
| 54 | Alliance des Démocrates pour le Renouveau | ADR | Kasalambi T.M. | 91-131 |
| 55 | Convention Nationale Chrétienne de Rassemblement pour la Solidarité et le Partage | CNCR | Tshilolo M. | 91-132 |
| 56 | Parti Social et Libéral | PSL | Monanga wa N. | 91-133 |
| 57 | Parti National pour la Liberté, la Démocratie et pour le Progrès | PLDP | Kapena M. 91-134 | |
| 58 | Union des Socio-nationalistes | USN | Weregemere B. | 91-135 |
| 59 | Parti du Peuple pour le Développement Economique et Social | PDES | Mutombo N. | 91-136 |
| 60 | Forum des Démocrates pour le Renouveau | FDR | KadimawaKadima | 91-140 |
| 61 | Rassemblement des Démocrates Libéraux | RDL | Mwamba Mulunda | 91-141 |
| 62 | Parti national pour le Renouveau | PNR | Ehombo Baseko | 91-142 |
| 63 | Union pour la Démocratie et le Progrès Social – Direction Politique Rénovée | DPR | NtumbaboM. | 91-149 |
| 64 | Parti Démocrate Islamique | PDI | ElongowaC. | 91-150 |
| 65 | Parti pour la Conscience Nationale | PACONA | Kalombo Yombo | I 91-15 |
| 66 | Ligue pour la Qualité de la Vie | LV | Mboma Kiri-K. | 91-152 |
| 67 | Union Nationale pour la Liberté et le Développement | UNLD | Kabange N.M. | 91-192 |
| 68 | Parti Socialiste du Zaïre | PSZ | Ngbanso Djobo | 91-193 |
| 69 | Parti de la protection d’Allah et Son Prophète Mahomed Roi Souverain |
PAPRA- HODORE |
DjumaAnambeku | 91-19 |
| 70 | Mouvement National de la Convention Lumumba Originelle |
MNC/L Originel |
Mende Omalanga | 91-195 |
| 71 | Front national zaïrois | FNZ | Kalemba Kakoba | 91-196 |
| 72 | Front Patriotique Uni | FPU | KalalaTuikale | 91-197 |
| 73 | Parti du Redressement National | PRN | Ndua Sachiman | 91-198 |
| 74 | Parti Démocratique et Social | PADES | Kakez Ekir | 91-199 |
| 75 | Les Forces Nouvelles du Progrès | FNP | Kadimba M.B. | 91-200 |
| 76 | Parti Progressiste Africain | PPA | Kambuyi M.M. | 91-201 |
| 77 | Organisation des Démocrates Autonomes du Peuple pour le Renouveau | ODAPR | Citondo Koni | 91-202 |
| 78 | Rassemblement Politique Islamique | RPI | Saleh bin Saleh | 91-203 |
| 79 | Front Patriotique pour le Renouveau | « Front Pa- Triotique » |
KinkelaVi Kan’sy | 91-204 |
| 80 | Jeunesse Libérale Progressiste | JLP | Tshibwabwa M. | 91-250 |
| 81 | Parti pour la Liberté et le Progrès | PLP | Phoba-did-Panzu | 91-251 |
| 82 | Parti Lumubiste Unifié | PALU | Gizenga Antoine | 91-252 |
| 83 | Parti des Unitaristes Progressistes | PUP | Kisimba M. | 91-253 |
| 84 | Rassemblement Général des paysans pour le Renouveau | RGPR | Mbombo wa K. | 91-254 |
| 85 | Mouvement National des Combattants Lumumbistes Authentiques |
MNCL/AU | Ekongo 0. | 91-255 |
| 86 | Parti National Social démocrate | PNSND | Mangala M.N. | 91-256 |
| 87 | Rassemblement des Nationalistes Lumumbistes Démocrates |
RNLD | Tshiefu Empenge | 91-257 |
| 88 | Front Islamique Démocratique du salut national | FIDSN | Kumbi Aziz | 91-258 |
| 89 | Parti des Intégristes Zaïrois | PIZ | Ngelezi Mashingu | 91-259 |
| 90 | Rassemblement de Solidarité Juvénile | RSJ | Mena Lufua | 91-260 |
| 91 | Congrès national pour l’Unité | CNU | Amuri Kizito | 91-261 |
| 92 | Union pour la Défense des Consommateurs | UDECO | Munongo Mwepu | 91-262 |
| 93 | Rassemblement du Peuple déshérité | RPD | Likata Ngandi B. | 91-263 |
| 94 | Karuya | Karuya | Kabuya Karamato | 91-264 |
| 95 | Convention pour la Réconciliation et la Confiance Nationale | CRCN | Kimvuela L. Bakul | 91-265 |
| 96 | Mouvement de Solidarité pour le Progrès Social | MSPS | Inoka Bongenya | 91-266 |
| 97 | Mouvement National pour le Progrès Social | MNPS | Mumbeya Kisonde | 91-267 |
| 98 | Rassemblement du Peuple pour la Reconstruction Nationale | RPRN | Lukezo Luansi | 91-268 |
| 99 | Rassemblement pour la Démocratie Sociale | RDS | Lukombo D.N. | 91-269 |
| 100 | Mouvement de Réveil pour la Conscience nationale | MRCN | Zuato Kombese | 91-270 |
| 101 | Front Républicain | FR | Lupumba Kamanda | 91-271 |
| 102 | Mouvement des nationalistes du cartel des Jeunes Indépendants | MNCPI | Tabu Ngena L. | 91-272 |
| 103 | Forces Ouvrières nationalistes | FON | Mbong-I-Ber | 91-273 |
| 104 | Fédération des Associations Culturelles du Zaïre | FAC | Kandolo Mukeni | 91-274 |
| 105 | Association Zaïroise pour la Promotion des Valeurs Culturelles | AZAPR0VAC | Binda Sapwe | 91-275 |
| 106 | Convention nationale de Développement | CND | Kabamba llunga | 91-276 |
| 107 | Front Unifié du Salut | FUS | Muembamba | 91-277 |
| 108 | Rassemblement pour le bien Commun | RBC | Kalunga wa N. | 91-278 |
| 109 | Parti Zaïrois de Développement | PZD | Motompe mwa L | 91-279 |
| 110 | Union des Nationalistes Progressistes | UNP | Ekengo Limba | 91-280 |
| 111 | Parti Socialiste | « Les Socia- Listes » |
Nzamba N.W. | 91-302 |
| 112 | Rassemblement des Jeunes Nationalistes | RJN | Bolamba M.A. | 91-303 |
| 113 | Alliance pour la Défense des Acquis du Mobutisme | ADAM | Baramoto Kpama Kata | 91-304 |
| 114 | Solidarité pour le Développement National | SODENA | Muhunga M.N. | 91-305 |
| 115 | Parti pour l’Unité Nationale | PUNA | Abou LB. | 91-306 |
| 16 | Mouvement des Combattants Socialistes | MCS | Mashiku V. | 91-307 |
| 117 | Parti Travailliste pour la Reconstruction | PTR | Mbomba N.B. | 91-308 |
| 118 | Solidarité | « Solidarité » | Kibu T.T. | 91-309 |
| 119 | Mouvement d’Union Nationale pour le Développement Intégral | MUNDI | Tshinema K. | 91-310 |
| 120 | Fédération Libérale pour la Renaissance | FLD | Masunda M. | 91-311 |
| 121 | Union Chrétienne pour le Renouveau de la Justice | UCRJ | Mukuba B. | 91-312 |
| 122 | Parti du Peuple pour la Démocratie Sociale | PPDS | Mpondja B. | 91-397 |
| 123 | Convention des Alliances Communautaires Africaines |
COACA | Kabamba wa Kabamba | 91-398 |
| 124 | La Nouvelle Alliance pour le Progrès de la Démocratie | NAPD | Mwema M.L. | 91-399 |
| 125 | Rassemblement des Démocrates Progressistes | RDP | Gamu-Kuba | 91-400 |
| 126 | Mouvement des Jeunes Radicaux | MJR | Amisso Lombe | 91-401 |
| 127 | Rassemblement des ouvriers et paysans | RDP | Selenge Molondo | 91-412 |
| 128 | Mouvement pour la Nouvelle République | MNR | Manziambo M. | 91-402 |
| 129 | Rassemblement National Démocratique | RND | Noie Munini Martine | 91-403 |
| 130 | Force Populaire Africaine | FPA | Sophie Zala L. Nkanza | 91-404 |
| 131 | Rassemblement des Jeunes pour la Reconstruction de la République | RJR | Tshiashala M.B. | 91-405 |
| 132 | Alliance des paysans indépendants | API | Bakajika Bantu | 91-406 |
| 133 | Mouvement des Réformistes Démocrates | MRD | Milegha wa B. | 91-407 |
| 134 | Organisation du Peuple pour la Démocratie et le Progrès | OPDP | Mulumba K. | 91-408 |
| 135 | Mouvement National de Combat pour la Liberté, la Démocratie et le Développement | MNCLD | 91-409 | |
| 136 | Parti pour la démocratie et la liberté totale | PDLT | Mpoyi Bakishi | 91-410 |
| 137 | Union des Démocrates Indépendants | UDI | Thambwe Mwamba | 91-411 |
Un autre clivage, perceptible au niveau de la conscience collective, est celui qui démarque les partis « unitaristes » des « fédéralistes ». Il repose sur le vieux débat des années 60 à propos de la forme de l’État. Les « unitaristes » regroupaient non seulement le MPR mais aussi et surtout des partis qui se réclamaient de la sensibilité « nationaliste », donc « lumumbiste » : PALU, FCN, MNC, MNC/L, MNC/O. Le fédéralisme recueillait une plus grande sympathie populaire car il s’opposait radicalement à la centralisation à outrance de la période mobutienne avec son cortège d’abus. Il est important de noter que plusieurs formations politiques décidèrent de faire référence à ce choix dans leur appellation officielle : UFER1 (Union des Fédéralistes et des Républicains Indépendants), DCF (Démocratie chrétienne Fédéraliste), PNF (Partis des Nationalistes Fédéralistes), ADF (Alliance Démocratique Fédéraliste) etc.
D’autres typologies peuvent également y être appliquées. Par rapport à l’ordre politique ancien qui a prévalu avant 1965, on pouvait distinguer les partis dont les racines profondes relevaient de cette première expérience de démocratisation, de ceux créés de toutes pièces au lendemain du 24 avril 1990, sans référence à des créations anciennes. Dans la première catégorie se rangent certes les partis d’obédience lumumbiste, mais aussi certains autres (ABAKO, ABAZI, P.S.A., etc.) dont les anciens sigles conservés portaient toutefois de nouvelles significations. Ainsi l’ABACO n’était plus « Alliance des Bakongo » mais plutôt « Alliance de Base pour 1 Action Commune » ; « Alliance des Bayanzi » (ABAZI) avait fait également peau neuve pour devenir « Alliance des Bâtisseurs du Zaïre ». Dans la foulée, le CEREA (Centre de Regroupement Africain) était devenu le « Centre d’Echange et de Regroupement Africain », le PSA (Parti Solidaire Africain) le « Parti Social Africain », le MNC/L (Mouvement National Congolais-Lumumba), le « Mouvement national de la Communauté Lumumbiste » et la COACA (COAKA, Coalition kasaïenne), la « Convention des Alliances Communautaires Africaines ». Le trait d’union entre l’ancien et le nouveau parti était garanti, sauf exception, par la filiation des nouveaux responsables aux anciens, le changement de façade ayant été rendu nécessaire soit par adaptation au contexte nouveau, soit par souci d’évacuer les motivations anciennes. Les partis de création récente firent appel à des recettes nouvelles. Même le MARC (Mouvement d’Action pour la Résurrection du Congo), créé à la faveur de la lutte contre la dictature à l’étranger, allait se transformer en « Mouvement d’Action pour le Réveil de la Conscience ».
L’engouement religieux suscita la création de certains, par conviction ou par opportunisme, pour exploiter un créneau à la mode. Ainsi s’explique l’existence de plusieurs partis « chrétiens « : PDSC (Parti Démocratique et Social Chrétien), DCF (Démocratie chrétienne Fédéraliste), PNCD (Parti Néo-Chrétien Démocratique), PLC (Parti libéral chrétien), CNCR (Convention Nationale chrétienne de Rassemblement pour la Solidarité et le Partage). La promotion du monde rural ou de la jeunesse constitua d’autres centres d’intérêt qui justifièrent quelques autres créations. Tel est le cas du PSIP (Parti pour la Solidarité des Indépendants et des Paysans), PNDC (Parti National du Développement Communautaire), PDES (Parti du Peuple pour le Développement Economique et Social), RDP (Rassemblement des Ouvriers et Paysans), API (Alliance des Paysans Indépendants) ou encore de JLP (Jeunesse libérale Progressiste), RSJ (Rassemblement de Solidarité Juvénile), RJN (Rassemblement des Jeunes Nationalistes), MJR (Rassemblement des Jeunes Radicaux). RJR (Rassemblement des Jeunes pour la Reconstruction de la République).
Dans cette nouvelle redistribution des rôles politiques, les partis les plus radicaux dans la revendication du changement ne se recrutèrent pas tant parmi les anciennes formations qui luttaient depuis longtemps dans l’exil (MARC, FLNC. MNCL, PALU). A l’exception de l’UDPS de E. Tshisekedi, le fer de lance de l’opposition radicale, se trouvait dans les nouvelles formations politiques, y compris celles formées par les anciens « compagnons » du maréchal-président. Tel est le cas du PDSC de J. Ileo, de l’UDI de Kengo wa Dondo et de Thambwe Mwamba. du FCN de Kamanda wa Kamanda. Etait-ce une confirmation a posteriori du caractère douteux de cette opposition taillée sur mesure et dont le combat se limitait à quelques écrits contre Mobutu à Bruxelles ou à Paris ?
L’ouverture de la Conférence nationale souveraine (7 août 1991) et surtout la mise en place du Bureau définitif de cette Conférence (décembre 1991) vint confirmer enfin qu’un processus irréversible s’était réellement déclenché et que le Zaïre était enfin promis à un changement qui avait l’ambition d’être radical et total [114]. Le ton fut donné par l’interpellation du peuple zaïrois dès l’installation officielle de ce bureau le 24 avril 1992. Son président, Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, président de la Conférence épiscopale du Zaïre, dont la candidature à la tête de la CNS avait été violemment combattue par le pouvoir, posa cette triple interrogation qui annonçait à la fois la fin d’un ordre politique et social et la naissance d’un autre :
Dieu nous interpelle en ces termes : Peuple zaïrois ! Je vous ai donné un pays merveilleux. Je l’ai doté des richesses inouïes et enviées tant pour ce qui est du sol que du sous-sol et d’une population saine et robuste. Qu ‘avez- vous fait pour que ce pays merveilleux devienne ce qu ‘il est aujourd’hui ? La nation africaine nous interpelle à son tour : Peuple zaïrois, avec les richesses dont tu disposes, tu devrais pouvoir non seulement t’assurer une vie décente mais aussi être en mesure d’assister les populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais comment as-tu fait pour que ta population se retrouve aujourd’hui plus pauvre que la plus pauvre d’Afrique ?
Et le monde nous interpelle à son tour en ces termes : « Le solidarité internationale s’est montrée autrement généreuse à ton égard, peuple zaïrois. Mais comment se fait-il que son aide n’ait profité en grande partie qu’à quelques groupes au lieu de la grande masse de la population ?
Et que répondrons-nous à ces interpellations, nous peuple zaïrois réuni en Conférence ? A notre avis, nous dirons à Dieu, à la Nation africaine et à l’Histoire que nous nous engageons à tout faire pour que tout cela change…
4.3 La conférence nationale souveraine
Le changement ! Ce mot devient vraiment magique. Il fit recette comme naguère la révolution, le nationalisme ou l’indépendance !… Les formations politiques et sociales « progressistes » préféraient s’en réclamer ostensiblement en prenant le nom de « Forces acquises au changement » par opposition aux courants « conservateurs et révisionnistes » – les Forces du statu quo – bien que ceux-ci se défendissent de rechercher eux aussi le changement. Sur le plan pratique, le fait significatif fut précisément l’avènement de la cartellisation politique qui succéda rapidement à la poussée anarchique des partis politiques au lendemain du 24 avril 1990. La poussée de ces cartels ne fut pas seulement informelle car les deux camps en présence pensèrent à s’organiser. Le MPR et ses alliés d’une part, l’UDPS et les siens d’autre part. Un clivage classique vit ainsi le jour, opposant la Mouvance présidentielle (MP) à l’Union sacrée de l’opposition (USO). Entre ces deux pôles se développa un Centre ramifié au moins en deux tendances : le centre-droit et le centre-gauche, suivant les accointances avec la Mouvance Présidentielle et l’Union Sacrée de l’Opposition. C’est dans ce cadre intermédiaire qu’il faut classer les autres regroupements politiques qui se constituèrent, notamment le Collectif Progressiste (C.P.), le Front Uni de l’Opposition (FUO), l’Association des Forces acquises au Changement Intégral (AFICI), l’Union Sacrée Libérale et Démocratique (USLD) qui est une dissidence de l’Union Sacrée, l’Union des Forces Nationales Lumumbistes (UFONAL), l’Union des Forces Indépendantes pour le Changement (UFIC)… Ces regroupements n’étaient pas donnés une fois pour toutes : ils furent l’objet de révisions successives suivant les circonstances et les intérêts. Les divisions furent fréquentes. Même le front de l’opposition à Mobutu enregistra des dissidences de l’Union Sacrée Libérale et Démocratique (USLD) et de l’Union Sacrée pro-rupture (USPR) qui devinrent distinctes de l’Union Sacrée de l’Opposition Radicale (USOR). D’autre part, ce mode de clivage ne fut pas à l’abri des contestations extrapolitiques, comme celle de la solidarité régionale et tribale prompte à des mobilisations « toutes tendances politiques confondues » dans le but d’appréhender des problèmes locaux et élaborer des stratégies politiques indispensables pour faire prévaloir au niveau national des préoccupations régionales.
Tableau 30 — Plates-formes politiques à la Conférence Nationale Souveraine
| DÉNOMINATION | SIGLE | TENDANCE POLITIQUE |
IMPORTANCE NUMÉRIQUE EN % |
|
| 1. | Alliance des Forces Islamiques pour le changement | AFIC | C | 0,2 |
| 2. | Union des Forces Indépendantes pour le Changement Intégral | AFICI | C | 19 |
| 3. | Collectif Progressiste | CP | C.G. | 8 |
| 4. | Front Uni de l’Opposition | FUO | C.G. | 4 |
| 5. | Groupe du Consensus Acquis au Changement | GCAC | CD | 2 |
| 6. | Mouvance Présidentielle | MP | D | 15 |
| 7. | Union des Forces Centristes | UFC | CD | 1 |
| 8. | Union des Forces Indépendantes pour le Changement | UFIC | CD | 3 |
| 9. | Union des Forces Nationalistes Lumumbistes | UFONAL | C | 0,8 |
| 10. | Union Sacrée de l’Opposition Libérale et Démocratique | USLD | CD | 5 |
| 11. | Union Sacrée de l’Opposition (Radicale) | USO | G. | 42 |
(NB/C = Centre ; D = Droite ; G = gauche).
Quel est le visage du changement revendiqué ? Vers quel destin évolue la société nationale ? Pour jeter un coup d’œil sous le voile qui se lève, il faut suivre la trajectoire entamée le 24 avril 1990. Le cheminement de la Deuxième à la Troisième République a exigé, en définitive, deux étapes intermédiaires : celle de la prétransition consacrée à l’élaboration de nouveaux principes de gestion de la République et celle de la transition chargée de la mise en place des animateurs de la Troisième République. La première phase de la prétransition a abouti à la tenue d’une imposante « Conférence nationale souveraine ». Au cours de celle-ci non seulement ces nouveaux principes de gestion ont été formulés, mais les conditions de fonctionnement de la transition ont été fixées par la mise en place de l’outil juridique régissant cette période intermédiaire, l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la transition, par celle d’un nouvel Exécutif présidé par E. Tshisekedi wa Mulumba [115] et celle d’une nouvelle Assemblée nationale, le Haut Conseil de la République, tous issus de la CNS [116].
Au moment où la transition était censée démarrer, s’ouvrit une période de crise ; le programme mis en place subit la contestation virulente du maréchal Mobutu et de l’ensemble de la famille politique présidentielle. Cette seconde phase de la prétransition aboutit à de nouveaux compromis dans lesquels les prévisions de la transition déjà arrêtées connurent des réajustements. Une nouvelle Charte de la transition fut élaborée, un nouveau parlement, le Haut Conseil de la République-Parlement de transition (HCR-PT) fut mis en place, de même qu’un nouveau gouvernement présidé non plus par Tshisekedi mais par Kengo wa Dondo. La Transition pouvait enfin démarrer, du moins en principe, avec pour objectif majeur l’adoption de la Constitution de la Troisième République et de l’organisation des élections à tous les niveaux.
Au vu de cet itinéraire, la Conférence Nationale Souveraine doit être considérée comme le temps fort qui a balisé le passage de l’ancien au nouvel ordre politique. Non seulement elle a été l’instance d’élaboration et de planification du devenir mais les événements qui l’ont suivie n’ont été qu’une manière de poursuivre le débat et d’exercer des pressions pour retarder le démarrage de la transition proprement dite, en attendant la prise en compte des points de vue qui passaient jusque-là pour être négligés ou minimisés, à tort ou à raison. En deçà et au-delà de ce moment historique, l’évolution a connu beaucoup de convulsions, que ce soit pour empêcher sa tenue, pour exercer un contrôle sur ses conclusions en cours d’élaboration ou encore pour empêcher que ses décisions et recommandations ne soient mises en application avant que celles-ci n’aient pris en charge les points de vue des forces conservatrices. L.D. Kabila allait mettre un terme à ce jeu politique.
La prétransition, dans sa double phase, a donc été une période de grande turbulence politique accumulant les spectacles de désordre et de chaos. Au niveau de l’exécutif, on assista à la valse d’une demi-douzaine de gouvernements rien qu’à la première phase. Le premier gouvernement de transition de Lunda Bululu, l’ancien secrétaire exécutif de la Communauté Economique des États d’Afrique Centrale (CEEAC) (du 25 avril 1990 au 15 mars 1991) fut suivi par le gouvernement de transition élargi de Mulumba Lukoji, choisi lui aussi comme Premier ministre en vertu de ses qualités d’expert international (du 30 mars au 30 septembre 1991 [117]. A ces deux professeurs d’université succéda peu après Etienne Tshisekedi à la tête d’un gouvernement de salut public, gouvernement qui rappela celui de Moïse Tshombe en 1964 par sa composition réduite et son recours exclusif à de nouvelles figures politiques à la tête des ministères. Mais cette équipe ne vécut que le temps d’être formée. Elle fut révoquée peu après à cause d’un désaccord sur la formule de prestation de serment. Le rapprochement du leader de l’opposition avec Mobutu s’était sans doute réalisé trop hâtivement à la suite des négociations superficielles (Palais de Marbre I) qui eurent lieu entre la Mouvance présidentielle et l’Opposition, sous la pression morale d’une effervescence militaire dont on parlera plus loin. Cette équipe fut donc remplacée par le gouvernement de combat de Bernadin Mungul- Diaka, qui vint au secours du pouvoir en place pour le sortir de l’impasse (du 23 octobre au 25 novembre 1991). Peu après, de nouvelles négociations (Palais de Marbre 11), par lesquelles l’Opposition escomptait voir Tshisekedi regagner le fauteuil de la primature, conduisirent plutôt à la nomination de Ngunz a Karl i Bond à la tête d’un gouvernement dit de large union nationale (du 25 novembre 1991 au 15 août 1992). Ce second transfuge de l’Opposition après Mungul-Diaka ne suscita pas d’avantage l’adhésion populaire à son action. La Conférence Nationale souveraine vint finalement renouveler la confiance populaire à Tshisekedi, leader de l’UDPS. L’événement constitua un symbole important. Pour la première fois depuis le 24 novembre 1965, quelqu’un accédait à la primature par voie d’élection et non par la volonté du président Mobutu (Tableau 31).
La seconde phase de prétransition, qui avait démarré après la CNS, fut plus laborieuse encore car la nation frisa l’éclatement. L’éviction de l’élu de la CNS par Mobutu donna le signal du dédoublement des institutions en 1993 au nom du clivage qui s’instaura entre la légalité provenant de la CNS et la légalité de fait. D’un côté, la Charte de Transition de la CNS, le HCR et le Gouvernement Tshisekedi ; de l’autre, l’ancienne institution, l’ancien parlement ressuscité et le collège des Secrétaires généraux investi des pouvoirs gouvernementaux. Un Conclave politique convoqué par le président procéda à une révision unilatérale de l’Acte constitutionnel de la CNS qui fut promulgué par le président de la République le 2 avril 1993 sous le signe de l’Acte constitutionnel harmonisé. La mise en place tout aussi unilatérale d’un gouvernement « d’Union nationale et de salut public » présidé par Faustin Birindwa, un ancien « compagnon » de Tshisekedi, consomma la rupture entre la famille politique présidentielle et l’Opposition. La médiation de l’ONU fut nécessaire, par l’intervention d’un envoyé spécial de son secrétaire général, l’Algérien Lakdhar Brahimi, pour que des négociations puissent s’engager à nouveau entre la coalition présidentielle organisée en « Forces Politiques du Conclave » (FPC) et l’Union Sacrée de l’Opposition Radicale et ses Alliés (USORAL). Le protocole d’Accord relatif aux Concertations politiques, signé le 11 janvier 1994 par les deux parties, ainsi que l’Arrangement Particulier relatif au partage équitable et équilibré du pouvoir, conduisit à une nouvelle charte de la transition, l’Acte Constitutionnel de la Transition, qui fut promulguée le 9 avril 1994.Un nouveau parlement de transition, le Haut Conseil de la République – Parlement de Transition (HCR-PT) fut constitué par l’élargissement de l’ancien Haut Conseil aux anciens commissaires du peuple et aux délégués à la négociation qui avait conduit à cet accord. Le choix du Premier ministre « issu de l’Opposition » suscita nombre de controverses qui aboutirent non pas à la reconduction de l’élu de la CNS mais plutôt à l’élection au sein du HCR-PT d’un nouveau Premier ministre, Léon Kengo wa Dondo dont le gouvernement reçut l’investiture le 11 juillet 1994.
Tableau 31 — Gouvernements de la période de transition
| Gouvernements | Premiers ministres | Durée | |
| 1. | Gouvernement de la transition | V. Lunda-Bululu | avril 1990-mars 1991 |
| 2. | Gouvernement d’union nationale | C. Mulumba Lukoji | mars 1991-septembre 1991 |
| 3. | Gouvernement | E. Tshisekedi | septembre-octobre 1991 |
| de Salut Public | wa Mulumba* | ||
| 4. | Gouvernement de Combat | B. Mungul-Diaka | octobre-novembre 1991 |
| 5. | Gouvernement de large union nationale | J.Nguz a Karl i Bond | novembre 1991 -août 1992 |
| 6. | Gouvernement issu de la CNS | E. Tshisekedi wa Mulumba | août-décembre 1992 |
| 7. | Collège des Secrétaires généraux | N. Zushi Mupiemina | décembre 92-mars 93 |
| 8. | Gouvernement de Salut Public et de large union nationale | F. Birindwa | mars 1993-juillet 1994 |
| 7. | Gouvernement de la transition | L. Kengo wa Dondo | juillet 94-mars 97 |
| 8. | Gouvernement d’Etat d’urgence | Likulia Bolongo | avril-mai 1997 |
* Tshisekedi a été nommé Premier ministre, pour la première fois, en juillet 1991, mais il déclina l’offre. Son gouvernement « issu de la CNS » (n° 6), malgré sa révocation en décembre 1992 par le maréchal Mobutu, a estimé être toujours en fonction jusqu’au 3 avril 1997, date à laquelle il fut « remanié ». à la suite d’une nouvelle nomination comme Premier ministre à laquelle succéda une ultime révocation.
La prétransition avait également accumulé une succession de drames. Cette descente aux enfers commença avec le « massacre » des étudiants de Lubumbashi (11-12 mai 1990) en représailles contre les excès que ces étudiants avaient commis à l’endroit de leurs camarades jugés complices du pouvoir en place. Elle s’était poursuivie avec le « pillage » par les militaires de la ville de Kinshasa (22-23 septembre 1991). L’exploit avait été réédité ensuite dans les principales villes du pays, assénant le coup de grâce à une économie déjà fort malade. Mais les troubles les plus importants avaient éclaté sous le gouvernement Nguz qui tissa une stratégie politique subtile sur base de la menace d’une réédition possible de la sécession katangaise. Dans ce cadre, pour affaiblir la position de ses anciens camarades de l’Opposition Radicale, devenus ses adversaires politiques, il s’était employé à attiser le vieux conflit katangais, toujours latent depuis 1957, mettant aux prises les « katangais authentiques » avec les « envahisseurs » luba venus du Kasaï, les frères ethniques de Tshisekedi et l’on avait compté des milliers de victimes, sommés de quitter le Katanga, abandonnant leurs biens et traqués par les originaires. Entretemps, un pseudo-coup d’État eut lieu en janvier 1992 à la Cité de la Voix du Zaïre. S’agissait-il d’un montage réalisé pour confondre l’Opposition ? Etait-ce l’initiative d’un groupe de soldats trop zélés, mécontents de la suspension des travaux de la CNS qui improvisèrent le projet d’investir la Cité de « la Voix du Zaïre » ? Toujours est-il que cet incident avait fourni au gouvernement, à l’époque, le prétexte nécessaire pour confirmer la fermeture de la CNS réalisée quelques jours plus tôt. Il accusa l’Opposition de chercher à prendre le pouvoir par la force [118]. Puis était venu le grave incident qui conduisit à la répression sanglante d’une marche pacifique des chrétiens réclamant la réouverture des travaux de la CNS (16 février 1992). Cette « marche d’espoir » avait abouti au sacrifice suprême de quelques dizaines de vies humaines, appelées désormais les « martyrs de la démocratie ».
Au cours de la prétransition, la misère sociale avait connu des proportions jamais atteintes auparavant. Et pour cause. La destruction économique n’avait été que plus spectaculaire par le bradage de la monnaie. L’opération Bindo, sous l’appât d’un système de prêt à des taux d’intérêt scandaleusement avantageux, avait tourné en une vaste escroquerie de petites économies, bien qu’elle disposât au départ du soutien des pouvoirs publics [119]. Pourtant, à cette même époque, de nouvelles fortunes s’étaient édifiées, non sans arrogance ; la gabegie financière s’était ajoutée au gonflement exponentiel du déficit budgétaire au point que l’inflation qui était de trois chiffres au cours de la décennie 1980-1990, contre deux en 1970- 1980, était passée à quatre chiffres, rien qu’au cours de ces premières années de la nouvelle décennie [120].
D’autre part, ce pourrissement de la situation politique et économique avait eu pour effet de hâter la prise de conscience de la population, d’aiguiser son discernement et de l’amener à condamner globalement et définitivement le régime de misère qu’il avait produit [121].
Plus que jamais le combat pour le changement avait été au programme. Dès le départ, il s’était enflammé autour de la revendication d’une conférence nationale souveraine « aux décisions exécutoires et opposables à tous ». Quand celle-ci avait pu enfin ouvrir ses portes, son itinéraire avait apparu comme une longue marche d’espoir, marche héroïque qui avait consacré la naissance, à n’en point douter, d’un nouvel ordre politique construit sur les décombres du passé.
Convoquée sous la pression de la population, la Conférence Nationale Souveraine (CNS) fut d’abord organisée de manière à prouver son inutilité et son manque d’efficacité. La confusion autour du mode de recrutement de ses délégués, la mise en place d’un premier bureau totalement inopérant, présidé par un vieillard (Kalonji Mutambayi) secondé par deux lycéens (Wa Za Banga et Mwadi Kabongo) sont des illustrations éloquentes de cette inefficacité. Quand, à la faveur des pillages militaires, ce bureau démissionna au profit de celui présidé par Mgr Monsengwo, d’autres pièges furent aussitôt dressés sans doute pour obtenir, par la voie des faits, l’effritement de ce grand forum. Quelques délégués exigèrent après coup une révision générale des délégations dans le strict respect du dosage géopolitique, critère qui ne joua pas lors de son organisation par Mulumba Lukoji. Sous ce prétexte, le gouvernement reconduisit des contingents de conférenciers dans leurs régions d’origine, moyennant des pourboires importants, dans le but d’invalider les séances de la CNS faute d’un quorum suffisant. On alla jusqu’à suspendre ses travaux. Mais la réaction populaire fut d’autant plus vive. L’enjeu consista pour le peuple à déjouer ces pièges multiples, tendus pour empêcher ce forum d’atteindre son but. En un mot, ce combat imposa une mobilisation générale, depuis l’offensive politique des « Forces acquises au changement » jusqu’aux caricatures impitoyables de la presse écrite, en passant par des grèves, des opérations « ville morte » et des dénonciations des « crimes politiques ». La « marche d’espoir » des chrétiens fut un temps fort dans ce combat du peuple pour le changement politique. Malenge K.M., dans son ouvrage Prêtre dans la rue (Kinshasa, 1992, 109-125), a retracé les étapes de cette « chasse aux soutanes ». On reprocha en effet au clergé sa solidarité avec les chrétiens au cours de cette journée « chaude » du dimanche 16 février. Voici le témoignage de Malenge : « Sans parler des laïcs, les ecclésiastiques ont été proprement molestés, sans compter les soutanes déchirées ou brûlées à un gaz spécial, les croix brisées, les églises profanées comme celle de Saint-Joseph où neuf corps avaient été allongés devant l’autel. Un commando spécial est descendu dans l’église, y a jeté les grenades lacrymogènes pour disperser les chrétiens et emporter de force tous les cadavres. Le lendemain, les unes des journaux portaient des titres pour les moins étranges …» [122]
Il a fallu payer ce prix pour que la CNS ouvre à nouveau ses portes fermées juste après la validation des mandats des membres et dont le nombre fut arrêté à deux mille huit cent quarante. Les multiples instances représentées par ces participants furent regroupées en trois composantes – Société civile, Partis politiques, Institutions publiques – auxquelles fut ajouté le groupe des « Invités de la CNS ».
Le premier temps fort fut consacré à un exercice de réévaluation générale de l’itinéraire postcolonial du pays. Cette relecture de l’histoire s’est imposée comme une étape d’exorcisme collectif dans le but, selon les propres termes du Règlement intérieur de la Conférence, « de dégager des responsabilités individuelles et collectives, de prendre des dispositions qui s’imposent et d’en tirer les leçons pour l’avenir ». La première célébration de la démocratie retrouvée fut sans doute cette restitution de la parole confisquée. Plusieurs « Déclarations de politique générale » furent présentées, celles des Partis politiques, Institutions publiques, Associations professionnelles et groupes d’intérêt divers [123]. Même les oubliés et les marginaux de l’histoire usèrent de leur droit de parole comme les damnés de l’épopée militante de Lumumba (A. Kalonji Ditunga, V. Nendaka) et les anciens Commissaires généraux (J Bomboko, M. Cardozo, A. Ndele) ; les nationalistes sortant tout droit de leur exil (A. Gizenga, Thomas Kanza, C. Gbenye) ; les victimes de la IIe République comme ceux qui ont combattu activement le régime Mobutu (Madame Kasa-Vubu, la fille de Mpolo, Nathanaël Mbumba etc.). L’opinion se rendit compte de la partialité de la « vérité historique » qu’elle avait si bien apprise auprès des hérauts de la IIe République : elle réalisa après coup que l’histoire du pays était jalonnée de plusieurs révolutions manquées – entre autres celle de P. Lumumba, de P. Mulele. de N. Mbumba et du groupe de 13 parlementaires – ; la remise en cause générale qu’on vivait sous le signe de la démocratie était une sorte de revanche de ce passé non assumé sur le présent, revanche aussi des idées sur les faits et de l’idéal sur la réalité. Dans le même contexte, l’opinion écouta avec horreur les récits des violations des droits de l’homme et les détails d’une mauvaise gestion qu’elle croyait si bien connaître mais qui, en réalité, avait atteint des proportions insoupçonnées.
11 s’avéra indispensable d’approfondir les multiples questions importantes soulevées. Aussi le second temps fort de cette Conférence fut-il consacré à l’expertise de la situation, à l’analyse des faits et à l’élaboration des décisions et des résolutions conséquentes. L’importance des Commissions constituées, 23 au total, indiquait l’ampleur des questions abordées. Quelques Commissions se spécialisèrent dans des problèmes ponctuels, liés à la plus brûlante actualité (Transition. Constitution, Bien mal acquis, Assassinats et Violation des droits de l’homme). La plupart eurent pour tâche de procéder à une autopsie plus générale en s’efforçant de dégager courageusement les conséquences qui s’imposaient, scrutant le passé, secteur par secteur. Il y eut ainsi des Commissions chargées de l’Ethique : de la Politique : du Judiciaire ; de l’Administration territoriale ; de l’Education nationale ; de la Recherche scientifique et technologique ; du Portefeuille de l’Etat : de l’Economie. Industrie, Commerce et Planification ; des Finances, monnaie, banque et crédits ; des Infrastructures de transport. Communication, Poste et télécommunications ; de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme ; de l’Agriculture, Elevage, Pêche et Développement rural ; des Eaux, Forêts, Mines et Energie ; de la Population, Statistiques et Documentation ; de la Santé ; de la Famille, Femmes et enfants ; de l’Information, Presse écrite et audiovisuelle ; de la Défense, sécurité et protection civile ; et enfin des Questions sociales et culturelles. Le résultat de cette expertise généralisée fut coulé dans quelques centaines de décisions et recommandations qui constituent les Actes de ce rendez-vous historique. Sans nul doute, ces conclusions plantent le décor de l’avenir du pays. L’outil juridique devant régir la IIIe République a été élaboré. Cette Constitution, la troisième à être rédigée par les nationaux eux-mêmes, a l’avantage, par rapport aux précédentes, d’être l’œuvre d’un groupe si important et d’être portée par une expérience de plus de trois décennies d’autogestion. Quel est le contenu de ce projet constitutionnel de plus de deux cents articles ? Quelle vision concrète reflète-t-il ?
A la lecture de ce texte constitutionnel, l’avenir du pays est perçu comme devant être à tout prix le contre-pied de ce passé dont les méfaits ont été si longuement dénoncés. La rupture avec le Zaïre, « Etat privatisé », fut marquée d’abord par l’affirmation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’y trouve garantie une pluralité des droits et libertés : droit de travail et de grève, droit au développement intégral, droit à l’éducation, à l’information, à la culture et à la jouissance du patrimoine commun de l’humanité. La volonté de rupture avec le passé avait aussi pour corollaire la condamnation des coups d’Etat militaires passés et futurs. Plus concrètement, on reconnaît désormais au peuple « le droit de désobéir et de résister à tout individu ou groupe d’individus qui prendrait le pouvoir ou s’y maintiendrait par la force, ou l’exercerait en violation de la Constitution ». De même il est stipulé par ailleurs que l’institution d’un parti unique constitue « un crime de haute trahison puni par la loi ». La condamnation du MPR est donc inscrite désormais dans la Constitution.
Le souci de garantir l’avenir ne s’arrêta pas à l’exorcisme du présent. La CNS estima utile de remonter également le cours de l’histoire et de corriger quelques- unes de ses erreurs. Le discours de la CNS a été explicite dans la condamnation des crimes politiques et économiques, dans la réhabilitation des victimes de l’intolérance politique et dans la confiscation au profit de l’État des biens communs spoliés et aliénés par complaisance [124]. La volonté de rupture avec le passé s’inscrivit également dans les symboles. Une chasse semble s’être instaurée contre les signes qui faisaient référence trop ostensiblement à la gestion mobutienne ou qui l’exaltaient. Déjà, dès le 24 avril 1990, les prénoms furent à nouveau intégrés dans l’identité du citoyen, composée désormais au moins de trois éléments : le prénom, le nom et le(s) postnom(s) ; de même la cravate retrouva droit de cité. Pour avancer d’un cran, la CNS préconisa entre autres de renouer sans ménagement avec les emblèmes fixés par la Constitution prémobutienne d’août 1964. Ainsi, le Zaïre redeviendrait le Congo avec pour drapeau le ciel bleu orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche, traversé d’une bande jaune, finement encadré [125]. Le « Debout Congolais » reprendrait à « La Zaïroise » tous ses droits pendant que la devise nationale devrait être revue pour redevenir « Justice, Paix, Travail ». La même volonté de prendre ses distances avec le passé s’est lue aussi dans la révision du calendrier des fêtes nationales où les innovations festives de Mobutu furent abandonnées au profit de la célébration des jours mémorables de la Transition. Sur cette lancée, quelques débaptisations spectaculaires furent décidées dans la capitale, en attendant que cette opération se généralise à l’ensemble du pays [126].
Au-delà des condamnations, des dénonciations et du rejet du passé, se sont esquissés à grands traits les contours de la IIIe République. La première optique retenue fut que la nouvelle République serait fédérale. Par là, on renouait une fois de plus avec le mode de gestion qui a prévalu avant l’ère mobutienne. La contestation des « Unitaristes », portée naguère par les Lumumbistes, ne fut pas absente et se montra même fort active. Mais contrairement aux années 60, cette option était aujourd’hui trahie par la pratique de la période mobutienne qui avait misé justement sur une centralisation à outrance au point d’avoir développé des frustrations dans la population. Cette centralisation administrative a délaissé les campagnes au profit des villes, plus particulièrement au profit de la ville de Kinshasa ; l’unitarisme traînait avec lui ses ambiguïtés. S’il a contribué à consolider la conscience nationale, il a placé aussi les administrations locales à la merci des fonctionnaires venus de Kinshasa ; ces derniers se sont comportés bien souvent comme en pays conquis, sans craindre la sanction populaire puisqu’ils ne devaient rendre compte de leurs gestes qu’aux autorités centrales. Dans un tel contexte, le fédéralisme est effectivement porteur d’espoir car lui seul porte la marque du changement radical ; il permet d’espérer que les nouveaux responsables administratifs pourront être plus motivés et plus astreints à une gestion plus correcte et rigoureuse des hommes et des biens.
Mais sur un autre domaine, cette option suscita des inquiétudes car elle était de nature à ressusciter les forces centrifuges en veilleuse. Une question brûlante était ainsi posée. L’unité nationale, fragilisée par la misère, tiendra-t-elle le coup pour contenir tous les débordements possibles ? Seule la longue expérience historique du peuple congolais permet de l’espérer, envers et contre tout, au delà des turbulences du moment suscitées visiblement pour des finalités faussement tribales, comme dans le cas des tensions au Katanga entre originaires et non originaires.
Dans la foulée, la terminologie administrative fut modifiée également. L’Etat fédéral sera subdivisé en provinces et non en Etats fédérés. Ce choix est symptomatique ; il dissimule mal la volonté commune de ne pas mettre en cause l’acquis de l’unité. La « province » est subdivisée à son tour en arrondissements et en villes et ces derniers en communes rurales et urbaines. Comme dans les années 60, la fédéralisation visait aussi la révision du découpage territorial ; à cette différence près que cette nécessité s’était déjà exprimée vers la fin de la décennie 80. Mais la IIe République, qui s’était engagée dans cette démarche, le fit de manière théorique, sans arriver à la concrétiser. La CNS offrit l’opportunité de l’envisager pour la Troisième République, du moins dans les principes. L’enjeu consistait essentiellement à mettre l’administration provinciale à la portée des administrés et rapprocher la population des centres de décision. Pour ce faire, il fallait constituer des entités plus restreintes. Les critères retenus pour ce découpage territorial étaient précis. Les provinces à créer devaient idéalement faire preuve de viabilité économique et avoir une étendue ne dépassant pas les 50 000 km2 de sorte que l’administré n’ait pas à parcourir plus de 300 km pour joindre l’administration provinciale. Il fallait en outre que la province dispose d’un minimum de 800 000 habitants ayant la volonté politique d’être gérés ensemble. L’hypothèse de travail retenue fut, autant que possible, de transformer les anciens districts coloniaux, devenus sous-régions sous la IIe République en provinces. Mais tous ne répondaient pas au critère formel de superficie et de poids démographique, malgré leur volonté d’être autonome. Aussi le découpage final devra-t-il être suffisamment souple pour concilier la volonté des populations avec les principes d’ensemble énoncés [127].
Le nouveau projet de société, oeuvre de la CNS, se définissait donc essentiellement comme l’antithèse de ce qui existait avant. Au fédéralisme répond en écho le régime parlementaire. Le « Franc » supplanterait le « Zaïre » comme unité monétaire ; les Forces Armées redeviendraient apolitiques à telle enseigne que le militaire devrait être exempté du droit de vote. Tant de principes auguraient d’un nouveau départ, à condition qu’ils puissent s’accompagner d’un nouvel état d’esprit.
4.4 Vers la Troisième République
Mais le changement tant revendiqué par la population et programmé par la Conférence Nationale Souveraine tarda à venir. La classe politique continua à se donner en spectacle, tandis que la situation sociale n’en finissait pas de se détériorer comme conséquence d’une criminalisation de l’économie insoutenable et révoltante. Après la dérive qui avait conduit au dédoublement des institutions, la promesse des concertations politiques, réalisées entre les deux familles politiques sous les auspices de l’ONU, ne s’était concrétisée qu’au compte-gouttes, sans arriver à dissiper un certain goût amer à cause des litiges nés de la nouvelle conjoncture politique. Certes l’adoption d’un nouveau texte constitutionnel, Y Acte Constitutionnel de la Transition, promulgué le 9 avril 1994, était venue disqualifier les deux Constitutions concurrentes de la transition : l’Acte portant Dispositions constitutionnelles relatives à la Transition de la CNS et l’Acte Harmonisé du Conclave. Mais l’élargissement [128] du Parlement de Transition en un Haut Conseil de la République-Parlement de Transition (HCR-PT), avait fait basculer la majorité en son sein, de la gauche oppositionnelle à la droite présidentielle. La recherche laborieuse d’un nouveau Premier ministre et, finalement, l’élection de Léon Kengo wa Dondo à cette fonction [129], avaient laissé des plaies qui n’arrivaient pas à être pansées. Aussi, le combat de l’opposition s’était-il focalisé, dans la suite, sur la simple reconquête de ce poste au profit de Tshisekedi wa Mulumba.
En effet, dès l’investiture de Kengo wa Dondo, les amis de l’élu de la CNS entamèrent le processus de la saisine de la Cour suprême de justice pour le recours en annulation de l’ordonnance de son investissement et de celle de son équipe. Cette ambition effrénée de réinstaller Tshisekedi comme Premier ministre, les amis politiques de Mobutu l’utilisèrent habilement comme appât pour tourner l’USORAL en dérision et provoquer son implosion. Effectivement, plus que jamais, celle-ci se mit à se livrer en son sein à la chasse aux sorcières, ne s’inquiétant nullement de fragiliser ses propres positions. A son initiative, et se faisant complice des forces adverses qui avaient milité pour l’échec de la CNS, elle désavoua Mgr Laurent Monsengwo, accusé d’être le parrain de la « troisième voie » [130], celle-là même qui avait conduit à la promotion de Kengo wa Dondo. Les forces mobutistes n’en demandaient pas tant ! Aussi le prélat cessa-t-il d’être le président du HCR-PT, le 1er juillet 1995 [131].
En 1996, « l’opposition à la dictature mobutienne » se retrouva elle-même divisée en trois ailes : celle de Tshisekedi, de Kibassa-Maliba et de Kengo wa Dondo. Les principaux partis qui s’étaient illustrés, au seuil de la transition, par leur opposition à la dictature, avaient tous éclaté, eux aussi, l’un après l’autre, en plusieurs ailes. Tel était le cas de l’UDPS (qui avait produit l’UDPS/national, UDPS/Réformateur), du PDSC (PDSC-Bo-Boliko, PDSC-Kititwa), du FCN (FCN-Mandungu, FCN-Kamanda) ou de l’UFERI (éclaté d’abord en UNADEF et UFERI, et ce dernier en UFERl-Nguz et UFERI-Kyungu).
Pourtant, la situation économique, plus que jamais préoccupante, ne se prêtait pas à une telle démobilisation, particulièrement après la réforme monétaire de 1993. Celle-ci avait consisté en la mise en circulation d’une nouvelle monnaie, le « Nouveau Zaïre » (NZ), venu prendre la relève de l’ancien Zaïre (Z) [132], comme naguère en France le « Nouveau Franc » (FF) qui vint au secours de l’ancien Franc (F). La mise en circulation de ces nouveaux billets, le 21 octobre 1993, fut accueillie par une hausse excessive des prix, accentuée par la rareté de petites coupures au détriment des grosses. Un seul billet de 100 NZ regroupait le salaire de trois ou quatre personnes obligées à faire le tour des boutiques à la recherche de la monnaie nécessaire au partage du salaire « commun ». Rien qu’entre septembre et octobre 1993, le taux d’inflation mensuelle s’éleva de 11,3 à 122 %. [133] Le refus des régions du Kasaï, le fief de l’opposition pure et dure, de consommer la nouvelle monnaie, consacra un état de « sécession » monétaire [134]. Les concertations, qui mirent fin au dédoublement politique, n’arrivèrent pas à supprimer ce clivage au sein du même pays. Pire encore, le début du mandat de Kengo vint dévoiler d’autres crimes économiques qui continuaient à se commettre à la faveur de fabrication frauduleuse des NZ qui s’introduisaient dans le pays avec la bénédiction des barons du régime, y compris celle du Président Mobutu lui-même. Le préalable à l’effort de redressement économique passait par la suppression de ces circuits frauduleux de fabrication et de distribution de la monnaie.
La fin de la transition, fixée au 10 juillet 1995, surprit le gouvernement de transition issu du HCR-PT en plein désarroi. Jusque-là elle n’avait pu finaliser la double mission qui lui avait été confiée de préparer les élections et de redresser tant soi peu le niveau de vie des citoyens. Aussi la période transitoire fut-elle prolongée de 24 mois, pendant lesquels la politique de Kengo allait, en plus des équations politiques, s’enliser encore davantage dans le bourbier financier et monétaire [135]. La bataille quelle engagea pour la maîtrise de la fabrication et de la distribution des NZ n’aurait pas été à l’abri des règlements de compte. Et il ne manqua pas de voix pour le dénoncer. De plus, le « clan Kengo », reconstitué presque entièrement à la faveur de la promotion de son leader, avait repris son refrain de la politique de la rigueur, une politique plus attentive aux exigences du FMI en matière de paiement de la dette qu’à celles du vécu quotidien de la population. Aussi prêta-t-il le flanc aux critiques les plus acerbes [136].
En dépit de ces pesanteurs, la marche vers la Troisième République connut quelque avancée. La Commission Nationale des Elections (CNE) fut mise en place en juin 1995. Présidée par un ancien Premier Président de la Cour suprême de justice, Bayona ba Meya, elle regroupait 44 membres. Le calendrier électoral qu’elle mit au point, incluant, en plus des élections proprement dites, les opérations préélectorales, s’étalait sur la période allant de novembre 1996 à juillet 1997. Le projet de Constitution de la Troisième République, élaboré par la CNS, fut soumis au toilettage du HCR-PT [137]. Adopté non sans difficulté le 6 octobre, il fut promulgué comme annexe de la loi référendaire, le 30 décembre 1996. Avec ses dispositions, le rendez-vous semblait définitivement pris pour les élections ! Et pour demeurer dans les délais, le gouvernement se prit même à rêver de la tenue des élections générales en deux temps. Avant l’échéance de juillet 1997, se tiendraient uniquement les législatives et les présidentielles ; ce qui permettrait à la République de se doter dans les délais des institutions centrales. Ces dernières se chargeraient alors de l’organisation des élections provinciales et communales au courant des années 1998 et 1999.
Mais, une question de fond demeurait pendante. Au-delà de ces perspectives formelles, quelles étaient les chances concrètes pour que les urnes conduisent au renouvellement de la classe politique, comme souhaité par le plus grand nombre ? En effet, visiblement, Mobutu avait pris ses précautions, dès 1990, pour brouiller les cartes de sa succession qu’il avait soigneusement verrouillée, d’abord en décrétant une démocratisation sur mesure le 24 avril 1990, ensuite en sapant les travaux de la CNS. Sa non-implication dans les conclusions de ce forum les rendait encore et toujours inopérantes. Il ne s’en cachait pas. 11 entendait se succéder à lui-même, autant par défi, histoire de s’offrir le plaisir de confondre tous ceux qui, nombreux, avaient prédit sa mort politique, que pour tenter de réparer ses propres dégâts, afin de pouvoir partir en beauté. «Je dois parachever mon oeuvre, s’exclamait-il en 1994, je ne peux pas laisser ce genre d’héritage à la jeunesse de mon pays et à la postérité. Parachever mon œuvre signifie laisser à ce pays quelque chose de digne » [138]. Tous ceux qui, par feinte ou dans les faits, passaient pour des concurrents éventuels à la magistrature suprême du pays, avaient été sommés de rentrer dans les rangs à coup d’argent et de postes ministériels comme Nguz, à moins de se faire marginaliser comme Tshisekedi ou d’être arrachés des sphères d’influence comme Monsengwo.
Malade puis opéré d’un cancer de la prostate à Lausanne en Suisse, le 22 août 1996, avant la convalescence dans le midi de la France, le maréchal ne parvenait pas à se défaire de cette ambition. Dans sa programmation politique, il n’y avait de place disponible que pour les prétendants au second rôle, réduits à s’entre-déchirer et à rivaliser de prouesses, à l’adresse réelle ou inavouée du prince érigé en arbitre suprême. L’opposition institutionnelle, symbolisée par l’UDPS de Tshisekedi, n’était pas exemptée de cette pratique. Le pèlerinage de son leader emblématique, le 21 novembre 1996, au chevet de l’illustre malade, à sa villa de Roquebrune-Cap-Martin, près de Nice en France, semblait avoir eu pour objectif de personnaliser la bipolarisation politique institutionnalisée, en éliminant tous les concurrents de la course à la deuxième place, réservée à l’opposition. Et ce risque, attendu de tous, de le voir reconnaître Tshisekedi comme son alter ego dans l’opposition, Mobutu ne le prit finalement qu’en dernière minute, après le désaveu, le 18 mars 97, de Kengo par un acte d’assemblée du HCR-PT. Tshisekedi fut alors nommé Premier ministre, mais quelques jours après, il était remplacé par le général Likulia Bolongo (Tableau 31).
Le changement ultime allait venir d’ailleurs. Car, jusque-là, l’opposition au régime de Mobutu, à l’étranger, n’avait pas encore abattu ses dernières cartes. Le survivant des rébellions, Laurent-Désiré Kabila, n’avait pas encore tout à fait déposé les armes. Il cumulait à présent une longue expérience de guerre et d’opposition politique. Il passait pour faussement inconnu [139]. De manière discrète et pourtant non moins visible, on se le rappelle, il avait assuré une présence active dans les tribulations qui avaient accompagné les quatre décennies de l’âge colonial depuis 1959, quand, à 20 ans, il avait fait ses premières armes dans la politique active. Bien que né à Jadotville [140] d’une mère lunda de Kapanga, il était, par son père, luba, originaire d’Ankoro dans le territoire de Manono [141]. De par sa condition, il aurait pu, comme Evariste Kimba, se réaliser dans la CONAKAT qui regroupait en principe toutes les associations tribales du Katanga. Mais il avait choisi plutôt de suivre Jason Sendwe dont le Balubakat, déjà sorti de cette confédération tribale pour retrouver son autonomie, était membre du cartel de Patrice Lumumba. La victoire écrasante des « unitaristes » sur les « fédéralistes », aux élections municipales de 1959, qui avait confié les rênes des principales communes d’Elisabethville et de Jadotville aux Luba, avait achevé de consommer la rupture avec la CONAKAT « fédéraliste » que dirigeaient Tshombe et Munongo. Kabila, élu conseiller provincial suppléant (après Prosper Muamba-Ilunga), avait commencé à s’initier à la pratique militaire au moment où Sendwe le chargea des jeunesses (milices) du parti. La proclamation de la sécession du Katanga par Tshombe lui avait donné l’occasion d’accéder pour la première fois à la pratique de la guerre, quand le fief de la Balubakat avait fait sécession dans la sécession. En effet, les tentatives de la Gendarmerie katangaise de mettre un terme à la « rébellion » du nord dégénèrent en guerre entre les deux Katanga, le nord et le sud. Mais la guerre ne fut pas toujours prometteuse. Kabila s’était retrouvé ensuite à Tours en France, mais surtout à Belgrade où il suivit une formation accélérée. C’est à son retour qu’il devint chef de cabinet du ministre de l’Information du gouvernement provincial du Nord-Katanga [142], puis siégea à son assemblée provinciale. Après l’élection de Jason Sendwe comme président provincial, le 21 septembre 1963, en remplacement de Mwamba-Ilunga. il perdit son poste de conseiller provincial (député provincial) effectif au profit de ce dernier et disparut de la région.
Effectivement, il sortit du cadre étroit du Katanga pour entrer dans la vie nationale. De Kinshasa, il se réfugia avec les autres nationalistes à Brazzaville, il exerça, comme on l’a déjà vu, les fonctions de secrétaire général aux Affaires sociales. Jeunesse et Sports au sein du CNL-Gbenye, avant d’entamer, avec Gaston Soumialot, l’action révolutionnaire au Nord-Katanga et au Kivu. On a vu combien cette expérience, prometteuse au début, tourna court à cause de bombardements, du largage des parachutistes belges à Stanleyville, de l’organisation de l’opération Ommegang et, pour couronner le tout, du coup d’Etat de 1965. L’échec des rébellions n’avait pas pu le contraindre à changer de métier. La même lutte, il la poursuivit en solo, option qui lui imposa de ne pas être prisonnier du maquis, puisqu’il fallait aussi des contacts extérieurs [143]. Par deux fois, il séjourna en Chine en 1964 et en 1966.
Il aurait également été remarqué par le KGB qui se fit une haute idée de son action. En Afrique, il fréquenta l’Algérie de Ben Bella et de Boumedienne, de même que la Libye de Mouammar Kaddafi, sans parler du Kenya et surtout de la Tanzanie de Julius Nyerere, qui servait toujours d’arrière à ses projets révolutionnaires. En 1982, du 18 au 20 septembre, on le retrouva à Rotterdam, avec Dikonda wa Lumanisha de l’UDPS, au « Tribunal Permanent des Peuples », quand il vint témoigner contre Mobutu. Opérateur politique actif, il l’était à sa manière, à cette époque où se radicalisait l’opposition des « Treize » et où E. Blumenthal dévoilait au monde l’ampleur de l’irrationalité de la gestion du maréchal-président. Son offensive de 1984-85 aurait sans doute porté ses fruits, si elle avait pu être synchronisée avec la double initiative du FLNC de 1977-78. Mais tout n’était pas perdu. En janvier 1986, son « compagnon » [144]), l’Ougandais Yoweri Museveni, à la tête de son « National Résistance Army » (NRA), où évoluaient nombre de Rwandais, parvint à chasser du pouvoir l’obscur successeur de Milton Obote, le général Okello. Continuant à leur faire confiance, le nouveau maître de l’Ouganda leur confia des fonctions importantes, surtout dans l’appareil militaire et de sécurité. C’est ainsi que le général-major Fred Rwigema a été chef d’Etat-major adjoint de la NRA et vice-ministre de la Défense nationale et Paul Kagame, directeur-adjoint des services de renseignements militaires. En créant, dans ce pays d’accueil, au début de 1988, un « Front Patriotique Rwandais » (FPR), doté d’une branche armée, « l’Armée Patriotique Rwandaise » (APR), ces chefs militaires [145] allaient être à la base d’une nouvelle dynamique.
Le discours du 24 avril surprit Kabila dans sa traversée du désert [146]. De nouveau, il signala sa présence politique dans cet épisode historique, en faisant part publiquement de ses opinions. A la conférence qu’il tint à l’Université de Madrid, le 23 juillet 1992, dans le cadre de ses cours d’été, il précisa combien il avait misé, lui aussi, sur la démocratisation décrétée en 1990.
« … nous avons proposé, de concert avec les autres formations ayant une existence de fait, un programme de redémocratisation politique, condition nécessaire au redressement économique et social du pays. Nous avons avancé alors l’idée de la tenue d’une véritable conférence nationale. Notre projet prévoyait la désignation des représentants des formations politiques certes, mais aussi de la société civile et, notamment, du clergé, des étudiants etc. Il reviendrait à cette Conférence Nationale la tâche de désigner un formateur de gouvernement provisoire rétablissant la séparation des pouvoirs, l’exercice du pouvoir législatif jusqu’à l’élection d’un Parlement, l’adoption d’un projet de loi sur le fonctionnement et le financement des partis politiques etc. « Au lieu de cela, on assista plutôt à la tenue d’une « Conférence Nationale décaféinée » regroupant « des hommes de paille désignés par le dictateur ». Et de conclure : « Nous restons encore disposés – pour un temps ne pouvant pas se prolonger indéfiniment – à accepter la participation, avec les garanties nécessaires, à une véritable Conférence Nationale dont la constitution et les principes correspondraient à ce que nous proposions dès le mois de mai 1990 [147], selon des règles très simples, semblables à celles généralement suivies dans le cas des autres pays africains » (Mukendi G. et Kasonga B., 1997 : pp. 190-191).
Plus tard, à l’époque du dédoublement des institutions de la transition, il adressa une « lettre ouverte » au président Mobutu, à la Présidence du HCR et à l’ensemble de ses compatriotes, à l’occasion de la célébration du 26e anniversaire de la fondation de son parti. Ce document, intitulé « Naufrage du processus de redémocratisation » (dont les Congolais n’ont pris connaissance qu’après ses victoires militaires sur le régime) était, dans sa conclusion, une déclaration explicite de sa volonté de se proposer comme alternative à l’imbroglio politique qui s’était installé, de manière si confortable, dans le pays. « Le Parti de la Révolution Populaire, concluait-il, reste disponible de faire partager aux autres sa clé de solution du mystère de l’impasse, dans l’unique souci de tirer tout le monde du marécage. Ce plan consiste à permettre le passage paisible du pays vers la démocratie, garantir la sécurité de ceux qui sont prisonniers du pouvoir en même temps que de ceux qui sont atterrés par la phobie de représailles, ainsi qu’au peuple de retrouver ses droits fondamentaux longtemps aliénés. Certes, je ne me leurre pas qu’en imprégnant la vie politique de la spécificité d’une pensée évoluée à l’écart des us et coutumes démantibulés de la Deuxième République, je mette en effervescence les tabous et provoque d’inhabituels mouvements d’immenses intérêts qui feront barrage » (Mukendi G. et Kasonga B., 1997 : 224). Auparavant, le révolutionnaire avait, dans cet important document, marqué son étonnement face à l’amnésie de la transition sur sa longue lutte et celle de son parti [148].
L’oublié de l’histoire avait parlé pour rappeler à tous son existence. Mais avait-il été entendu ? Aurait-il pu l’être, à cette époque où les concertations politiques engagées entre l’USORAL et le FPC, sous les auspices de l’ONU, semblaient porter leurs fruits ? Le message passa inaperçu. Le second rendez-vous de Kabila avec l’establishment politique de Kinshasa fut donc manqué, après celui qui aurait dû les réunir autour d’une conférence nationale. Ce courant, apparemment plus radical encore que celui de Tshisekedi, n’était pas prêt à des concessions avec un Mobutu, d’après lui, qui aurait si bien appris à « détruire (chose faite !) et non à construire ». Il en allait de même de la classe politique. « Classe dirigeante de la société zaïroise, a-t-il écrit, tu n’avais pas, tu n’as pas, tu ne peux pas avoir, tu n’auras jamais de programme politique de redressement national acceptable ni concevable du bonheur de la multitude dont tu as un tel mépris au point de te conduire sur son sol comme dans un pays conquis auquel ne te lie aucun lien ‘affectionnel’, sinon donnes-en la preuve après 30 ans d’exercice du pouvoir ». Dans cette logique, seul le processus révolutionnaire pouvait venir à bout d’une telle inertie.
Ce processus allait s’imposer, trois années plus tard. En effet, les choses commencèrent à se préciser en 1994, à la suite de la mort tragique et brutale, le 6 avril, de Juvénal Habyarimana, « frère et ami » du maréchal Mobutu. La prise de Kigali par le FPR, le 12 avril 1994, signifiait pour Kabila qu’il pouvait désormais, en plus de l’Ouganda, compter fermement sur le Rwanda où Kagamé occupait les fonctions de vice-président de la République et ministre de la Défense nationale. Le rêve d’une guerre de libération était enfin dans l’ordre du possible.
4.5 De la guerre du Kivu à la guerre de libération
Kabila n’eut pas le loisir de mettre le feu aux poudres. C’était déjà le cas, du fait de la tension permanente entre autochtones et immigrants banyarwanda, tension attisée, suivant un rythme saisonnier, par les événements politiques, autour de la question complexe de nationalité.
La mise en cause, à partir de la CNS, de Mobutu, protecteur et artisan de la promotion des Banyarwanda et son effacement progressif dans les affaires de l’Etat par son déménagement à Gbadolite, autorisèrent les groupes autochtones à hausser de plus en plus le ton, réactivant par là une crise restée en latence pendant près de trente ans. Ils s’efforcèrent même à renverser la vapeur à leur avantage. Déjà le refus de la CNS d’admettre en son sein les délégués des partis réputés représenter des « étrangers » – notamment le CEREA que Rwakabuba avait fait renaître -, et le quadrillage du Nord-Kivu par des gendarmes essentiellement nande, hunde et nyanga avaient contribué à créer un climat particulier au début des années 90. Les débats du Parlement de transition sur la question de nationalité et surtout la constitution en son sein d’une Commission ad hoc chargée de statuer sur cette problématique au Kivu (Commission Vangu) finirent par libérer les angoisses des autochtones face à « l’invasion » rwandophone. On ne cessa de dénoncer le pseudo-projet tutsi de détachement du Kivu du Congo, en vue de la création d’une « république de Virunga » par la fusion avec l’Ouganda et le Rwanda-Burundi [149].
Avec de telles psychoses et l’effritement des administrations publiques, il était évident que l’évolution de la situation allait désormais échapper à tout contrôle, y compris celui du Parlement de transition et de l’Etat lui-même. A peu près partout dans le Kivu émergèrent des « mutuelles » ethniques [150]. Structures à la fois d’entraide et d’autodéfense, elles allaient faciliter les affrontements. Car la remise en cause de la nationalité avait surtout pour implication le fait de provoquer celle des acquis fonciers et commerciaux. Les Rwandophones ne pouvaient donc pas se permettre de ne pas organiser la résistance. La seconde « guerre kanyarwanda », dans le Nord-Kivu, s’était donc déclenchée dès le début de la décennie, quand les Hutu, suivant le mot d’ordre de Magrivi (Mutuelle Agricole de Virunga), refusèrent de se soumettre aux injonctions de l’administration et de la police locales et mirent en place des structures parallèles. Cela dégénéra en incidents sanglants dans le Masisi (1991, 1993) et à Walikale (1992). Mais la médiation personnelle de Mobutu permit une accalmie en 1994.
Une autre grande source d’insécurité provenait des troupes régulières des Forces Armées Zaïroises. Non seulement les effectifs n’avaient plus été entraînés depuis la fin des années 70 et n’étaient pas capables de faire face à une guérilla qui connaissait le terrain mieux qu’eux, mais leurs propres officiers, à cause de 1 appât du gain, ne s’interdisaient pas de mettre en vente armes et munitions disponibles, contribuant ainsi à l’entretien de la violence à laquelle ils étaient censés mettre fin. Désertions, indiscipline et exactions contre la population avaient laissé la porte ouverte à tous les opportunismes et les aventures. Ainsi était née dans le Rutshuru la rébellion des Ngilima. Recrutées parmi les autochtones tembo, hunde, nande, ces milices qui se sont donné un nom ethnique (« Ngilima », dans sa première acception, est le nom d’un clan nande) étaient sans doute les « rescapés » des groupes rebelles qui avaient pris le maquis depuis 1986, d’abord sur les contreforts du Ruhenzori puis dans la forêt de Béni [151]. S’ils se qualifiaient de « Maï Maï » (« invulnérables » parce que les balles de fusil se transformeraient en eau), comme lors des rébellions de 1963-63, c’est en raison de leurs croyances dans des recettes d’immunisation qui avaient eu cours à l’époque (Willame, J.C., 1997 : 71). Vêtus d’un simple pagne de raphia, ils combattaient les Banyarwanda mais aussi les militaires de l’armée régulière. Car, à leur égard, ces derniers avaient des attitudes ambiguës lors de leurs campagnes de pacification de la région [152].
On en serait sans doute resté là si les choses ne s’étaient pas compliquées avec l’arrivée massive des réfugiés rwandais. La victoire du FPR qui s’était emparé de Gisenyi le 18 juillet 1994 eut un impact incalculable. On prit conscience de ce que les Congolais avaient été présents dans les deux camps des belligérants. Pendant que les unités des FAZ combattaient, aux côtés de celles du FAR, les troupes du FPR, comme en 1992 sous les ordres du général Mahele, ils finançaient le même FPR par l’entremise des Rwandophones. En effet, nombre de Banyamulenge et d’autres Tutsi du pays avaient pris une part effective à la guerre, par solidarité avec les Tutsi rwandais. Ceux qui n’avaient pu se rendre au front s’étaient organisés pour y prendre part indirectement, par la participation à l’effort de guerre (Braeckman C., 1996 : 276). Chaque groupe d’antagonistes rwandais assimilaient à l’ennemi ceux qui avaient servi à ce dernier de partenaires.
La catastrophe représentée par l’irruption des centaines de milliers de réfugiés [153] du Rwanda à Goma, à partir du 18 juillet 1994, et surtout le repli des Forces Armées Rwandaises (FAR) et des milices armées (Interhamwe) dans le Kivu, avec armes et bagages, furent autant de signaux du transfert de la guerre rwandaise au Congo, partiellement par nationaux interposés. Elle allait s’étendre de part et d’autre de la frontière avec le Rwanda, car les belligérants traditionnels se retrouvaient face à face: au Rwanda, les Tutsi, les nouveaux hommes forts du régime et, au Kivu, les Hutu encadrés par les génocideurs et les milices armées. Au Kivu, la fracture entre « allochtones » hutu et tutsi était désormais béante, accentuée par l’insouciance insolente du maréchal Mobutu. En effet, l’organisation des funérailles de l’ancien président Habyarimana par Mobutu et son enterrement à Gbadolite [154] furent perçus comme une manière de confirmer les anciennes alliances et de défier les nouveaux maîtres du Rwanda, les incitant à en faire autant en sens inverse.
On aurait dit que le maréchal Mobutu ne réalisait pas à suffisance combien la conjoncture internationale avait changé depuis la fin de la guerre froide. Son « Zaïre » avait cessé d’être un enjeu majeur. Une nouvelle politique américaine avait pris la relève de celle qui faisait de lui le « gendarme » de la région. Lui-même, pour avoir été un instrument trop fidèle de l’ancienne politique, était devenu un élément gênant et encombrant. Le recrutement des amis de l’Amérique de Bill Clinton se faisait même dans le camp des socialistes d’hier, à la condition qu’ils garantissent ses intérêts. Dans cette perspective, l’Ouganda, le Burundi et le Rwanda [155] passaient pour plus « intéressants », parce qu’ils faisaient partie du cordon sanitaire dressé contre l’intégrisme musulman. Le front de la guerre contre ce « fléau » passait par le Sud-Soudan. John Garang devait être soutenu pour faire reculer, davantage vers le nord, cette « ligne de front ». L’implosion de l’ancien Congo belge, dans cet entendement, semblait fort probable. L’enjeu revenait à encadrer ce processus de dégénérescence, afin qu’il n’entraîne pas de trop graves conséquences pour toute la région. Et la perspective d’une succession d’affrontements avec des troupes rwandaises, avant les élections, était, à tout prendre, une conjoncture heureuse car elle contribuait à l’affaiblissement de la DSP et de la Garde Civile. Une manière d’atténuer le risque des exactions nombreuses sur la population, en cas d’échec de Mobutu aux élections.
C’est à partir d’août 1996 que cette tension larvée se mua en une crise entre les deux Etats les plus proches de la CEPGL. Le facteur déterminant fut le retour dans la région d’Uvira des recrues qui avaient combattu dans les rangs de l’APR. accompagnées des combattants d’origine ougandaise et rwandaise. Leur nombre oscillait entre 800 et 3.000. « Une partie de ces recrues auraient, selon certaines sources, été chargées d’attaquer à revers les camps hutu de la région de Bukavu-Uvira afin de les obliger à fuir vers le Rwanda. Selon d’autres sources, une fraction de ces hommes aurait caché ses armes et se serait mêlée à la population » (Willame, J.C., 1997 : 93). Pourquoi ce retour ? La coalition des Grands Lacs déterminée à renverser le régime de Mobutu aurait-elle décidé de passer de la parole à l’acte ? Le 10 octobre 1996, le président de la République rwandaise, Pasteur Bizimungu, justifia ce geste par le devoir de solidarité à l’égard des « frères » Banyamulenge en rébellion à la suite des provocations des autochtones. « Je voudrais dire aux Banyamulenge qu’ils doivent faire la leçon d’histoire à ceux-là qui les pourchassent et leur apprendre le savoir-vivre (…) Le Rwanda est habituellement une terre d’accueil pour ceux qui sont en détresse. Le Rwanda ne peut refuser d’accueillir les frères. Mais si le pari est de chasser ceux-là qui ont vécu dans ce pays depuis plus de 400 ans (…), les seuls Banyamulenge que nous accueillerons sont les enfants et les vieilles femmes. Les autres doivent rester là-bas pour corriger et donner la leçon de savoir-vivre à ceux-là qui veulent les chasser » [156].
Mais au-delà de l’impératif de solidarité, se dissimulait un autre motif. Le Rwanda « libéré » cherchait, lui aussi, à se libérer des « mercenaires » africains qu’il avait utilisés pour arriver à cette fin. Museveni, en son temps, avait été confronté à la même difficulté, qu’il avait résolue de la même manière. De même qu’il s’était débarrassé de ses combattants tutsi en les aiguillant vers la guerre du Rwanda, de même ces derniers agissaient en les orientant vers la « libération » du Sud-Kivu et partant, celle de l’ensemble du pays. A cette entreprise, Pasteur Bizimungu essaya de greffer des prétentions territoriales, invoquant l’existence d’un « Grand Rwanda » antérieur (qui incluait en son sein le Kivu) que le « petit » Rwanda actuel, issu de la colonisation, devait à tout prix reconstituer. « Je voudrais encore dire à la population de Cyangungu (…) qu’à l’arrivée des Blancs au Rwanda, le Rwanda avait à peu près six cents ans d’existence en tant que pays. Il s’étendait des Lacs Rweru et Cyohoha franchissant la chaîne des Volcans jusqu’au Lac Rwicanzige (lac Edouard). Il s’étendait aussi de la Rusumo jusqu’aux frontières du Buhunde et nous vivions en bonne intelligence, sans problèmes avec les Bahunde. Même la région jadis appelée Bishugi considérée aujourd’hui comme berceau des Banyamulenge, tous les habitants de ces contrées étaient des Rwandais. Même Kayenzi et autres, situées actuellement au Zaïre, faisaient partie du Rwanda. Ces Banyamulenge dont vous entendez parler sont nos congénères avec qui nous partagions le Rwanda. Mais, à partir des années 1960-63, avec la fondation de l’OUA, nous avons souscrit au principe de l’intangibilité des frontières » [157].
Un autre impératif (et non des moindres) relevait de la volonté tutsi de parachever la guerre, de poursuivre l’ennemi avant qu’il ne se réorganise et de l’anéantir totalement. L’opération « Turquoise » avait empêché la matérialisation de cette étape ultime. Dans la guerre de libération du Congo devait donc se poursuivre sournoisement la guerre du Rwanda, puisque FPR et FAR, Tutsi et Hutu se retrouvaient face à face, comme naguère sur le champ de bataille. Il était à craindre que ces affrontements, où la capitulation n’est pas admise, n’aboutissent à l’extermination des « vaincus », surtout qu’elle se réaliserait dans la discrétion, sous la couverture de la guerre entre AFDL et FAZ.
En tout cas, il était temps de « réquisitionner » cette drôle de guerre des Grands Lacs, de la recycler et de l’ennoblir en lui assignant une cause plus propre et digne d’éloge. Le grand mérite de Kabila était donc d’avoir réussi la « confiscation » de cette guerre et de lui avoir trouvé un objectif édifiant, sans réussir pour autant à la détourner complètement de ses motivations initiales [158]. Le Rwanda tutsi pouvait poursuivre les Hutu et les FAR en déroute, « venger » le génocide tutsi et se débarrasser définitivement des Ougandais, Erythréens, Tanzaniens et Rwandophones congolais qui lui avaient prêté main-forte pour anéantir le régime d’Habyarimana.
Le 19 octobre 1996, la ville d’Uvira tomba entre les mains des rebelles. Une coalition politico-militaire, mise en place la veille, se devait de prendre en charge cette première victoire qui faisait accéder les affrontements ethniques dans le Kivu à une véritable guerre. En effet, un Protocole d’accord avait été signé à Lemera (près d’Uvira), le 18 octobre 1996, entre le PRP de L.D. Kabila et trois autres formations : le Conseil National de Résistance pour la Démocratie (CNRD) d’André Kisase Ngandu, le Mouvement Révolutionnaire pour la libération du Zaïre (MRLZ) de Masasu Nindaga et enfin, l’Alliance Démocratique des Peuples (ADP) de Déogratias Bugera. Tous se mirent d’accord pour créer ensemble une Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL) avec Laurent Kabila pour « porte-parole », en raison de son multilinguisme (il parle couramment le français, l’anglais, le kiswahili et le kiluba). Lors de la deuxième session du Conseil constitutif de l’Alliance, tenue à Goma, du 31 décembre 1996 au 4 janvier 1997. ils décidèrent de renforcer leur union en fusionnant les quatre mouvements. Et dans les statuts dont elle se dota à cette occasion, FAFDL s’est définie comme « structure d’action politico-militaire ayant pour objectif le démantèlement du pouvoir fasciste en place au Congo et l’établissement d’un régime démocratique véritable dont le peuple congolais avait besoin, à savoir : un régime fondé sur une légitimité réellement populaire». Le mouvement se dota d’un président de fait, en la personne de Laurent-Désiré Kabila [159]. Le président du Conseil constitutionnel, Déogratias Bugera, devint le secrétaire général. Que cette deuxième session ne se soit pas déroulée sans quelques frictions, cela est probable, puisque certaines sources croient y déceler les causes immédiates de l’assassinat de Ngandu Kisase, qui eut lieu le 6 janvier [160]. Il fut remplacé au commandement des Forces de l’Alliance par Masasu Nindaga.
La première victoire significative du mouvement eut lieu le 30 octobre 1996, quand elle s’empara de la ville de Bukavu, quatre jours après Nyangezi et deux jours après la nomination par Kinshasa des gouverneurs militaires à la tête des deux régions du Kivu [161]. 11 devint désormais évident qu’on était sorti de la rébellion des Banyamulenge et que le mouvement avait d’autres ambitions. Pour la première fois, Kabila sortit de l’ombre, après trente ans de clandestinité. Dans un meeting à Uvira, il annonça officiellement son projet de renverser le régime de Mobutu. Les combats qu’il engagea alors pour le contrôle de l’aéroport de Goma, aboutirent, le 3 novembre, à celui de toute la ville. C’est à cette étape qu’aurait été décidée définitivement l’option d’une guerre totale, qui ne s’arrêterait qu’à l’anéantissement du régime de Mobutu. Les victoires allaient alors se succéder avec la conquête de Béni et Bunia (7 et 8 déc.). L’occupation du Maniema marqua une étape importante qui ouvrit la voie à la fois vers l’ouest et le sud, en même temps qu’elle allait autoriser, pour une fois, le déplacement du quartier général des Forces de l’Alliance, pour être installé davantage au cœur du pays, en dehors du cadre ambigu de la région des Grands Lacs. Cela fut possible après la chute de sa capitale, Kindu, dans la nuit du 2 au 3 mars. La nouvelle dynamique se traduisit aussi par la reddition sans combat de Kalemie (3 févr.) ainsi que la chute de la cité minière de Kalima (23 févr.), Moba (9 mars), des villes ferroviaires de Nyunzu et Kabalo (2 mars) ainsi que de Manono (4 mars), pendant que, sur l’axe du nord, l’Alliance n’avait cessé de continuer sa progression vers Watsa (31 janv.) et Isiro (13 févr.) [162].
Quel était le secret de ces victoires qui s’accéléraient au fur et à mesure de la progression de la guerre ? De toute évidence, il était lié, dès le départ, à plusieurs facteurs comme le mauvais moral des troupes gouvernementales aux motivations douteuses, leur mauvais encadrement [163] et leur croyance, comme en 1963-64, au mythe de l’invincibilité des rebelles qui, dans l’entendement populaire, étaient capables d’attraper des bombes au vol et disposaient des armes « sophistiquées » aux détonations inhabituelles et particulièrement assourdissantes. En revanche, les Forces de l’Alliance, constituées essentiellement des professionnels de la guerre, ayant foi au combat engagé [164], se trouvaient encouragées par l’aisance des victoires successives et le résultat plus que satisfaisant des stratégies adoptés, notamment celle de s’emparer d’abord des dépôts d’armes.
Il aura suffi, rapportent les historiographes de cette guerre, de l’encerclement des camps de réfugiés de Mugunga et Katale, pour que l’Alliance s’empare d’un important stock d’armes et de munitions : plus de 5 000 tonnes (?) du matériel rassemblé là à partir du lot cédé par l’armée, française après l’opération « Turquoise », des dons reçus des FAZ et des milices burundaises de Nyangoma, ainsi que des achats effectués à partir des fonds emportés après la débâcle du Rwanda et ceux récoltés grâce à la revente de vivres reçus du HCR et les cotisations perçues dans ces camps. La conquête des villes était le résultat d’une psychose admirablement entretenue grâce à l’utilisation des médias, qui avaient prise sur les populations, comme CNN, RFI, BBC-Afrique ou Africa n° 1. La chute de Kalemie, par exemple, aurait été la résultante d’une simple méprise d’ordre linguistique. « Les mercenaires sud- africains (au service de l’armée gouvernementale) auraient demandé (en anglais) aux soldats zaïrois de remplir les réservoirs à carburant. Ceux-ci demandèrent : « pétrole ? » « Yes », répondirent les mercenaires (l’anglais « petrol » signifie « essence » I). En conséquence, les soldats remplirent les réservoirs de vrai pétrole… Et, lorsqu’il fallut résister à l’attaque de l’Alliance, les embarcations ne purent démarrer. Une seule solution : fuir, abandonner le combat » (Mukendi G. et Kasonga B., 1997 : pp.61-62).
La promesse d’une contre-offensive, annoncée fièrement par le premier ministre Kengo comme « totale et foudroyante », avec bombardement à la précision « chirurgicale », suivant le mot de son ministre de la Défense nationale, le général Likulia Bolongo, ne put donc se concrétiser. La chute de Kisangani, le 15 mars, où avaient été concentrés carburant, armements et mercenaires serbes, dissipa les dernières illusions d’une possible reprise en main de la situation militaire par les FAZ. Même le mythe du mercenaire blanc, qui a eu l’effet en 1964, comme en 1977 et 1984, s’est effrité, à cause de la victoire éclatante des Forces de l’Alliance. La conduite de la fin de la transition, perçue, dès le début de la guerre, comme devant impliquer à la fois Kabila et Mobutu, cessa ici de refléter cette image. A partir de la chute de Kisangani, Mobutu appartenait au passé. L’essaimage des soldats de Kabila dans le reste du territoire national ne prendrait plus que le temps nécessaire pour s’y rendre à pied. On continua à passer de reddition en reddition. Kasenga au nord-est de Lubumbashi (23 mars), Kamina (31 mars), Luena, la cité minière d’extraction du charbon (4 avril) précédèrent Mbuji-Mayi (5 avril), le fief de Tshisekedi, Kipushi (6 avril), Ubundu et Likasi (10 avril) puis Kananga (12 avril), Kolwezi (13 avril) et Mweka (20 avril), sans oublier Boende dans l’Equateur, de même que Luebo, Ilebo et Tshikapa (23 avril) au Kasaï occidental. Avril se clôtura avec la « libération » de Kikwit (29 avril).
Restait Kinshasa, avec les villes de sa périphérie, Kenge et Matadi. Il fallait réussir « l’atterrissage en douceur » de la fusée Kabila, sans dégâts intempestifs dans la capitale et sans qu’elle ne soit emportée par son élan, au-delà de la piste, sur un autre terrain, comme celui de l’Etat voisin. Il était tout autant à craindre que Mobutu vaincu puisse recourir à la tactique de la terre brûlée et mettre la capitale à feu et à sang. Prévoyante, l’Amérique avait, dès le mois de mars, déployé des soldats à Brazzaville, suivie en cela par des pays d’Europe comme la France, la Belgique et l’Espagne. Un porte-hélicoptères, avec à son bord plus de 1 500 Marines et des hélicoptères d’attaque et de transport avait stationné au large des côtes congolaises. Kenge fut le dernier bouchon à faire sauter avant la prise de Kinshasa. La médiation du Représentant spécial de l’ONU et de l’OUA, l’Algérien Mohammed Sahnoun, et les négociations qui s’ensuivirent [165], avaient pour objectif de réussir la prise de la capitale sans effusion de sang. La présence d’un millier de combattants de Jonas Savimbi dans les rangs gouvernementales aurait failli compromettre ce transfert du pouvoir en douce. Mais il se trouva compensé par l’engagement dans la bataille de 1 armée de Dos Santos [166]. Le « miracle » se produisit le samedi 17 mai, quand les Kinois assistèrent à l’entrée des troupes de l’Alliance dans la ville – les Kadogo (enfants-soldats) en tête -, au moment où, à Lubumbashi, Laurent-Désiré Kabila se proclamait Chef de l’Etat de la « République démocratique du Congo » après suspension de toutes les institutions publiques préexistantes [167]. Quelques heures plus tôt, à Gbadolite, Mobutu venait de quitter définitivement le pays. Dans la nuit de vendredi 16 à samedi 17 mai, le général Mahele qui, payant de sa personne, avait ordonné l’ouverture de la ville pour laisser l’entrée libre aux hommes de Kabila. a été abattu au camp Tshatshi, au cours d’une altercation avec des soldats de la DSP. Sa décision courageuse, qui causa sa mort, avait sauvé la capitale d’un carnage certain, au vu de la quantité d’armes qui fut découverte plus tard tant chez des particuliers qu’à des endroits publics.
Lors de la prestation de serment du nouveau Président de la République, le jeudi 29 mai 1997, en présence des parrains du tout Nouveau Régime, Yoweri Museveni de l’Ouganda, Eduardo Dos Santos de l’Angola, Pasteur Bizimungu du Rwanda. Pierre Buyoya du Burundi, Frédéric Chiluba de la Zambie. Kabila annonça solennellement la fin de la Deuxième République et l’émergence de la Troisième, « l’antithèse » de la précédente. La nouvelle république décollerait, de manière plus effective, à l’issue des élections générales, après que le régime se serait doté d’une Constitution [168]. D’ores et déjà, suivant le mot d’ordre du nouveau chef de l’Etat, le pays était appelé à se refaire une santé et à entamer le processus de sa propre reconstruction. « Nous devons reconstruire l’appareil de l’Etat afin de le rendre apte à jouer son rôle dans la gestion du pays. Nous devons aussi nous attaquer à réhabiliter toutes nos infrastructures sociales et économiques, surtout celles de transport qui sont une condition nécessaire de développement de notre agriculture. Celle-ci se basera plus sur les performances de la traditionnelle courbe pour se moderniser, se mécaniser et couvrir aussi bien les produits vivriers que ceux industriels d’exportation. Les industries agro-alimentaires à l’horizon, nos produits d’industrie manufacturière utilisant la remarquable ingéniosité de notre peuple et, enfin, les industries minières lourdes seront l’objet de toutes nos préoccupations. Nous devons en effet chasser le chômage du pays et créer du travail pour occuper notre jeunesse si vivante dans les rues de la capitale. Enfin, pour réaliser tous ces programmes, nous allons réunifier le pays du point de vue monétaire. Aux divers Zaïres et Nouveaux Zaïres dévalués, nous comptons substituer un Franc congolais assaini et fort » (…) [169].
Une page d’histoire venait d’être tournée. Comme pour le confirmer, Mobutu s’éteignit au Maroc le dimanche 7 septembre, la nouvelle ère venait d’être ouverte [170], dans une étrange conformité avec les prévisions pourtant désuètes de la transition. Le calendrier électoral de la CNE avait, en effet, prévu que l’élection présidentielle devait se dérouler impérativement en juillet 1997, si toutefois elle avait pu être organisée. Un peu plus tôt qu’à la date prévue, en mai 1997, le Congo avait son nouveau Président de la République. L’événement a eu lieu avant et non après les élections présidentielles, exactement comme en novembre 1965, quand Mobutu s’improvisa président, peu avant la date où les Chambres réunies devaient choisir le nouveau Président de la République. Le fait qu’à chacun de ces deux rendez-vous, la nation congolaise ait eu chaque fois recours à la voie de fait, pour le renouvellement des premiers animateurs politiques de la République, loin des procédures inscrites dans la Constitution, rappelait qu’au coeur du grand continent, le processus de production de la modernité politique indigénisée n’était pas encore achevé et que la longue marche vers l’Etat de droit était encore et toujours en cours.
Texte : Discours de clôture de la conférence nationale souveraine
La clôture de la CNS a eu lieu le dimanche 6 décembre 1992. Les propos de Mgr Monsengwo restitués ici dans ses larges extraits font le point de ce cheminement, donnent la mesure de l’espoir qui en découle et des écueils à éviter. Ce discours est structuré en quatre parties.
1 Découvrir le passé afin de projeter le futur
L’histoire de ce forum est née d’un constat. Le peuple ne communiait plus avec le système politique en vigueur dans le pays. Il ne s’y retrouvait plus. Il ne s’identifiait plus à lui et donc refusait à lui apporter son adhésion. Les consultations populaires initiées par le Président de la République ont donné au peuple l’occasion de lui exprimer ses sentiments sur le régime de la 2e République et l’ont convaincu d’abolir le système du Parti-État. Le 24 avril 1990, le régime du Parti-État a été dissous. Un nouveau système de gouvernement, basé sur la démocratie, devait être mis en place.
Et ce fut tout l’objet du discours courageux du Chef de l’État, le 24 avril 1990. Mais encore fallait-il élaborer le système nouveau, dans un cadre approprié, pourvu qu’il emporte l’adhésion et le consensus du peuple. Et c’est ainsi qu’est née l’idée de la Conférence Nationale Souveraine. Celle-ci est conçue comme un forum composé de toutes les forces vives du pays appelées à jeter les bases du nouveau projet de société qui doit se substituer à celui du Parti-État. A cet effet, la Conférence Nationale Souveraine devait procéder à une analyse approfondie de l’histoire de notre pays, de ses institutions, du système qui a guidé leur fonctionnement et des hommes qui les ont animées. Cela s’appelle la relecture de l’histoire du pays ; non pas à des fins archéologiques pour une simple raison de curiosité du passé, mais aussi et surtout pour se prémunir contre la répétition des mêmes erreurs dans l’avenir. Une relecture de l’histoire qui laisse intactes les techniques et les méthodes propres de l’histoire qui feront les historiens de notre pays, sur la base des témoignages de notre relecture de l’histoire. Ne dit-on pas qu’un pays sans histoire est un pays sans mémoire ? Les principales leçons tirées de cette relecture de notre histoire sont les suivantes : le passé de notre pays est’ caractérisé par l’intolérance, l’exclusion et même l’incurie. L’échantillon de déballage fait lors des Déclarations de politique générale ne laisse aucun doute à ce sujet. Les violations des droits de l’homme étaient monnaie courante, d’autant que l’impunité les accompagnait la plupart du temps. L’épanouissement était le privilège de quelques groupes bien choisis parmi la famille, les amis, la tribu et la région, à la faveur d’un clientélisme institutionnel. L’incurie était à la mesure de l’enrichissement de quelques-uns au détriment de la majorité du peuple ; ainsi que le confirme le paradoxe de l’opulence de quelques-uns face à la misère du peuple. Ce qui nous a fait poser une fois la question : qu’avez-vous fait de votre frère ? Le passé de notre pays est aussi caractérisé par l’intolérance, compagne fidèle de l’antidémocratie. Certes, des textes constitutionnels ont été adoptés, instaurant un régime démocratique. Mais la démocratie est vite apparue comme une panacée dont l’application n’a pas suivi, faute d’esprit et de culture démocratiques dans le chef des principaux animateurs et surtout dans celui du peuple dont la prise de conscience qui ne devait d’ailleurs être que progressive de sa souveraineté, n’est encore qu’embryonnaire. Mais le peuple devient critique. Et cette prise de conscience, pouvons-nous déjà dire, vient à pas de géant à la faveur de la Conférence Nationale Souveraine.
Le passé de notre pays se distingue aussi par l’exclusion, amie de l’intolérance. Et comme j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, l’exclusion ne fait pas partie des traditions politiques de notre pays. L’intolérance signifie que l’on ne tolère pas la contradiction. On fuit les débats d’idées. On recourt aux manifestations de violence pour incriminer ou empêcher simplement la libre expression des opinions, bref pour s’opposer à la démocratie. Notre pays connait des violences et des exclusions résultant de l’intolérance. Hélas ! de nombreuses victimes innocentes sont à déplorer. Elles sont l’objet de l’exclusion parce que n’appartenant pas à telle tribu ou ne partageant pas telles idées.
C’est avec la connaissance de lot du passé qu’il nous fallait élaborer un nouveau projet de société, avec un système de gouvernement et de nouvelles institutions qui garantissent le plein exercice de la démocratie, en assurant le respect des exigences de cette forme de gouvernement.
2 En marche vers des valeurs de noblesse
Personne ne peut douter qu’après plus de 20 ans de monopartisme, il ne soit pas aisé d’instaurer d’emblée la démocratie sans résistance ni dérapage. Les premières difficultés résultent de la mauvaise perception du changement dans le chef de quelques-uns ou du fait que, dans le chef de certains autres, la bonne perception du changement ne se réalise pas aussi vite qu’ils le souhaitent. C’est ce qui a expliqué les difficultés du démarrage des travaux de la Conférence Nationale Souveraine, les départs forcés des conférenciers, l’intolérance sous diverses formes jusqu’aux tristes événements du 16 février 1992, sans parler de l’insécurité généralisée et de l’exode forcé des originaires du Kasai résidant au Katanga. Tout cela, nous devons l’appréhender dans un sens de tolérance. Cela fait partie de l’engendrement douloureux de la 3e République. Que de sommes de travail, de patience et de difficultés il a fallu pour bâtir la nation zaïroise/congolaise.
Heureusement la foi du peuple dans le véritable changement a permis à la Conférence Nationale Souveraine de surmonter les difficultés et de réaliser quelques succès dans la poursuite de son programme. A notre sens, le plus grand acquis de la Conférence Nationale Souveraine, outre la problématique de tout un peuple en marche vers des valeurs de noblesse, est que désormais aucun dirigeant ni gestionnaire de l’État ne se permettra de gérer la chose publiqi à la manière de la 2e République. Il y regardera par deux fois, car sait-on jamais, tout pourra un jour être connu et sanctionné. Je me contenterai en plus de souligner particulièrement comme résultat de nos travaux la mise en place des institutions de la transition, conformément à l’Acte portant dispositions constitutionnelles relative à la période de Transition, Acte adopté unanimement par la Plénière toutes tendances confondues, ainsi que l’élaboration du projet de Constitution de la IIIe République adopté aussi unanimement par la Conférence Nationale Souveraine.
A propos de la transition, je suis heureux de féliciter d’une manière particulière, les membres de la Commission de transition pour l’excellent travail qu’ils ont accompli en produisant l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, Acte qui a pu couler en termes de loi les 10 principes clés du Compromis politique, arrivant ainsi à réconcilier les signataires du compromis et ceux qui les avaient délégués d’une part et la Conférence Nationale Souveraine d’autre part grâce à l’Acte portant dispositions constitutionnelles. La philosophie de cet Acte est clair : le Chef de l’État au-dessus de la mêlée, un Gouvernement responsable de la gestion et un Haut Conseil de la République chargé du contrôle et de la sanction. L’agencement des compétences de toutes les institutions est fait de manière que l’information et la concertation sont permanentes entre les trois institutions. Conformément à cet agencement, la Conférence Nationale Souveraine a mis en place les trois institutions : un Chef de l’État, un Gouvernement et un Haut Conseil de la République issus de la Conférence Nationale Souveraine. Ces trois institutions sont appelées à travailler dans la non-conflictualité, la concertation et l’harmonie. Si tel ne parait pas être toujours le cas, la faute n’incombe pas à l’Acte, mais dans la manière dont les animateurs desdites institutions l’appliquent.
S’agissant du projet de Constitution de la IIIe République, il est de type fédéral. Qu’est- ce à dire ? Il consacre premièrement l’unité nationale. Car sans unité nationale, la fédération n’a pas de sens. Cette unité est placée sous la garantie du pouvoir fédéral.
Deuxièmement, l’autonomie constitutionnelle des entités fédérées. Elle leur garantit le droit de s’occuper, sans ingérences intempestives du pouvoir central, de leurs intérêts locaux. Troisièmement, la libre coopération entre États fédérés pour le développement de leurs administrés. Le passage de l’État unitaire de notre pays à celui de l’État fédéral se fera juridiquement lors de l’adoption de la Constitution par le référendum. Mais il faudra un minimum de temps pour que les institutions fédérées de base puissent disposer effectivement de l’ensemble de leurs moyens d’action. Aussi, tous ceux qui éprouvent dans l’adoption par la CNS de la Constitution de la IIIe République, la crainte de se voir précipité vers l’inconnu, peuvent-ils se tranquilliser. Qu’on le veuille ou non, il faudra donner le temps au temps pour que celui-ci traduise et consolide intégralement dans les faits l’option juridique fédéraliste. Certains pays amis d’Europe nous en donnent l’exemple depuis deux décennies ou près de dix- sept ans.
3 Pour un nouveau projet de société
Quelque beaux et fignolés que puissent être les textes d’une loi ou d’un contrat, si ceux qui sont appelés à l’appliquer ne sont pas de bonne foi ou sont incompétents, l’objectif poursuivi par cette loi ou ce contrat ne sera jamais atteint. L’expérience de la lre et de la IIe République est là pour nous en convaincre. La Loi fondamentale de 1960 peut avoir eu des lacunes, mais les hommes de bonne foi voués à la cause du peuple ne pouvaient pas ne pas trouver une solution pour la sauvegarde de l’ordre républicain. Malheureusement, la bonne foi a fait défaut quelque part et le drame est né entre le Président de la République et son Premier Ministre. En 1964, la Constitution de Luluabourg a vu le jour, mais elle n’a pas fait long feu. Encore une fois parce que la bonne foi fait défaut et elle a été remplacée par le calcul politique, sacrifiant l’intérêt du peuple. La Constitution du MPR avec deux partis politiques, soutenue par le Manifeste de la N’Sele, n’était pas en soi si mauvaise. Mais encore une fois, les animateurs politiques à la recherche de la consolidation du Pouvoir, ont progressivement oublié la finalité du pouvoir et glissé fatalement vers l’autocratie. Le pouvoir autocratique ne se partage pas. Il échappe au contrôle et à la sanction, privilégie ceux qui intègrent le processus de la consolidation de l’autocratie, exclut toute opposition et crée ainsi les germes de son autodestruction.
C’est la raison pour laquelle nous mettons en garde le peuple zaïrois, chaque fois qu’il aura à choisir les animateurs d’une institution, afin qu’il veille aux critères de la compétence, de moralité et d’honorabilité. Faute de quoi, il n’aura servi à rien de construire l’édifice de la IIIe République avec tant de précautions, les animateurs mal intentionnés le détruiront en peu de temps. Aussi en appelons-nous à la conscience de tous et de chacun pour y veiller. Vous, peuple souverain, votre responsabilité est grande. Les dirigeants que vous aurez choisis, vous les aurez mérités. Alors veillez aux critères des valeurs morales, intellectuelles et spirituelles dans le choix de vos dirigeants. Vous formateurs de l’opinion, vous avez une responsabilité lourde dans la mesure où vous êtes capables d’atteindre une audience très large. Aussi prenez garde. Vous pouvez fabriquer des démocrates en mettant en exergue les valeurs républicaines tout comme vous pouvez aussi créer des dictateurs en promouvant le culte de la personnalité. Vous constituez le quatrième pouvoir. Veillez à ne pas l’oublier. Quant à vous, intellectuels, n’abusez pas de la confiance que vous témoigne le peuple en justifiant auprès de lui, par des arguments pseudo-scientifiques, les antivaleurs dans lesquelles vous vous complaisez. Comme nous avons eu l’occasion de le dire, l’intelligence est faite pour la vérité comme l’oeil pour la lumière. Vous éducateurs, parents, soyez les modèles des valeurs que vous voudrez voir imiter par ceux qui vous sont confiés par le pays.
4 Chaque être humain est capable de bien
Dans notre for intérieur, chacun de nous doit examiner sa conscience pour savoir si lui aussi n’a pas sa part de responsabilité dans la débâcle de notre pays et s’il ne doit pas battre sa coulpe. Ne nous divertissons pas à faire l’examen de conscience des autres. Que chacun se regarde dans le miroir de sa vie et se place devant Dieu et devant sa conscience. Nous avons voulu et nous nous sommes employés à le faire ; nous avons voulu, avons-nous dit, amener chacun de nous à cet examen de conscience sans complaisance de son propre passé. Même ceux dont le rôle de toute évidence les désigne comme artisans du système que le peuple vient de rejeter – le peuple c’est-à-dire nous tous -, et dont pourtant ils ont tiré l’avantage matériel visible, n’arrivent pas encore à se convaincre qu’ils doivent demander pardon au peuple meurtri. Nous ne leur en tenons pas rigueur. Nous poursuivons le travail commencé pour les y amener. Aussi comprenez-vous que dans cet état de choses, le rite de réconciliation prévu à l’occasion de la clôture ne pourra avoir lieu, faute de ce repentir et de cette demande de pardon. Nous aurions préféré voir spontanément se développer ce sentiment accompagné d’ailleurs de l’engagement, que plusieurs ont déjà eu l’occasion de manifester, à réparer. Nous n’avons rien vu venir. La société elle-même, sur la base des décisions de la Conférence Nationale Souveraine, trouvera sans doute la voie pour obtenir réparation pour le préjudice subi suite à la mauvaise gestion de l’État.
Mais comme nous l’avons aussi dit, ce fait ne signifie pas que la Conférence Nationale Souveraine ait raté la réconciliation. Cette réconciliation s’est faite tout au long de notre cheminement. Elle est en voie de se faire. L’Acte portant dispositions constitutionnelles, le projet de Constitution de la IIIe République, l’ensemble des décisions prises par des Actes au cours de nos débats et de nos discussions sont là pour nous dire que nous nous sommes mis d’accord, que nous nous sommes entendus, que nous nous sommes réconciliés autour d’un même idéal de changement. Cette réconciliation continue donc et nous sommes persuadés que la cérémonie de ce jour se fera encore un jour.
Les lampions de la CNS s’éteindront bientôt, le travail en faveur du changement tel que perçu par la CNS est l’affaire de tous. Vous êtes des ambassadeurs de la CNS auprès de la population de vos entités. Ne trahissons pas le projet de société de la IIIe République, tel qu’il apparaît dans son projet de Constitution et dans les divers Actes que la CNS a adoptés.
Deuxième République-Transition
Treizième équipe gouvernementale de la Deuxième République (5 octobre 1967 – 4 mars 1969). Pour la dernière fois, E. Tshisekedi (à droite de J. D. Mobutu) est encore la deuxième personnalité de l’Exécutif national en qualité de ministre de l’Intérieur et des affaires coutumières, suivi de J. Bomboko (à gauche du président), ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur. Le 16 août 1968, il allait permuter avec J. Nsinga (à côté de Bomboko), le ministre de la justice. Derrière, entre ces derniers, on reconnaît E Kibassa-Maliba, ministre de la jeunesse et des sports (Photo RTNC)
Présentation (1977) au Stade du 20 Mai de deux «gendarmes katangais» capturés pendant la guerre de 80 jours
(Photo RTNC)
Bain de foule des présidents des Etats
membres de la CEPGL à Bukavu. De gauche à droite, Juvénal Habyarimana (Rwanda),
Mobutu Sese Seko (Zaïre) et Jean-Baptiste Bagaza (Burundi) (Photo RTNC)
Le cardinal Malula célèbre au stade du 20 mai la messe du Centenaire de l’Eglise catholique au Congo, le 3 juin 1979 (Photo RTNCj
Étienne Tshisekedi wa Mulumba, figure emblématique de l’opposition intérieure au régime de Mobutu, immortalisant une audience accordée à des «proches» dans le bureau de sa résidence à Limete (photo Shako)
Faya Tess, chanteuse de l’Afrique en pleine exhibition au Palais du Peuple en 1988.
© auteur
Une vue de la «Marche d’espoir» des chrétiens de la paroisse Notre Dame des Grâces a Binza pour réclamer la réouverture de la CNS (Dimanche 16 février 1992).
© auteur
Face aux forces Politiques du Conclave (FPC), la délégation de l’Union Sacrée de l’Opposition Radicale et Alliés (USOR et Alliés) aux Concertations politiques du Palais du Peuple. Face au micro, de gauche à droite, Gérard Kamanda wa Kamanda le porte-parole de la délégation et Roger Gisanga a Gidiata, son président, janvier 1994.
(Photo Okana)
Le 17 mai, les troupes de l’AFDL prennent possession de la capitale (Photo Minasema)
A l’orée de la Troisième République: l’amitié des enfants des pionniers de l’indépendance. Ci-dessus, Justine Mpoyo Kasa-Kubu ministre-résident en Belgique (à gauche) félicitée par Juliana Lumumba vice-ministre de l’information, presse et affaires culturelles (à droite) lors de la présentation de son livre au Centre-Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, le 20 août 1997.
© : Afrique-Editions (Photo Kalala)
«Moi, Laurent-Désiré Kabila, président de la République Démocratique du Congo…!», le jeudi 29 mai 1997
Photo Minasema)
[1] Dans ce chapitre, on parlera plus particulièrement de » zaïrois » et de » Zaïre » (au lieu de « congolais » de « Congo ») pour désigner la période mobutienne, pendant laquelle le nom du pays avait changé.
[2] Quelle que soit son étymologie (Sao-Longo/Zaa-Longo = Jean Longo ou Is’aa longo = « père de la houe » en lomongo, surnom d’un colonial au Sud-Equateur vers les années 20), Salongo, tiré d’une chanson populaire, a toujours été associé au travail agricole (Hulstaert. G., « Note sur l’origine du mot Salongo », Annales Aequatoria, 6, 1985, p. 205-206). Transformé en concept, au cours de l’ère mobutienne, ce terme faisait référence au travail manuel collectif, décrété le samedi ou, de manière ponctuelle, pour préparer un événement. Cette initiative fut calquée sur le modèle de Jukong (Chine) ou de Djoutche (Corée du Nord), à l’issue d’un voyage du président Mobutu dans le Sud-Est asiatique.
[3] Suite au rapport du gouverneur Paluku, la garde militaire fut retirée de la résidence de l’ancien président, à qui il fut interdit de quitter le Mayumbe. Il mourut à Borna. (Monguya Mbenge D. 1977 : 45-16).
[4] Il existe une explication « du dedans » qui justifie le choix de ces termes. Le président lui-même l’explicita : » Nous avons créé un parti national ; ce parti, nous ne l’avons pas appelé parti mais mouvement parce qu’il était destiné à entretenir le mouvement des idées-forces de notre mouvement en vue d’une action permanente. Ce mouvement, nous l’avons qualifié de populaire, terme qui démontre notre souci de le voir s’intéresser à l’ensemble de nos populations. Et enfin, ce mouvement populaire, nous avons voulu qu’il soit le mouvement populaire de la Révolution, MPR, afin que l’on connaisse d’emblée le sens nouveau que nous voulons donner à notre action, une action qui implique une rupture et un changement, une rupture totale, un changement radical par rapport aux idées reçues et aux méthodes qui avaient fait faillite avant notre arrivée à la tête du pays ».
[5] A cet endroit, le président érigea en 1966 une ferme présidentielle et une résidence secondaire, inspiré par l’expérience de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Par la suite, il se ravisera et établira la future « capitale » potentielle plutôt à Gbadolite. N’sele devint alors la Cité du Parti jusqu’en 1990 avant d’être restituée à la République sous l’appellation de la Cité de la N’sele. Soulignons que N’sele, comme Gbodolite furent des centres de développement agricole. Dès 1968, fut créé le « Domaine agro-industriel présidentiel de la N’sele (DAIPN) tandis que Gbadolite était doté d’un Centre de développement agricole (CDA).
[6] Le texte du « Manifeste de la N’sele » a connu plusieurs éditions. L’édition originelle peut être consultée dans Mobutu S.S. action et parole. (Présidence de la République 1975, pp 62-67).
[7] Ces grèves, dont le motif « officiel » était la situation interne des établissements concernés, se multiplièrent curieusement, tant à Kinshasa que dans l’arrière-pays. Au cours du seul mois de janvier 67, elles éclatèrent à l’école du commerce (future ISC) et à la section de Lovanium à Bukavu, à I IBTP, à l’Institut National des Mines de Bukavu, à l’UOC puis à l’IPN.
[8] Les Discours, Allocutions et Messages du Président Mobutu ont été publiés par le Bureau de la présidence de la République. Les textes de 1965 à 1975 font l’objet des deux premiers tomes publiés en 1975. Deux autres tomes couvrent la période allant de 1976 à 1981. L’année 1982 constitue un volume à part. Pour la période allant de 1983 à 1990, les textes ne sont pas encore disponibles.
[9] Makanda (Kabobi) Hubert, l’un des présidents les plus remarquables de l’AGEL à l’université Lovanium de Kinshasa, au cours des années 60, fut incorporé au Bureau Politique du MPR en 1972 et mourut peu de temps après, sans doute empoisonné. Avant sa mort, il avait initié un projet « d’école du parti » pour la formation des cadres du pays. Lorsqu’il fut finalement créé, cet institut porta son nom.
[10] Madrandele Tanzi fut l’un des premiers universitaires à avoir cru dans le projet du MPR ; il en devint l’un des premiers théoriciens. Il mourut à Lubumbashi en février 1974 des suites d’une crise cardiaque. On évoqua l’hypothèse d’un empoisonnement dont il aurait été victime par erreur, ayant consommé une nourriture destinée au cardinal Malula – mais cela n’est pas attesté.
[11] En réalité, l’auteur était plutôt un religieux belge. (P. Lefebre, CICM).
[12] Tel est le cas de certains noms issus des maximes et des sagesses populaires qui invitaient à réfléchir avant d’agir ! D’autres noms étaient volontairement fantaisistes comme ceux-ci : Abomi soda (a tué un soldat), Aleteia (mot grec qui a une consonance faussement africaine), Jeki (prononciation africanisée du prénom « Jean » frappé d’interdit) etc. Ce n’est que plus tard, après la réaction à chaud, qu’apparurent des prénoms d’origine locale faisant référence à des vertus chrétiennes : Safi (pureté), Bolingo (amour), Bomengo (bonheur), etc.
[13] Conférence épiscopale du Zaïre. Troisième Assemblée générale du synode des évêques, Kinshasa, 1977, p 15.
[14] Les actes de ce Colloque ont été publiés partiellement chez Présence Africaine en 1982. Quelques autres textes, parmi tant d’autres qui devaient faire l’objet d’une autre publication, ont paru dans le recueil d’études sur le Congo édité par Jewsiewicki (1984). Critiques, ils dénonçaient déjà les débordements et les excès auxquels conduisait la pratique idéologique du Parti unique. La suite de l’évolution démontra finalement qu’elle servit surtout d’instrument au culte de la personnalité et à l’assujettissement des masses.
[15] Furent ainsi créés : l’Ordre National du Léopard (Ordonnance-Loi n° 66/330 du 24 mai 1966), l’Ordre National du Zaïre (Ordonnance-Loi n° 68/437 du 2 décembre 1968), l’Ordre des Compagnons de la Révolution (Ordonnance-Loi n° 74/016 du 20 janvier 1974). Le président Mobutu a créé aussi 5 autres décorations : La Médaille du mérite civique (1966), la Médaille du mérite agricole (1966), la Médaille du mérite des arts, sciences et lettres (1966), la Médaille du mérite conjugal (1983) et la Médaille du mérite maternel (1983).
[16] Dans l’empire luba, l’hymne aux jumeaux, Djalelo, était exécuté spécialement en hommage au grand chef et à la divinité. Le titre originel de la chanson signifiait « Aujourd’hui contemplons le roi Python » (Djalelo tubanjilanga ye Mulopwe Moma) ; elle comprenait une quarantaine de couplets. L’adaptation au Mulopwe Mobutu comprenait une vingtaine de couplets dont voici le premiers :
Djalelo tubanjilanga ye Mulopwe Mobutu.
Si ubamumone mubanjile Sese Seko
Si ubamumone mubanjile Wa Za Banga
Si ubamumone mubanjile Mukulu wa Ntanda.
Aujourd’hui, louons Mulopwe Mobutu
Quand vous (le) voyez, louez Sese Seko
Quand vous (le) voyez, louez Wa Za Banga
Quand vous (le) voyez, louez notre chef suprême.
[17] Le musicologue Philippe Kanza a identifié l’origine de cet hymne. Il s’agit d’une contrefaçon de l’opéra Aïda que Giuseppe Verdi composa pour l’ouverture du Théâtre du Caire en 1871.
[18] Il suffit, pour s’en convaincre, de prendre connaissance du serment des troupes Kamanyola, qui fut élargi ensuite à l’ensemble de l’armée. « Makila ma biso, mpo na ekolo, mpo na Mobutisme, mpo na Guide, vive le Guide, vive le président-fondateur, vive le Zaïre » (Notre sang sera versé pour la patrie, pour le Mobutisme, pour le Guide. Vive le Guide, vive le président-fondateur, vive le Zaïre).
[19] Signalons que, dans le cadre de l’application de la politique de l’authenticité, les camps militaires furent débaptisés pour porter les noms des héros de la guerre contre les rébellions. Ainsi les camps Reisdorf (Kin II), Brichard (Ndolo), Prince Charles (Kisangani rive gauche), Gilliaert (Kananga), Massart (Lubumbashi), Lemarinel (Kolwezi Nzilo III) devinrent respectivement camps Loano, Mbaki, Lokosa, Bobozo, Mutombo, Bonange.
[20] Par la suite, ce titre sera remplacé par celui du chef d’état major des FAZ
[21] Le slogan en lingala était explicite : « Olinga, olinga te, ozali kaka MPR » (que tu le veuilles ou non, tu es toujours membre du MPR).
[22] Cf. Panorama des 20 ans du Mouvement Populaire de la Révolution, édité par la Présidence de la République en 1987. La première partie de cette étude est consacrée au « Mouvement Populaire de la Révolution – Parti-État » et comprend des analyses notamment sur les mutations internes au sein du MPR (pp 21-40), sur son contenu doctrinal et sur ses organes (pp 41-136).
[23] Par la suite, les concepts de » Conseil législatif national » et « Conseil exécutif national » seront réduits en « Conseil législatif » et « Conseil exécutif ». Le » Commissaire de région » redeviendra » Gouverneur » à partir de 1977.
[24] Pour plus de renseignements concernant l’itinéraire de ces personnages, consulter l’ouvrage de Mabi M. et Mutamba M. 1986.
[25] A propos de la CEPGL, consultez notamment la thèse de Kilembe Sessa : L’apport de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (Zaïre, Rwanda, Burundi) consacrée au développement agricole régional, Montpellier, thèse 3e Cycle, 1980.
[26] Kamitatu Massamba (1977 :16-26) a estimé que l’affaire angolaise constituait un tournant décisif dans la politique intérieure et extérieure du Zaïre. Sans cet épisode, le cours des événements aurait certainement été différent.
[27] Claudine Vidal (1971 : 527-528), dans ses enquêtes au Rwanda en 1967-68, à la fin des années 60, a été frappée par la permanence de la mémoire des souvenirs macabres qui interdisait pratiquement que le passé ne puisse être évoqué sans susciter de nouvelles passions. Visiblement, cette capacité (rwandaise) de conservation du souvenir des blessures intérieures contraste avec l’étonnante amnésie congolaise en ce qui concerne les faits marquants du passé.
[28] Le coup d’Etat mené par Juvénal Habyarimana, Hutu (de Gisenyi) contre un autre Hutu. Grégoire Kayibanda (de Gitarama) divisa la communauté hutu en deux groupes. Les « fidèles » de l’ancien régime, contraints eux aussi à l’exil, se rapprochèrent des Tutsi. Ils allaient constituer le nouveau pouvoir de Kigali au cours des années 90.
[29] Le regard populaire, au Congo, qualifie de « Rwandais » tout ressortissant de l’ancien Rwanda-Urundi qu’il soit effectivement Rwandais ou Burundais. Ils appellent « Zaïrwandais », ceux parmi eux qui se déclarent « zaïrois », peu importe qu’ils soient Rwandophones du « cru » ou immigrés de plus fraîche date.
[30] Au recensement de 1970, il y avait dans le Masisi 193.428 « Zaïrwandais » sur une population totale de 273.920 (soit les 70,6 % de la population). A Rutshuru, il y en avait 81.509 sur 333.916 (soit 24,4 %) ; à Goma, ils étaient 17.713 sur 74.835 (23,7 %) et à Walikale, 1.882 sur 78.334 (2,4 %) (cf. de Saint Moulin L., Atlas des collectivités… 1976).
[31] On peut citer, entre autres, le cas de Marcel Bisukira (munyamulenge ?) ministre du Commerce Extérieur au gouvernement central de Lumumba) ; comme celui de Cyprien Rwakabuba (Tutsi de Rutshuru) et de Célestin Rwamakuba (Hutu de Rutshuru) ministres provinciaux respectivement de l’Enseignement et des Mines. Rwakabuba a déjà publié ses mémoires sous le titre de Souvenirs et témoignages (Kinshasa, éd. Isata, 1994).
[32] Selon le recensement de 1970, les Rwandais sont surtout présents à Kinshasa (352) où ils constituent le troisième groupe d’étrangers en ordre d’importance, dans le Haut-Congo (467) et au Katanga (172) (cf. de Saint Moulin L., Atlas des collectivités… 1976).
[33] En octobre 1965, l’assemblée provinciale du Nord-Kivu vota une résolution d’expulsion de tous les Rwandais de la région, pour « collusion avec les rebelles ».
[34] L’art.6 de cette Constitution précise (à son premier alinéa) qu’« il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée, à la date du 30 juin (60), à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus ou d’une partie de tribu, établies sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 »
[35] Ancien étudiant de l’université Lovanium où il fut président de « 1 Association des Etudiants Rwandais », B. Bisengimana est, avec son compatriote André Katabarwa, le premier ingénier civil électricien (1961) de l’université (Annuaire des diplômés de l’université Lovanium de Kinshasa 1958-1968, Kinshasa février 1969, p. 32).
[36] A son « départ » en 1977, ses fonctions furent réparties entre plusieurs instances : le Premier Commissaire d’Etat, le Conseiller spécial du Chef de 1 Etat en matière de sécurité, le Comité Central du MPR.
[37] On n’osa pas (encore) étendre ce privilège aux « autres » immigrants qui sont venus à partir de 1959. Cette loi 72/002 du 5 janvier 1972 fixait en quelque sorte les conditions d’application de 1 Ordonnance-loi 71/002 du 28 mars 1971 qui stipulait, en son article unique : » les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationaité zaïroise à la date susdite ».
[38] Cf. Mémorandum des Hutu zaïrois adressé au Président-Fondateur du MPR, Président de la République du Zaïre, 1980 ; Mémorandum du Mwami Ndeze Iriyuz’Umwami au Président de la République, novembre 1980.
[39] Celle-ci fut accordée par le Président de la république (après avis conforme du Comité Central), de manière discrétionnaire, aux rwandophones « barons » du régime, pour « services éminentes » rendus à la nation.
[40] La remise en cause de la législation sur la nationalité poussa à des réactions « suicidaires ». En 1981, un groupe nommé « Peuples d’origine rwandaise au Zaïre » adressa une lettre au secrétaire général de I ONU pour lui demander I autorisation de créer un Etat séparé et indépendant du Nord-Kivu. Cette nouvelle loi, I ancien doyen de la faculté de Droit de l’université de Kinshasa, Ndeshyo Rurihoze (Hutu) 1 a qualifiée » d’injuste, d’arbitraire et d’inéquitable » (« La nationalité de la population zaïroise d’expression kinyarwanda au regard de la loi du 29 juin 1981 », Kinshasa, Bibliothèque du Centre d’études et de recherches sur l’intégration africaine ‘CERIA’, juin 1992). Psychologiquement, il était, en effet, inadmissible de perdre un « droit acquis » pendant 9 ans, de 1972 à 1981.
[41] On consultera avec intérêt le texte de Mudimbe V.Y. présentant le bilan culturel de 1960 à 1980 (Vanderlinden, J., pp. 311-398) et celui de Ndaywel sur l’importance du Zaïre culturel dans l’univers négro-africain (Kaké i.B. 1990 :175-187).
[42] Abacos vient de la contraction de » à bas costume ».
[43] Les noms des pagnes proviennent de plusieurs sources, notamment des chansons en vogue à l’époque de leur apparition sur le marché (Mon mari est capable, Mbanda monument, Bombanda compliqué, Bina na ngai na respect, etc) ou des circonstances sociales et politiques du moment (Libanga ga diamant, Nzete ga mbongo, Ceinture ga Maréchal, Minu ga Bobi Ladawa, Masasi ga Maréchal). Il n’est pas rare que son nom ait une connotation érotique : Tangawisi (un aphrodisiaque), Lisu ga pité (regard sensuel), etc. Une étude onomastique rigoureuse pourrait établir une nomenclature plus complète.
[44] Il existe également des restes de plusieurs types, chaque modèle portant un nom pittoresque, notamment Bala-bala (la rue), Bunga nzela (perdre le nord !), Silawuka (folie), Mbanda leka ngai na leka (rivale, passe ton chemin et j’en fais autant), Bga ntaba (crotte de chèvre), Mpongo Loue (nom d’une chanteuse), Etoko (natte), etc.
[45] L’épouse du chef de l’État était ainsi appelée « citoyenne présidente » ou « marna présidente » ; il en allait de même pour les autres fonctions : « marna commissaire d’État » ; « marna directrice », « marna étudiante », etc.
[46] Cf. ordonnance n° 73/079 du 14 février 1973. A propos de cette législation on peut consulter l’étude de Pauwels J.M. et Pintens W. 1983.
[47] Le premier cas est celui des noms généalogiques, par exemple, Sabwa à Matanda (Sabwa issu de Matanda) ; le deuxième celui des noms aristocratiques. En voici quelques exemples : Ne Kongo. Mwene Malamba, Mbwil a Mpang, Fumu wa Utadi, Udjuu Ungwankebi (Ne, Mwene, Mbwil, Mfumu, Udjuu signifiant » Seigneur » !). Le troisième cas, celui des noms-proverbes sera illustré par le postnom fameux de » Banga Mpongo Bakokele Lokanga » (référence à l’aigle). Enfin le dernier cas, tout aussi fréquent, est celui des noms correctifs. En voici quelques exemples : Mandata Mandar (mot déformé suivi du mot originel signifiant palme) ; Malala Alar (Orange-Orange). Une étude systématique de ces identités que les intéressés se sont octroyées eux-mêmes s’impose pour une meilleure connaissance de la pensée zaïroise.
[48] Les recherches du prof. B. Luykx portèrent essentiellement sur cette question. Cf. « Adaptation de la liturgie en pays de mission Mission et Liturgie, Bruges, 1960, pp. 67-77 ; Eglise Vivante, t. XII. 1960, pp. 34-45 ; Rythmes du Monde, n° 34. 1960. pp. 3-13.
[49] Cf. Décret Zaïrensium Diocesium du 30 avril 1988 de la Congrégation pour le culte divin, à la demande insistante de Son Excellence Mgr Monsengwo Pasinya, évêque titulaire de Aequae novae in Proconsulari, président de la Conférence des évêques du Zaïre.
[50] Il s’agit de la chanson Nakomitunaka dont la première strophe (traduite) est bien connue dans son langage originel.
Ae ! nakomitunaka
Nzambe nakomitunaka
Poso moïndo ewuta nde wapi
Koko na biso ya kala ye nde nani ee
Yezu mwana Nzambe ye mpe mundele
Adamu na Eva bango mpe mindele
Mpo na nini Nzambe osala biso boye ?
[51] Entre 1966 et 1977, eut lieu un débat en matière de politique linguistique. Il s’agissait d’adopter une langue nationale. Un problème se posa : il fallait privilégier une des langues au détriment des trois autres. Ce choix délicat, surtout entre le lingala et le swahili, ne put se faire. A partir des années 80, la crise économique fit oublier ce problème. Mais le débat n’est pas clos. On prendra connaissance de quelques opinions qui furent exprimées : K. Mateene, « Du choix du lingala comme langue national », Voix Muntu, 10, 1966, pp. 11-12 ; Mudimbe, V; Y, «Autour d’une langue nationale», Synthèses, 15, 1970, pp. 14-19 ; Gudijiga, B., « La Francophonie au Congo », Congo-Afrique, 54, 1971, pp. 191-200 ; Kajiga, B. « La langue swahili », Zaïre-Afrique. 67. 1972. pp. 15-16 : Kazadi, N. et Mutombo H.M., « Propos sur l’expansion de la langue luba ». Africa. 5.1981. pp. 19- 27 ; Sesep Nsial, « La querelle linguistique au Zaïre », Linguistique et Sciences Humaines, 23, 1978, pp. 1-30.
[52] A Kinshasa, les journaux s’appelaient Elima et Salongo, A Lubumbashi, Taïfa, Mwanga puis Mjumbe. à Kisangani, Boyoma, à Mbandaka, Mambenga, à Bukavu, Jua, à Kikwit Beto na beto. etc.
[53] 11 existe au sein de l’université zaïroise, plus précisément au sein de sa faculté des Lettres, un département de philologie africaine (langues et littérature africaines) dont les travaux ont poursuivi l’étude des langues locales. A Lovanium, Bwatsha-Kafungu, un étudiant spécialisé dans cette matière, (1965) a créé le Club Muntu qui édita une revue, la Voix Muntu. Un ancien de la même option. A. Bong’llanga travailla à l’élaboration de manuels scolaires en lingala. En 1969, Mgr Kajiga Baliuta créa, à Goma, le Centre Ntu, consacré à l’étude du swahili et à la traduction des textes dans cette langue. Le CELTA (Centre de Linguistique théorique et appliquée) fondé par Mudimbe V.Y. a repris à son compte cette préoccupation, tant pour la recherche fondamentale que pour l’enseignement pratique.
[54] L’auteur se distingua également en tant que critique littéraire, notamment par son étude sur Jacques Rabemananjara (Jacques Romananjara, l’homme et l’œuvre PA 1981) et par celle qu’il consacra à la Littérature zaïroise de langue française (Karthala 1984). Sur ce même thème, il avait également établi une Biographie littéraire de la République du Zaïre 1931-1972, (Lubumbashi 1973).
[55] L’auteur publiera un autre recueil (la Cendre demeure, Kinshasa, 1983) mais se spécialisera surtout dans la critique littéraire. Il publiera trois anthologies littéraires : Anthologie de la poésie zaïroise (Kinshasa, 1977) ; Poésie vivante I et II (Ed. du Mont Noir, 1970 et 1972) ; Le Zaïre écrit (Tübingen 1976).
[56] Mudimbe est aussi un brillant essayiste comme en témoignent ses autres travaux : L’autre face du royaume (Lausanne 1973) ; L’odeur du père (PA 1972) ; The Invention of Africa (Bloomington, 1988) ; The Surreptitious Speech : Présence africaine and the Politics of Othemess 1947-87 (The University of Chicago Press, 1992) ; Africa and the Disciplines (en collaboartion The University of Chicago Press, 1993) ; Shaba deux (PA 1989) constitue la dernière production littéraire de l’auteur.
[57] Ce roman fut réédité chez Hatier en 1984. Notons que Ngal est également l’auteur d’une étude remarquable sur A. Césaire (Dakar, nouvelles Editions Africaines, 1975 : réédition en 1994).
[58] Citons encore ses ouvrages les plus récents, notamment le Réfugié (1984) ; Monnari est en grève (1986) ; Psaumes sur le fleuve Zaïre (1987) ; La pierre qui saigne (1990). Ngoma Binda a tenté d’établir une synthèse critique de l’ensemble de son oeuvre.
[59] Professeur à l’INA, il publia également un ouvrage didactique (Je fais du théâtre, Paris, 1984) ; La maison d’édition « Arts et Spectacles » publia en 1985 le disque Ngembo. Sa pièce, Notre sang (Kinshasa 1991) le révèle comme visionnaire. Il prit part à la lutte contre le sida avec sa pièce Tu es sa femme, peu de temps avant de s’éteindre le 27 septembre (1994).
[60] Il s’agit notamment du Prix Paul Verlaine de l’Académie française (1987), du Grand Prix littéraire de l’association des écrivains francophones d’Afrique noire (1991), du Jasmin d’argent pour l’originalité poétique (1992) et du prix Théophile Gautier (1993). Cf. M.C. De Coninck, Kama Kamanda : au pays du conte, Paris, l’Harmattan, 1993 ; P. Sartin, Kama Kamanda, Poète de l’exil, Paris, l’Harmattan, 1994.
[61] En tant que critique littéraire, il publia également plusieurs titres, notamment « Littérature zaïroise avant I960 «Zaïre-Afrique n°68, octobre 1972, pp. 477-497 ; «La Voix du Congolais et la prise de conscience des évolués » Lectures africaines vol 1, fasc. 1.1972-1973 ; Littératures africaines, poésie-romans de 1930 à nous jours, Silex, 1984 ; Kourouma et le mythe : une lecture de « Les soleils des indépendants» Silex, 1985 ; Ecritures et discours littéraires : études sur le roman africain, L’Harmattan, 1989.
[62] Les études ethnomusicologiques en sont à leurs premiers balbutiements en dépit des efforts de Benoît Quersin de l’Institut des Musées Nationaux du Zaïre (IMNZ). Dans l’optique de la valorisation de cet héritage dans son environnement propre, il nous faut mentionner l’initiative prometteuse du Festival de Gungu où chaque année, les danses et les musiques du terrain (Pende, Mbuun, Yaka, Kweso) sont proposées.
[63] L’Afrique Jazz de Kabasele s’engagea politiquement et se fit le chantre des idéaux lumumbistes et nationalistes. Sa chanson « Moninga sepela indépendance » (Mon cher réjouis-toi, nous sommes indépendants) devint l’hymne national de la « République Libre du Congo ». Les autres chansons engagées furent, mis à part de nombreux hymnes à Lumumba, Afrika mobimba (l’Afrique entière et unie), Ebale ya Congo lopango te (le fleuve Congo n’est pas une frontière… entre deux peuples qui n’en font qu’un) ; Matanga ya Modibo Keita (le deuil de Modibo Keita).
[64] Consulter à ce propos l’étude de Kapalanga Gazungil Sang’Amin (1989), en particulier la partie consacrée à l’animation politique (pp. 99-148).
[65] Kwamy a réalisé un autre film – Ngambo – qui obtint également un prix au Fespaco (Ouagadougou).
Son long métrage Libanga en cours de réalisation constituera vraisemblablement son plus grand succès après le film sur Wendo Kolosoy.
[66] On consultera à ce propos l’ouvrage de Bamba N. et Musangi N. intitulé Anthologie des Sculpteurs et Peintres Zaïrois, Nathan, 1987.
[67] Plus tard, le tronc commun fut supprimé et la durée du cycle spécialisé fut portée à 6 ans au lieu de 4. L’ordre de création des ISP fut le suivant : ISP/Lumumbashi (1959). IPN/Kinshasa (1961). ISP/ Bukavu (1961), ISP/Gombe (1961), ISP/Kananga (1966). ISP/Kikwit (1966), ISP/Mbandaka (1967), ISP/Kisangani (1967), ISP/Bunia (1968). ISP/Mbuji-Mayi (1968). ISP/Mbanza-Ngungu (1972), ISPT/Likasi (1976), ISPT/Kinshasa (1976), ISP/Wemba-Nyama (1982). Le mouvement d’implantation se poursuit encore
[68] En octobre 1981, une autre réforme universitaire intervint dans le sens d’une décentralisation. L’UNAZA fut démantelée en trois réseaux d’établissements, coiffés chacun d’un conseil d’administration : les Universités, les Instituts supérieurs pédagogiques, les Instituts supérieurs techniques (comprenant les Instituts des Arts et du développement). En 1989, le Comité central prôna l’autonomie de chaque établissement qui devrait être doté de son conseil d’administration propre.
[69] L ONRD subit une première réforme en 1975 lorsqu’il devint l’Institut de Recherche scientifique (1RS). En novembre 1982, l’IRS fut démantelé en 9 Centres de recherches autonomes : le Centre de recherche en Sciences de l’Homme (CRSH) ; le Centre de recherche en Sciences appliquées et technologie (CRSAT) ; L’Institut national pour l’Etude et la Recherche agronomiques (INERA) une adaptation du sigle de l’ancien INEAC (Institut National d’Etudes Agronomiques au Congo). Il y eut également le centre de recherche agro-alimentaire (CRAA) et le Centre de recherche en Sciences Naturelles (CRSN), le Centre régional des études nucléaires de Kinshasa (CRENK). le Centre de recherches géologiques et minières (CRGM), l’Institut géographique du Zaïre (1GZA) ; et l’Institut de recherche en Sciences de la santé (IRSS).
[70] Les Archives nationales (Arnaza), et la Bibliothèque Nationale du Zaïre (BNZ) furent créées en 1989.
[71] 11 s’agit de Sophie Lihau-Kanza, qui fut nommée Ministre des Affaires sociales. Elle fut promue peu après » ministre d’État ».
[72] Anouarite Nengapeta (en religion Sœur Marie-Clémentine) : vierge et martyre, elle est en effet la première zaïroise à avoir été béatifiée. Elle est invoquée dans les prières.
[73] Il existe une abondante littérature relative au cheminement économique national. Les synthèses les plus
significatives sont les suivantes : Vanderlinden J. (éd.) 1980 :177-307C Young C. et Turner T. 1985 276-362 ; Cornevin R. 1989 :467-496 ; Panorama des vingt ans du MPR… 143-412. On consultera également avec intérêt : Bezy F. et alii 1981 ; Gamela N.D. et alii 1987.
[74] Parmi les investissements nouveaux, l’Industrie minière se classa en tête (58,62 %) suivie de loin par le bâtiment (15,39 %) et le transport (13,50 %).
[75] Cf. LUTUMBA-LU-VILU. De la zaïrianisation à la rétrocession et au dialogue Nord-Sud. (Une tentative de libération intégrale du peuple Zaïrois). (1973-1975) Bruxelles, 1976; Young C. et Turner T. 1985 :326-362.
[76] Cf. discours du 30 novembre 1973 devant le Conseil législatif à N’sele Mobutu – Discours, Allocutions et Messages, Paris 1975, t.2, pp. 409-424.
[77] Cette politique fait l’objet d’une critique acerbe. Cf. Chômé J., Zaïre… pp. 121-126 ; Kamitatu Massamba, Zaïre… pp. 40-41 ; Jacques Depelchin (1992 :187-213) démontre que ce projet puisait son fondement à la fois dans l’héritage de Lumumba et dans la politique économique de l’EIC.
[78] Après la rétrocession, on passera au cours de la 2e moitié de la décennie 80, à une autre étape de l’évolution de la politique économique. Il fut alors question de privatisation, une manière pour quelques-uns de confisquer à leur profit le bénéfice de la politique du libéralisme économique.
[79] Il suffit d’inventorier le contenu des slogans de la politique agricole pour se rendre compte que leur répétition signifiait que rien de concret ne démarrait. En effet, en 1966, il fut question de « retroussons les manches » et du « retour à la terre ». 1967 a été « l’année de l’agriculture » ; 1968 « année du Salongo » ; 1973 « année du scandale agricole » censé supplanter l’identité du « scandale géologique » ; 1974 fut l’année où l’agriculture devint « la priorité des priorités ». Plus tard, il fut question de « l’indépendance du ventre »
[80] L’étude de J.C. Willame (1986) démontre que cette construction gigantesque dont le projet remonte à la période coloniale, demeure sous-utilisée et donc, représente un investissement mal placé.
[81] Consulter à ce propos l’excellente étude de Kawata Bwalum (1989 :351-370) consacrée à l’endettement du Zaïre.
[82] La dette extérieure zaïroise provient essentiellement de sources officielles. Au regard des potentialités du pays, elle est remboursable. En effet, par rapport au PNB (1987), l’encours de la dette zaïroise à long terme n’étant que de 139,5 % alors qu’à la même époque celui de la Zambie était de 227,5 %, celui du Congo était de 195 % et celui de la Tanzanie était de 144,1 %. Calculée « per capita », la dette publique extérieure supportée par chaque habitant était de 264 dollars, alors que celles de la Côte d’Ivoire, du Congo et du Nigéria étaient respectivement de 1 221, 2 318 et 268 dollars (Kawata B. 1989 :354-5).
[83] Dans son discours d’autocritique, à l’issue de la « guerre de 80 jours » (1″ juillet 1977), le président déclara : « Certains, nous voyant dans la crise actuelle, critiquent les initiatives que nous avions prises avant la crise. Us oublient qu’au moment où nous avions pris ces initiatives, toutes les prévisions étaient favorables »
[84] D’après les prévisions de l’Ogedep, si le rythme de remboursement s’était maintenu, l’évolution globale de la dette zaïroise aurait été la suivante : 849 millions de dollars (1987), 861 millions (1989), 791 (1992), 732 (1993), 756 (1994). (Cf. Kawata B. 1989 :360).
[85] L’autocritique a toujours caractérisé le régime politique de Mobutu, depuis la dénonciation des » dix fléaux » qui rongent la société zaïroise jusqu’aux conclusions de la douzième session du Comité central (1986) en passant par plusieurs discours et messages présidentiels d’autocritique (1977, 1980, etc.).
[86] Cf. Département de l’Economie nationale, Conjoncture économique 1980-1981.
[87] Le mot Libanga signifie « pierre ». Il fait référence à la recherche de « pierres précieuses » qui était perçue comme une solution ultime aux problèmes de subsistance. Par extension. Libanga signifia tout type d’expédient permettant de résoudre ce type de problème. Jadis on parlait davantage de l’article 15 (Pean P. 1988 :139-166).
[88] A cause de la suppression des restaurants universitaires, l’étudiant devait pourvoir lui-même à ses besoins alimentaires.
[89] A Bruxelles, les immigrants congolais ont trouvé une manière d’organiser leur vie dans un quartier de la ville qu’ils ont baptisé Matonge (du nom d’un quartier populaire de Kinshasa). Toute la vie congolaise y est reconstituée, ce qui permet aux intéressés d’oublier, et d’avoir un lieu pour meubler leur « mal du pays ».
[90] Les Ouest-Africains étaient invariablement appelés « Sénégalais » (ndingari en lingala, Shingangadi en Ciluba).
[91] Ce mot d’ordre fut interprété à l’époque à Léopoldville comme ayant une base institutionnelle au sein de l’État du Sud-Kasaï. On prétendit que l’article 15 de la constitution de cet État sécessionniste stipulait qu’il fallait se débrouiller. En réalité il n’en était rien. La règle d’or de la débrouillardise n’a jamais fait l’objet d’une disposition juridique quelconque.
[92] Voir les études déjà citées de Joseph Houyoux.
[93] Ce médecin installé à Kangu dans le Bas-Zaïre s’était fait l’apôtre de l’éducation sanitaire ; son matériel didactique est maintenant utilisé dans l’ensemble du pays.
[94] Les toutes dernières projections (1991) établies sur base des résultats du dernier recensement scientifique estiment qu’en 1989 la population zaïroise était composée de 38 545 000 âmes réparties comme suit : 6 728 000 au Kivu, 5 207 000 au Shaba, 5 073 000 au Haut-Zaïre, 4 617 000 à Bandundu, 4 313 000 à l’Equateur, 3 804 000 à Kinshasa, 3 335 000 au Kasaï Oriental, 2 982 000 au Kasaï-Occidental, 2 485 000 au Bas-Zaïre. Les progressions démographiques estimées sont les suivantes : 39 984 000 en 1992, 41 281 000 en 1993, 42 545 000 en 1994, 43 868 000 en 1995, 45 259 000 en 1996, 46 674 000 en 1997, 48 090 000 en 1998, 48 518 000 en 1999 (S. Ngondo, L. de Saint Moulin et B. Tambashe 1992 :31-32).
[95] Cette même année furent perpétrés à Idiofa des massacres d’adeptes du prophète Martin Kasongo. C’est à cette occasion que la mère de Mulele fut exécutée.
[96] Publié en 1978 à Kananga, cet ouvrage connut une traduction anglaise aux USA en 1984. Sa dernière édition, la quatrième, date de 1991
[97] Voir les déclarations successives des évêques du pays notamment Appel au redressement de la nation (1978); Notre foi en l’homme, image de Dieu (1981); Message et déclarations: 25 anniversaire de l’Indépendance (1985). Plus récemment il y a eu : Le Chrétien et le développement de la Nation (1988) ; Tous appelés à bâtir la nation (1990) ; Libérer la démocratie (1991). Libérés de toute peur au service de la nation (1991) : Pour un nouveau projet de société zaïroise (1992) ; Pour la poursuite de la démocratisation au Zaïre (1992) : Un effort supplémentaire pour sauver la nation (1993) : Tenez bon dans la foi (1993), etc.
[98] L’auteur poursuivit sa réflexion dans un autre ouvrage intitulé Zaïre, le pouvoir à la portée du peuple (1977).
[99] Jules Chômé publia en 1974 et en 1978 des écrits qui mettent Mobutu en cause dans la crise que traversait le Zaïre (de Villers G., 1995). Monguya M. (1977, 1993) s’efforça de rendre public ce qui passait pour être à l’époque la contre-histoire du régime. Kalonga Kabwe s’interrogeait : Qui gagnera au Congo-Kinshasa ? (Montreal 1976). Le cas Buana Kabwe est caractéristique de l’ambiguïté de cette littérature des anciens barons du régime. Après un écrit apologétique (1975), il publia un document critique, une lettre ouverte à Mobutu (1977).
[100] Signalons les regroupements ci-après : FODEL1CO (Forces démocratiques de Libération du Congo) de Gizenga, PPA (Parti populaire africain), FSA (Front socialiste africain) de Kamitatu-Massamba. CLCK (Conseil de Libération du Congo-Kinshasa). CRL (Conseil révolutionnaire de Libération). FOC (Front des Opprimés du Congo), PRMC (Parti révolutionnaire marxiste congolais). MNCL (Mouvement national congolais/Lumumba). CODESCO (Convention des démocrates socialistes congolais).
[101] Fungula F.N. « Une réflexion sur l’opposition politique zaïroise » in Jewsiewiscki B. (ed) 1984. p. 120.
[102] On se référera ici aux travaux de J.C. Willame (» La seconde guerre du Shaba ». Genève-Afrique, vol XVI, 1,1977-78, pp 9-26 ; « Contribution à l’étude des mouvements d’opposition au Zaïre : le FLNC Cahiers du CEDAF, n° 6, 1980, pp. 1-41).
[103] Lors de cette seconde attaque, il semble que le FLNC ne devait pas bénéficier du soutien des Cubains et des FAPLA (Kestergat J. 1986 :284-286). L’attaque fut menée depuis la Zambie pour tromper la vigilance des Angolais. La prise de Kolwezi s’accompagna d’un véritable massacre des Européens, qu’on attribuait jusqu’ici aux « rebelles ». Le témoignage d’un sergent des FAZ est venu corroborer les dires de N. Mbumba qui a toujours déclaré que ces excès étaient le fait des FAZ. (Pierre Yambuya, 1991)
[104] La France, plus prompte que la Belgique, dépêcha sur les lieux six cents légionnaires du 2- REP (Régiment étranger parachutiste) qui furent largués à Kolwezi le vendredi 19 mai 1978 en deux temps : à 15hl0’ et à 17hl5′. La Belgique n’apprécia pas cette concurrence de la France (Simonet H. 1986 :181-206)
[105] La « Lettre ouverte » fut signée par Ngalula Pandanjila, Tshisekedi wa Mulumba, Makanda Mpinga Shambuyi, Kapita Shabangi, Kiungu wa Kumwanza, Lumbu Maloba Ndoba, Kanana Tshungu, Lusanga Ngiele, Kasala Kaumba, Bengamine Manga Ruga, Dia Onken Ambel, Ngongo Mukendi, Mbombo Lona ; ils seront désormais désignés sous le terme de « groupe des 13 ».
[106] L’allemand Erwin Blumenthal effectua un séjour à la Banque du Zaîre en 1978 et dressa à lissue de cette mission, un rapport explosif (Dingia 1992 -136-155). Il sera remplacé au Zaire par un autre fonctionnaire international, Mamadou Touré, de nationalité mauritanienne.
[107] A propos des résidences présidentielles à l étranger. [inventaire présenté par un journal belge en 1975 était le suivant : une résidence près de Lausanne (Suisse), un château à Namur. une villa à Rhode-St-Genèse, un immeuble sur le boulevard Reyers et sur le boulevard Lambermont à Bruxelles et quelques autres propriétés en Belgique ; une résidence avenue Foch à Paris. une autre à Nice, à Venise, un château en Espagne, un immeuble à Bangui et une villa en Cte dlvoire. Additionnée à ses avoirs dans des banques suisses, la fortune présidentielle à l étranger était estimée à l’époque à un minimum de US $ 152.875.000 (C. Young et Turner T., 1985. 179).
[108] D’après un rapport des commissions parlementaires sur la Banque du Zaire, Mobutu et sa famille auraient prélevé de la caisse en 1977,1 646 510 847 FB, 22 900 000 FE. 408 220 FS et US $ 1 765 000; en 1978, 1 649 455 852 FB, 2 598 000 FF 45 037.94 FS et US $ 1 000 000.en 1979, 369 992 740 FB, 201 562,96 FF, 1891 FS et US $ 1891. Au total. pour [exercice 1977, 1978, 1979, ces dépenses s’élevaient à 3 665 959 438 FB, 25 705 562.96 FF. 423 257,94 FS et US $ 2 766 800. La ventilation de ces montants fait apparaitre que bien des personnes profitaient de cette couverture présidentielle. Par exemple sur les exercices 1977. la ventilation révèle entre autres les détails ci-après : 30 000 000 FB (Mme Davister), 10 000 O00 FB (prof. A. Doucy), 20 500 000 FB (R.P A du Vernay) ; 295 292 000 FB, 19 600 000 FF 10O 000 FS, US$ 1378500 (Litho Mobut) ; 33 000 000 FB (Kengo wa Dondo), 2 641 702 FB (Engulu Baanga Mpongo), 200 000 FF (Mme Bokonga), 350 000 FB (Mme Poto Gal0) 500 000 (Mme Tamba), 1 200 000 FB (Mme Bumba Moaso), 116 350 FB (Mme Mboli), 100 000 FB (Mme Munga), 200 000 FB (Mme Bukembo), 8 200 FS et US $ 1 500 (vice-amiral Lomponda wa Botende), US $ 5 000 (général Babia), 435 000 FB (Tabu Ley et autres) (CI. Dungta E., 1992·117- 176).
[109] C. Young a eu raison de s’interroger : « Zaïre : is there a State ? » (in Jewsiewicki B ed. 1984/80- 82). Cent ans après la fondation de l’EIC, la notion occidentale de l’État – nation était encore marginale.
[110] Lors de la 13e Conférence annuelle de l’Association canadienne des Etudes africaines (1983), la table ronde consacrée à « l’impuissance des sciences sociales : méconnaissance ou connaissance du Zaïre » aboutit aux mêmes constats, tout comme 1 étude de C. Young et T. Turner (1985) et celle de Nzongola-Ntalaja (1986).
[111] Le Chrétien et le Développement de la Nation. Kinshasa 1988, pp 88-S9.
[112] Trois passages de ce mémorandum réclamèrent le départ de Mobutu (cf. Gbabendu Engunduka A. et Efolo Ngobaasi E., 1991, vol. 2, pp. 36 et sv.)
[113] Lui-même le déclara en janvier 1990. Ce chiffre se trouve dans sa date de naissance (14 octobre), dans celles du premier coup d’Etat (14 septembre) et du deuxième coup d’Etat (24 novembre).
[114] Après de nombreuses hésitations, la Conférence nationale souveraine convoquée pour le 31 juillet 1991 (ordonnance n° 91-205 du 15 juillet) fut ouverte le 7 août par le Premier ministre Mulumba Lukoji. Le bureau provisoire fut présidé par Kalonji Mutambayi wa Pasteur Kabongo. Ce dernier présenta sa démission en septembre. Un autre bureau provisoire fut constitué en décembre 1991, présidé par Mgr Monsengwo. 11 fut installé par le Premier ministre Nguz a karl i Bond. Après la valorisation des mandats des délégués, les travaux effectifs ont démarré en avril 1992 avec la mise en place du bureau définitif.
[115] Le 15 août 1992, à 2 heures du matin, Etienne Tshisekedi, leader de l’UDPS fut élu premier ministre par l’Assemblée plénière de la Conférence Nationale Souveraine, à la majorité absolue. Il battit ainsi son concurrent, Thomas Kanza, venu à la Conférence Nationale Souveraine au titre « d’invité » et dont la candidature fut soutenue par la « Mouvance présidentielle » et l’UFONAL, sa plate-forme originelle.
[116] Suivant les prescrits de l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition adopté par la Conférence Nationale Souveraine (4 août 1992), la transition aurait dû avoir une durée maximale de 24 mois. Le Président de la République en fonction demeurait en place jusqu’à la fin de la période de transition (art. 11) ; de même que le Premier ministre élu par la Conférence Nationale Souveraine (art. 71) et le Haut Conseil de la République, l’instance chargée du suivi et du contrôle de l’exécution des Actes de la Conférence Nationale Souveraine, après la clôture de celle-ci. Dans cet entendement l’Assemblée nationale était renvoyée et la Constitution de la 2e République définitivement abolie.
[117] Le mandat de Mulumba Lukoji fut interrompu du 22 au 25 juillet par une première nomination d’Etienne Tshisekedi comme Premier ministre ; mais ce dernier déclina l’offre du Président Mobutu.
[118] Le procès des « mutins de la Voix du Zaïre » qui fut radiodiffusé permit de déceler nombre de contradictions qui donnent à penser que ce coup fut un montage réalisé sans doute dans le but de confondre certaines têtes gênantes.
[119] Le succès de l’opération Bindo fit école. Il suscita, dans l’euphorie des premiers jours, plusieurs autres initiatives similaires (opérations « Nguma », le « Panier de la ménagère », de Masamuna) qui conduisirent toutes à cette escroquerie du petit peuple. Pour plus de renseignements, prendre connaissance de l’étude de B. Jewsiewicki, « Jeux d’argent et de pouvoir au Zaïre : la ’bindomanie’ et le crépuscule de la Deuxième République ». Politique africaine, n° 46, juin 1992. pp. 50-70.
[120] Lors de la déclaration politique, l’Union des Démocrates Indépendants (UDI) à la tribune de la CNS (16 mai 1992), son porte-parole A. Thambwe Mwamba précisa : « Jamais les finances publiques ne se sont aussi mal comportées dans notre pays… Pour le seul mois d’avril, le déficit budgétaire s’est situé à 13 400 milliards de Zaïres, presque autant que le niveau du cumul des trois premiers mois de l’année qui s’est chiffré à 15 800 milliards. Pour couvrir le déficit budgétaire, le pouvoir a recouru systématiquement à la planche à billets. Et le financement monétaire prévu à 50 milliards de Zaïres en 1990 a été de 500 milliards à la fin du même exercice, soit dix fois plus que les prévisions ; tandis qu’en 1991, il est passé tout simplement de 1 000 milliards prévus à 15 000 milliards, soit quinze fois plus. L’inflation est à son paroxysme avec 4 228 % contre 265 % en 1990, alors qu’elle était à moins de 60 % avant la prétransition ».
[121] Par rapport à 1990, les années 91-92 apportèrent une plus grande unanimité dans la dénonciation des méfaits de l’ère mobutienne. Ainsi les barons du régime – les dinosaures – furent dénoncés comme faisant partie d’une maffia – Prima Curia – chargée de la perpétuation du mobutisme. Par rapport aux » Consultations populaires », le discours populaire devint à la fois plus critique et plus précis.
[122] « Le sang des chrétiens a coulé » (Référence Plus), « Les chrétiens de Kinshasa ont payé de leur sang l’entêtement du pouvoir » (Umoja), « Dimanche noir pour les soutanes blanches » (Soft de Finances), « Du sang pour une alliance » (Le Phare), « Dimanche massacre » (Le Grognon). Sur cet épisode de l’histoire de la transition, consulter le recueil de textes publiés par le Père Philippe de Dorlodot (Marche d’espoir – 16 février 1991, non-violence pour la démocratie au Zaïre-Paris, Groupe-Amos – L’Harmattan, 1994).
[123] 192 déclarations furent enregistrées à la plénière de la CNS du 7 mai au V juin 1992 ; 84 provenaient de la Société civile, 26 des Institutions publiques, 58 des partis politiques et 24 des Invités (La Solidarité. n° 24, 5-12, octobre 1992 : 8).
[124] Les rapports volumineux des Commissions des biens mal acquis et des assassinats rendent compte de cet état de choses
[125] B. Jewsiewiscki aurait donc eu raison en 1984 d’intituler le livre quïl édita sur le Congo-Zaïre : État Indépendant du Congo belge, République Démocratique du Congo. République du Zaïre … ? La réponse au point d’interrogation finale serait-elle là ? Le mot « Zaïre » qui tire pourtant ses origines de l’héritage historique prémobutiste risque de ne pas subsister au régime de Mobutu qui l’a imposé comme dans le cas du Ghana, de Centrafrique, du Bénin et du Burkina- Faso qui ont survécu, respectivement à N. Nkrumah, à B. Boganda, à M. Kerekou et à T. Sankara. Le fait est significatif en lui-même et donne la mesure de la volonté de rupture avec le passé. Un effort de réappropriation de ce terme, on la déjà dit, aurait permis de consolider la distinction heureuse entre les deux Républiques du Congo. 1 ancien Moyen-Congo (Brazzaville) et l’ancien Congo belge (Kinshasa). De plus, le concept du Zaïre aurait pu continuer à désigner avec bonheur, grâce à son caractère extraethnique, la supranationalité congolaise par rapport aux multiples « nationalismes » locaux au rang desquels on compte le nationalisme « kongolais »
[126] Au chapitre des débaptisations, les stades du 20 Mai. du 24 Novembre et Kamanyola deviendraient respectivement stade Tata Raphaël (de la Kethule), stade Cardinal Malula et stade des Martyrs de la Pentecôte. Les avenues du 24 Novembre et des 3 Z se transformeraient en avenue de la Démocratie et en avenue P. Lomami Tshibamba. Le nouveau calendrier des fêtes nationales a été arrêté comme suit : 4 janvier : Fête des Martyrs de l’Indépendance : 17 janvier (anniversaire de la mort de Lumumba) : Fête des héros nationaux : 16 février (massacre des chrétiens) : Fête des Martyrs de la Démocratie ; 11 mai (massacre des étudiants à Lumumbashi) : Fête de la jeunesse ; 4 juin (première contestation estudiantine organisée contre le régime de Mobutu) : Fête de l’Education nationale ; 30 juin : Fête de l’Indépendance ; 1er août : Fête de la Famille : 17 novembre : Fête de l’Armée.
[127] Suivant les critères énoncés, le Congo fédéral devrait en principe être découpé en 25 provinces, en plus de la ville de Kinshasa. Il s’agira des provinces suivantes : Bas-Uélé (Chef-lieu : Buta), Kongo Central (Matadi), Equateur (Mbandaka), Haut-Lomami (Kamina) ; Haut-Katanga (Lubum- bashi), Haut-Uélé (Isiro), Ituri (Bunia), Kabinda (Kabinda), Kasaï (Tshikapa), Kwango (Kenge), Kwilu (Kikwit), Lualaba (Kolwezi), Tshilenge (Mbuji-Mayi), Lu hua (Kananga), Maindombe (Inongo), Maniema (Kindu), Mongala (Lisala), Nord-Kivu (Goma), Nord-Ubangi (Gbadolite), Sankuru (Lodja), Sud-Kiuu (Bukavu), Sud-Ubangi (Gemena), Tangan^ka (Kalemie), Tshopo (Kisangani), Tshuapa (Boende), mais ce projet risque d’être remis à plus tard au profit d’une décentralisation plus effective des entités administratives actuellement en place.
[128] Le 20 janvier 1994, les 416 membres du HCR issus de la CNS entérinèrent la proposition du Protocole d’accord relatif à l’élargissement de leur nombre aux 222 députés de l’ex-assemblée générale du temps du parti-Etat et aux 100 « concertateurs » qui ne relevaient pas de l’une ou de l’autre catégorie. Au total, 718 conseillers de la République.
[129] Kengo wa Dondo fut élu le 14 juin 1994 (sur 465 conseillers de la République présents. 332 votèrent pour lui, 78 pour C. Mulumba Lukoji, 30 pour V. Lunda Bululu. 7 pour A. Z’Ahidi Ngoma, 7 bulletins nuls et 1 abstention). Le 11 juillet, son gouvernement obtint l’investiture du HCR-PT. Conformément à l’Arrangement Particulier, il comprend 46 postes répartis en 4 vice- premiers ministres, 24 ministres et 18 vice-ministres, en nombre égal entre FPC et USORAL,
[130] Mgr Monsengwo s’était expliqué : » J’avais dit, le 30 mars 1993: ni le gouvernement Tshisekedi (composé des seuls éléments de l’USOR et du MPR) ni le gouvernement Birindwa (composé uniquement des éléments de FPC) ne sont de nature à réconcilier les fils et les filles de ce pays. Une solution concertée s’impose. Prêcher la nécessité d’un gouvernement d’union nationale par le dialogue et la concertation, n’est-ce pas la volonté de la CNS et la mission qu’elle m’a assignée comme médiateur constitutionnel ? Aurais-je dû appeler à la confrontation, à la violence, à la guerre civile ? (Zaïre-Afrique, 294,1995, p. 199). Sur l’Eglise catholique et la transition, se référer à R. Gaise Nganzi, L’Eglise catholique et le processus de démocratisation au Zaïre, Kinshasa, Facultés catholiques de Kinshasa, 1996.
[131] La procédure du désaveu fut irrégulière, Mgr Monsengwo présenta lui-même sa démission comme président du HCR-PT, le 27 janvier 1996. Peu après, il fut invalidé comme conseiller de la République.
[132] 1 NZ équivalait à 3 millions de Z.
[133] Cf. Zaïre-Afrique, 281, 1994, p. 57
[134] A cause de leur « sécession », les Kasaï réalisèrent une relative accalmie de prix soutenue par un approvisionnement aérien, d’origine sud-africaine, de produits de première nécessité. Le phénomène a fait l’objet d’une étude « immédiate » de Kabuya Kalala et Yav Karl Yav (« L’espace monétaire kasaïen : leçons de la survivance d’une monnaie déchue », Zaïre-Afrique, 290, 1994, pp. 607-616)
[135] La loi n° 95-004 du 6 juillet 1995 modifia comme suit l’art. 117 de l’Acte Constitutionnel de la Transition : « Sans préjudice des autres dispositions de 1 Acte Constitutionnel de la Transition, la durée de la transition est de 24 mois à dater du 10 juillet 1995 ». Au terme de cette période, après un référendum constitutionnel, les différentes échéances électorales, communales, législatives et présidentielles devaient se succéder,
[136] Ce que tente de démontrer le plaidoyer de Mukulumanya wa Ngate Zenga (L’affaire Kengo- Mukulumanya ou l’autre face de la Rigueur. Kinshasa. 1995) et Mutinga Mutuishayi M. (Kengo wa Dondo: un premier ministre contesté – légalité, expertise et nationalité douteuses. Kinshasa, Col. Temps Présent, 1996).
[137] Parmi les modifications introduites figurait, entre autres, l’adoption de la dénomination de « la République Fédérale du Zaïre » (au lieu de « Congo ») et celle de « Debout Zaïrois » (au lieu de « Debout Congolais ») comme hymne national.
[138] Jeune Afrique Economique, 180, juin 1994, p. 20.
[139] P. Artigue (1961) ne fait même pas mention de son nom parmi » les leaders congolais » du début des années 60.
[140] D’autres sources affirment qu’il serait né à Moba (Baudouinville) (Lejeune E., L.D. Kabil, militant nationaliste congolais. Bruxelles, Gamma Press, 1997).
[141] Une autre version, qui a cours dans les milieux kimbanguistes, affirme que son père serait un ancien relégué, originaire du Bas-Congo, qui aurait été envoyé dans les terres » lointaines » du Katanga.
[142] Erigé en province le 11 juillet 1962, le Nord-Katanga fut la première région à accéder à ce statut, après la révision des dispositions de Loi Fondamentale, quant au nombre de provinces. Auparavant, une autonomie de fait avait été instaurée dès novembre 1960 par P. Mwamba-Ilunga qui installa un » gouvernement populaire » à Manono.
[143] C’est cette exigence de quitter constamment le maquis qui fit l’objet des critiques les plus acerbes de la part des Cubains et de Che. Ils se plaignaient entre autres de son « arrogance » et de ses visites épisodiques, avec « force bouteilles de whisky », dans la compagnie des « mulâtresses guinéennes » (Taibo 11 P. et al., 1994 : 139-140).
[144] En 1971, Museveni était venu visiter le maquis de Kabila, en quête d’armes pour approvisionner sa propre « rébellion » contre le régime d’Amin Dada. Il n’est pas impossible que l’homme politique ougandais, tutsi originaire de l’Ankole par sa mère, ait effectué d’autres séjours dans les maquis du Congo.
[145] Fred Rwigema trouva la mort lors de la première attaque le 10 octobre 1990 du Rwanda par l’APR, au départ de l’Ouganda. Kagame, alors en stage d’officier aux USA, retourna sur le terrain, le 14 octobre, pour prendre la tête des opérations (cf. F. Reyntjens, « Les mouvements armés de réfugiés rwandais : rupture ou continuité ? », Civilisations, XL, 2,1992, p. 170-182 ; M. Gaud et L. Porgès, » Biographies de quatorze chefs de guerre », L’Afrique contemporaine, n° 180, octobre-décembre 1996, p. 185-189).
[146] Pendant cette époque, Kabila avait-il joué les émissaires auprès de Mobutu à Gbadolite, pour le compte du chef de l’Armée Populaire de Libération du Soudan, John Garang de Mabior ? (Le Vif/ L’Express, n° 2394, 23-29 mai 1997, p.64). Cela n’est pas prouvé.
[147] A la suite du discours du 24 avril 1990, des concertations des partis d’opposition avaient été organisées en Europe, notamment à Bruxelles et à Genève. Déjà le 27 avril. Marcel Lihau avait déclaré à partir de Bruxelles : « tous les partis zaïrois doivent se retrouver dans une conférence pour tracer l’avenir du pays… »
[148] « Monsieur Mobutu, le 24 avril 1990, tu ne daignas pas faire appel au PRP, tu ne lui rendis pas la vérité prophétique qui lui revenait ; au contraire, tu tentas de noyer ce premier parti anti-dictatorial du pays dans les méli-mélo, et la mêlée d’anciens agents de ton régime invités à se regrouper en formation politique avec intention de le soumettre à tes critères de législation. (…) Ce n’est pas, distingués messieurs, que vous ayez la mémoire courte de l’histoire de la résistance du PRP contre la dictature dont beaucoup d’entre vous étaient des instruments d’exécution efficaces et fidèles. J’insiste, dirigés par des complices et anciens serviteurs zélés du dictateur et coupables de ne pas rendre justice au PRP, premier parti anti-Mobutu, anti- Deuxième République fondé le 24 déc. 1967 avec pour objectif, la restauration des institutions démocratiques. » (Mukendi G. et Kasonga B., 1997 : pp. 213-214).
[149] « … créant des poches d’expansion à travers toute la région des Grands Lacs en utilisant les Hutu par leur appartenance à l’Etat rwandais et non à la nation rwandaise référentiellement à la notion qu’ils ont eux-mêmes de celle-ci, les Tutsi de I Ouganda, du Rwanda, du Burundi et tous les autres qui vivent au Zaïre, au Kenya et en Tanzanie, projettent, dans un futur proche, la naissance d’un empire hamite qui, pour des raisons de camouflage, s’appellerait la république des Volcans ou les Etats-Unis d’Afrique Centrale si leur union fédéraliste relie effectivement Dar-es-Salaam à Matadi » (Cf. Rapport de la Commission d’Information sur la situation des réfugiés et des populations déplacées dans les régions du Nord- et du Sud-Kivu. Kinshasa, HCR-PT, avril 1995).
[150] 11 s’agissait notamment de Kayanda (chez les Nande). Bushenge Hunde (chez les Hunde). Magrivi (Mutuelle Agricole des Virunga. Hutu), Umoja (Hutu et Tutsi), Acuba (Hunde-Nyanga-Tembo). Il existait aussi des » milices », comme Kigarizo Bokogbwa (Banyarwanda hutu). Ngilima (Hunde- Haavu-Nyanga-Tembo).
[151] A en croire Willame (1997 : 71), ces « rebelles », vivant du trafic de l’ivoire, avaient été organisés politiquement, à l’époque, en un « Parti de Libération Congolais ». Ils avaient effectué plusieurs raids dans des villages frontaliers avec l’Ouganda, entre novembre 1986 et septembre 1988, avant de se disperser, suite aux attaques des FAZ. Une partie se serait réfugiée dans le Parc de la Garamba au nord-est du Nord-Kivu ; une autre se serait repliée dans la forêt de Béni où ils continuèrent à semer l’inquiétude.
[152] Le général Eluki organisa successivement en 1996, les opérations « Kimia » (février) et « Mbata » (avril) pour » pacifier » la région.
[153] Au Nord- et au Sud-Kivu, plusieurs camps de réfugiés se formèrent, notamment ceux de Mugunga (près de Goma), Katale et Kahindo (sur la route de Rutshuru), Chimanga (dans Walungu) et Kashusha (dans Kabare). Des efforts seront entrepris par le gouvernement et le Parlement de transition en vue du rapatriement des réfugiés rwandais dans leur pays, mais en vain. Visiblement, le maréchal Mobutu avait besoin politiquement de cette présence massive.
[154] A l’époque, la veuve Habyarimana aurait prévenu Mobutu que » quelque chose d’important se tramait à la frontière est du Zaïre, des préparatifs, des mouvements d’armes et de troupes, comme si une offensive se préparait ». Elle ne fut pas écoutée (cf. Jeune Afrique. n° 1910-1011. 13-26 août 1997, p. 27).
[155] Pour la première fois dans l’histoire militaire régionale, un attaché militaire américain permanent fut installé à Kigali en 1996. Ce pays aurait, en effet, été identifié comme une des meilleures bases d’opérations vers l’intérieur de 1 Afrique et vers 1 océan Indien, grâce à sa belle infrastructure routière et à son aéroport international, capable de recevoir de gros porteurs. Ce pays était intéressant également comme « voie d’accès » et « lieu de transit » en vue de l’exploitation des richesses du Kivu (pétrole, nobium, gaz, méthane), comme celles de l’ensemble du Congo « utile ». Près d’un mois avant la fin de la « libération », le 15 avril 1997, « l’America Minerais Fields » de Jean Raymond Boulle avait déjà arraché une concession de 42.000 km2 pour l’exploitation des minerais (cuivre, cobalt, zinc et uranium).
[156] Cf. Discours de Monsieur Pasteur Bizimungu, président de la République rwandaise, Cyangungu jeudi 10 octobre 1996 (traduit du kinyarwanda), Demain le Congo, n° 244, 1997, p.7.
[157] Cf. Discours de M. Pasteur Bizimungu, Président de la République rwandaise, Cyangungu, jeudi 10 octobre 1996 (Demain le Congo, n° 244, 1997 : p.7). Rappelons qu’à l’époque de l’arrivée des Blancs, le « royaume du Rwanda » n’occupait qu’une petite région au centre du pays et était en voie de conquérir les territoires septentrionaux du Rwanda gouvernés par des roitelets hutu indépendants de la cour du Mwami. S’il existait des communautés s’exprimant en kinyarwanda au Congo, elles n’avaient pas de liens directs avec cette même cour centrale de laquelle elles s’étaient à dessein détachées (Newbury C., 1988 : 23-29)
[158] Les accusations de « massacres » étaient donc inévitables (cf. Garreton R., Rapport sur la situation des droits de l’homme au Zaïre dans la zone occupée par les rebelles dans l’est du Zaïre 25-29 mars 1997, pp. 5-14 ; Ngefa Atondoko G., Nord-Kivu : Existence des charniers et des fosses communes, Kinshasa. Azadho. Communiqué de presse no 005/97), avec risque d’être adressées à des boucs émissaires et non aux véritables auteurs de cette politique.
[159] Les statuts de l’AFDL stipulent que « le président est élu par le Conseil d’Alliance pour une période de deux ans renouvelable. Il nomme le vice-président et les 15 membres du Comité exécutif » (art. 18). Le président dispose de pouvoirs fort étendus, puisqu’il est de droit président du Comité exécutif et du Conseil d’Alliance. « Toute décision du Comité exécutif revêtue de sa signature a force de loi à tous les échelons organiques du mouvement. Il accorde l’amnistie aux condamnés ; réduit les peines, les suspend ou les annule. Il peut retarder l’exécution des peines » (art.21).
[160] Le général Ngandu Kisase, dont le CNRD était issu du MNCL, aurait été assassiné dans une embuscade par une faction rivale au parc de Virunga. Le différend qui opposait ce chef militaire tetela avec Kabila soutenu par les Tutsi congolais, alors qu’il était plutôt partisan de la réduction de l’influence des Rwandophones sur le mouvement, alimente quantité de spéculations à propos de sa mort. Rien pourtant n’atteste que l’AFDL et son président aient été complices de cette exécution (Cf. Le Vif/L’Express, 2394, 23-29 mai 1997, p.64).
[161] Dès l’attaque de Bukavu, le mardi 29 octobre, l’archevêque Mzee Christophe Munzihiruva fut assassiné (cf. In memoriam, MgrC. Munzihirwva serviteur et témoin, Kinshasa, Loyola, 1997).
[162] D’après François Soudan (Jeune Afrique, 1899, 28 mai-3 juin 1997, p.50), « Des milliers de soldats de l’armée régulière ougandaise, appuyés par des dizaines de soldats de blindés, avaient littéralement envahi le nord-est du pays, écrasant les camps rebelles ougandais qui y avaient trouvé asile et enlevant au passage, pour le compte de Kabila, les villes de Watsa, Butembo, Bunia et Béni »
[163] Lors d’une conférence de presse (1er novembre 1996), le chef d’état-major général des Faz. Eluki Monga Aundu, accusa le gouvernement Kengo de ne pas lui fournir les moyens nécessaires pour la guerre. Son successeur (Tableau 24), le général Mahele, nommé le 14 décembre, revint sur ce même refrain. Dans son adresse aux troupes, il dira : « Jean le Baptiste qui avait interdit aux militaires de piller, avait demandé aux responsables politiques… « de s’occuper d’eux ».
[164] En plus des troupes de Kagamé qui aidèrent à la prise de Goma et de Bukavu, nombre d’officiers rwandais, à titre de sanction ou de disgrâce, ont eu la charge d’encadrer les troupes de l’AFDL jusqu’à Kinshasa. Plusieurs milliers de Tutsi ougandais, rwandais et burundais, vinrent grossir, toujours via Kigali, les rangs de combattants. Pendant les quatre premiers mois, l’Ouganda et le Rwanda auraient assuré l’essentiel de l’approvisionnement en carburant et munitions en échange d’un afflux de diamants (Kigali) et d’or (Kampala) (Jeune Afrique. 1899. 28 mai-3 juin 1997. p.50).
[165] Les négociations entre le gouvernement de la république du Zaïre et l’AFDL débutèrent à Lomé (Togo), le 27 mars 1997 en présence des chefs d’Etat du Cameroun, du Togo, du Nigeria et du secrétaire général de l’ONU. Elles se poursuivirent à Prétoria (Afrique du Sud), du 6 au 8 avril en présence de monsieur Thabo Mbeki, vice-président sud-africain. Mobutu et Kabila se rencontrèrent le 4 mai, sur le navire de guerre sud-africain Outeniqua, à Pointe-Noire (Congo), en présence de Nelson Mandela, le Président sud-africain. Une seconde rencontre, prévue pour le 13 mai ne put avoir lieu.
[166] Le général Joao de Matos, chef d’état-major de l’armée angolaise, supervisa lui-même, en avril, l’intervention de deux à trois mille de ses soldats de la base de Quimbele, envoyés jusqu’à la rivière Wamba afin de couper en deux une ultime contre-offensive des Faz (Jeune Afrique, 1899, 28 mai- 3 juin 1997, p. 50). De plus, pour hâter la prise de Kinshasa et épargner des vies humaines, le général Mahele aurait fourni lui-même aux chefs militaires de l’AFDL des informations nécessaires pour prendre à revers ce dernier carré des mobutistes (Jeune Afrique, n° 1910-1911, 13-26 août 1997, p. 26)
[167] La nouvelle « République démocratique du Congo» n’était pas à confondre avec celle qui était l’émanation de la Constitution de Luluabourg. Celle-ci a pour emblème celui du 30 juin 60 (le drapeau bleu, avec une grande étoile jaune au milieu et six petites étoiles jaunes). Le Décret-loi constitutionnel n° 003 du 28 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo concentra tous les pouvoirs entre les mains du Chef de l’Etat, sauf le pouvoir judiciaire. Cette situation exceptionnelle était ainsi fixée jusqu’à l’adoption d’une nouvelle constitution par l’assemblée constituante.
[168] Suivant le calendrier électoral rendu public par le nouveau Président de la République, les premières élections législatives et présidentielles, auraient lieu en avril 1999. Elles seraient précédées de l’élaboration de la Constitution par une Constituante qui sera installée le 30 juin 1997 et l’organisation d’un référendum constitutionnel en décembre 1998.
[169] Cf. « Discours d’investiture du Président de la République, Laurent-Désiré Kabila, Stade des Martyrs (ex-Kamanyola), le jeudi 29 mai 1997 », La Manchette, 107, 3-9 juin 1997, p.5
[170] Le monde féminin kinois marqua l’événement en baptisant trois nouveaux pagnes superwax de Pesa mono passage (premiers mots d’un chant religieux de revendication du changement), Libandi ya Kabila (la tête chauve de Kabila), Kamoke Sukali (Doux Kadogo, « Kamoke » étant l’appellation kinoise des enfants-soldats de l’Alliance, le correspondant de « Kakesa » et de « Kafioti », respectivement en ciluba et kikongo)



