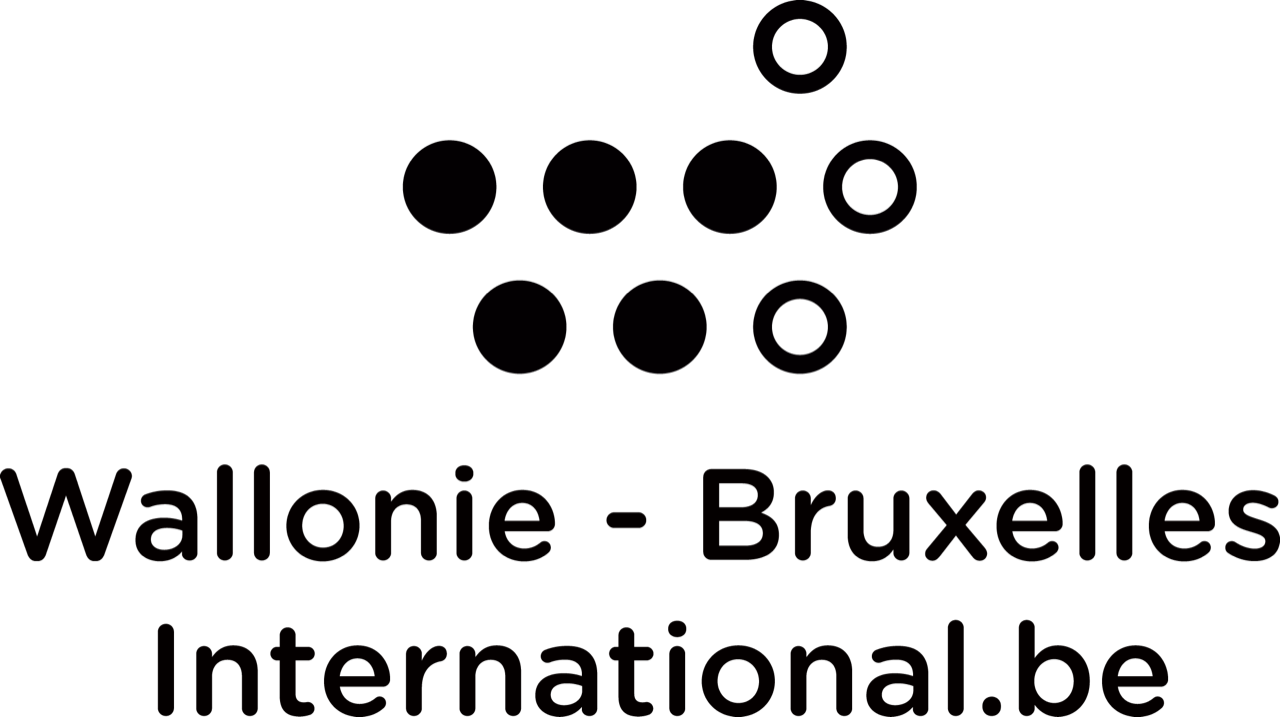1. Objectifs de la leçon :
A la fin de la leçon, l’élève doit être capable de :
1. Expliquer les manifestations du changement culturel de l’Afrique postcoloniale ;
2. Comprendre la nécessité de préserver le patrimoine culturel africain
3. Analyser le rôle de la culture dans la construction identitaire des États africains ; ;
4. Discuter des grands événements culturels organisés en Afrique depuis 1960 ;
5. Expliquer l’apport de la culture au développement de l’Afrique.
2. Introduction
La culture africaine est à la fois héritage ancestral et innovation moderne. Elle regroupe les coutumes, les croyances, les arts et les savoirs transmis de génération en génération. Depuis 1960, avec les indépendances, les sociétés africaines cherchent à préserver leurs traditions tout en s’ouvrant au monde moderne.
Cependant, ce développement culturel a été freiné par des crises politiques, le néocolonialisme et, en RDC particulièrement, le GENOCOST (génocide lié à l’exploitation brutale des ressources). Malgré cela, la culture demeure une force de cohésion, d’émancipation et d’affirmation identitaire.
3. La littérature africaine postcoloniale
Depuis 1960, la littérature africaine est l’un des moyens les plus puissants par lesquels les Africains ont affirmé leur identité, dénoncé les oppressions et projeté une vision d’avenir. Elle est à la fois mémoire, critique sociale et laboratoire de l’imaginaire.
- RDC : Sous la politique d’authenticité de Mobutu, la littérature devient un outil d’affirmation identitaire et de contestation, avec des figures comme V.Y. Mudimbe (Entre les eaux) et Georges Ngal (L’Errance).
- Afrique de l’Ouest : Léopold Sédar Senghor (Sénégal) illustre, aux côtés d’autres écrivains de sa génération, la force du mouvement de la Négritude. Dans la même veine intellectuelle, Cheikh Hamidou Kane (L’Aventure ambiguë, 1961) met en lumière le drame existentiel du déracinement et du choc entre valeurs africaines et modernité occidentale. Birago Diop, avec ses Contes d’Amadou Koumba (1947), transmet la richesse de la tradition orale, tandis que Boubacar Boris Diop engage sa plume dans les grandes questions de mémoire et de société (Murambi, le livre des ossements, 2000). Mariama Bâ, à travers Une si longue lettre (1979), incarne l’émancipation féminine et la critique sociale, et Ahmadou Kourouma (Les Soleils des indépendances, 1968) dénonce avec lucidité les désillusions postcoloniales.
- Afrique de l’Est : Ngũgĩ wa Thiong’o prône l’écriture en langues africaines (Décoloniser l’esprit), tandis que Nuruddin Farah (Somalie) explore dictature et exil.
- Afrique australe : En Afrique du Sud, Nadine Gordimer et J.M. Coetzee (prix Nobel) dénoncent l’apartheid, aux côtés de militants écrivains comme Alex La Guma.
- Maghreb : Kateb Yacine (Nedjma) incarne la mémoire de la guerre d’Algérie ; Assia Djebar (L’Amour, la Fantasia) éclaire la condition féminine.
- Afrique centrale : Sony Labou Tansi (Congo-Brazzaville) invente une écriture absurde contre la dictature ; Mongo Beti (Cameroun) critique l’Église coloniale.
- Diaspora : Des écrivains comme Chimamanda Ngozi Adichie, Alain Mabanckou et Wole Soyinka portent les voix africaines sur la scène mondiale.
Ainsi, la littérature postcoloniale africaine a contribué à décoloniser les imaginaires, donner la parole aux dominés, porter la mémoire des résistances et inscrire l’Afrique dans l’universel sans renier ses racine
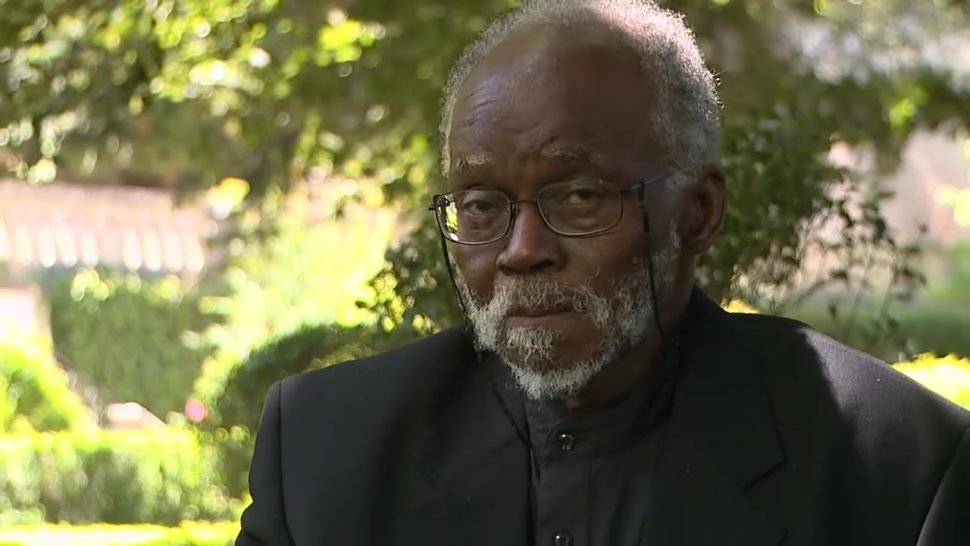
4. Les arts plastiques
Après les indépendances, les arts plastiques africains se sont diversifiés en se libérant progressivement de l’académisme colonial. Chaque région du continent a produit une école ou un courant qui exprime à la fois mémoire et innovation.
- Nigeria : la Zaria Art Society (1960) rompt avec le réalisme colonial et valorise les traditions Yoruba.
- RDC : l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et l’atelier du « Hangar » de Lubumbashi forment des pionniers comme Pili Pili Mulongoy et Alfred Liyolo.
- Congo-Brazzaville : l’école de Poto-Poto développe un style narratif coloré.
- Soudan : la Khartoum School fusionne calligraphie arabe et symboles africains.
- Sénégal : l’« École de Dakar » portée par Senghor illustre la Négritude, avec Papa Ibra Tall et Ousmane Sow.
- Maghreb : des artistes comme Farid Belkahia (Maroc) et Mohammed Khadda (Algérie) renouvellent l’abstraction et la calligraphie.
- Afrique australe : l’art devient un outil de lutte contre l’apartheid, avec Gerard Sekoto et la sculpture de Tengenenge au Zimbabwe.
Ces écoles ont fait de l’art un espace de mémoire et de résistance, mais aussi de créativité moderne.
4. 1. La restitution du patrimoine africain
Depuis les années 2010, la restitution des œuvres pillées par la colonisation est au cœur des débats :
- Rapport Sarr-Savoy (France, 2018).
- Retour des trésors royaux d’Abomey au Bénin (2021).
- Restitution en RDC d’un masque Suku par la Belgique (2022).
- Restitution des restes humains (Herero, Nama, Sarah Baartman).
La restitution n’est pas seulement matérielle : elle constitue une reconnaissance des crimes coloniaux et une réparation morale et symbolique.
4. 2. L’art contemporain africain
Depuis les années 1980, l’art africain s’impose sur la scène mondiale. Héritiers des traditions locales, les artistes contemporains interrogent mémoire, injustices et migrations.
- El Anatsui (Ghana) : sculptures monumentales en métal recyclé.
- Chéri Samba (RDC) : peinture populaire critique.
- William Kentridge (Afrique du Sud) : dessins et vidéos contre l’apartheid.
- Wangechi Mutu (Kenya) : plasticienne féministe et écologiste.
- Kehinde Wiley (diaspora) : portraits monumentaux revisitant la peinture classique.
L’art contemporain africain est désormais planétaire, exposé à Dakar, Venise, Londres, Paris ou New York, affirmant que l’Afrique n’est pas seulement mémoire, mais aussi innovation et créativité universelle.

5. Architecture contemporaine
5. 1. L’architecture contemporaine
L’architecture africaine contemporaine est diverse et reflète l’évolution des sociétés. On distingue :
- Architecture populaire (cases, habitations traditionnelles adaptées au climat et aux matériaux locaux).
- Architecture alimentaire (greniers, espaces de conservation et de préparation).
- Architecture administrative et commerciale (bâtiments modernes dans les villes).
- Architecture religieuse (la plus monumentale).
- Architecture portuaire et aéroportuaire, liée aux échanges internationaux.
- Architecture funéraire, héritière des traditions et des influences étrangères.
Exemples marquants :
- En Nubie (Éthiopie) : églises chrétiennes en pierre, influencées par l’art byzantin.
- En Afrique du Nord et de l’Ouest : grandes mosquées en terre (ex. Djenné, Mali), fusion entre traditions africaines et style musulman.
- Avec le christianisme colonial : cathédrale d’Abidjan, basilique de Yamoussoukro (inspirée de Saint-Pierre de Rome), temple kimbanguiste de Nkamba.
- Dans l’art funéraire moderne : tombes décorées, influencées par les Européens et enrichies de sculpture et d’ornementation.

5. 2. La sculpture contemporaine
La sculpture africaine contemporaine se développe à partir des années 1960. Elle a deux grandes orientations :
- Production commerciale : sculptures destinées aux touristes, vendues dans les galeries, ports et aéroports – souvent qualifiées à tort d’« art d’aéroport ».
- Sculpture monumentale : grandes statues et œuvres publiques, présentes sur les places des grandes villes, symbolisant la mémoire nationale ou l’indépendance.
Malgré les critiques occidentales, cet art témoigne d’une créativité authentique, d’une beauté plastique et d’une adaptation aux réalités économiques modernes.
6. La peinture contemporaine
- À l’époque coloniale, la peinture africaine contemporaine avait un caractère narratif : scènes de vie quotidienne, contes, légendes, représentations simples sur papier ou toile.
- On distingue deux catégories d’artistes : Autodidactes : créant spontanément, inspirés des traditions locales. Artistes formés dans les écoles d’art : Académies de Kinshasa, Lubumbashi, Poto-Poto, etc.
- Avec la formation académique, la peinture africaine s’ouvre à des techniques modernes (impressionnisme, cubisme, abstraction) tout en gardant une identité africaine.
7. La musique
7. 1. La rumba congolaise : patrimoine mondial

Le 14 décembre 2021, la rumba congolaise a été inscrite par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette reconnaissance internationale confirme que la rumba n’est pas seulement une musique, mais un symbole identitaire et historique pour l’Afrique et sa diaspora.
Née au début du XXe siècle, la rumba s’inspire à la fois des rythmes bantous traditionnels (notamment le nkumba, danse ancestrale du bassin congolais qui symbolise l’union et la fertilité) et des sonorités afro-cubaines ramenées par les marins et commerçants via l’Atlantique. Cette fusion a donné naissance à un style musical original, à la fois enraciné dans l’Afrique et ouvert au monde.
- Les pionniers : Wendo Kolosoy, surnommé « Papa Wendo », est considéré comme le père fondateur avec son titre mythique Marie-Louise (1948). Plus tard, des figures majeures comme Franco Luambo Makiadi et Tabu Ley Rochereau ont transformé la rumba en un véritable langage social et politique, chantant la joie, l’amour, mais aussi la critique des injustices et des régimes autoritaires.
- Un vecteur d’unité et de panafricanisme : des années 1960 aux années 1980, la rumba accompagne les indépendances africaines et devient la bande sonore des espérances panafricaines, avec celle qui deviendra l’hymne des indépendances africaines : « Indépendance Cha Cha », du Grand Kallé. Elle circule de Kinshasa à Dakar, d’Abidjan à Nairobi, et inspire de nombreux musiciens du continent.
- Un art total : au-delà de la musique, la rumba a façonné la danse, la mode vestimentaire (la SAP, Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes) et les pratiques festives, devenant un style de vie, avec notamment Papa Wemba.
- Un patrimoine vivant : aujourd’hui encore, avec des héritiers comme Koffi Olomide, JB Mpiana, Werrason,Fally Ipupa, Ferre Gola,Héritier Watanabe et bien d’autres, la rumba continue de se réinventer, entre tradition et modernité, tout en gardant son rôle de miroir social.
La rumba congolaise est ainsi une mémoire partagée entre les deux Congos (Kinshasa et Brazzaville), un lien entre l’Afrique et sa diaspora, et une fierté panafricaine désormais reconnue au niveau mondial.
7. 2. Diversité musicale africaine
La musique africaine postcoloniale reflète les luttes, les espoirs et les identités des peuples. Chaque région a produit des styles devenus des références mondiales :
- Afrique centrale : La rumba congolaise, symbole d’unité et de panafricanisme, donnera naissance au soukous, rythme dansant qui conquiert l’Afrique.
- Afrique de l’Ouest : Le Nigeria voit naître l’Afrobeat de Fela Kuti, musique engagée contre la dictature. Au Sénégal, Youssou N’Dour popularise le mbalax, et au Mali, la kora et le balafon sont remis à l’honneur par Salif Keïta.
- Afrique de l’Est : La benga (Kenya) et le taraab (Tanzanie) marient rythmes africains et influences arabes/indiennes ; le Bongo Flava moderne s’impose avec Diamond Platnumz.
- Afrique du Nord : Le chaâbi et le raï algériens expriment luttes sociales et contestation (Cheb Khaled). En Égypte, Oum Kalthoum incarne une musique nationale et panafricaine.
- Afrique australe : La musique devient un instrument de lutte contre l’apartheid avec Miriam Makeba et Hugh Masekela.
- Diaspora : Le reggae de Bob Marley devient un hymne panafricain, tandis que le hip-hop africain (Positive Black Soul, Kery James) s’impose comme voix contestataire.
La musique africaine est à la fois un miroir de la société et un outil de résistance. Elle transcende les frontières et accompagne les grandes luttes de libération comme les mutations identitaires du continent.
7. 3. Les voix féminines
La musique africaine ne serait pas complète sans l’apport des femmes artistes, qui ont brisé les barrières sociales et porté la mémoire et la résistance.
- Afrique australe : Miriam Makeba, « Mama Africa », ambassadrice mondiale contre l’apartheid.
- Afrique de l’Ouest : Angélique Kidjo (Bénin), voix de la liberté et de l’égalité des genres ; Oumou Sangaré (Mali), la « diva du Wassoulou » ; Cesária Évora (Cap-Vert), qui a popularisé la morna.
- Afrique centrale : Tshala Mwana et Mbilia Bel, pionnières de la musique congolaise moderne.
- Afrique du Nord : Oum Kalthoum (Égypte), grande diva du monde arabe ; Souad Massi (Algérie), chanteuse engagée pour la liberté et la justice.
Ces artistes féminines ont donné à la musique africaine une dimension universelle et émancipatrice, au même titre que les grandes figures masculines.

8. Les arts du spectacle
Les arts du spectacle – théâtre, danse, performance – occupent une place essentielle dans la culture africaine postcoloniale. Ils prolongent la tradition orale et deviennent des instruments de critique sociale, de transmission de mémoire et d’affirmation identitaire.
A. Nigeria (Mbari Club, Ibadan, années 1960)
- Fondé par Ulli Beier, avec la participation de Wole Soyinka (prix Nobel de littérature 1986).
- Lieu de fusion artistique où se rencontrent littérature, théâtre, danse et arts visuels.
- A révélé des dramaturges comme Duro Ladipo et des artistes de performance comme Twins Seven Seven.
B. RDC
- Dès l’indépendance, le théâtre devient un espace de critique sociale et politique.
- Groupes et institutions :
- Union du Théâtre Africain (UTHAF).
- Théâtre de la Colline (1967, créé par le CEPHILE).
- Théâtre National du Congo/Zaïrois, qui devient un foyer de création scénique.
- Figures : M.K. Mikanza (Le Petit Nègre), Sony Labou Tansi (Congo-Brazzaville, La Vie et demie).
C. Sénégal et Afrique de l’Ouest
- Théâtre Daniel Sorano (Dakar, 1965) : institution nationale, vitrine de la culture sénégalaise, soutenue par Léopold Sédar Senghor.
- Le Ballet national du Sénégal promeut danse et musique traditionnelles en lien avec la modernité.
- Dramaturges : Cheikh Aliou Ndao, Abdou Anta Kâ.
D. Afrique du Nord et Maghreb
- Le théâtre devient un outil de mémoire postcoloniale.
- En Algérie, des auteurs comme Kateb Yacine utilisent le théâtre (Le Cadavre encerclé) comme arme politique.
- Au Maroc, Tayeb Saddiki modernise le théâtre marocain en combinant tradition orale (halqa) et techniques modernes.
E. Afrique de l’Est
- Ngũgĩ wa Thiong’o (Kenya) utilise le théâtre comme arme de libération. Sa pièce Ngaahika Ndeenda (Je me marierai quand je voudrai, 1977), jouée en kikuyu, fut censurée et valut à l’auteur l’emprisonnement.
- Le théâtre devient un espace de résistance culturelle face aux régimes autoritaires.
F. Afrique australe
- Sous l’apartheid, le théâtre est une arme de contestation.
- Athol Fugard (Afrique du Sud) dénonce la ségrégation raciale (Sizwe Banzi is Dead, Master Harold… and the Boys).
- Le théâtre communautaire et militant accompagne les luttes des townships.
Les arts du spectacle en Afrique postcoloniale allient héritage oral et critique sociale. Ils sont un lieu de création, de résistance et de mise en scène des aspirations populaires.
9. Festivals panafricains
Depuis les indépendances, les festivals panafricains sont devenus des moments de rencontre, de célébration et de rayonnement de la culture africaine. Ils affirment une identité commune, valorisent les artistes et constituent une diplomatie culturelle au service de l’unité africaine.
- FESMAN (Festival mondial des arts nègres) :
Initié par Léopold Sédar Senghor, il réunit depuis 1966 artistes d’Afrique et de la diaspora. Du premier FESMAN de Dakar (1966), symbole de la Négritude, au troisième (2010), marqué par le thème de la Renaissance africaine et l’inauguration du Monument de la Renaissance, il incarne la continuité du panafricanisme culturel. - PANAF d’Alger (1969, puis 2009) :
Ce festival associa culture et politique en faisant d’Alger la « capitale des luttes de libération ». Il réunit artistes, musiciens et intellectuels comme Miriam Makeba, Hugh Masekela et Cheikh Anta Diop. - FESPACO (Ouagadougou, depuis 1969) :
Plus grand festival de cinéma africain, il a révélé des cinéastes comme Ousmane Sembène, Souleymane Cissé et Abderrahmane Sissako. Son trophée, l’« Étalon de Yennenga », est devenu un symbole de la fierté cinématographique africaine. - FESPAM (Brazzaville, depuis 1996) :
Dédié à la musique, il promeut la diversité musicale africaine et son rôle comme patrimoine commun et facteur de paix. - Dak’Art (depuis 1990) :
Biennale des arts contemporains africains, elle met en avant peintres, sculpteurs et plasticiens (ex. Chéri Samba, El Anatsui), projetant l’art africain sur la scène mondiale.
Ces festivals ne sont pas de simples événements culturels. Ils incarnent une politique de l’unité africaine, renforcent les liens entre les peuples et affirment la place de l’Afrique dans la culture mondiale.
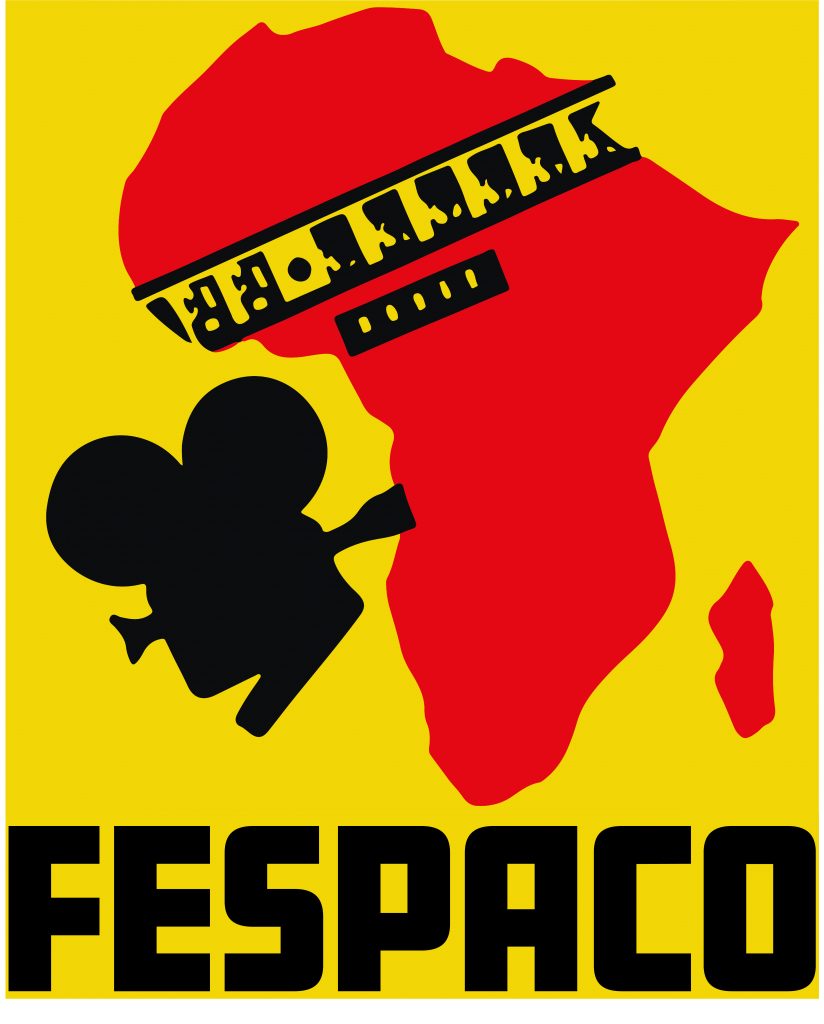
10. Les musées
Après les indépendances, les musées africains sont devenus des instruments de représentation nationale et de transmission de la mémoire collective. Ils ne se limitent pas à conserver des objets : ils valorisent l’identité culturelle, renforcent la conscience historique et participent aux débats sur la restitution du patrimoine pillé.
- Zambie (Lusaka) : musée national, symbole de l’unité et de l’histoire nationale.
- Togo (Lomé) : présenté comme le « Togo en miniature », il rassemble la diversité culturelle.
- Cameroun (Yaoundé) : conçu comme un « livre d’histoire » vivant, il conserve la mémoire nationale.
- Sénégal (Dakar) : du Musée Dynamique (1966) au Musée des Civilisations noires (2018), véritable vitrine panafricaine et lieu de restitution d’œuvres d’art.
- Afrique du Sud : le Robben Island Museum, ancienne prison de Nelson Mandela, illustre la fonction politique des musées comme lieux de mémoire et de résistance.
- Égypte (Le Caire) : le Grand Musée Égyptien conserve l’héritage pharaonique, symbole universel.
- Éthiopie (Addis-Abeba) : le Musée national conserve « Lucy », rappelant le rôle de l’Afrique comme berceau de l’humanité.
Ainsi, les musées africains sont à la fois conservatoires, symboles identitaires et espaces de justice historique.
Tableau 1 Les grands musées africains
| Musée | Ville / Pays | Date de création | Spécificités / Rôle |
| Musée National | Lusaka, Zambie | 1964 | Symbole de l’unité nationale ; retrace l’histoire de la Zambie de la préhistoire à l’indépendance. |
| Musée National | Lomé, Togo | 1975 | Présenté comme le « Togo en miniature » ; valorise la diversité culturelle du pays. |
| Musée National | Yaoundé, Cameroun | 1988 | Conçu comme un « livre d’histoire » vivant ; conserve la mémoire nationale et la diversité culturelle camerounaise. |
| Musée Dynamique | Dakar, Sénégal | 1966 | Vitrine culturelle post-indépendance ; accueille expositions africaines et internationales. |
| Musée des Civilisations Noires | Dakar, Sénégal | 2018 | Grande vitrine panafricaine ; conçu pour accueillir les restitutions d’œuvres d’art pillées. |
| Robben Island Museum | Robben Island, Afrique du Sud | 1997 (après la fin de l’apartheid) | Ancienne prison de Nelson Mandela ; site de mémoire de la lutte anti-apartheid. |
| Grand Musée Égyptien | Le Caire, Égypte | (en construction, ouverture progressive depuis 2021) | Conserve le patrimoine pharaonique ; l’un des plus grands musées archéologiques au monde. |
| Musée National | Addis-Abeba, Éthiopie | 1958 | Conserve Lucy (3,2 millions d’années) ; rappelle l’Afrique comme berceau de l’humanité. |
11. Le GENOCOST : une blessure culturelle et mémorielle
Parler du GENOCOST du point de vue culturel, c’est montrer que ce génocide pour des gains économiques lié au caoutchouc, aux minerais stratégiques, au coltan et au cobalt n’a pas seulement détruit des vies, mais aussi attaqué la mémoire et la créativité des Congolais. Sa violence la plus sournoise réside dans la volonté de nier l’humain et de transformer la souffrance en marchandise.
a. Une mémoire volée
Le GENOCOST a produit une fracture mémorielle : des millions de morts réduits au silence, des récits tronqués, une histoire bafouée. Derrière chaque minerai exporté se cache une mémoire de sang, et la culture devient un champ de lutte pour la rappeler.
b. L’art comme résistance
Malgré l’absence de mémoriaux officiels, les artistes ont fait de leurs œuvres des tombeaux symboliques. Peinture, musique, littérature et théâtre incarnent une contre-mémoire insurgée qui dénonce à la fois l’ancien colonisateur, les multinationales et les élites complices.
c. Une culture face à la marchandisation
Le GENOCOST tue doublement : par les vies perdues et par la réduction de la culture à un produit. On célèbre la rumba ou l’art congolais sans reconnaître qu’ils portent les stigmates d’un peuple meurtri. L’hypocrisie mondiale consiste à admirer ces créations tout en fermant les yeux sur les cadavres derrière chaque gramme de coltan.
d. Le devoir de mémoire
Intégrer le GENOCOST dans la culture, c’est refuser l’oubli et transformer la mémoire en outil de résistance. Tant que les Congolais chantent, peignent et racontent, le génocide économique ne pourra pas effacer leur histoire.
12. Conclusion
L’Afrique postcoloniale a produit une culture foisonnante : la littérature a décolonisé les esprits, les arts plastiques ont affirmé l’identité visuelle et posé la question des restitutions, la musique portée par la rumba a uni et mobilisé les peuples, les festivals et musées ont projeté une fierté panafricaine. Avec le GENOCOST, la culture africaine devient aussi un espace de mémoire et de dénonciation. Malgré les crises et les entraves néocoloniales, elle reste une arme de résistance et un moteur de renaissance.
13. Résumé
Depuis 1960, l’Afrique postcoloniale a connu un essor culturel majeur. La littérature s’est émancipée, les arts plastiques se sont diversifiés à travers plusieurs écoles, la musique est devenue un miroir de la société, le théâtre un lieu de critique sociale, et les festivals panafricains ont affirmé l’unité culturelle. Les musées symbolisent la mémoire nationale. Malgré les crises, la culture demeure un pilier de développement et d’affirmation identitaire.