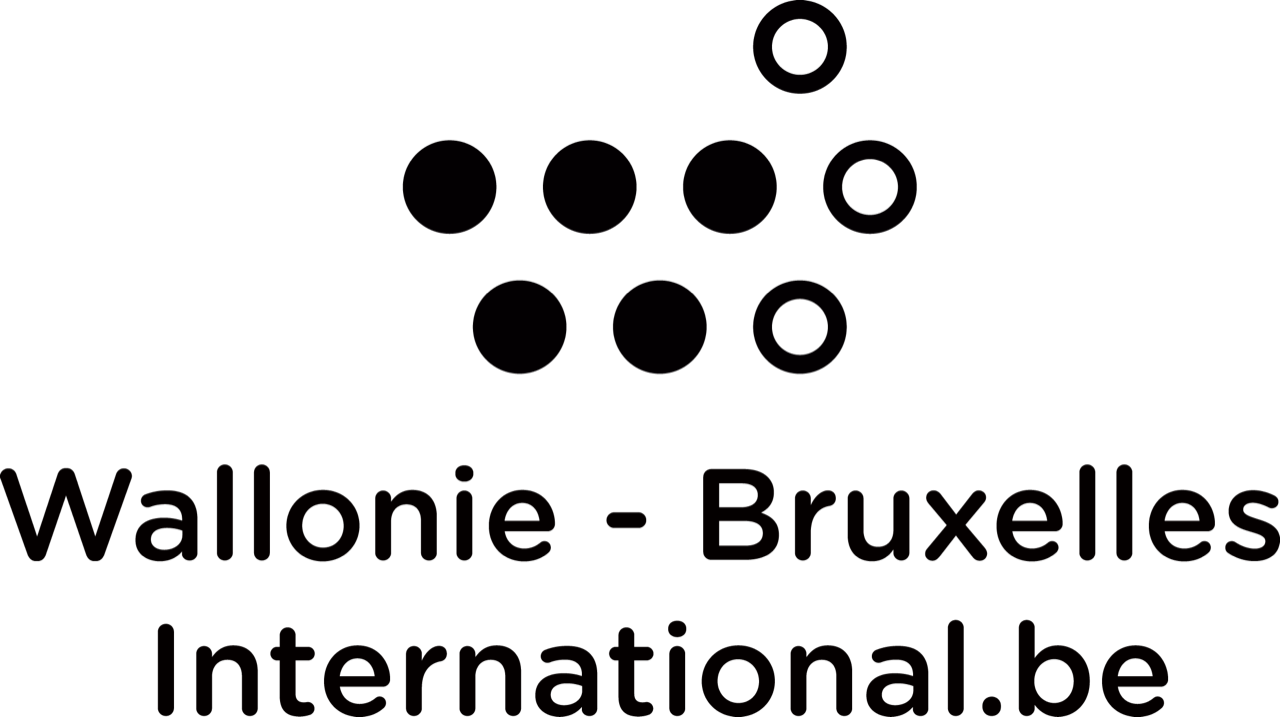1880-1890 (Kongo)
"Récipient avec relief figuratif et bouchon" ivoire Kongo

Ce récipient sculpté en ivoire représente des figures masculines en relief sur deux registres différents. En haut, des Européens, en bas, des Africain. Il s’agit d’un ivoire souvenir de Loango (côte) que les Européens achetaient avant de rentrer en Europe. Toutefois, la majorité de ces ivoires sont gravées sur des défenses entières. Ce récipient est donc inhabituel. Au niveau des scènes, il s’agit de scènes quotidiennes représentées. Dans le registre supérieur se trouvent sept hommes européens, bien habillés qui se livrent à des échanges commerciaux. Dans le registre inférieur, on retrouve sept hommes africains également. La violence se retrouve dans chaque scène.
Clés de compréhension du document
A. Approches possibles du document dans le cadre d’un cours d’histoire
- Décoloniser le regard sur l’histoire et l’ « art africain ».
- La critique de la violence coloniale.
- La colonisation belge au Congo.
- Les interactions entre Africains et Européens durant la période coloniale.
- L’art comme reflet des tensions sociales et politiques.
B. Contextes du document
1. Le royaume Kongo
Le royaume du Kongo, fondé au XIVe siècle, prospère grâce à une économie diversifiée basée sur le commerce, la cueillette du palmier à huile, la métallurgie du fer et l’utilisation du nzimbu comme monnaie. Intégré dans un vaste réseau commercial, il exerce une influence au-delà de ses frontières reconnues.
En 1482, les Portugais entrent en contact avec le royaume. En 1491, le roi Nzinga a Nkuwu se convertit au christianisme sous le nom de João Ier, marquant un tournant dans les relations diplomatiques. Cependant, vers la fin de son règne, une résistance au catholicisme émerge, et il revient aux pratiques traditionnelles.
Après sa mort en 1506, son fils Alfonso Ier monte sur le trône, soutenu par le Portugal. Il renforce le christianisme et envoie des jeunes Bakongo étudier en Europe, mais les relations avec les Portugais se détériorent. Ces derniers exigent de plus en plus d’esclaves pour leurs colonies, ce qui pousse Alfonso à capturer des populations voisines. Il meurt en 1543 après avoir échappé à un complot.
À partir de 1569, les révoltes des peuples voisins et la pression portugaise affaiblissent le royaume. Álvaro Ier accepte un acte de vassalité envers le Portugal, tandis que Garcia II tente en vain de diversifier les alliances. Après la défaite d’Ambuila en 1665, le royaume du Kongo s’affaiblit, fragmenté par des luttes internes et une influence étrangère croissante. Au XVIIIᵉ siècle, Kimpa Vita tente de réunifier le royaume en fondant un mouvement religieux syncrétique, mais elle sera exécutée en 1706. Bien que le royaume disparaisse comme entité politique au XIXᵉ siècle, son héritage reste vivant dans les traditions des Bakongo, aujourd’hui reconnu à travers des sites comme Mbanza Kongo et la mémoire de figures comme Kimpa Vita. Au XIXe siècle, Léopold II met la main sur l’Etat Indépendant du Congo (1855) et sur une grande partie de l’ancien royaume Kongo.
2. Les relations commerciales entre le royaume du Kongo et l’Europe
Les relations commerciales entre le royaume de Kongo et les Européens débutent à la fin du XVe siècle, avec l’arrivée des Portugais en 1483. Dès lors, le royaume développe des liens diplomatiques, religieux et économiques étroits avec Lisbonne. Les échanges incluent le cuivre, les tissus de raphia, l’ivoire, et rapidement, les captifs destinés à la traite transatlantique. En retour, le Kongo reçoit des armes à feu, de l’alcool, des perles, des textiles européens et d’autres produits manufacturés.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le commerce esclavagiste devient le moteur principal des relations avec les Européens. Plusieurs puissances européennes – Portugal, Pays-Bas, Royaume-Uni, France – établissent des factoreries (comptoirs commerciaux) le long des côtes d’Afrique centrale, notamment à Loango, Cabinda, Malembo et au Congo proprement dit. Ces factoreries servent de points d’échange mais aussi de lieux de stockage des marchandises et d’embarquement des esclaves. Les Européens y sont souvent installés de manière précaire, dépendants des alliances avec les chefs locaux.
Au XIXe siècle, bien que la traite transatlantique soit officiellement abolie, les échanges se poursuivent sous d’autres formes, notamment le commerce de l’ivoire, du caoutchouc, de l’huile de palme et du copal. Dans ce contexte, la présence européenne se renforce avec l’installation permanente de missions, d’agents commerciaux et de comptoirs souvent liés à des sociétés privées, en lien avec l’expansion coloniale. Sur les côtes, ces présences préfigurent l’occupation territoriale qui s’intensifiera dans les années 1880 avec la conférence de Berlin et la création de l’État indépendant du Congo.
Pour aller plus loin sur le royaume Kongo :
Cartes disponibles sur Bokundoli :
C. Points d’attention
- Dénonciation subtile de la violence coloniale : Cet objet d’apparence décorative est en réalité une critique fine de la réalité coloniale. Le sculpteur oppose deux mondes sur un même support : en haut, des Européens représentés comme civilisés et ordonnés ; en bas, des scènes de coercition, d’humiliation et de violence impliquant des Africains. Il suggère ainsi que derrière l’image policée du commerce, se cache une brutalité bien réelle. Le commerce de l’oiseau mort entre les deux Européens se situe juste au-dessus de la scène de capture des Africains, établissant une subtile équivalence. Bien que le sculpteur accorde aux protagonistes européens la distance physique par rapport aux Africains qu’ils s’efforçaient de maintenir dans ces centres commerciaux de la fin du XIXe siècle, il les implique sans détour dans la violence du commerce atlantique, se tournant vers le commerce transatlantique des esclaves. Ceux qui tiennent les parapluies et les cannes, les fusils et les clés, sont indéniablement ceux qui sont en charge.
- Symbolisme et dynamique : L’agencement des scènes sur deux registres – Européens au-dessus, Africains en dessous – peut être lu comme un commentaire sur les hiérarchies imposées par le système colonial. Les Européens se tiennent volontairement à l’écart des colonisés et mettent un point d’honneur à créer une distance. Toutefois, la violence des scènes du bas sont indubitablement liées aux actions qui se passent en haut.
- Un objet d’exportation, entre adaptation et résistance: Ce récipient, destiné à un client européen, mobilise des formes locales (ivoire sculpté, symboles Kongo) tout en détournant les attentes : il ne célèbre pas la rencontre coloniale, il la met en question.
- Les colonisés ne sont pas de simples objets de l’histoire : Cet objet permet un travail critique avec les élèves sur les images : qui les produit, pour qui, et pourquoi ? Il montre que les Africains n’étaient pas de simples objets de l’histoire coloniale, mais des observateurs et des commentateurs de leur temps, capables d’utiliser les moyens disponibles pour transmettre un message.
D. Pour aller plus loin :
- Isidore Ndaywel, Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998.
- Jan Vansina, Le royaume du Kongo et ses voisins, dans Histoire générale de l’Afrique, V. : L’Afrique du XVIe au XVIIIe siècle, 1999, p. 601 -642.
- Receptacle with Figurative Relief and Stopper sur https://www.metmuseum.org/art/collection/search/316796