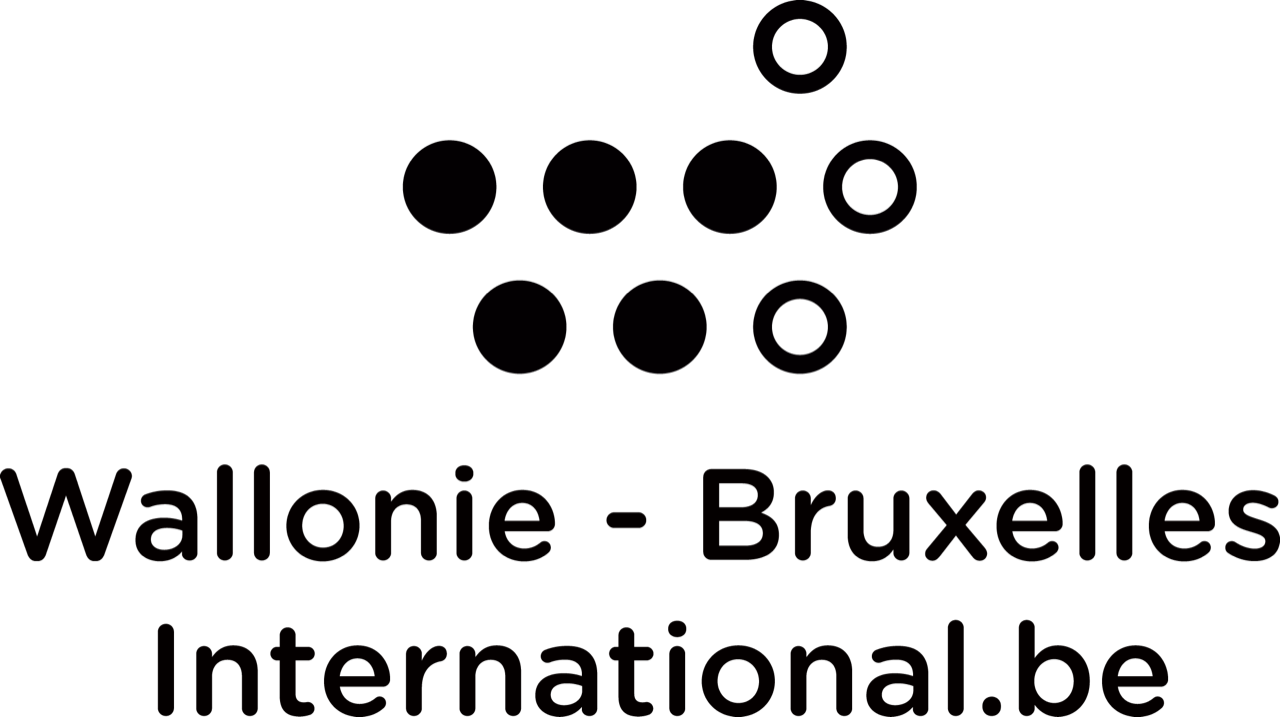1850 (Kongo)
Nkisi N'Kondi

Clés de compréhension du document
A. Approches possibles du document dans le cadre d’un cours d’histoire
- Décoloniser le regard sur l’histoire et l’ « art africain ».
- La diversité des systèmes politiques et juridiques en Afrique avant la colonisation.
- Les représentations artistiques du pouvoir (comparaison avec d’autres formes d’autorité visuelle dans le monde).
- L’instrumentalisation d’objets rituels par les colonisateurs européens.
- Les effets du regard colonial sur les objets africains.
B. Contextes du document
1. Le royaume Kongo
Le royaume du Kongo, fondé au XIVe siècle, prospère grâce à une économie diversifiée basée sur le commerce, la cueillette du palmier à huile, la métallurgie du fer et l’utilisation du nzimbu comme monnaie. Intégré dans un vaste réseau commercial, il exerce une influence au-delà de ses frontières reconnues.
En 1482, les Portugais entrent en contact avec le royaume. En 1491, le roi Nzinga a Nkuwu se convertit au christianisme sous le nom de João Ier, marquant un tournant dans les relations diplomatiques. Cependant, vers la fin de son règne, une résistance au catholicisme émerge, et il revient aux pratiques traditionnelles.
Après sa mort en 1506, son fils Alfonso Ier monte sur le trône, soutenu par le Portugal. Il renforce le christianisme et envoie des jeunes Bakongo étudier en Europe, mais les relations avec les Portugais se détériorent. Ces derniers exigent de plus en plus d’esclaves pour leurs colonies, ce qui pousse Alfonso à capturer des populations voisines. Il meurt en 1543 après avoir échappé à un complot.
À partir de 1569, les révoltes des peuples voisins et la pression portugaise affaiblissent le royaume. Álvaro Ier accepte un acte de vassalité envers le Portugal, tandis que Garcia II tente en vain de diversifier les alliances. Après la défaite d’Ambuila en 1665, le royaume du Kongo s’affaiblit, fragmenté par des luttes internes et une influence étrangère croissante. Au XVIIIᵉ siècle, Kimpa Vita tente de réunifier le royaume en fondant un mouvement religieux syncrétique, mais elle sera exécutée en 1706. Bien que le royaume disparaisse comme entité politique au XIXᵉ siècle, son héritage reste vivant dans les traditions des Bakongo, aujourd’hui reconnu à travers des sites comme Mbanza Kongo et la mémoire de figures comme Kimpa Vita.
2. Les figures de pouvoir Kongo
Les objets kongo, et plus largement en Afrique centrale, sont souvent liés à des fonctions rituelles, juridiques ou sociales. Les sculptures appelées nkisi (pluriel minkisi) sont des objets de pouvoir conçus pour protéger, guérir, ou rendre justice. Elles sont le fruit d’une collaboration entre un sculpteur et un spécialiste religieux (le nganga), qui active la puissance de la figure à l’aide de substances médicinales insérées dans une cavité du corps de la sculpture.
La figure présentée ici est un exemple particulièrement élaboré de ce type d’art. Elle est associée à Mangaaka, une force spirituelle majeure chargée de faire respecter les lois et de punir les transgressions. Sa posture imposante, les mains sur les hanches, le torse clouté de lames métalliques, expriment l’autorité, la vigilance et la capacité d’agir. Ces clous ou lames marquent les actions menées par la figure : pactes, jugements, punitions, etc.
Cette sculpture montre que, loin des clichés d’un art africain « primitif » ou purement décoratif, il s’agit ici d’une œuvre au service d’une société organisée, avec ses règles, ses institutions et ses valeurs.
Pour aller plus loin sur le royaume Kongo :
Cartes disponibles sur Bokundoli :
C. Points d’attention
- L’interprétation coloniale : Au moment de leur collecte, ces figures ont souvent été mal comprises par les Européens, qualifiées de « fétiches » ou d’objets « magiques », et utilisées pour justifier l’idée d’une Afrique « sauvage » à civiliser. Or, ce Nkisi témoigne au contraire de l’existence d’une société régie par des règles. Cette sculpture est associée à Mangaaka, une force spirituelle majeure chargée de faire respecter les lois et de punir les transgressions. Les divers éléments métalliques incrustés témoignent de son rôle central de témoin et d’exécuteur dans les affaires cruciales de sa communauté. Ils rappellent les serments prononcés, les traités conclus et les efforts entrepris pour éradiquer le mal. Cette œuvre appelle ainsi à une réflexion sur les conséquences liées à la transgression des codes de conduite sociale établis.
- La collaboration entre artisans et spécialistes rituels : Ces figures ne sont pas de simples sculptures artistiques, mais des instruments de justice et de régulation sociale. Leur fabrication impliquait des savoirs techniques et spirituels complexes. Ce Nksi a été conçu dans le royaume Kongo sur la côte du Congo et de l’Angola à la deuxième moitié du 19e siècle.
- Ne pas réduire le nkisi à de la « sorcellerie » ou de la « superstition » : Le nkisi est parfois présenté dans les manuels anciens ou dans certains discours comme un objet magique ou superstitieux. Cette vision eurocentrée nie la cohérence des systèmes de pensée africains. Il s’agit d’un objet complexe, au croisement du spirituel, du social, du juridique et du politique. Les colonisateurs ont nié toute forme de pensée et de réflexion aux peuples africains afin d’asseoir leur domination.
- Attention à l’esthétisation excessive de l’objet : Le regard occidental a souvent privilégié l’aspect esthétique des objets africains en les exposant comme des œuvres d’art, sans expliquer leur usage, leur sens, ni leur lien avec la vie quotidienne ou spirituelle des sociétés qui les ont produits.
D. Pour aller plus loin :
- Isidore Ndaywel, Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998.
- Jan Vansina, Le royaume du Kongo et ses voisins, dans Histoire générale de l’Afrique, V. : L’Afrique du XVIe au XVIIIe siècle, 1999, p. 601 -642.
- Bruno Pinçon, et Dominique Ngoïe-Ngalla . L’unité culturelle Kongo à la fin du XIXe siècle. L’apport des études céramologiques. Dans: Cahiers d’études africaines, vol. 30, n°118, 1990. pp. 157-177.
- Pierre de Maret, Bernard-Olivier Clist, et Koen Bostoen. « Regards croisés sur le royaume Kongo. » dans: Une archéologie des provinces septentrionales du royaume Kongo. Archaeopress, 2018. 455-460.
- Mangaaka Power Figure (Nkisi N’Kondi) sur https://www.metmuseum.org/art/collection/search/320053