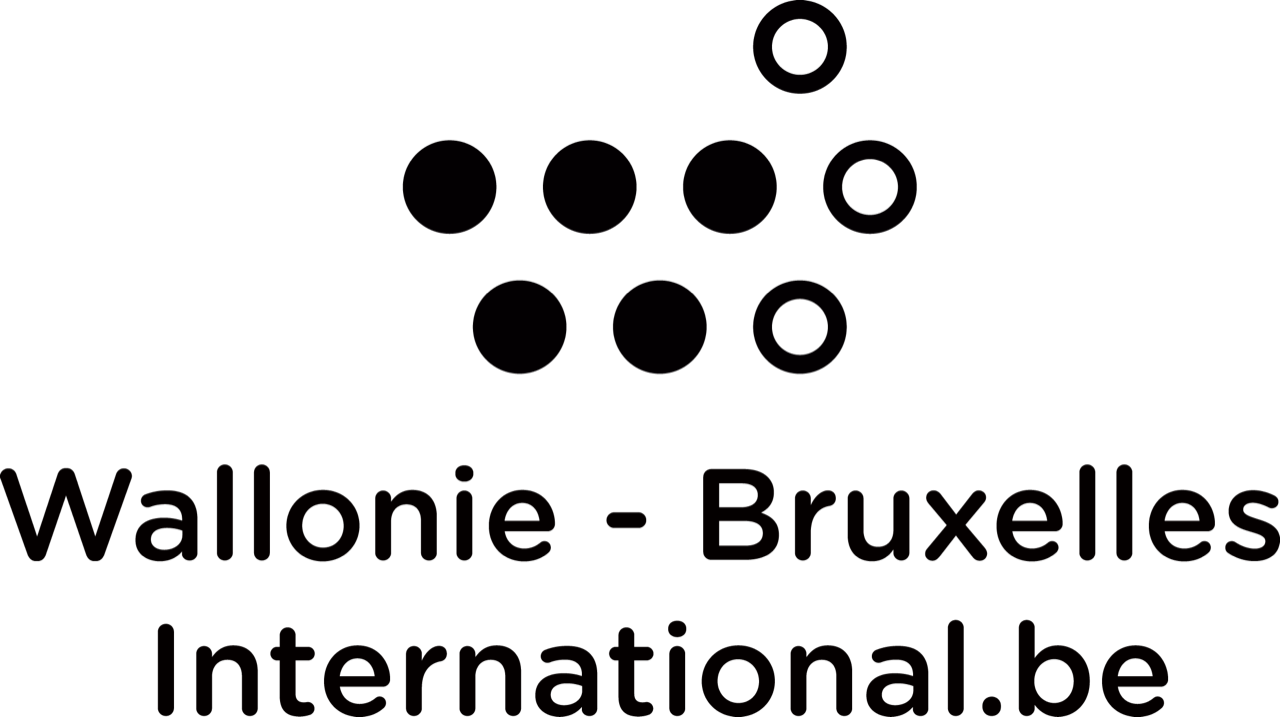1894 (Namibie)
Lettre de Witbooi au commandant Leutwein, le 17 août 1894
| « À son Excellence, commandant Leutwein,
J’ai reçu votre longue lettre tard hier soir. Je comprends que vous m’accusez de diverses choses et que vous vous disposez à trouver là la justification et l’audace de prononcer contre moi une sentence de mort et de l’exécuter par vos armes. (…) 2. Vous dites que j’ai incité des gens à commettre des injustices. Cela (…) n’est pas vrai. Vous citez Simon Koper, mais vous-même, vous avez rencontré Simon Koper1 et pu constater (…) combien il vous est opposé sans que j’aie le moins du monde à l’encourager. (…) 3. Vous dites que je maintiens être le propriétaire de ma terre et que j’estime être le seul à avoir le droit de vendre cette terre. Voici ma réponse : vous, les Blancs, et tous les peuples rouges2 savez très bien que cette terre est vraiment à moi, depuis le temps de mes défunts grands-pères ; car les nations rouges ont attaqué feu mon grand-père sans raison et il a vaincu ces nations. Une seconde fois, ces nations m’ont attaqué et, moi, je les ai à nouveau vaincues. Par conséquent, cette terre est doublement mienne. Je n’ai pas obtenu cette terre contre de l’argent, ni en cadeau, ni par la ruse : je l’ai achetée au prix du sang. C’est la loi ancestrale de la conquête. Cela vous le savez, puisque vous savez que la terre est à moi, et que vous ne pouvez la prendre autrement, que vous comprenez maintenant qu’il faut me la prendre par la force. Sur ce point non plus, je ne suis pas coupable. 4. Vous dites déplorer que je n’accepte pas la Protection du Kaiser allemand, que vous m’en tenez rigueur, et que vous allez devoir punir ce crime par la puissance de vos armes. Voici ma réponse. Jamais de ma vie je n’ai rencontré le Kaiser allemand et je ne peux donc l’avoir offensé en parole ou en acte. Par ailleurs, Dieu nous a donné sur terre des royaumes distincts. Partant, je sais et je crois que ce n’est ni un péché, ni un crime de ma part que de vouloir rester le chef indépendant de mon pays et de mon peuple. (…) Vous dites aussi que vous êtes innocent des massacres à venir, que vous m’en tenez pour responsable. Mais c’est absurde. Que vous puissiez même croire cela me stupéfie. Après que je vous ai fait savoir que j’étais en paix avec vous et ne voulais pas être la cause de nouveaux massacres, vous venez me dire que vous avez l’intention de m’écraser. La responsabilité du sang innocent que mon peuple et le votre vont faire couler ne repose pas sur mes épaules. (…) » Lettre de Witbooi au commandant Leutwein, le 17 août 1894, dans Votre paix sera la mort de ma nation, Lettres de guerre d’Hendrik Witbooi, capitaine du Grand Namaqualand, présentées et annotées par Jocelyn Nayrand et Dominique Bellec, Le Pré-Saint-Gervais, Éditions Le passager clandestin, 2011, p. 135-136.
|
Clés de compréhension du document
A. Approches possibles du document dans le cadre d’un cours d’histoire
- Résistances africaines face à la colonisation. Le texte montre qu’il n’y a pas eu de « conquête facile ». De nombreux chefs africains, comme Witbooi, ont négocié, protesté, résisté avant que les conflits ne deviennent armés.
- Correspondance politique coloniale. C’est un exemple rare de voix africaine écrite dans le contexte colonial. Il permet de réfléchir au pouvoir des archives, à ce qui a été transmis ou effacé.
- Pensée politique africaine. Witbooi ne se contente pas de protester : il argumente, s’appuie sur des principes, défend une vision du droit, de l’honneur et de la coexistence entre peuples.
- Origines d’un génocide. La lettre précède de quelques années le génocide des Hereros et des Namas (1904–1908), l’un des premiers génocides du XXe siècle. Elle aide à comprendre l’escalade de la violence coloniale.
B. Contextes du document
1. La colonisation allemande
La présence allemande en Afrique est relativement tardive par rapport aux autres puissances européennes. Lors de la conférence de Berlin (1884-1885), l’Allemagne obtient le droit d’établir plusieurs colonies, notamment le Sud-Ouest africain, qui correspond à l’actuelle Namibie. Ce territoire devient officiellement un protectorat allemand en 1884, sous le nom de Deutsch-Südwestafrika.
La région est habitée par plusieurs peuples, dont les Hereros (majoritairement éleveurs dans le centre et l’est) et les Namas (souvent semi-nomades, dans le sud). Ces sociétés possèdent des systèmes de gouvernement, des réseaux d’alliances, et des relations complexes entre elles.
L’arrivée des colons allemands bouleverse ces équilibres. Le pouvoir colonial tente d’imposer des traités inégaux, de s’approprier des terres fertiles, et d’exploiter la main-d’œuvre locale. Les méthodes de domination incluent la ruse diplomatique, les alliances forcées, mais aussi la violence militaire.
C’est dans ce contexte que surgit la figure d’Hendrik Witbooi (vers 1830–1905), chef des Nama. Chrétien lettré, parlant l’allemand et l’afrikaans, il connaît bien les enjeux géopolitiques. Il dirige une résistance active à la colonisation allemande. Sa lettre de 1894 reflète à la fois la connaissance des règles européennes (traités, négociation, souveraineté) et l’attachement à l’autonomie politique africaine.
À cette époque, les relations entre les Nama de Witbooi et les Allemands sont tendues, parfois ouvertes à la discussion, mais souvent marquées par la méfiance et les affrontements. Cette lettre est un appel à éviter la guerre, mais sans céder à la domination.
2. Le génocide des Hereros et des Namas (1904 -1908)
En 1904, les Hereros se soulèvent contre l’occupation allemande. En réponse, l’Allemagne envoie des renforts militaires sous les ordres du général Lothar von Trotha. Il applique une politique d’anéantissement : les Hereros sont repoussés dans le désert du Kalahari, où beaucoup meurent de soif et de faim. En 1905, les Namas rejoignent à leur tour la résistance, malgré les appels au compromis faits auparavant.
Hendrik Witbooi est tué au combat en 1905. La guerre se prolonge jusqu’en 1908. Pendant cette période, les autorités coloniales mettent en place des camps de concentration, notamment à Shark Island, où les déportés sont soumis au travail forcé, à la famine et à des expérimentations médicales.
Les historiens estiment qu’environ 80 % de la population herero (près de 65 000 personnes) et 50 % de la population nama ont été exterminées.
Ce génocide est l’un des premiers du XXe siècle, et préfigure d’autres violences coloniales ou totalitaires. Il a longtemps été ignoré ou minimisé dans les récits européens, mais il est aujourd’hui reconnu officiellement comme un génocide par le gouvernement allemand (depuis 2021), après des décennies de revendications des descendants des victimes.
Cartes disponibles sur Bokundoli :
Leçon disponible sut Bokundoli : Les résistances à la conquête européenne.
C. Points d’attention
- Éviter l’idée d’une soumission passive. Le texte montre que les peuples africains ont pu formuler des refus argumentés, ont parfois écrit leur opposition et proposé des alternatives à la violence.
- Ne pas réduire le texte à une réaction émotionnelle. Witbooi parle en stratège politique, pas seulement en victime. Son discours est celui d’un homme d’État qui tente de défendre la souveraineté de son peuple.
- Replacer cette lettre dans une trajectoire tragique. Même si Witbooi tente encore la négociation en 1894, la suite montre que la diplomatie n’a pas été respectée par les autorités coloniales, qui ont imposé la domination par la guerre et l’extermination.
- Travailler les notions de mémoire et de reconnaissance. La Namibie indépendante reconnaît Witbooi comme un héros national, tandis que l’Allemagne n’a reconnu ce génocide que récemment. Ce document permet d’ouvrir un débat sur la mémoire coloniale en Afrique et en Europe.
D. Biographies
E. Pour aller plus loin :
- Votre paix sera la mort de ma nation, Lettres de guerre d’Hendrik Witbooi, capitaine du Grand Namaqualand, présentées et annotées par Jocelyn Nayrand et Dominique Bellec, Le Pré-Saint-Gervais, Éditions Le passager clandestin, 2011.